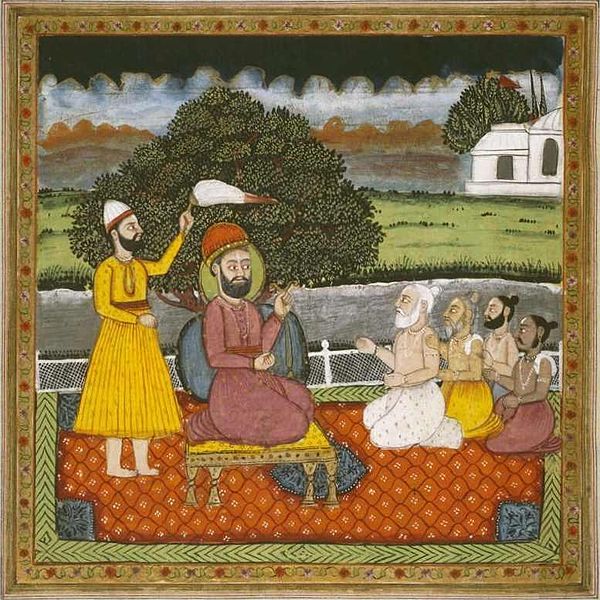La crise politique française de juin 2024 amène, forcément, une profusion d’agitation et de confusion. C’est l’expression d’une panique : on s’imagine que le monde est stable, on découvre subitement qu’il ne l’est pas, toutes les illusions s’effacent et on ne sait pas par quoi elles vont être remplacées.
Il faut ici s’intéresser à cette période d’entre-deux : après les élections européennes, avant les élections parlementaires, avec le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella en position de force.
L’une des questions les plus ardentes dans un tel contexte est bien sûr de savoir ce que représente « l’extrême-droite aux portes du pouvoir ». Avant les élections parlementaires, c’est la question clef : dans quelle mesure existe-t-il une menace fasciste en cas de triomphe électoral du Rassemblement national?
Ce qui amène à la question : qu’est-ce que le fascisme? Et pour le comprendre de manière dialectique, voici un commentaire d’un texte-miroir, c’est-à-dire d’un texte qui prétend avoir une analyse correcte, avec les méthodes justes d’étude de la réalité, et qui en réalité correspond à l’agitation et la confusion.
En regardant l’absurdité du propos, les méprises, les tromperies, on en saura davantage. C’est le principe de la dialectique : le vrai se positionne par rapport au faux, et inversement. D’ailleurs, les auteurs de ce texte, le groupe « Unité Communiste » de Lyon, est coutumier du fait, puisqu’il ne cesse de puiser en nous, tout en ne produisant que des caricatures soit ridicules, soit sordides.
Le texte est tiré de l’article « Que faire (le 30 juin) ? », publié très tardivement (le 14 juin 2024) par rapport au début de la crise politique, et l’extrait s’intéresse à la définition du fascisme.
« Pour définir très brièvement ce que sont essentiellement le fascisme et ses conditions d’émergence, l’on peut mobiliser la synthèse que donne Dimitrov au VIIe congrès de l’Internationale communiste (1935), elle-même fondée sur les travaux antérieurs de Zetkin. »
Est-il vrai de dire que les travaux de Georgi Dimitrov sur le fascisme sont fondés sur les travaux antérieurs de Clara Zetkin ?
Absolument pas. Une telle chose n’a d’ailleurs jamais été dite nulle part, et pour cause : les deux thèses s’opposent.
Clara Zetkin parle de la situation dans les années 1920, et elle constate la chose suivante. Dans les pays européens où une révolution a commencé à la suite de la révolution russe, en cas d’insuccès, la contre-révolution passe au terrorisme et massacre les révolutionnaires.
Ce fut le cas, comme on le sait, de manière très importante en Hongrie et en Finlande. L’Italie pré-fasciste avait également connu une période intense de contestation révolutionnaire.
Le fascisme est donc, pour Clara Zetkin, une punition.
Est-ce le cas pour Georgi Dimitrov ?
Pas du tout : Georgi Dimitrov explique que le fascisme est le produit du poids massif que prend une fraction de la bourgeoisie dans un contexte de crise générale du capitalisme, afin d’aller à la guerre.
Georgi Dimitrov ne parle donc pas que d’un contexte de lutte de classes, il analyse les mécanismes internes au mode de production capitaliste.
C’est donc bien différent, et on comprend pourquoi eUnité Communistee ne parle absolument jamais du conflit armé en Ukraine. Il ne croit pas en l’inéluctable marche à la guerre, il rejette au fond justement les enseignements de Georgi Dimitrov et de l’Internationale Communiste.
« Le fascisme est le produit de la crise générale du capitalisme. Cette crise est autant économique que politique. D’une part, elle entraîne les masses populaires dans la misère et l’ensemble des classes dans l’incertitude. D’autre part, elle sape les « moyens de violence » de l’État bourgeois, ce qui le rend incapable de remplir son rôle de classe (la répression du mouvement ouvrier et révolutionnaire). »
Il va de soi que le groupe « Unité Communiste » n’a jamais défini ce qu’est la crise générale du capitalisme. Nous seuls l’avons fait. On est ici dans une escroquerie.
Quant au reste, ce qui est dit est faux. Pour la paupérisation, il y a un phénomène inégal. Lorsque la crise générale s’ouvre, il y a la misère dans l’Est de l’Europe, mais dans l’Ouest de l’Europe cela mettra plusieurs années avant qu’on n’arrive à une telle situation.
Ensuite, il y a eu une crise générale en Allemagne en 1918 et les années qui ont suivi, et à chaque fois l’État bourgeois a très bien rempli son rôle d’écraser le mouvement ouvrier et révolutionnaire.
Il y a ici une assimilation erronée entre « crise » et « effondrement ».
« D’une telle crise, peut naître une situation révolutionnaire, c’est-à-dire où la prise du pouvoir par un mouvement révolutionnaire est possible. Cependant, si le mouvement révolutionnaire en est incapable, alors la situation observe un équilibre des forces entre la classe bourgeoise et la classe prolétaire, et leurs institutions de classes respectives (l’État bourgeois et le Parti communiste).
Le fascisme intervient lorsque le mouvement révolutionnaire n’est pas assez fort pour prendre le pouvoir, mais que l’État bourgeois n’est pas assez fort pour réprimer le mouvement révolutionnaire et relancer l’économie, et ainsi restaurer l’ordre. »
Corrigeons immédiatement : ce n’est pas un « mouvement révolutionnaire » qui prend le pouvoir. C’est là une conception putschiste. C’est la classe ouvrière qui prend le pouvoir, à travers son Parti et l’organisation à la base (les « soviets »), ce qui n’a rien à voir.
D’autre part, ce qu’on lit est anti-dialectique, et correspond à la thèse typique de Léon Trotsky. Il y aurait une troisième force, en plus du prolétariat et de la bourgeoisie. Le fascisme interviendrait « de l’extérieur » pour faire pencher la balance.
C’est la thèse du fascisme comme mouvement de gangsters manipulant des petits-bourgeois appauvris pour forcer le cours des choses.
De toutes manières, parler de la possibilité d’« un équilibre des forces entre la classe bourgeoise et la classe prolétaire », c’est déjà ne rien avoir compris à la dialectique. C’est littéralement penser, au lieu que 1 devient 2, que 2 devient 1.
« Dans cette situation, et dans cette situation seulement, le coût politique et économique important que représente le fascisme pour la classe bourgeoise devient acceptable : acculée, la bourgeoisie préfère l’aliénation partielle à l’aliénation totale. »
Cette thèse dit le contraire de ce que dit justement Georgi Dimitrov, et encore une fois on retrouve les thèses de Léon Trotsky. Pour Léon Trotsky, l’ensemble de la bourgeoisie remet les clefs de l’État à des gangsters, aventuriers et opportunistes. Pour Georgi Dimitrov, une fraction seulement de la bourgeoisie agit pour s’accaparer le pouvoir, aux dépens des autres.
D’où, justement, dans la conception du Front populaire de Georgi Dimitrov, l’alliance antifasciste nécessaire avec une partie de la bourgeoisie, ce que Léon Trotsky a toujours dénoncé.
« Pourquoi est-ce que le fascisme représente un coût politique et économique considérable pour la bourgeoisie ?
Parce que le fascisme n’est pas une nouvelle forme d’alliance politique dans le cadre de l’État bourgeois démocratique, mais une nouvelle forme de l’État bourgeois — l’État fasciste.
Dans celui-ci, la bourgeoisie dans son ensemble abdique son pouvoir au profit exclusif d’une frange de celle-ci : la frange la plus réactionnaire. »
Ici, les propos semblent revenir à la ligne de Georgi Dimitrov. En apparence seulement, car il est dit que « la bourgeoisie abdique son pouvoir ». Ce qui signifie que la bourgeoisie « pense », qu’elle « choisit », ce qui est absolument impossible.
C’est là où on reconnaît un esprit de confusion, de lectures mal digérées, de vision universitaire et abstraite des choses.
Mais le pire n’est pas là. Car, ce qui est terrible, c’est de parler de « l’État fasciste » comme d’une « nouvelle forme de l’État bourgeois ». Cela peut sonner juste. Mais dire les choses ainsi revient à considérer que la bourgeoisie peut donner naissance à quelque chose de nouveau, qu’elle peut s’élever qualitativement.
Sur ce plan, ce qu’on lit est une pure catastrophe et une révision totale de la base même du marxisme.
Présenter le passage à une dictature terroriste comme un saut qualitatif est en incohérence complète avec la conception communiste d’une bourgeoisie en pleine décadence.
« Ce qui motive cette décision, c’est la contrainte imposée par le statu quo, la crise que l’État bourgeois démocratique est incapable de résoudre, c’est à dire d’une part la dégradation générale de l’économie (déclassement, chute du taux de profit, faillite, etc.), et d’autre part, le risque révolutionnaire (produit par la crise économique). »
Ce qu’on lit ici, c’est que la bourgeoisie « pense », elle « décide », et pire encore en toute conscience. On a ici le fantasme d’une bourgeoisie omnisciente, armée du Capital de Marx et cherchant à se guérir elle-même. C’est tout à fait représentatif d’une pensée prisonnière de la bourgeoisie elle-même, incapable de trouver un autre horizon sur le plan de l’idéologie, de la conception du monde.
Les pseudos-révolutionnaires pétris dans la pensée bourgeoise considèrent toujours, au fond d’eux, que la bourgeoisie restera intelligente, rationnelle, débrouillarde, etc.
« Dans ce contexte, la bourgeoisie consent à déléguer son pouvoir à la frange de celle-ci qui est capable d’apporter une issue à la crise : la dictature ouverte et terroriste de cette frange de la bourgeoisie.
Pour ne pas perdre complètement son pouvoir (à cause de la crise économique et politique), la bourgeoisie dans son ensemble se résout à perdre partiellement son pouvoir pour rendre possible une nouvelle forme de sa dictature de classe — qualitativement différente de la dictature bourgeoise démocratique —, la dictature bourgeoise fasciste. »
C’est incohérent, tout est faux. La bourgeoisie « consent à déléguer » : elle pense et elle a conscience qu’elle pense ! Elle perd « partiellement son pouvoir » au profit d’une frange de celle-ci, est-il dit, alors que quelques lignes au-dessus, il est dit le contraire : « la bourgeoisie dans son ensemble abdique son pouvoir au profit exclusif d’une frange de celle-ci ».
Ce texte-miroir a cela de très utile, qu’il est faux dans tout, et que même dans ses erreurs, il est truffé d’erreurs. Telle est la souffrance des trompeurs, des éclectiques, qui doivent toujours en rajouter une couche pour essayer de rendre l’ensemble cohérent.
« Cette dictature est « ouverte et terroriste », car elle ne tolère aucune opposition organisée à l’extérieure de son régime, c’est-à-dire aucune menace ouverte (contrairement à la dictature bourgeoise démocratique), et qu’elle ne recule devant aucune extrémité pour supprimer celle-ci.
L’État fasciste impose un nouveau rapport politique entre les classes, dans lequel la bourgeoisie non-fasciste se voit aussi soumise à la dictature, c’est-à-dire à l’arbitraire de l’État, au profit de la frange de la bourgeoisie au pouvoir. »
On voit ici apparaître le concept de « bourgeoisie non-fasciste », ce qui est un retour à Georgi Dimitrov. Et on sait que le concept de Front populaire s’associe à celui de révolution démocratique, anti-monopoles et anti-guerre, pas à celui de révolution socialiste.
Hélas, hélas encore, il est dit que la « dictature bourgeoise démocratique » tolère une opposition organisée à l’extérieur de son régime. C’est là du révisionnisme le plus complet, c’est la thèse de Maurice Thorez et de Palmiro Togliatti dans les Partis Communistes de France et d’Italie durant les années 1940.
Cette thèse prône, de manière syndicaliste révolutionnaire, ou ultra-démocratique, une contre-société au sein de la « dictature bourgeoise démocratique », pour finalement aboutir, de manière hypothétique, à des institutions nouvelles absorbant les anciennes.
C’est une interprétation opportuniste des thèses d’Antonio Gramsci sur « l’hégémonie », et c’est là d’ailleurs très exactement le noyau dur de l’idéologie du groupe « Unité Communiste ».
« De plus, cette dictature est aussi économique, c’est-à-dire que dans celle-ci les intérêts économiques de la frange de la bourgeoisie au pouvoir (dans l’État) priment sur les intérêts économiques de la bourgeoisie qui n’est plus au pouvoir (en dehors de l’État).
Le fascisme tend à transformer le capitalisme monopoliste d’État en capitalisme d’État, où les monopoles ne sont plus seulement intégrés dans celui-ci, mais fusionnés avec celui-ci (au profit de la frange de la bourgeoisie fasciste, et au détriment du reste des franges de la bourgeoisie).
À cela se rajoute que la simple transition de l’État bourgeois démocratique vers l’État bourgeois fasciste amène une importante déstabilisation des marchés nationaux et internationaux. »
Le révisionnisme du propos est ici on ne peut plus clair, puisqu’il est dit de manière totalement aberrante que :
« Le fascisme tend à transformer le capitalisme monopoliste d’État en capitalisme d’État, où les monopoles ne sont plus seulement intégrés dans celui-ci, mais fusionnés avec celui-ci. »
On est ici dans une construction intellectuelle purement universitaire, purement de laboratoire. La catastrophe est totale.
1. Prenons d’abord le capitalisme monopoliste d’État et son rapport avec le fascisme.
Qu’est-ce qu’un régime fasciste ? Justement, un régime caractérisé par la domination des monopoles, qui possèdent les rouages de l’État, de manière quasi entière. C’est ce qu’on appelle le capitalisme monopoliste d’État. Les grands monopoles utilisent l’État, les petits capitalistes sont hors-jeu.
Or, on lit ici qu’il y aurait un « capitalisme monopoliste d’Etat » avant le fascisme. Ce qui n’a strictement aucun sens : si les monopoles avaient déjà le pouvoir quasi total sur l’État, pourquoi alors auraient-ils besoin du fascisme ?
2. Cette thèse du « capitalisme monopoliste d’Etat » a été inventée par les révisionnistes du PCF (Paul Boccara) et d’URSS (Eugen Varga). Le groupe « Unité Communiste » montre ici sa filiation historique sur le plan idéologiue.
3. Que signifie la « fusion » des monopoles avec l’État ? Où diable le groupe « Unité Communiste » a-t-il vu cela ? Ou alors c’est la même vision fantasmée, typiquement française, d’une Allemagne nazie où tout appartient à l’État, où les gens marchent tous au pas de l’oie, où il n’y a plus de fêtes, etc.
Et, d’ailleurs, les Français ont exactement la même vision du Socialisme. C’est un préjugé petit-bourgeois bien connu.
En réalité, dans le fascisme, le petit capitalisme existe tout à fait, les entreprises capitalistes se font concurrence, etc., c’est du capitalisme et il n’y a pas d’absorption par l’État. Ce qui change, c’est que les monopoles, au cœur de la superstructure impérialiste du capitalisme, ont pris le dessus et impulsent la direction désormais.
« Le fascisme ne peut exister que porté par un mouvement de masse interclassiste. Il lui est nécessaire, premièrement, pour que la frange fasciste de la bourgeoisie puisse s’imposer dans l’État bourgeois démocratique face à toutes les autres franges de la bourgeoisie, et deuxièmement, pour que le fascisme puisse légitimer et défendre son propre régime auprès des masses.
Or, ce mouvement de masse fasciste ne peut se perpétuer qu’avec un « programme pseudo-révolutionnaire » qui promet des rétributions matérielles aux masses en échange de leur adhésion et de leur soumission.
Une fois arrivée au pouvoir, la frange fasciste de la bourgeoisie doit donner une réalité à ces promesses, pour pérenniser son régime.
Or, le corporatisme n’est pas gratuit, et il peut se traduire par une baisse du taux de profit pour la bourgeoisie qui a délégué son pouvoir. »
Ce qu’on lit ici est totalement faux et propose même la dangereuse illusion d’un fascisme qui pourrait élever le niveau de vie des masses, grâce au corporatisme « stabilisant » le capitalisme.
On a d’ailleurs littéralement l’impression qu’une fois au pouvoir, les fascistes se comportent vis-à-vis des masses comme le père Noël.
L’Histoire ne montre pas du tout cela, bien au contraire, la victoire du fascisme s’accompagne d’une paupérisation générale et d’une marche forcée à la guerre impérialiste. Les « succès » économiques s’appuient fondamentalement sur cette militarisation acharnée.
« En résumé, le fascisme est l’ultime salut de la dictature bourgeoise, lorsque l’État bourgeois démocratique en crise est incapable d’assurer la sauvegarde de la classe dominante face au mouvement révolutionnaire, mais que le mouvement révolutionnaire ne peut pas saisir l’opportunité de la prise du pouvoir. »
C’est en apparence la thèse de Clara Zetkine, ce n’est pas du tout la thèse de Georgi Dimitrov et de l’Internationale Communiste. C’est surtout la porte ouverte de manière très claire à la thèse de Léon Trotsky, avec sa conception d’une remise du pouvoir aux gangsters, aventuriers et autres opportunistes démagogues.
« Le fascisme représente des sacrifices conséquents pour la bourgeoisie, qui ne peuvent être consentis que lorsqu’ils sont rendus nécessaires par les circonstances, c’est-à-dire lorsque la bourgeoisie est acculée.
Seul le risque existentiel représenté par le mouvement révolutionnaire, porté par la crise générale du capitalisme, peut être suffisant pour amener la bourgeoisie à entreprendre une reconfiguration fasciste des rapports de classe. »
C’est faux : le fascisme émerge justement car la bourgeoisie ne peut plus consentir de sacrifices. Si elle le pouvait, elle utiliserait le réformisme à prétention sociale.
Et c’est là où on retrouve la conception totalement fausse de la bourgeoisie qui « pense », de la bourgeoisie qui « choisit ». Une conception portée par des gens qui ne peuvent pas se placer intellectuellement en-dehors de la bourgeoisie.
Citons ici Georgi Dimitrov au 7e congrès de l’Internationale Communiste, en août 1935. Il montre bien que, loin des sacrifices, la bourgeoisie maintient son exploitation et l’aggrave même, qui montre bien que loin de « choisir », la bourgeoisie est obligée de se ratatiner et de s’effacer devant sa fraction la plus puissante, la plus agressive.
« La bourgeoisie dominante cherche de plus en plus le salut dans le fascisme, afin de prendre contre les travailleurs des mesures extraordinaires de spoliation, de préparer une guerre de brigandage impérialiste, une agression contre l’Union Soviétique, l’asservissement et le partage de la Chine et sur la base de tout cela de conjurer la révolution.
Les milieux impérialistes tentent de faire retomber tout le poids de la crise sur les épaules des travailleurs. C’est pour cela qu’ils ont besoin du fascisme.
Ils s’efforcent de résoudre le problème des marchés par l’asservissement des peuples faibles, par l’aggravation du joug colonial et par un nouveau partage du monde au moyen de la guerre.
C’est pour cela qu’ils ont besoin du fascisme. »
Ce texte-miroir est donc bien utile. Il montre que sans comprendre la marche à la guerre, toute conception antifasciste est obligée de se tromper et d’imaginer un fascisme venant de « l’extérieur », comme si un « équilibre » entre prolétariat et bourgeoisie devait être bousculé on ne sait comment.
Ce n’est ainsi pas pour rien que le groupe « Unité Communiste » oublie systématiquement à la fois la guerre en Ukraine, ainsi que la volonté ouverte de la France d’y participer pour détruire la Russie.
La guerre comme réponse inéluctable du capitalisme à sa crise générale forme un concept inacceptable pour qui veut rester « rationnel », au sein de la rationalité bourgeoise française, dans l’esprit intellectuel universitaire.
Seul un réel positionnement révolutionnaire permet inversement d’oser assumer la thèse de la guerre comme inéluctable, parce que c’est le choix de rupture idéologique ouverte, de la guerre de classe entre prolétariat et bourgeoisie.
Aussi, pour conclure, il faut considérer que c’est l’aspect principal. Ce texte-miroir est exemplaire de la tiédeur qui peut exister avec des gens mélangeant tout, s’adaptant de manière opportuniste, incapable d’assumer la rupture.
Cette tiédeur ne peut être que très grande en France, pays où une petite-bourgeoisie intellectuelle est massivement présente. Des gens pour parler sans avoir étudié – et étudier sérieusement -, à partir d’une position bien au chaud de la « rationalité » bourgeoise française, cela ne manque pas !
Dans un contexte de crise générale du capitalisme, il faut savoir échapper à de tels gens, et les réfuter, afin qu’ils ne contaminent pas avec leurs fictions, leurs constructions incohérentes, leurs conceptions artificielles, leur fourre-tout opportuniste.