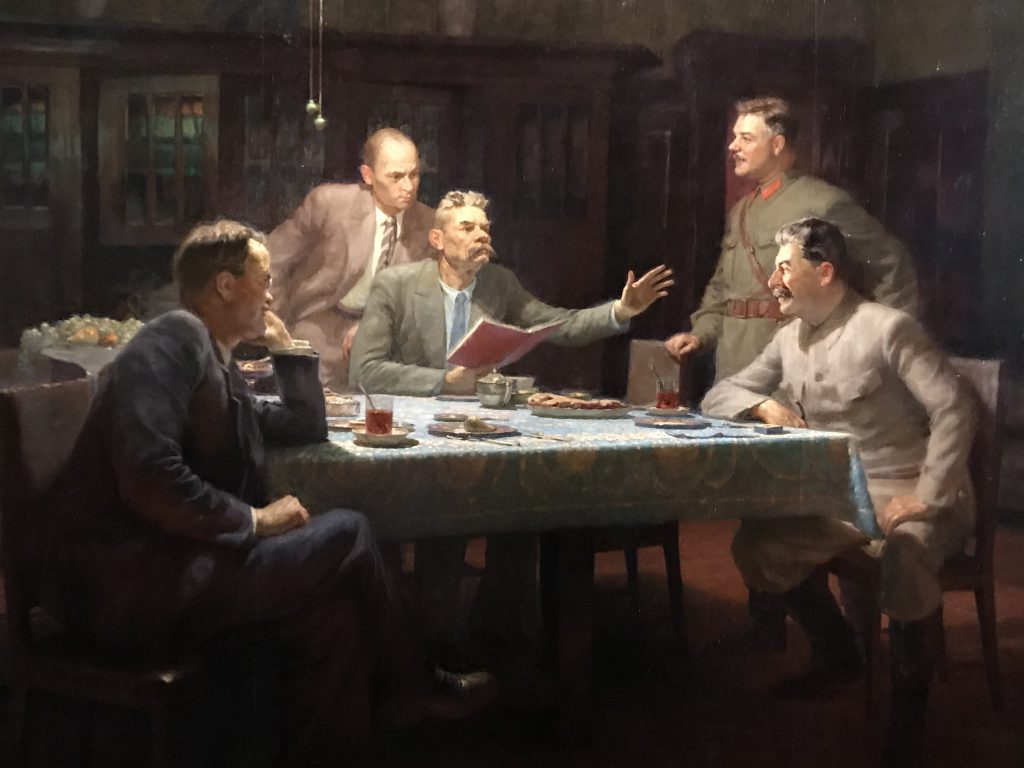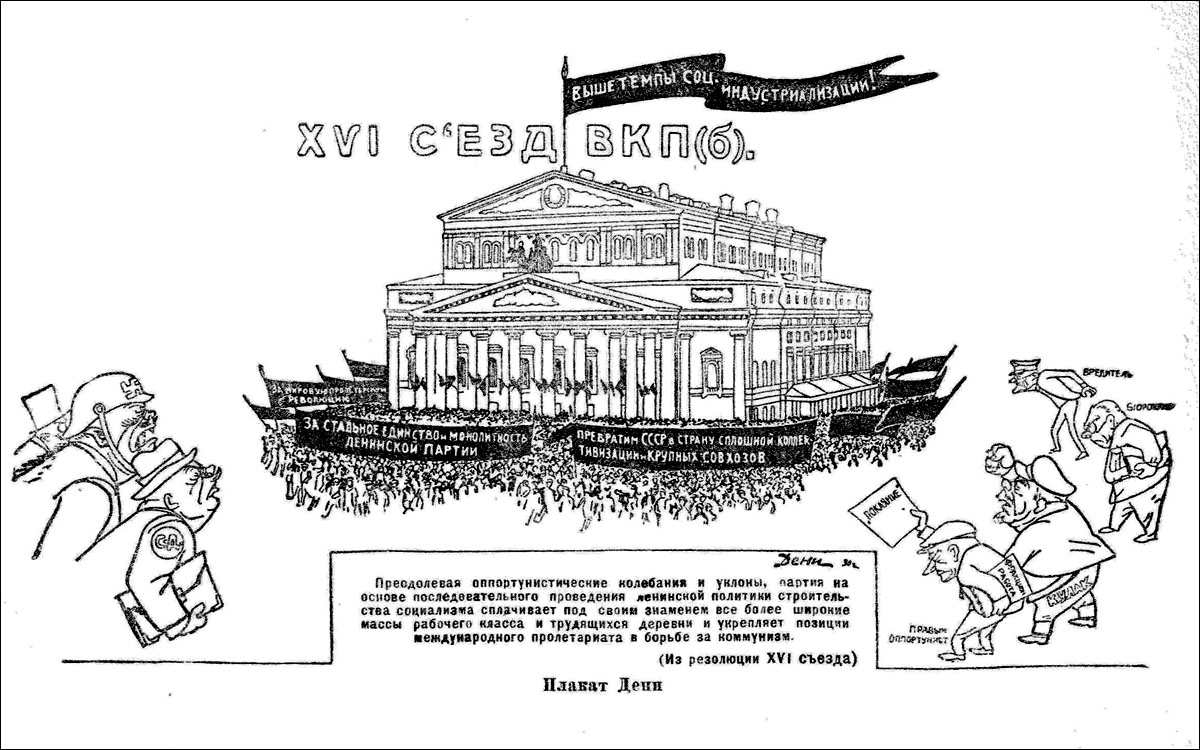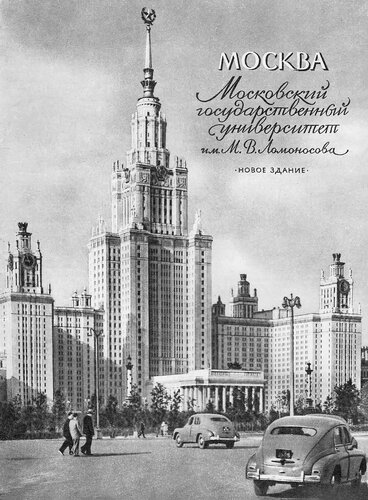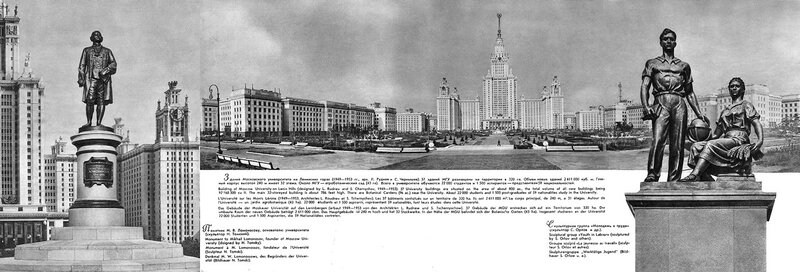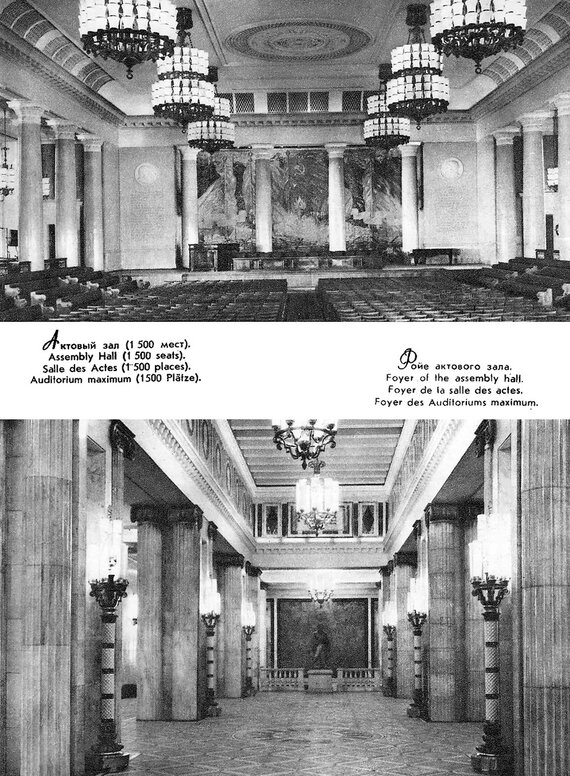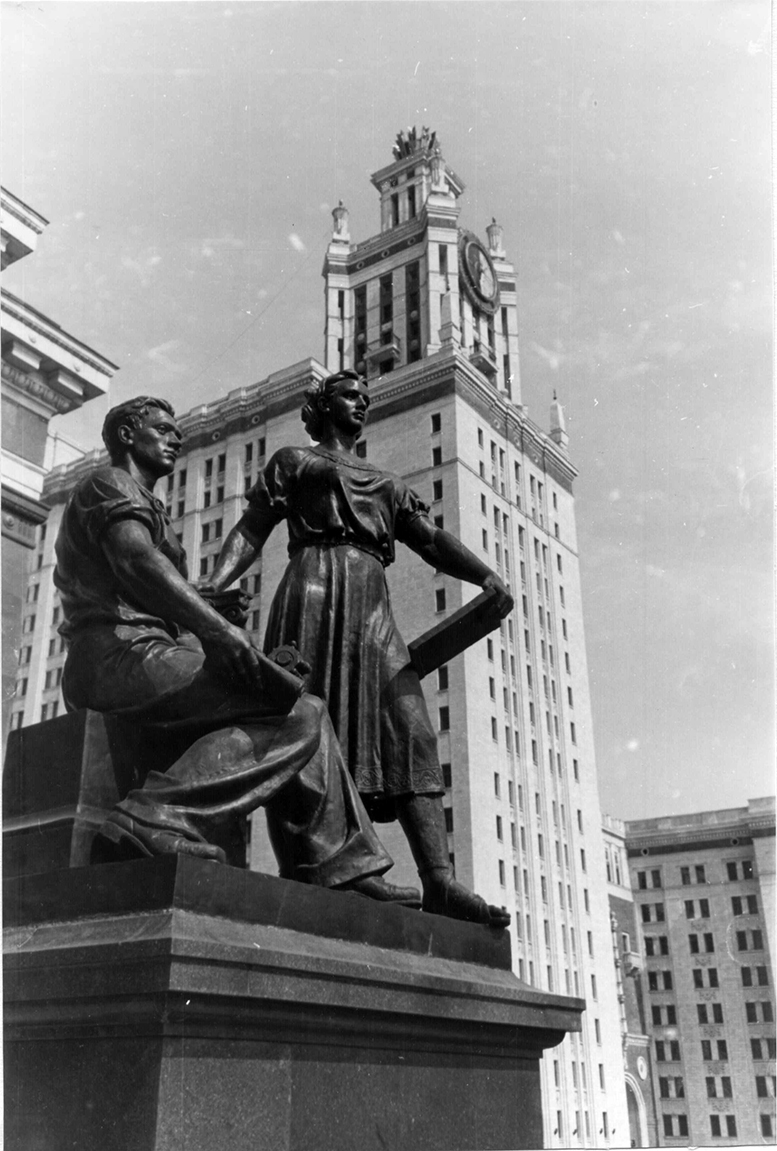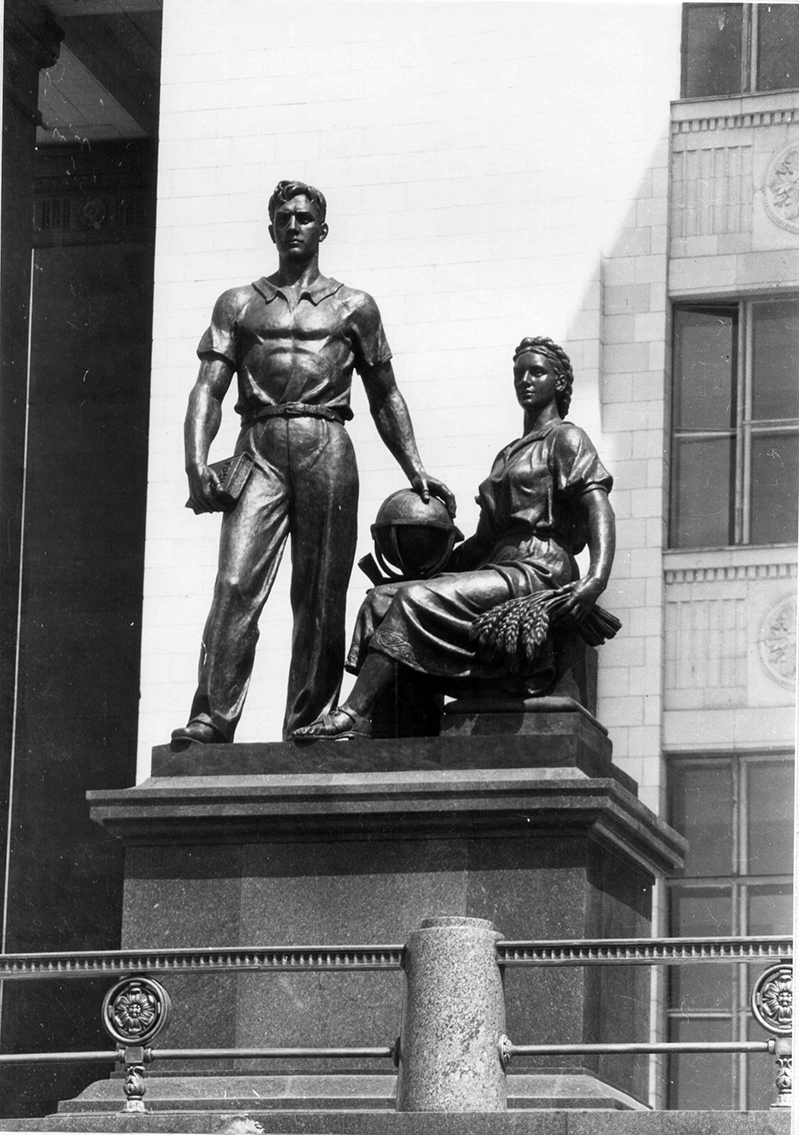Discours d’introduction à la Conférence des musiciens
soviétiques de 1948.
Quelques mots sur le livret. Le livret de cet
opéra est artificiel et les événements à rendre sont inexacts et
faux du point de vue historique.
Voici, brièvement, de quoi il est question.
L’opéra est consacré à la lutte livrée pour l’amitié des peuples
dans le Caucase du Nord, en 1918-1920. Les peuples du Caucase, dont
l’opéra a en vue de montrer des Ossètes, les Lesghiens et les
Géorgiens, passent, avec l’aide d’un commissaire envoyé de Moscou,
de la lutte contre le peuple russe, en particulier contre les
Cosaques, à la paix et à l’amitié avec lui.
Ce qu’il y a d’historiquement faux ici, c’est que
ces peuples n’ont jamais été en inimitié avec le peuple russe.
Tout au contraire, dans la période historique à laquelle est
consacré cet opéra, c’est précisément de concert avec les
Ossètes, les Lesghiens et les Géorgiens que le peuple russe et
l’Armée rouge battaient les forces de la contre-révolution,
jetaient les fondements du pouvoir des Soviets dans le Caucase
du Nord et instauraient la paix et l’amitié des peuples.
A l’époque, ce sont les Tchétchènes et les
Irigouchis qui faisaient obstacle à l’amitié des peuples.
Donc, en ce temps-là, ce sont les Tchétchènes
et les Ingouchis qui semaient la haine entre les nationalités, et
voilà qu’au lieu d’eux, on présente au public les Ossètes et les
Géorgiens ! C’est là une erreur historique grossière ; c’est
falsifier l’histoire ; c’est attenter à la vérité historique.
Bien qu’il soit question dans cet opéra d’une
époque fort intéressante, de l’époque de l’instauration du pouvoir
des Soviets dans le Caucase du Nord, avec toute la complexité de ses
coutumes multinationales et la variété des formes de la lutte de
classes, et alors que dans ces conditions cet opéra aurait dû
rendre pleinement la vie fertile en événements et les mœurs des
peuples du Caucase du Nord sa musique s’est trouvée être très
loin de l’œuvre populaire des peuples du Caucase du Nord.
Si les Cosaques paraissent sur la scène et
ils jouent un grand rôle dans l’opéra – ni la musique, ni les
chants n’ont rien de typique pour les Cosaques, leurs chansons et
leur musique. Il en est de même des peuplades de montagnards. Si au
cours de l’action on danse une lesghienne, la mélodie ne rappelle en
rien les mélodies si connues et si populaires des lesghiennes. Le
compositeur, en quête d’originalité, a écrit pour sa lesghienne,
une musique peu compréhensible, fastidieuse et beaucoup moins jolie
et riche en contenu que la musique populaire ordinaire de la
lesghienne.
Puis, reprenant la parole au cours de la
discussion, Jdanov fit l’intervention suivante :
Permettez-moi d’abord de faire quelques
remarques sur le caractère de la discussion qui se déroule ici.
L’appréciation générale de la situation dans le domaine de la
création musicale se ramène à cette constatation : ça ne va pas
fort.
Il s’est exprimé, il est vrai, différentes
nuances au cours des interventions. Les uns ont dit qu’elle boitait
surtout sous le rapport de l’organisation, ils ont montré
l’insuffisance de la critique et de l’autocritique et dénoncé les
fausses méthodes de direction, particulièrement à l’Union des
compositeurs.
D’autres, s’associant à la critique de
l’organisation et du régime régnant dans les organisations, ont
signalé ce qui va mal dans l’orientation idéologique de la musique
soviétique. Les troisièmes ont tenté d’escamoter le caractère
aigu de la situation ou de passer sous silence les questions
désagréables. Mais de quelque façon qu’aient été exprimées ces
nuances, le ton général de la discussion se réduit à constater
que ça ne va pas fort.
Je n’ai pas l’intention d’apporter une dissonance
ou une « atonalité » dans cette appréciation, quoique l’«
atonalité » soit aujourd’hui à la mode. La situation est en effet
bien mauvaise. Il me semble qu’elle est pire qu’on ne l’a dit ici.
Je n’ai pas l’intention de nier les résultats
obtenus par la musique soviétique. Ils existent, bien sûr, mais si
l’on se représente quels résultats nous aurions pu et dû obtenir
dans le domaine de la musique, si l’on compare même les succès
dans ce domaine avec les résultats obtenus dans d’autres domaines de
l’idéologie, il faut avouer qu’ils sont tout à fait insignifiants.
Si l’on prend, par exemple, la littérature, on
voit aujourd’hui certaines revues éprouver de véritables
difficultés parce qu’elles n’arrivent plus à faire place à tous
les manuscrits dignes de publication qu’elles ont en portefeuille. Il
semble qu’aucun des orateurs n’ait pu se vanter d’une telle
surproduction en musique. Il y a progrès dans le domaine du cinéma
ou de la dramaturgie.
Mais dans le domaine de la musique il n’y a pas le
moindre progrès sensible.
La musique est en retard, tel est le ton de toutes
les interventions. Aussi bien à l’Union des compositeurs qu’au
Comité des arts, il s’est créé une situation évidemment anormale.
Du Comité des arts on a peu parlé et on ne l’a pas suffisamment
critiqué. En tout cas on a parlé notablement plus et de façon plus
incisive de l’Union des compositeurs.
Et pourtant, le Comité des arts a joué un rôle
de fort mauvais aloi. En se donnant l’air de défendre de toutes ses
forces la tendance réaliste en musique, le Comité a favorisé de
toutes les façons la tendance formaliste en élevant ses
représentants sur le pavois, et par là-même il a rendu possible la
désorganisation et l’introduction de la pagaille idéologique dans
les rangs de nos compositeurs. En outre, inculte et incompétent
dans les questions musicales, le Comité s’est mis à la traîne des
compositeurs du clan formaliste.
On a comparé ici le Comité d’organisation de
l’Union des compositeurs à un monastère ou aux généraux sans
armée. Il n’est pas besoin de contester ces affirmations.
Si le sort de la création musicale soviétique se
trouve être la prérogative du cercle le plus fermé de compositeurs
et de critiques dirigeants, de critiques choisis suivant le principe
du soutien des chefs et créant autour des compositeurs une
atmosphère enivrante d’adulation, s’il n’y a pas de discussion de
travail, si à l’Union des compositeurs s’est instaurée une
atmosphère confinée, moisie, où l’on distingue les compositeurs de
première et de seconde qualités, si le style dominant dans les
conférences de l’Union des compositeurs est le silence respectueux
ou les pieuses louanges aux élus, si la direction du Comité
d’organisation est coupée de la masse des compositeurs alors
on ne peut pas ne pas reconnaître que la situation sur l’« Olympe »
musical est devenue menaçante.
Il convient de dire un mot particulier de critique
de l’orientation vicieuse de la critique et de l’absence de
discussion de travail à l’Union des compositeurs. Du moment qu’il
n’y a pas discussion de travail, qu’il n’y a ni critique ni
autocritique, il n’y a pas non plus mouvement en avant. La discussion
de travail est une critique objective, indépendante – c’est
aujourd’hui devenu un axiome – apparaissent comme
la condition la plus importante du progrès créateur.
Là où il n’y a pas critique et discussion de
travail, les sources mêmes du mouvement se tarissent, il s’installe
une atmosphère de serre, de moisissure et de stagnation, dont nos
compositeurs n’ont nul besoin.
Ce n’est point par hasard que les gens qui
prennent part pour la première fois à une conférence sur les
questions musicales, trouvent étrange que puissent se perpétuer des
contradictions aussi irréductibles entre le régime très
conservateur qui préside à l’organisation de l’Union des
compositeurs, et les idées soi-disant ultra-progressives de ses
dirigeants actuels dans le domaine de l’idéologie et de la
création.
On sait que la direction de l’Union a inscrit sur
son drapeau des formules prometteuses comme l’appel à l’esprit
novateur, le rejet des traditions désuètes, la lutte contre l’ «
épigonisme », etc.
Mais il est curieux que les mêmes personnes qui
veulent paraître très radicales et même ultra-révolutionnaires
dans leur programme créateur, qui prétendent au rôle de
destructeurs des canons vieillis que ces mêmes personnes,
quand elles prennent part à l’activité de l’Union des compositeurs,
se révèlent extraordinairement rétrogrades, imperméables
aux nouveautés et aux changements, conservatrices dans leurs
méthodes de travail et de direction, et souvent paient volontiers
tribut dans les questions d’organisation aux pires traditions et à
l’« épigonisme » tant décrié, cultivant les procédés les plus
bornés et éculés quand il s’agit de diriger la vie et l’activité
de leur propre groupement.
Comment cela se fait, il est aisé de l’expliquer.
Si une phraséologie boursoufflée sur les soi-disant tendances
nouvelles de la musique soviétique, s’associe à des actes qui ne
sont nullement d’avant-garde, cela seul suffît à provoquer un doute
légitime sur le caractère progressiste des bases idéologiques sur
lesquelles reposent des méthodes aussi réactionnaires.
L’organisation a en toutes choses une grande
importance, vous le comprenez parfaitement. Il faut c’est évident,
procéder à une sérieuse ventilation dans les organisations de
compositeurs et de musiciens, il faut qu’un souffle frais y
purifie l’air pour qu’y soient créées des conditions normales au
travail créateur.
Mais la question d’organisation, pour importante
qu’elle soit, n’est pas fondamentale. La question fondamentale, c’est
l’orientation de la musique soviétique. La discussion qui s’est
déroulée ici élude quelque peu le problème et ce n’est pas juste.
Si en musique vous cherchez la phrase musicale
claire, de même dans la question de l’orientation de notre musique
nous devons chercher à atteindre la clarté.
A la question : s’agit-il de deux tendances en
musique ? la discussion apporte une réponse parfaitement nette
: oui, c’est précisément de cela qu’il s’agit. Bien que certains
camarades aient essayé de ne pas appeler les choses par leur
nom et que l’on ait joué partiellement en sourdine, il est clair
qu’il y a lutte entre les tendances, que les efforts faits pour
remplacer une orientation par une autre sont manifestes.
En même temps une partie de nos camarades a
prétendu qu’il n’y avait pas de raison de poser la question de la
lutte des tendances, qu’il ne s’était produit aucun changement
d’ordre qualitatif, qu’on assistait seulement au développement de
l’héritage classique dans les conditions du milieu soviétique.
On a dit qu’il n’y avait aucune révision des
fondements de la musique classique et que, par conséquent, il n’y
avait pas matière à discussion, qu’il était vain de faire du
bruit.
Le problème se réduirait tout au plus à des
corrections de détail, à des cas isolés d’engouement pour la
technique, à des fautes isolées de caractère naturaliste, etc.
C’est justement parce que l’on s’est livré à un camouflage de cette
nature, qu’il convient de s’étendre plus en détail sur la lutte des
deux tendances.
Il ne s’agit évidemment pas seulement de
corrections, il ne suffit pas de dire qu’il y a une gouttière dans
le toit du Conservatoire et qu’il faut la boucher et l’on ne
peut pas ne pas être d’accord là-dessus avec le camarade Chebaline,
mais le trou n’est pas seulement dans le toit du Conservatoire ce
serait vite réparé ; il s’est formé une brèche beaucoup plus
importante dans les fondations mêmes de la musique soviétique.
Il n’y a pas là-dessus deux avis et tous les
orateurs l’ont montré : dans l’activité de l’Union des compositeurs
le rôle dirigeant est joué aujourd’hui par un groupe limité de
compositeurs. Il s’agit des camarades Chostakovitch, Prokofiev,
Miaskovsky, Khatchatourian, Popov, Kabalevski, Chebaline. Qui
voulez-vous encore associer à ces camarades ?
Une voix crie : « Chaporine ». Jdanov
poursuit :
Lorsqu’on parle du groupe dirigeant qui tient tous
les fils et toutes les clés du « Comité exécutif des arts » ce
sont les noms qu’on donne le plus souvent. Nous admettrons que ces
camarades sont les principales figures dirigeantes de la tendance
formaliste en musique. Et cette tendance est totalement fausse.
Les camarades sus-nommés ont, eux aussi, pris ici
la parole, et déclaré qu’eux aussi étaient mécontents qu’à
l’Union des compositeurs il n’y ait pas d’atmosphère de critique,
qu’on les loue exagérément, qu’ils sentent un certain
affaiblissement de leurs contacts avec les cadres de base des
compositeurs, avec les auditoires, etc.
Mais pour constater toutes ces vérités, sans
doute n’avait-on pas besoin d’attendre un opéra incomplètement ou
imparfaitement réussi.
Ces aveux auraient pu être faits beaucoup plus
tôt. C’est qu’au fond pour ce groupe dirigeant de nos compositeurs
du clan formaliste, le régime qui régnait jusqu’ici dans les
organisations musicales n’était, pour modérer mon expression,
« point désagréable ». Il a fallu la conférence au Comité
central du Parti pour que ces camarades découvrent le fait, que ce
régime recèle aussi des côtés négatifs. En tout cas, jusqu’à la
Conférence au C.G., aucun d’entre eux n’a jamais proposé de rien
changer à l’état de choses existant dans l’Union des compositeurs.
Les forces du « traditionalisme » et de l’« épigonisme »
agissaient sans défaillance.
On a dit ici que le moment était venu de changer
carrément les choses. On ne peut pas ne pas en tomber d’accord.
Pour autant que les postes de commande de la
musique soviétique sont occupés par les camarades en question, pour
autant qu’il a été démontré que des tentatives pour les critiquer
auraient provoqué, comme l’a dit ici le camarade Zakharov, une
explosion, une mobilisation immédiate de toutes les forces contre la
critique, il faut en conclure que ce sont précisément ces camarades
qui ont créé cette insupportable atmosphère de serre, de
stagnation et de rapports amicaux, qu’ils sont maintenant disposés à
déclarer indésirables.
Les dirigeants de l’Union des compositeurs ont dit
ici qu’il n’y a pas d’oligarchie à l’Union des compositeurs. Mais
alors se pose la question: pourquoi s’accrochent-ils tant aux postes
de directeurs de l’Union? Le pouvoir les séduit-il pour
lui-même?
En d’autres termes, ces gens ont-ils pris
l’autorité en mains parce qu’il leur est agréable de détenir
l’autorité pour elle-même, ont-ils été atteints d’une telle
démangeaison administrative, veulent-ils simplement jouer aux
petits princes comme Vladimir Galitski dans le « Prince Igor »?
Ou bien serait-ce que cette domination s’est
établie en vue de donner à la musique une orientation déterminée
? Je pense que la première supposition tombe et que la seconde est
la bonne.
Nous n’avons pas raison d’affirmer que la
direction des affaires de l’Union n’est pas liée à l’orientation.
Nous ne pouvons pas adresser une telle accusation disons, à
Chostakovitch Par conséquent, si l’on dirigeait, c’était pour
orienter.
Effectivement nous avons affaire à une lutte très
aiguë, encore que voilée en surface, entre deux tendances.
L’une représente dans la musique soviétique une
base saine, progressive, fondée sur la reconnaissance du rôle
énorme joué par l’héritage classique, et en particulier par les
traditions de l’école musicale russe, sur l’association d’un contenu
idéologique élevé, de la vérité réaliste, de liens organiques
profonds avec le peuple, d’une création musicale chantante, d’une
haute maîtrise professionnelle.
La deuxième tendance exprime un formalisme
étranger à l’art soviétique, le rejet de l’héritage classique
sous le couvert d’un faux effort vers la nouveauté, le rejet du
caractère populaire de la musique, le refus de servir le peuple,
cela au bénéfice des émotions étroitement individuelles d’un
petit groupe, d’esthètes élus.
Cette tendance remplace la musique naturelle,
belle, humaine, par une musique fausse, vulgaire, parfois simplement
pathologique.
En outre, c’est une particularité de la seconde
tendance que d’éviter les attaques de front, de préférer cacher
son activité révisionniste sous le masque d’un accord prétendu
avec les propositions fondamentales du réalisme socialiste.
De telles méthodes « de contrebande » ne sont
évidemment pas neuves, les exemples du révisionnisme proclamant son
accord avec les propositions fondamentales de la théorie révisée,
ne manquent pas dans l’histoire. Il est d’autant plus nécessaire
de démasquer la véritable nature de cette seconde tendance et le
mal qu’elle a fait au développement de la musique soviétique.
Analysons par exemple la question de l’attitude
envers l’héritage classique. Les compositeurs en question ont beau
jurer qu’ils se tiennent des deux pieds sur le sol de
l’héritage classique, il n’y a pas moyen de démontrer que les
partisans de l’école formaliste prolongent et développent les
traditions de la musique classique.
N’importe quel auditeur dira que les œuvres des
compositeurs soviétiques du clan formaliste sont radicalement
différentes de la musique classique. La musique classique se
caractérise par la vérité et le réalisme, par l’art d’unir
une forme éclatante à un contenu profond, d’associer la plus haute
maîtrise avec la simplicité la plus accessible.
La musique classique en général, la musique
classique russe en particulier, ignorent le formalisme et le grossier
naturalisme. Ce qui les caractérise, c’est l’élévation de l’idée
: car elles savent reconnaître les sources de la musique dans
l’œuvre musicale des peuples, elles ont respect et amour pour le
peuple, pour sa musique et sa chanson.
Quel pas en arrière font nos formalistes hors de
la grand’route de notre histoire musicale lorsque sapant les bases de
la vraie musique ils composent une musique monstrueuse,
factice, pénétrée d’impressions idéalistes, étrangère aux
larges masses du peuple, s’adressant non à des millions de
soviétiques mais à quelques unités ou à quelques dizaines d’élus,
à une « élite » !
Comme cela ressemble peu à Glinka, à
Tchaïkovsky, à Rimsky-Korsakov, à Dargomyjski, à Moussorgski, qui
voyaient le principe de leur œuvre dans leur capacité d’exprimer
l’esprit du peuple, son caractère ! La volonté d’ignorer les
besoins du peuple, son esprit, sa création, signifie que la tendance
formaliste en musique a un caractère nettement antipopulaire.
Si chez certains compositeurs soviétiques a cours
cette théorie illusoire selon laquelle « on nous comprendra dans
cinquante ou cent ans », « si nos contemporains ne peuvent
nous comprendre, la postérité nous comprendra », alors c’est
une chose simplement effrayante. Si vous êtes déjà accoutumés à
cette pensée, une telle habitude est extrêmement dangereuse.
De tels raisonnements signifient qu’on se coupe
d’avec le peuple. Si moi écrivain, artiste, littérateur,
responsable du Parti je ne cherche pas à être compris de mes
contemporains, alors pour qui donc vivre et travailler ?
Mais cela conduit au vide spirituel, à l’impasse.
On dit que certains critiques musicaux parmi les flatteurs murmurent
aux compositeurs, maintenant en particulier, des « consolations » de
cette sorte. Mais des compositeurs peuvent-ils entendre de sang-froid
de tels conseils, sans traîner les conseillers au moins devant un
tribunal d’honneur ?
Rappelez-vous comment les classiques répondaient
aux exigences du peuple. On oublie déjà chez nous en quels termes
lumineux se sont exprimés les « Grands Cinq » [littéralement le «
groupe vigoureux », groupe de compositeurs russes du milieu du XIXe
siècle, avec comme principaux représentants Mili Balakirev, Modest
Moussorgski, Alexander Borodine, Nikolaï Rimsky-Korsakov, César
Cui] et le grand critique musical Stassov, leur compagnon, sur le
caractère populaire de la musique.
On oublie le mot remarquable de Glinka sur les
rapports du peuple et des artistes: « Celui qui crée la musique
c’est le peuple, et nous, les artistes, ne faisons que l’arranger ».
On oublie que les choryphées de l’art musical n’ont écarté aucun
genre, quand ces genres les aidaient à promouvoir l’art musical dans
de larges masses populaires.
Mais vous écartez même des genres tels que
l’opéra, vous tenez l’opéra pour une œuvre de second ordre, vous
lui opposez la musique symphonique instrumentale, pour ne rien dire
de votre attitude dédaigneuse envers la musique de chant, la musique
chorale ou la musique de concert : vous trouvez honteux de vous
abaisser jusqu’à elle et de satisfaire aux exigences populaires.
Cependant, Moussorgski a mis en musique le «
Hopak ». Glinka utilisa le « Komarinski » dans l’une de ses
meilleures œuvres. Peut-être faudra-t-il reconnaître que le
propriétaire foncier Glinka, le fonctionnaires des tsars Serov et le
gentilhomme Stassov étaient plus démocrates que vous.
C’est paradoxal, mais c’est un fait. Vous avez
souvent juré vos grands dieux que vous tenez pour la musique
populaire ; s’il en est ainsi, pourquoi dans vos œuvres
utilisez-vous si peu les mélodies populaires ? Pourquoi se
répètent les défauts que critiquait déjà Serov lorsqu’il
montrait que la musique « savante », c’est-à-dire professionnelle,
se développait parallèlement et indépendamment de la
populaire ?
Est-ce que chez nous la musique symphonique
instrumentale se développe en une étroite interaction avec la
musique populaire, que ce soit la chanson, la musique de concert ou
la musique chorale ?
Non, on ne peut le dire. Au contraire, on constate
ici indéniablement une rupture qui tient à la sous-estimation par
nos symphonistes de la musique populaire. Je rappellerai en quels
termes Serov caractérisait son attitude envers la musique populaire.
Je pense à son article La musique des chants de la Russie du Sud où
il disait :
« Les chansons. populaires en tant qu’organismes
musicaux ne sont absolument pas l’œuvre de talents isolés, mais la
production du peuple tout entier ; elles sont, par toute
leur structure, très différentes de la musique artificielle
qui résulte d’une imitation consciente des modèles, qui est le
produit de l’école, de la science, de la routine et de la réflexion.
Ce sont les fleurs d’un point donné, apparues
comme d’elles-mêmes, poussées dans tout leur éclat sans la moindre
prétention d’auteur, et, par suite, elles ne ressemblent guère à
ces produits de châssis ou de serres de la composition savante.
C’est pourquoi apparaît le plus clairement en
elles la naïveté de la création et (pour reprendre la juste
expression de Gogol dans les Âmes mortes) la haute
sagesse de la simplicité, grâce essentielle et secret
essentiel de toute création artistique.
Comme un lys dans sa splendeur parfaite éclipse
l’éclat du brocart et des pierres précieuses, de même la musique
populaire, par sa simplicité enfantine, est mille fois plus riche et
plus forte que tous les artifices de l’art d’école, préconisés par
les pédants dans les conservatoires et les académies musicales. »
Comme tout est bon, juste et fort ! Comme
l’essentiel est bien saisi : le développement de la musique doit se
faire sur la base d’une action réciproque, d’un enrichissement de la
musique « savante » par la musique populaire ! Mais de nos
articles théoriques et critiques d’aujourd’hui ce thème a presque
complètement disparu.
Cela confirme une fois de plus le danger que
courent les chefs de file de la musique contemporaine, de se couper
du peuple lorsqu’ils renoncent à une source aussi belle de création
que la chanson et la mélodie populaires. Une telle coupure ne peut
évidemment être le fait de la musique soviétique.
Permettez-moi de passer à la question des
rapports de la musique nationale et de la musique étrangère.
Des camarades ont dit ici avec raison qu’on
constate un engouement et même une certaine orientation vers la
musique bourgeoise occidentale contemporaine, vers la musique de
décadence, et qu’il y a là également un des traits fondamentaux de
l’orientation formaliste dans la musique soviétique.
Stassov a fort bien parlé en son temps des
rapports de la musique russe avec la musique de l’Europe occidentale,
dans son article Ce qui freine le nouvel art russe, où il écrivait
:
« II est ridicule de nier la science, la
connaissance en quelque domaine que ce soit y compris dans le domaine
musical. Mais les jeunes musiciens russes qui n’ont pas derrière eux
comme l’Europe, pour les soutenir, une longue chaîne de périodes
scolastiques, regardent audacieusement la science en face : ils la
vénèrent, utilisent ses bienfaits, mais sans exagération et sans
servilité. Ils nient la nécessité de sa sécheresse et de ses
excès pédants, ils se refusent à ses jeux gymnastiques auxquels
donnent tant d’importance de milliers d’Européens, et ils ne croient
pas qu’il faille humblement végéter de longues années sur ces
mystères sacro-saints. »
Ainsi parlait Stassov de la musique classique de
l’Europe occidentale. En ce qui concerne la musique bourgeoise
contemporaine, qui se trouve en pleine décadence et dégradation,
il n’y a rien à tirer d’elle. A plus forte raison sont absurdes et
ridicules les manifestations de servilité devant une telle musique.
Si l’on étudie l’histoire de notre musique russe,
puis soviétique, on en vient à la conclusion qu’elle a poussé,
s’est développée et est devenue une force puissante justement parce
qu’elle a réussi à tenir sur ses propres pieds et à trouver ses
propres voies de développement, qui lui ont donné la possibilité
de mettre à nu la richesse du monde intérieur de notre peuple.
Ceux-là se trompent profondément qui pensent que
l’épanouissement de la musique nationale russe, aussi bien que
celles des autres peuples soviétiques, signifie un affaiblissement
de l’internationalisme dans l’art.
Celui-ci ne naît pas sur la base d’un
affaiblissement et d’un appauvrissement de l’art national. Au
contraire, l’internationalisme naît là où s’épanouit l’art
national. Oublier cette vérité, cela signifie perdre la ligne
directrice, perdre son visage, devenir des cosmopolites sans
attaches. Seul peut apprécier la richesse musicale d’autres peuples
le peuple qui possède une culture musicale hautement développée.
On ne peut pas être un internationaliste en
musique, comme en toute autre chose, sans être un véritable
patriote de sa patrie. Si à la base de l’internationalisme il y a le
respect des autres peuples, on ne peut pas être un internationaliste
sans respecter et sans aimer son propre peuple.
Cela, toute l’expérience de l’U.R.S.S. le prouve.
Par conséquent l’internationalisme en musique, le respect de l’œuvre
des autres peuples, se développent sur la base de l’enrichissement
et du développement de l’art musical national, sur la base d’un
épanouissement tel qu’il ait quelque chose à faire partager aux
autres peuples, et non sur la base d’un appauvrissement de
l’art national, d’une imitation aveugle de modèles étrangers,
et de l’effacement des particularités du caractère national en
musique. Rien de tout cela ne doit être oublié lorsqu’on parle des
rapports de la musique soviétique et de la musique étrangère.
Continuons. Quand on dit que la tendance
formaliste s’écarte des principes de l’héritage classique, on ne
peut pas ne pas parler de l’affaiblissement du rôle de la musique
descriptive. On en a déjà parlé ici, mais l’essence du
principe de cette question n’a pas été convenablement tirée au
clair. Il est parfaitement évident que la musique descriptive tient
moins de place ou n’en tient presque plus du tout.
Les choses en sont venues à ce point qu’on est
obligé d’expliquer le contenu d’une œuvre musicale nouvelle même
après qu’elle a été jouée. Il s’est formé toute une nouvelle
profession, celle des commentateurs recrutés par les amis
qui s’efforcent d’après leurs conjectures personnelles de déchiffrer
après coup, le contenu des œuvres musicales déjà jouées, dont le
sens obscur, à ce qu’on dit, n’est pas tout à fait clair, même à
leurs auteurs.
Oublier la musique à programme, c’est aussi
s’écarter des traditions progressives. On sait que la musique
classique russe était, en règle générale, à programme.
On a parlé ici de la volonté d’innover. On a dit
que cette volonté d’innover n’était pas loin d’être le trait
distinctif principal de la tendance formaliste ; mais la volonté
d’innover n’est pas une fin en soi ; le nouveau doit être
meilleur que l’ancien autrement il n’a pas de raison d’être. Il me
semble que les tenants de la tendance formaliste utilisent
principalement ce petit mot d’innovation aux fins de propagande
de la mauvaise musique.
On ne peut pourtant qualifier d’innovation toutes
les originalités, toutes les grimaces et toutes les cabrioles en
musique. Si l’on ne veut pas se contenter de lancer des mots sonores,
il faut se représenter nettement de quel ancien il faut essayer de
s’éloigner et vers quel nouveau il faut tendre. Si l’on ne fait pas
cela, alors les phrases sur l’innovation en musique ne vont signifier
qu’une chose : révision des fondements de la musique.
Cela ne peut signifier que le rejet de lois et de
normes dont on ne peut s’écarter. Et qu’on ne puisse s’en écarter,
ce n’est pas là du conservatisme ; et si l’on s’en écarte, ce n’est
point faire œuvre de novateur. L’innovation ne coïncide pas
toujours avec le progrès.
On tourne la tête à beaucoup de jeunes musiciens
avec l’esprit d’innovation comme avec un épouvantail en leur disant
que s’ils ne sont pas originaux, nouveaux, cela signifie qu’ils
sont prisonniers des traditions conservatrices. Mais pour autant
qu’innovation n’est pas synonyme de progrès, la diffusion de telles
opinions représente une profonde illusion sinon une tromperie.
Or, « l’innovation » des formalistes n’est même
pas nouvelle, car ce nouveau sent la musique bourgeoise décadente de
l’Europe et de l’Amérique contemporaines. Voilà où il faut
dénoncer les véritables épigones !
Il fut un temps où dans les écoles primaires et
secondaires, comme vous vous le rappelez, on s’était engoué de la
méthode des « brigades laboratoires » et par le « plan Dalton »,
selon lesquels le rôle du maître à l’école était réduit au
minimum, tandis que chaque élève avait le droit, au commencement de
la leçon, de fixer le programme de la classe.
Le maître, en arrivant pour sa leçon, demandait
aux élèves : « Qu’est-ce que nous allons faire aujourd’hui ?
» Les élèves répondaient : « Parlez-nous de l’Arctique,
parlez-nous de l’Atlantique, parlez-nous de Tchapaïev, parlez-nous
du Dnieprostroï ».
Le maître devait se plier à toutes ces
exigences. Cela s’appelait la méthode des « brigades laboratoires
». En fait, cela signifiait que toute l’organisation de
l’enseignement était mise sens dessus dessous, puisque les élèves
étaient dirigeants et le maître dirigé. Il y avait eu autrefois
des (manuels poussiéreux, le système de notation sur 5 avait
disparu. Tout cela c’était des nouveautés, mais je vous le demande
ces nouveautés étaient-elles progressives ?
Le Parti, comme on sait, a supprimé ces «
nouveautés ». Pourquoi ? Parce que ces « nouveautés » très « à
gauche » dans la forme, étaient en fait parfaitement réactionnaires
et conduisaient à la liquidation de l’école.
Autre exemple : il n’y a pas si longtemps, a été
organisée une Académie des Beaux-Arts. La peinture, c’est votre
sœur, une des muses. En peinture, comme vous le savez, les
influences bourgeoises furent fortes à un moment donné; elles
se manifestaient sans discontinuer sous le drapeau le plus « à
gauche », se collaient les étiquettes de futurisme, de cubisme, de
modernisme ; « on renversait » « l’académisme pourri », on
préconisait l’innovation. Cette innovation s’exprimait dans des
histoires de fous : on dessinait par exemple une femme à une tête
sur quarante jambes, un œil regardant par ici et l’autre au diable.
Comment tout cela s’est-il terminé ? Par un krach
complet de « la nouvelle tendance ». Le Parti a pleinement rendu
son importance à l’héritage classique de Repine, de Briullov, de
Verechtchaguine, de Vasnetsov, de Sourikov. Avons-nous bien fait de
maintenir les trésors de la peinture classique et de mettre en
déroute les liquidateurs de la peinture ?
Est-ce que la survivance de telles « écoles »
n’aurait pas signifié la liquidation de la peinture ? Hé quoi, en
défendant la tradition classique en peinture, le Comité central
s’est-il conduit en «conservateur», s’est-il trouvé sous
l’influence du « traditionalisme », de 1′ « épigonisme », etc.,
etc… ? Tout cela ne tient pas debout.
Il en est de même en musique. Nous n’affirmons
pas que l’héritage classique est le sommet absolu de la culture
musicale.
Si nous parlions ainsi, cela voudrait dire que
nous reconnaissons que le progrès s’est achevé avec les classiques.
Mais jusqu’à présent les modèles classiques restent
insurpassés. Cela veut dire qu’il faut étudier et étudier
encore, prendre de l’héritage classique tout ce meilleur dont nous
avons besoin pour le développement ultérieur de la musique
soviétique.
On parle d’épigonisme et autres balivernes, et
avec ces mots-là on effraie la jeunesse pour la détourner
d’apprendre auprès des classiques. On lance pour mot d’ordre qu’il
faut dépasser les classiques. C’est évidemment excellent. Mais
pour les dépasser il faut commencer par les rattraper, et c’est un
stade que vous négligez comme si c’était déjà une étape
dépassée.
Mais pour parler sincèrement et exprimer la
pensée du spectateur et de l’auditeur soviétiques, ce ne serait pas
mal du tout si l’on voyait paraître chez nous un peu plus d’oeuvres
ressemblant aux classiques par le contenu et la forme, par
l’élégance, la beauté et la musicalité. Si c’est là de l’ «
épigonisme », eh bien, ma foi, il n’y a pas de honte à être un
tel épigone !
Un mot des déviations naturalistes. Il est apparu
ici qu’on s’écartait de plus en plus des normes naturelles et saines
de la musique. On fait de plus en plus de place dans notre musique
à des éléments de grossier naturalisme. Or voici comment il y
a quatre-vingt-dix ans Serov prévenait ses contemporains contre
l’attrait d’un naturalisme grossier :
« Dans la nature il y a une infinité de sons
différents de nature et de qualité, mais tous ces sons qui en
certains cas s’appellent bruit, roulement, fracas, craquement,
clapotement, grondement, bourdonnement, tintement, hurlement,
grincement, sifflement, parole, chuchotement, bruissement,
grésillement, murmure, etc., etc… et en d’autres circonstances ne
peuvent s’exprimer par le langage, tous ces bruits ou bien n’entrent
pas du tout dans la composition de la langue musicale, ou n’y entrent
qu’à titre d’exception (sons de cloches, de cymbales, de triangle,
bruits de tambour, de tambourin, etc…)
« La matière proprement musicale c’est un son
d’une qualité particulière. »
N’est-il pas vrai, n’est-il pas juste que le son
des cymbales ou le bruit du tambour doit être l’exception et non la
règle dans une œuvre musicale ?
N’est-il pas clair que tout bruit naturel ne doit
pas être transporté dans une œuvre musicale ? Or combien y a-t-il
chez nous d’engouement insolent pour un naturalisme vulgaire
qui représente indiscutablement un pas en arrière !
Il faut dire carrément que toute une série
d’œuvres contemporaines sont à ce point surchargées de bruits
naturalistes qu’elles rappellent, pardonnez l’inélégance de
l’expression, soit la fraise de dentiste, soit une périssoire
musicale. Simplement ce sont les forces qui manquent,
prêtez-y attention !
C’est ici qu’on commence à sortir des limites du
rationnel, des limites non seulement des émotions humaines normales,
mais aussi de la raison de l’homme normal. Il y a, il est
vrai, aujourd’hui des « théories » à la mode qui prétendent
que l’état pathologique est une forme supérieure de l’humanité et
que les schizophréniques et les paranoïaques dans leur délire
peuvent atteindre à des hauteurs spirituelles où n’atteindra
jamais un homme ordinaire dans son état normal.
Ces « théories » ne sont évidemment pas
accidentelles, elles sont très caractéristiques de l’époque de
pourriture et de décomposition de la culture bourgeoise. Mais
laissons toutes ces « recherches » aux fous, exigeons de nos
compositeurs une musique normale, humaine.
Quel a été le résultat de l’oubli des lois et
des normes de la création musicale ? La musique s’est vengée des
efforts faits pour la dénaturer. Quand la musique perd tout contenu,
toute qualité artistique, quand elle devient inélégante, laide,
vulgaire, elle cesse de satisfaire les besoins pour lesquels elle
existe, elle cesse d’être elle-même.
Vous vous étonnez peut-être qu’au Comité
central du Parti bolchevik on exige de la musique beauté et
élégance. Qu’est-ce qui se passe encore ? Eh bien, non, ce n’est
pas un lapsus, nous déclarons que nous sommes pour une musique belle
et élégante, une musique capable de satisfaire les besoins
esthétiques et les goûts artistiques des Soviétiques, et ces
besoins et ces goûts ont grandi incroyablement.
Le peuple apprécie le talent d’une œuvre
musicale dans la mesure où elle reflète profondément l’esprit de
notre époque, l’esprit de notre peuple, dans la mesure où elle est
accessible aux larges masses. Qu’est-ce donc qui est génial en
musique ?
Ce n’est pas du tout ce que ne peuvent apprécier
qu’un individu ou un petit groupe d’esthètes raffinés ; une œuvre
musicale est d’autant plus géniale que le contenu en est plus riche
et plus profond, que la maîtrise en est plus élevée, qu’est plus
grand le nombre de ceux qui la reconnaissent, le nombre de ceux
qu’elle est capable d’inspirer.
Tout ce qui est accessible n’est pas génial, mais
tout ce qui est vraiment génial est accessible, et d’autant plus
génial que plus accessible aux larges masses du peuple.
A. N. Serov avait profondément raison lorsqu’il
disait : « Contre la beauté vraie en art le temps est impuissant,
autrement on n’aimerait plus ni Homère, Dante ou Shakespeare, ni
Raphaël, Le Titien ou Poussin, ni Palestrina, Haendel, ou Glück ».
Une œuvre musicale est d’autant plus haute
qu’elle fait entrer en résonance plus de cordes de l’âme humaine.
L’homme du point de vue de sa perception musicale est une
membrane merveilleusement riche, un récepteur travaillant sur
des milliers d’ondes – on peut, sans doute, choisir une
meilleure comparaison – et pour l’émouvoir il ne suffît pas
d’une seule note, d’une seule corde, d’une seule émotion.
Si un compositeur n’est capable de faire vibrer
qu’une ou que quelques-unes des cordes humaines, cela ne suffit pas,
car l’homme moderne et surtout le nôtre, l’homme soviétique,
se présente aujourd’hui comme un organisme perceptif
extrêmement complexe. Si Glinka, Tchaïkovsky, Serov, ont parlé du
haut développement du sens musical dans le peuple russe, au temps où
ils s’exprimaient ainsi le peuple russe n’avait pas encore une large
idée de la musique classique.
Sous le pouvoir soviétique, la culture musicale
des peuples s’est extraordinairement développée ; si déjà
auparavant notre peuple se distinguait par son sens musical,
aujourd’hui son goût artistique s’est enrichi en raison de la
diffusion de la musique classique.
Si vous avez laissé s’appauvrir la musique, si,
comme il est arrivé dans l’opéra de Mouradéli, ne sont utilisées
ni les possibilités de l’orchestre ni les aptitudes des
chanteurs, alors vous avez cessé de satisfaire les besoins musicaux
de vos auditeurs. Et l’on récolte ce qu’on a semé. Les compositeurs
dont les œuvres sont incompréhensibles au peuple ne doivent pas
s’attendre à ce que le peuple, qui n’a pas compris leur musique, «
s’élève » jusqu’à eux.
La musique qui est inintelligible au peuple, lui
est inutile. Les compositeurs doivent s’en prendre, non au peuple
mais à eux-mêmes, ils doivent faire la critique de leur propre
travail, comprendre pourquoi ils n’ont pas satisfait leur peuple,
pourquoi ils n’ont pas mérité son approbation, et ce qu’ils doivent
faire pour qu’il les comprenne et approuve leurs œuvres.
Voilà en quel sens il faut réformer votre
travail. En outre, vous courez le risque de perdre la maîtrise de
votre profession musicale. Si les déviations formalistes
appauvrissent la musique, elles comportent encore un autre danger :
c’est de ruiner la maîtrise du métier.
A ce propos, il me faut m’attarder sur une erreur
très répandue, selon laquelle la musique classique serait plus
simple et la musique moderne plus complexe, la complication de la
technique contemporaine étant considérée comme un pas en avant,
étant donné que tout développement va du simple au complexe et du
particulier en général. Il n’est pas vrai que toute complication
signifie maîtrise plus grande. Non, pas n’importe laquelle. C’est
une profonde erreur que de prendre toute complication pour un
progrès.
J’en donnerai un exemple : on sait que la langue
littéraire russe utilise un grand nombre de mots étrangers, on sait
comme Lénine se moquait de l’emploi abusif de tels termes, et
comme il combattit pour épurer la langue nationale des emprunts
qui rengorgeait. La complication de la langue par l’introduction d’un
mot étranger, là où il y a la possibilité d’employer un mot
russe, n’a jamais passé pour un progrès linguistique.
Par exemple le mot étranger « losung » (mot
d’ordre) est remplacé aujourd’hui par le mot russe correspondant [en
russe prlzy]; est ce que cela ne constitue pas un pas en avant ? Il
en est de même en musique.
Sous le masque d’une complication purement
extérieure des procédés de composition, se cache une tendance à
l’appauvrissement de la musique. La langue musicale
devient inexpressive.
On y introduit tant d’éléments grossiers,
vulgaires, faux, qu’elle cesse de répondre à sa destination :
procurer une jouissance. La signification esthétique de la musique
doit-elle donc être abolie ? Est-ce en cela, dites-moi, que
consiste l’innovation ? Ou bien la musique devient-elle une
conversation du compositeur avec lui-même ?
Mais alors pourquoi l’imposer au peuple? Cette
musique devient antipopulaire, étroitement individualiste et le
peuple a le droit de devenir, et devient en effet, indifférent à
son destin. Si l’on exige de l’auditeur qu’il loue une musique
grossière, inélégante, vulgaire, fondée sur des atonalités, sur
des dissonances continuelles, lorsque les consonances deviennent
un cas particulier et les fausses notes et leur combinaison la règle,
c’est qu’on s’est écarté des normes fondamentales de la musique.
Tout cela pris ensemble, menace la musique de
liquidation, tout comme le cubisme et le futurisme en peinture ne
représentent pas autre chose qu’une menace de destruction de la
peinture. Une musique qui volontairement ignore les émotions
humaines normales et ébranle le psychisme et le système nerveux, ne
peut être populaire, ne peut être au service de la société.
On a parlé ici d’un engouement unilatéral pour
la musique symphonique instrumentale sans texte, cet oubli de la
diversité des genres musicaux n’est pas juste. A quoi il conduit, on
peut en juger par l’opéra de Mouradéli. Vous vous rappelez comme
les grands maîtres de l’art variaient généreusement les genres.
Ils comprenaient que le peuple demande la
diversité. Pourquoi êtes-vous si différents de vos grands ancêtres
? Vous êtes autrement insensibles qu’eux qui, occupant les cimes de
l’art, écrivaient pour le peuple soli, chœurs et musique
d’orchestre.
Parlons de la disparition de la mélodie dans la
musique. La musique contemporaine est caractérisée par l’amour
unilatéral du rythme aux dépens de la mélodie. Mais nous savons
que la musique ne donne de plaisir que lorsque tous ses éléments –
la mélodie, le chant, le rythme – se trouvent
dans une certaine union harmonieuse.
L’attention unilatérale accordée à l’un
d’eux aux dépens d’un autre aboutit à détruire l’interaction
correcte des divers éléments de la musique, ce qui ne peut
évidemment être accepté par une oreille humaine normale.
On se laisse aller aussi à utiliser les
instruments en dehors de leur destination propre ; le piano par
exemple se change en instrument de batterie. On réduit le rôle de
la musique vocale au bénéfice d’un développement unilatéral de la
musique instrumentale. La musique vocale elle-même tient de moins en
moins compte des normes de l’art vocal.
Pareils écarts par rapport aux normes de l’art
musical signifient la violation, non seulement des bases
fonctionnelles normales du son musical, mais encore des bases
physiologiques de l’oreille humaine normale. On n’a malheureusement
pas encore assez fouillé chez nous le domaine de la théorie qui
traite de l’influence physiologique de la musique sur l’organisme
humain.
Et pourtant il faut admettre qu’une musique
mauvaise, disharmonique, lèse sans aucun doute l’activité
psycho-physiologique régulière de l’homme.
Conclusions. Il faut rétablir pleinement
l’importance de l’héritage classique, il faut rétablir une musique
humaine normale.
Il faut souligner le danger de liquidation que
fait courir à la musique l’orientation formaliste et condamner cette
tendance comme une tentative à la Erostrate pour détruire le temple
de l’art bâti par les grands maîtres de la culture musicale.
Il faut que tous nos compositeurs se transforment et se tournent face
à notre peuple. Il faut que tous se rendent compte que notre Parti,
qui exprime les intérêts de notre Etat, de notre peuple, ne
soutiendra que la tendance saine, progressive de la musique, celle du
réalisme socialiste soviétique.
Camarades ! Si la haute dignité de compositeur
soviétique vous est chère, vous devez montrer que vous êtes
capables de mieux servir votre peuple que vous ne l’avez fait
jusqu’ici. Un sérieux examen vous attend. La tendance formaliste en
musique a été condamnée par le Parti il y a déjà 12 ans.
Pendant cette période le gouvernement a
récompensé de prix Staline nombre d’entre vous, y compris certains
qui avaient péché par formalisme. Ces récompenses c’était une
avance.
Nous n’estimions pas pour autant que vos œuvres
étaient exemptes de fautes, mais nous patientions, attendant que nos
compositeurs trouvent en eux-mêmes la force de choisir la vraie
route.
Mais maintenant chacun voit que l’intervention du
Parti était nécessaire. Le C.C. vous déclare sans ambages que sur
la voie choisie par vous notre musique ne s’illustrera pas.
Les compositeurs soviétiques ont deux tâches
responsables au plus haut degré. La principale, c’est de développer
et de parfaire la musique soviétique. L’autre consiste à défendre
la musique soviétique contre l’intrusion des éléments de la
décadence bourgeoise.
Il ne faut pas oublier que l’U.R.S.S. est
actuellement l’authentique dépositaire de la culture musicale
universelle, de même que dans tous les autres domaines elle est le
rempart de la civilisation et de la culture humaine contre la
décadence bourgeoise et la décomposition de la culture.
Il faut s’attendre à ce qu’aux influences
bourgeoises venues d’au delà de nos frontières fassent écho des
survivances du capitalisme dans la conscience de quelques
représentants de l’intelligentsia soviétique, chez qui elles
se traduisent par des efforts d’une folle légèreté pour troquer
les trésors de la musique soviétique contre les misérables
haillons de l’art bourgeois contemporain.
Aussi n’est-ce pas seulement l’oreille musicale,
mais aussi l’oreille politique des compositeurs soviétiques qui doit
être plus sensible.
Vos liens avec le peuple doivent être plus
étroits que jamais. Vous devez tendre à la critique une oreille
très attentive. Vous devez suivre les processus qui se développent
dans l’art de l’Occident.
Mais votre tâche ne consiste pas seulement à
empêcher la pénétration des influences bourgeoises dans la musique
soviétique. Votre tâche consiste à confirmer la supériorité de
la musique soviétique, à créer une puissante musique
soviétique qui incorpore ce qu’il y a de meilleur dans le passé de
la musique, qui reflète la société soviétique d’aujourd’hui et
puisse élever plus haut encore la culture de notre peuple et sa
conscience communiste.
Nous, bolcheviks, nous ne rejetons pas l’héritage
culturel. Au contraire nous assimilons avec esprit critique
l’héritage culturel de tous les peuples, de toutes les époques,
pour en saisir tout ce qui peut inspirer aux travailleurs de la
société soviétique de grandes actions dans le domaine du travail,
de la science et de la culture. Vous devez aider le peuple en cela :
si vous ne proposez pas cette tâche, si vous ne vous y donnez pas
tout entiers, avec toute votre ardeur et votre enthousiasme
créateurs, alors vous ne remplirez pas votre rôle historique.
Camarades! nous voulons, nous souhaitons
passionnément que nous ayons nous aussi nos « Grands Cinq », que
nos musiciens soient plus nombreux et plus forts que ceux qui ont
jadis étonné le monde par leur talent et fait honneur à notre
peuple. Pour être forts il faut que vous rejetiez loin de votre
route tout ce qui peut vous affaiblir et que vous choisissiez les
seules armes qui vous aideront à être forts et puissants.
Si vous utilisez à fond l’héritage de la géniale
musique classique, et si en même temps vous le développez dans
l’esprit des exigences nouvelles de notre grande époque, vous serez
les « Grands Cinq » soviétiques.
Nous voulons que le retard dont vous souffrez soit dominé aussi rapidement que possible, que vous vous réformiez et vous transformiez en glorieuse cohorte des compositeurs soviétiques, fierté de tout le peuple soviétique.
=>Retour au dossier sur le réalisme socialiste