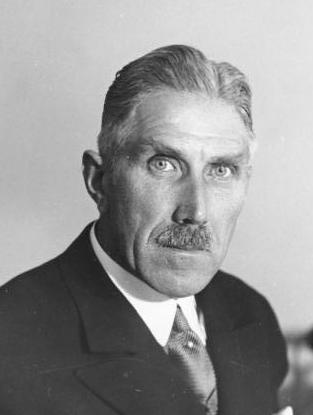1. Le prolétariat industriel des villes, dirigé par le Parti communiste, peut seul libérer les masses laborieuses des campagnes du joug des capitalistes et des propriétaires fonciers, de la désorganisation économique et des guerres impérialistes, qui recommenceront inévitablement si le régime capitaliste subsiste. Les masses laborieuses des campagnes ne pourront être libérées qu’à condition de prendre fait et cause pour le prolétariat communiste et de l’aider sans réserve dans sa lutte révolutionnaire pour le renversement du régime d’oppression des grands propriétaires fonciers et de la bourgeoisie.
D’un autre côté, le prolétariat industriel ne pourra s’acquitter de sa mission historique mondiale, qui est l’émancipation de l’humanité du joug du capitalisme et des guerres, s’il se renferme dans les limites de ses intérêts particuliers et corporatifs et se borne placidement aux démarches et aux efforts tendant à l’amélioration de sa situation bourgeoise parfois très satisfaisante. C’est ainsi que se passent les choses dans nombre des pays avancés où existe une « aristocratie ouvrière », fondement des partis soi-disant socialistes de la 2e Internationale, mais en réalité ennemis mortels du socialisme, traîtres envers sa doctrine, bourgeois chauvins et agents des capitalistes parmi les travailleurs. Le prolétariat ne pourra jamais être une force révolutionnaire active, une classe agissant dans l’intérêt du socialisme, s’il ne se conduit pas comme une avant-garde du peuple laborieux que l’on exploite, s’il ne se comporte pas comme le chef de guerre à qui incombe la mission de le conduire à l’assaut des exploiteurs ; mais jamais cet assaut ne réussira si les campagnes ne participent à la lutte des classes, si la masse des paysans laborieux ne se joint pas au parti communiste prolétarien des villes et si, enfin, ce dernier ne l’instruit pas.
2. La masse des paysans laborieux que l’on exploite et que le prolétariat des villes doit conduire au combat, ou, tout au moins, gagner à sa cause, est représentée, dans tous les pays capitalistes, par :
1°) Le prolétariat agricole composé de journaliers ou valets de ferme, embauchés à l’année, à terme ou à la journée, et qui gagnent leur vie par leur travail salarié dans les diverses entreprises capitalistes d’économie rurale et industrielle. L’organisation de ce prolétariat en une catégorie distincte et indépendante des autres groupes de la population des campagnes (au point de vue politique, militaire, professionnel, coopératif, etc…), une propagande intense dans ce milieu, destinée à l’amener au pouvoir soviétique et à la dictature du prolétariat, telle est la tâche fondamentale des partis communistes dans tous les pays ;
2°) Les demi-prolétaires ou les paysans, travaillant en qualité d’ouvriers embauchés, dans diverses entreprises agricoles, industrielles ou capitalistes, ou cultivant le lopin de terre qu’ils possèdent ou louent et qui ne leur rapporte que le minimum nécessaire pour assurer l’existence de leur famille. Cette catégorie de travailleurs ruraux est très nombreuse dans les pays capitalistes ; les représentants de la bourgeoisie et les « socialistes » jaunes de la 2e Internationale, cherchent à dissimuler ses conditions d’existence véritables, particulièrement la situation économique ; tantôt en trompant sciemment les ouvriers, tantôt par suite de leur propre aveuglement, qui provient des idées routinières de la bourgeoisie ; ils confondent volontiers ce groupe avec la grande masse des « paysans ». Cette manœuvre, foncièrement bourgeoise, en vue de duper les ouvriers, est surtout pratiquée en Allemagne, en France, en Amérique, et dans quelques autres pays. En organisant bien le travail du Parti communiste, ce groupe social pourra devenir un fidèle soutien du communisme, car la situation de ces demi-prolétaires est très précaire et l’adhésion leur vaudra des avantages énormes et immédiats.
Dans certains pays, il n’existe pas de distinction claire entre ces deux premiers groupes ; il serait donc loisible, suivant les circonstances, de leur donner une organisation commune ;
3°) Les petits propriétaires, les petits fermiers qui possèdent ou louent de petits lopins de terre et peuvent satisfaire aux besoins de leur ménage et de leur famille sans embaucher des travailleurs salariés. Cette catégorie de ruraux a beaucoup à gagner à la victoire du prolétariat ; le triomphe de la classe ouvrière donne aussitôt à chaque représentant de ce groupe les biens et les avantages qui suivent :
a) Non-paiement du prix du bail et abolition du métayage (il en serait ainsi en France, en Italie, etc…) payés jusqu’à présent aux grands propriétaires fonciers ;
b) Abolition des dettes hypothécaires ;
c) Émancipation de l’oppression économique exercée par les grands propriétaires fonciers, laquelle se présente sous les aspects les plus divers (droit d’usage des bois et forêts, de friches, etc…) ;
d) Secours agricole spécial et financier immédiat du pouvoir prolétarien, notamment secours en outillage agricole ; octroi de constructions se trouvant sur le territoire de vastes domaines capitalistes expropriés par le prolétariat, transformation immédiate par le gouvernement prolétarien de toutes les coopératives rurales et des compagnies agricoles, qui n’étaient avantageuses sous le régime capitaliste qu’aux paysans riches et aisés, en organisations économiques ayant pour but de secourir, en premier lieu, la population pauvre, c’est-à-dire les prolétaires, les demi-prolétaires et les paysans pauvres.
Le Parti communiste doit aussi comprendre que pendant la période de transition du capitalisme au communisme, c’est-à-dire pendant la dictature du prolétariat, cette catégorie de la population rurale manifestera des hésitations plus ou moins sensibles et un certain penchant à la liberté du commerce et à la propriété privée ; car, nombre de ceux qui la composent faisant, au moins dans une petite mesure, le commerce des articles de première nécessité, sont déjà démoralisés par la spéculation et par leurs habitudes de propriété. Si, cependant, le gouvernement prolétarien réalise, dans cette question, une politique ferme et inexorable, et si le prolétariat vainqueur écrase sans merci les gros propriétaires fonciers et les paysans aisés, ces hésitations ne sauront être de longue durée et ne pourront modifier ce fait indubitable qu’en fin de compte le groupe dont il s’agit sympathise avec la révolution prolétarienne.
3. Ces trois catégories de la population rurale, prises ensemble, forment, dans tous les pays capitalistes, la majorité de la population. Le succès d’un coup d’État prolétarien, tant dans les villes que dans les villages, peut donc être considéré comme indiscutable et certain. L’opinion opposée est cependant très en faveur dans la société actuelle. En voici les raisons : elle ne se maintient qu’à force d’agissements trompeurs de la science : de la statistique bourgeoise qui cherche à voiler par tous les moyens en son pouvoir l’insondable abîme qui sépare ces classes rurales de leurs exploiteurs, les propriétaires fonciers et les capitalistes, ainsi que les demi-prolétaires et les paysans pauvres des paysans aisés ; cette opinion persiste grâce à la maladresse des héros de la 2e Internationale Jaune et de « l’aristocratie ouvrière » dépravée par les privilèges impérialistes, et à la mauvaise volonté qu’ils mettent à faire, parmi les paysans pauvres, une propagande prolétarienne et révolutionnaire vigoureuse et un bon travail d’organisation ; les opportunistes employaient et emploient toujours leurs efforts à imaginer diverses variétés d’accord pratiques et théoriques avec la bourgeoisie, y compris les paysans riches et aisés, et ne pensent nullement au renversement révolutionnaire du gouvernement bourgeois et de la bourgeoisie elle-même ; enfin, l’opinion dont il s’agit se maintient jusqu’ici grâce à un préjuge opiniâtre et, pour ainsi dire, inébranlable, parce qu’il se trouve étroitement uni à tous les autres préjugés du parlementarisme et de la bourgeoisie démocratique ; ce préjugé consiste dans la non-compréhension d’une vérité parfaitement démontrée par le marxisme théorique et suffisamment prouvée par l’expérience de la révolution prolétarienne russe ; cette vérité est que les trois catégories de la population rurale dont nous avons parlé, abruties, désunies, opprimées et vouées, dans les pays même les plus civilisés, à une existence demi-barbare, ont, par conséquent, un intérêt économique, social et intellectuel à la victoire du socialisme, mais ne peuvent néanmoins appuyer vigoureusement le prolétariat révolutionnaire qu’après la conquête du pouvoir politique, lorsqu’il aura fait justice des gros propriétaires fonciers et capitalistes mettant ainsi les masses rurales dans l’obligation de constater qu’elles ont, en lui, un chef et un défenseur organisé, assez puissant pour les diriger et leur montrer la bonne voie.
4. Les « paysans moyens » sont au point de vue économique de petits propriétaires ruraux qui possèdent ou prennent à terme, eux aussi, des lopins de terre peu considérables sans doute, mais leur permettant quand même, sous le régime capitaliste, non seulement de nourrir leur famille et d’entretenir en bon état leur petite propriété rurale, mais de réaliser encore un excédent de bénéfices, pouvant, tout au moins dans les années de bonne récolte, être transformé en économies relativement importantes ; ces paysans embauchent assez souvent des ouvriers (par exemple, deux ou trois ouvriers par entreprises) dont ils ont besoin pour toutes sortes de travaux. On pourrait citer ici l’exemple concret de « paysans moyens » d’un pays capitaliste avancé : ceux de l’Allemagne. Il y avait, en Allemagne, d’après le recensement de 1907, une catégorie de propriétaires ruraux possédant chacun de cinq à dix hectares, dans les propriétés desquels le nombre des ouvriers embauchés s’élevait presque au tiers du chiffre total des travailleurs des champs.
[Note : voici quelques chiffres exacts : Allemagne : propriétés rurales de 5 à 10 hectares, employant des ouvriers embauchés : 652 798 (sur 5 736 082), ouvriers salariés : 487 764, ouvriers mariés : 2 003 633. Autriche (recensement de 1910) : 383 351 propriétés rurales, dont 126.136 employant des travailleurs embauchés, ouvriers salariés : 146 044, ouvriers mariés : 1 265 969. Le nombre total des fermes en Autriche s’élève à 2 856 349.]
En France, où les cultures spéciales, comme la viticulture, sont plus développées, et où la terre demande beaucoup plus d’effort et de soins, les propriétés rurales de cette catégorie emploient probablement un nombre plus important de travailleurs salariés.
Pour son avenir le plus rapproché et pour toute la première période de sa dictature, le prolétariat révolutionnaire ne peut pas se donner comme tâche la conquête politique de cette catégorie rurale et doit se borner à sa neutralisation, dans la lutte qui se livre entre le prolétariat et la bourgeoisie. Le penchant de cette couche de la population tantôt vers un parti politique, tantôt vers un autre, est inévitable et, probablement, sera-t-il au commencement de la nouvelle époque et dans les pays foncièrement capitalistes, favorable à la bourgeoisie. Tendance d’ailleurs fort naturelle, l’esprit de propriété privée jouant chez elle un rôle prépondérant. Le prolétariat vainqueur améliorera immédiatement la situation économique de cette couche de la population en supprimant le système du bail, les dettes hypothécaires et en introduisant dans l’agriculture l’usage des machines et l’emploi de l’électricité. Cependant, dans la plupart des pays capitalistes, le pouvoir prolétarien ne devra pas abolir sur le champ et complètement le droit de propriété privée, mais il devra affranchir cette classe de toutes les obligations et impositions auxquelles elle est sujette de la part des propriétaires fonciers ; le pouvoir soviétique assurera aux paysans pauvres et d’aisance moyenne la possession de leurs terres, dont il cherchera même à augmenter la superficie, en mettant les paysans en possession de terres qu’ils affermaient autrefois (abolition du fermage).
Toutes ces mesures, suivies d’une lutte sans merci contre la bourgeoisie, assurera le succès complet de la politique de neutralisation. C’est avec la plus grande circonspection que le pouvoir prolétarien doit passer à l’agriculture collectiviste, progressivement, à force d’exemples, et sans la moindre mesure de coercition à l’égard des paysans « moyens ».
5. Les paysans riches et aisés sont les entrepreneurs capitalistes de l’agriculture ; ils cultivent habituellement leurs terres avec le concours des travailleurs salariés et ne sont rattachés à la classe paysanne que par leur développement intellectuel très restreint, par leur vie rustique et par le travail personnel qu’ils font en commun avec les ouvriers qu’ils embauchent. Cette couche de la population rurale est très nombreuse et représente en même temps l’adversaire le plus invétéré du prolétariat révolutionnaire. Aussi, tout le travail politique des partis communistes dans les campagnes doit-il se concentrer dans la lutte contre cet élément, pour émanciper la majorité de la population rurale laborieuse et exploitée, de l’influence morale et politique, si pernicieuse, de ces exploiteurs ruraux.
Il est bien possible que, dès la victoire du prolétariat dans les villes, ces éléments aient recours à des actes de sabotage et même à des prises d’armes, manifestement contre-révolutionnaires. Aussi, le prolétariat révolutionnaire devra-t-il commencer sur-le-champ la préparation intellectuelle et organisatrice de toutes les forces dont il aura besoin pour les désarmer et pour leur porter, tandis qu’il renversera le régime capitaliste et industriel, le coup de grâce. À cet effet, le prolétariat révolutionnaire des villes devra armer ses alliés ruraux et organiser, dans tous les villages des soviets où nul exploiteur ne sera admis et où les prolétaires et les demi-prolétaires seront appelés à jouer le rôle prépondérant. Même dans ce cas cependant, la tâche immédiate du prolétariat vainqueur ne devra pas comporter l’expropriation des grandes propriétés paysannes, parce que à ce moment même les conditions matérielles et, en partie, techniques et sociales, nécessaires à la socialisation des grandes propriétés, ne seront pas encore réalisées. Tout porte à croire que, dans certains cas isolés, des terres affermées ou strictement nécessaires aux paysans pauvres du voisinage seront confisquées ; on accordera également à ces derniers, l’usage gratuit, à certaines conditions toutefois, d’une partie de l’outillage agricole des propriétaires ruraux riches ou aisés. Mais, en règle générale, le pouvoir prolétarien devra laisser leurs terres aux paysans riches et aisés et ne s’en emparer que dans le cas d’une opposition manifeste à la politique et aux prescriptions du pouvoir des travailleurs. Cette ligne de conduite est nécessaire, l’expérience de la révolution prolétarienne russe, où la lutte contre les paysans riches et aisés traîne en longueur dans des conditions très complexes, ayant démontré que ces éléments de la population rurale, douloureusement frappés pour toutes leurs tentatives de résistance, même les moindres, sont pourtant capables de s’acquitter loyalement des travaux que leur confie l’État prolétarien et commencent même, quoique très lentement, à se pénétrer de respect envers le pouvoir qui défend tout travailleur et écrase impitoyablement le riche oisif.
Les conditions spéciales qui ont compliqué et retardé la lutte du prolétariat russe, vainqueur de la bourgeoisie, contre les paysans riches, dérivaient uniquement du fait qu’après l’événement du 25 octobre 1917, la révolution russe avait traversé une phase « démocratique » — c’est-à-dire, au fond, bourgeoise démocratique — de lutte des paysans contre les propriétaires fonciers ; on doit encore ces conditions spéciales à la faiblesse numérique et à l’état arriéré du prolétariat des villes et, enfin, à l’immensité du pays et au délabrement de ses voies de communication. Mais les pays avancés de l’Europe et de l’Amérique ignorent toutes ces causes de retard, et c’est pourquoi leur prolétariat révolutionnaire doit briser plus énergiquement, plus rapidement, avec plus de décision et beaucoup plus de succès, la résistance des paysans riches et aisés et leur ôter, à l’avenir, toute possibilité d’opposition. Cette victoire de la masse des prolétaires, des demi-prolétaires et des paysans, est absolument indispensable, et tant qu’elle n’aura pas été remportée, le pouvoir prolétarien ne pourra se considérer comme une autorité stable et ferme.
6. Le prolétariat révolutionnaire doit confisquer immédiatement et sans réserve toutes les terres appartenant aux grands propriétaires fonciers, c’est-à-dire à toutes les personnes exploitant systématiquement, dans les pays capitalistes, que ce soit de façon directe ou par l’entremise de leurs fermiers, les travailleurs salariés, les paysans pauvres et même, assez souvent, les paysans moyens de la région, à tous les propriétaires qui ne participent aucunement au travail physique dans la plupart des cas, descendants des barons féodaux (nobles de Russie, d’Allemagne et de Hongrie, seigneurs restaurés de France, lords anglais, anciens possesseurs d’esclaves en Amérique), magnats de la haute finance ou, enfin, ceux qui sont issus de ces deux catégories d’exploiteurs et de fainéants.
Les partis communistes doivent s’opposer énergiquement à l’idée d’accorder une indemnité aux grands propriétaires fonciers expropriés et lutter contre toute propagande en ce sens ; les partis communistes ne doivent pas oublier que le versement d’une semblable indemnité serait une trahison envers le socialisme et une contribution nouvelle imposée aux masses exploitées, accablées par le fardeau de la guerre qui a multiplié le nombre des millionnaires et a accru leurs fortunes.
Dans les pays capitalistes avancés, l’Internationale Communiste estime qu’il serait bon et pratique de maintenir intactes les grandes propriétés agricoles et de les exploiter de la même façon que les « propriétés soviétiques » russes [Note : il serait bon de favoriser la création de domaines administrés par des collectivités (Communes)].
Quant à la culture des terres enlevées par le prolétariat vainqueur aux grands propriétaires fonciers, en Russie, elles étaient jusqu’à présent partagées entre les paysans ; c’est que le pays est très arriéré au point de vue économique. Dans des cas très rares le gouvernement prolétarien russe a maintenu en son pouvoir des propriétés rurales dites « soviétiques » et que l’État prolétarien exploite lui-même, en transformant les anciens ouvriers salariés en « délégués de travail » ou en membres de soviets.
La conservation des grands domaines sert mieux les intérêts des éléments révolutionnaires de la population, surtout des agriculteurs qui ne possèdent point de terres, des demi-prolétaires et des petits propriétaires qui vivent souvent de leur travail dans les grandes entreprises. En outre, la nationalisation des grands domaines rend la population urbaine moins dépendante à l’égard des campagnes au point de vue du ravitaillement.
Là où subsistent encore des vestiges du système féodal, où les privilèges des propriétaires fonciers engendrent des formes spéciales d’exploitation, où l’on voit encore le « servage » et le « métayage », il est nécessaire de remettre aux paysans une partie du sol des grands domaines.
Dans les pays où les grands domaines sont en nombre insignifiant, où un grand nombre de petits tenanciers demandent des terres, la distribution des grands domaines en lots peut être un moyen sûr pour gagner les paysans à la révolution, alors que la conservation de ces quelques grands domaines ne serait d’aucun intérêt pour les villes, au point de vue du ravitaillement.
La première et la plus importante tâche du prolétariat est de s’assurer une victoire durable. Le prolétariat ne doit pas redouter une baisse de la production, si cela est nécessaire, pour le succès de la révolution. Ce n’est qu’en maintenant la classe moyenne des paysans dans la neutralité et en s’assurant l’appui de la majorité, si ce n’est de la totalité, des prolétaires des campagnes, que l’on pourra assurer au pouvoir prolétarien une existence durable.
Toutes les fois que les terres des grands propriétaires fonciers seront distribuées, les intérêts du prolétariat agricole devront passer avant tout.
Tout l’outillage agricole et technique des grandes propriétés foncières et rurales doit être confisqué et remis à l’État, à condition toutefois, qu’après la distribution de cet outillage, en quantité suffisante, aux grandes propriétés rurales de l’État, les petits paysans puissent en profiter gratuitement, en se conformant aux règlements élaborés à ce sujet par le pouvoir prolétarien.
Si, tout au commencement de la révolution prolétarienne, la confiscation immédiate des grandes propriétés foncières, ainsi que l’expulsion ou l’internement de leurs propriétaires, leaders de la contre-révolution et oppresseurs impitoyables de toute la population rurale, sont absolument nécessaires, le pouvoir prolétarien doit tendre systématiquement, au fur et à mesure de la consolidation de sa position dans les villes et les campagnes, à l’utilisation des forces de cette classe, qui possède une expérience précieuse des connaissances et des capacités organisatrices, pour créer avec son concours, et sous le contrôle de communistes éprouvés, une vaste agriculture soviétique.
7. Le socialisme ne vaincra définitivement le capitalisme et ne sera à jamais affermi qu’au moment où le pouvoir gouvernemental prolétarien, ayant réprimé toute résistance des exploiteurs et assuré son autorité, aura réorganisé toute l’industrie sur la base d’une nouvelle production collectiviste et sur un nouveau fondement technique (application générale de l’énergie électrique dans toutes les branches de l’agriculture et de l’économie rurale). Cette réorganisation seule peut donner aux villes la possibilité d’offrir aux campagnes arriérées une aide technique et sociale susceptible de déterminer un accroissement extraordinaire de la productivité du travail agricole et rural et d’engager, par l’exemple, les petits laboureurs à passer, dans leur propre intérêt, progressivement, à une culture collectiviste mécanique.
C’est précisément dans les campagnes que la possibilité d’une lutte victorieuse pour la cause socialiste exige de la part de tous les partis communistes un effort pour susciter, parmi le prolétariat industriel, le sentiment de la nécessité des sacrifices à consentir pour le renversement de la bourgeoisie et pour la consolidation du pouvoir prolétarien ; chose absolument nécessaire parce que la dictature du prolétariat signifie qu’il sait organiser et conduire les travailleurs exploités et que son avant-garde est toujours prête, pour atteindre ce but, au maximum d’efforts héroïques et de sacrifices ; en outre, pour remporter la victoire définitive, le socialisme exige que les masses laborieuses les plus exploitées des campagnes puissent voir, dès la victoire des ouvriers, leur situation presque immédiatement améliorée aux dépens des exploiteurs ; s’il n’en était pas ainsi, le prolétariat industriel ne pourrait pas compter sur l’appui des campagnes et ne pourrait pas, de ce fait, assurer le ravitaillement des villes.
8. Les difficultés énormes que présentent l’organisation et la préparation à la lutte révolutionnaire de la masse des travailleurs ruraux que le régime capitaliste avait abrutis, éparpillés et asservis, à peu près autant qu’au moyen-âge, exige de la part des partis communistes, la plus grande attention envers le mouvement gréviste rural, l’appui vigoureux et le développement intense des grèves de masses de prolétaires et des demi-prolétaires ruraux. L’expérience des révolutions russes de 1905 et 1917, confirmée et complétée actuellement par celle de la révolution allemande et d’autres pays avancés, prouve que seul le mouvement gréviste, progressant sans cesse (avec la participation, dans certaines conditions, des « petits paysans ») peut tirer les villages de leur léthargie, réveiller chez les paysans la conscience de classe et le sentiment de la nécessité d’une organisation de classe des masses rurales exploitées et montrer clairement aux habitants de la campagne l’importance pratique de leur union avec les travailleurs des villes. À ce point de vue, la création de syndicats ouvriers agricoles et la collaboration des communistes dans les organisations d’ouvriers agricoles et forestiers sont de la plus haute importance. Les communistes doivent particulièrement soutenir les organisations formées par la population agricole étroitement liée au mouvement ouvrier révolutionnaire. Une propagande énergique doit être faite parmi les paysans prolétaires.
Le Congrès de l’Internationale Communiste flétrit et condamne sévèrement les socialistes félons et traîtres que l’on trouve malheureusement, non seulement au sein de la l’Internationale Jaune, mais aussi parmi les trois partis européens les plus importants, sortis de cette Internationale ; le congrès voue à la honte les socialistes capables non seulement de considérer d’un œil indifférent le mouvement gréviste rural, mais encore de lui résister (comme K. Kautsky), de peur qu’il n’en résulte une réduction du ravitaillement. Tous les programmes et toutes les déclarations les plus solennels n’ont aucune valeur, s’il n’est pas possible de prouver pratiquement que les communistes et les leaders ouvriers savent mettre au-dessus de toutes choses le développement de la révolution prolétarienne et sa victoire, qu’ils savent consentir pour elle aux sacrifices les plus pénibles, parce qu’il n’est pas d’autres issues, pas d’autres moyens pour vaincre la famine et la désorganisation économique et pour conjurer de nouvelles guerres impérialistes.
9. Les partis communistes doivent faire tout ce qui dépend d’eux pour commencer au plus tôt l’organisation des soviets dans les campagnes et en premier lieu, des soviets qui représenteraient des travailleurs salariés et les demi-prolétaires. Ce n’est qu’en coopération étroite avec le mouvement gréviste des masses et avec la classe la plus opprimée que les soviets seront à même de s’acquitter de leur mission et deviendront assez forts pour soumettre à leur influence (et les incorporer par la suite) les « petits paysans ». Si cependant le mouvement gréviste n’est pas encore assez développé et la capacité d’organisation du prolétariat rural est encore trop faible, tant à cause de l’oppression des propriétaires fonciers et des paysans riches, que de l’insuffisance de l’appui fourni par les ouvriers industriels et par leurs syndicats, la création des soviets dans les campagnes demande une longue préparation ; elle doit être faite par la création des foyers communistes, par une propagande active, en termes clairs et nets, des aspirations communistes que l’on expliquera à force d’exemples illustrant les diverses méthodes d’exploitation et d’oppression, et enfin au moyen de tournées de propagande systématiques des travailleurs industriels dans les campagnes.
=>Retour au dossier sur le Second congrès
de l’Internationale communiste