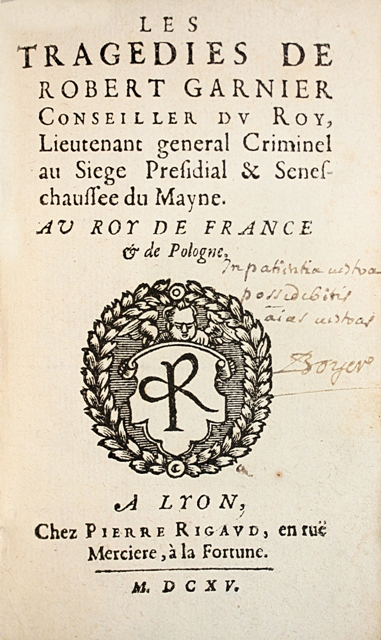1. — L’ICJ depuis le 4 e Congrès Mondial
§1. Conformément aux décisions du 4e Congrès de l’IC, le 3e Congrès de l’ICJ a concrétisé le mot d’ordre général «Aux masses» posé au 2e Congrès de l’ICJ. Il a défini les formes d’organisation, le contenu des méthodes et de l’activité d’une organisation de masses de la jeunesse ouvrière ; il a indiqué comme tâche principale le transfert de la base d’organisation dans les ateliers par la création de Cellules d’usines ; il a souligné la nécessité de donner un caractère plus politique aux JC en les faisant participer aux combats et aux problèmes de la classe ouvrière ; il a assigné comme objectif pratique immédiat aux JC la lutte contre le militarisme bourgeois, contre le danger de guerre et l’offensive du capital.
§2. L’histoire des JC pendant la dernière période a montré la justesse et la nécessité de ces résolutions. Elles ont été entièrement vérifiées et ont permis aux JC de se transformer en une organisation de masses de la jeunesse ouvrière. L’ICJ a fait des pas de géant dans ce sens.
Cela s’est manifesté par les progrès incessants, en qualité et en quantité, des JC les plus importantes. Ces progrès sont d’autant plus intéressants qu’on a pu constater dans le même temps un déclin des jeunesses «socialistes».
Si les JC continuent à appliquer énergiquement les résolutions de leurs 2 e et 3 e Congrès Mondiaux conformément à la situation objective révolutionnaire, on verra que leur essor n’est pas fortuit ni passager, mais durable et fera d’elles un vaste mouvement des jeunes travailleurs en amenant la complète liquidation des Jeunesses suivant encore les drapeaux «sociaux» ou «socialistes».
§3. Les résultats les plus importants ont été atteints dans les domaines suivants :
a) L’activité politique des JC, leur participation aux combats de la classe ouvrière et des PC, ont cru considérablement. Leur ligne politique a toujours été bonne et juste. Elles se sont montrées, dans la plupart des cas, les meilleurs champions d’avant-garde de l’IC, surtout contre les tendances opportunistes surgies dans divers pays.
b) Pour la réorganisation sur la base des Cellules d’entreprise, les JC n’ont pas seulement fait l’éducation idéo logique de leurs membres ; les plus importantes ont encore créé les conditions préliminaires nécessaires à leur réforme complète. Les JC et l’ICJ ont été les pionniers de cette réforme et par-là ont beaucoup aidé l’œuvre des PC et de l’IC et recueilli une expérience précieuse.
c) L’IC félicite chaudement l’ICJ de son initiative et de son action héroïque dans la lutte contre la guerre et l’impérialisme et dans le travail au sein de l’armée bourgeoise.
La propagande parmi les troupes d’occupation françaises en Allemagne, surtout dans la Ruhr, a été le premier travail international pratique et concret exécuté dans ce domaine. De même l’œuvre des JC françaises dans l’armée française marque un énorme progrès. L’IC des Jeunesses a fourni la preuve qu’un travail de ce genre, même dans les conditions les plus difficiles, est possible et efficace.
d) L’ICJ a également obtenu de grands résultats quant à son développement en une organisation mondiale, fortement centralisée et soudée par une direction internationale.
Outre la croissance des effectifs des plus importantes Jeunesses, l’IC constate l’approfondissement incessant de son influence sur la jeunesse ouvrière et la conjonction intime de plus en plus parfaite des Jeunesses des divers pays en une solide organisation mondiale.
Les JC n’ont malheureusement trouvé qu’un appui insuffisant auprès des PC.
Tandis que différents Partis (par exemple les Partis français et allemand) leur ont apporté un vigoureux concours, elles ont eu à surmonter une forte résistance de certains autres, ou plutôt de leurs organes dirigeants, avant de pouvoir remplir leur mission (par exemple en Pologne, où le Parti n’a rien fait pour encourager leur campagne antimilitariste ; en Suède, où les JC et l’ICJ ont été vivement combattues par la majorité du CC, parce qu’elles défendaient la ligne de l’IC ; en Tchécoslovaquie, où le Parti a longtemps entravé la création des Cellules d’usine ; dans les Balkans et ailleurs).
Les décisions du 3e Congrès de l’IC sur l’indépendance des Jeunesses ne sont pas encore tout à fait appliquées.
§4. Dans certains domaines, les Jeunesses n’ont pu développer leur activité qu’incomplètement. Ainsi la lutte contre l’offensive du capital, contre la paupérisation de la jeunesse ouvrière, le travail dans les Syndicats, sauf dans quelques pays, ont été trop faibles.
Le travail d’éducation ne correspond pas encore aux tâches posées par le rajeunissement, par l’afflux de nombreux nouveaux membres et par les grandes luttes à soutenir. Le manque de l’appui des Partis y a contribué.
Le travail pour conquérir la jeunesse des campagnes, qui doit emprunter des méthodes particulières, est encore insuffisant. La lutte contre les jeunesses fascistes, nouvellement créées, ainsi que contre les Jeunesses chrétiennes, ne put être menée comme il convient dans la période écoulée.
2. — Tâches prochaines de l’ICJ
§5. Le développement de l’ICJ, dans la dernière période, permet au 5e Congrès de constater que les décisions des 2e et 3e Congrès de l’ICJ et celles du 3e Congrès de l’IC sur les Jeunesses étaient absolument justes et ont été vérifiées par la pratique.
L’ICJ et ses Sections doivent continuer leur travail dans le sens de ces décisions et entreprendre immédiatement leur transformation en organisations vraiment léninistes, points d’appui du bolchévisme. La bolchévisation des Jeunesses doit être la tâche centrale de l’ICJ, le point de départ de tous ses travaux.
La bolchévisation de l’ICJ doit trouver surtout, et plus énergiquement que jusqu’ici, son expression dans la transformation des JC en organisations de masses de la jeunesse ouvrière. L’idée que l’organisation des jeunes communistes est l’unique organisation de classe qui dirige la jeunesse travailleuse, qui en défend les intérêts, doit prendre racine dans la jeunesse ouvrière.
Les Jeunesses ont aussi la tâche importante d’éduquer leurs membres pour en faire de véritables jeunes léninistes. Elles doivent faire comprendre à chacun les principes et la tactique de Lénine et le mettre en état de les pratiquer. L’éducation léniniste doit s’exprimer par la participation active des Jeunesses aux luttes du PC et de la classe ouvrière, par l’union du travail pratique dans les masses et de la théorie.
L’ICJ doit continuellement affermir dans ses Sections les principes de la centralisation, de la discipline internationale, de l’unité et de l’enracinement dans les masses, ainsi que l’idée que la classe ouvrière est le guide de tous les opprimés ; elle doit faire entrer les paysans pauvres et les Jeunesses opprimées des pays coloniaux dans le front de la classe ouvrière internationale.
§6. Les JC doivent s’occuper principalement des questions que voici : intime participation à la vie du PC et aux luttes de la classe ouvrière (activité politique), réorganisation sur la base des Cellules d’usine, travail actif dans l’armée bourgeoise et lutte contre la menace de guerre, préparation pratique (surtout militaire) à la guerre civile, travail économique et syndical, travail parmi la jeunesse agricole, travail d’éducation.
a) Activité politique. — Elle doit être renforcée là où elle n’a pas atteint un degré suffisant.
Elle consiste à participer activement, en étroite liaison avec les PC et, sous leur direction, à toutes les luttes de la classe ouvrière, à mobiliser à cet effet la jeunesse ouvrière et à collaborer avec la même activité à la solution et à l’éclaircissement de toutes les questions des PC et de l’Internationale et, en général, à la vie du Parti. Ce n’est pas une tâche particulière à côté de toutes les autres : la politique pénètre toute l’activité, l’anime et l’oriente dans un sens léniniste.
Elle constitue la base et la méthode de toutes les tâches de la Jeunesse Communiste. Les PC doivent tout faire pour développer les JC, renfort de la classe ouvrière et pépinière de nouveaux combattants politiquement qualifiés.
b) Quant à la création des Cellules d’usine, les JC doivent continuer énergiquement le travail commencé. Elles doivent aborder maintenant immédiatement la réforme. Pour le prochain congrès mondial, réorganisation complète sur la base des Cellules d’usine !, voilà le mot d’ordre que tout jeune communiste doit tâcher de réaliser.
c) Le travail dans l’armée et contre les nouvelles guerres doit être continué immédiatement et énergiquement.
C’est une des tâches les plus urgentes découlant de la situation internationale et des perspectives de révolution. La transition de la simple propagande au travail concret, comme nous l’avons vu commencer dans les régions occupées de l’Allemagne et en France, doit s’étendre à l’échelle internationale.
Il faut accorder une attention et une force spéciales à la réalisation du mot d’ordre de Lénine sur la création de Cellules dans les armées bourgeoises. Les JC doivent donner toutes leurs forces pour mobiliser la jeunesse ouvrière contre les nouvelles guerres impérialistes.
Elles doivent opposer, au mot d’ordre hypocrite et trompeur des social-démocrates sur la grève générale contre la guerre, une propagande appuyée sur la façon dont éclatent les guerres et sur la nécessité de transformer la guerre impérialiste, une fois qu’elle a éclaté, en guerre civile au sein des Etats impérialistes, et de mener en conséquence un travail révolutionnaire dans les armées bourgeoises.
d) La période de la lutte directe pour le pouvoir, qui est imminente dans plusieurs pays, oblige l’ICJ à examiner sérieusement les expériences faites en septembre en Bulgarie et en octobre en Allemagne ; elle doit, sous la direction du PC, faire dans les Sections intéressées un travail préparatoire d’après ces expériences.
L’éducation militaire systématique des membres des JC sous la direction du PC est particulièrement nécessaire.
e) La lutté économique syndicale doit être renforcée, ou bien sérieusement commencée. Les JC doivent passer à l’action dans la défense des intérêts matériels et culturels de la jeunesse ouvrière.
Elles ont donc à augmenter considérablement leurs efforts dans les Syndicats réformistes pour les révolutionner. Elles continueront à former et à consolider leurs fractions au sein de tous les Syndicats et à lutter en principe contre toute séparation des adultes et des jeunes, surtout sous la forme de Sections des jeunesses dans les Syndicats.
Elles peuvent le faire en prouvant par la pratique devant les syndicats et devant les ouvriers adultes que les JC sont là seule organisation de masse de la jeunesse ouvrière, que ce sont elles qui défendent les intérêts de la jeunesse laborieuse dans le cadre de la lutte de tout le prolétariat.
C’est ce qu’elles feront aussi à l’égard des Syndicats Rouges, avec lesquels les JC collaborent le plus étroitement possible, car seuls ils sont prêts à défendre effectivement les intérêts de la jeunesse ouvrière.
Les communistes au sein des Syndicats doivent travailler à ce que les JC soient reconnus dans les Syndicats et par les ouvriers adultes comme organisations représentant et défendant les intérêts économiques et autres de la jeunesse ouvrière.
Les fractions communistes doivent veiller à ce qu’aux élections des différents Comités syndicaux des membres des JC soient présentés comme candidats et élus.
f) Il est très important de gagner la jeunesse travailleuse des campagnes, qui dans la plupart des pays influera la victoire de la révolution prolétarienne. Ce travail est encore à commencer dans la plupart des pays.
g) Plus les JC rallient au tour d’elle la jeunesse travailleuse, et plus elles doivent s’efforcer de poursuivre parmi les jeunes un travail d’éducation léniniste, systématique et communiste, étroitement lié aux luttes du PC et de la classe ouvrière. Autrement elles risquent de perdre le caractère communiste de leur lutte et leur activité.
L’éducation à poursuivre dans la période prochaine doit être surtout politique. Elle doit rendre les jeunes communistes, capables de recueillir et de continuer l’héritage de Lénine en paroles et en actes.
Il dépendra de l’appui accordé par l’IC et les PC que les JC soient capables d’accomplir cette tâche d’éducation léniniste. C’est une des tâches les plus urgentes de l’Internationale de rendre possible cet appui. Le travail antireligieux doit également trouver l’attestation nécessaire.
§7. À côté des tâches sur lesquelles les JC peuvent concentrer leur travail, dans le temps prochain, elles ne doivent pas négliger leurs tâches en d’autres domaines.
La lutte contre les adversaires, surtout contre les organisations fascistes, contre la jeunesse socialiste et contre les associations religieuses doit continuer à l’avenir le plus énergiquement, et les JC doivent se rendre compte le but de cette lutte ne pourra être que la liquidation, c’est-à-dire l’anéantissement de cette organisation.
Il ne faut pas non plus oublier de préparer les JC contre les tentatives d’oppression de la part de la bourgeoisie et pour le temps d’illégalité.
Le travail dans les colonies et les pays semi-coloniaux des États impérialistes, doit se poursuivre à l’avenir énergiquement avec comme but le soulèvement de la jeunesse travailleuse indigène et son entraînement dans l’ICJ.
En même temps l’ICJ a la tâche de rallier aux directives de l’IC la jeunesse coloniale et semi-coloniale, des dominons et de l’Orient luttant pour sa libération nationale et de la conquérir pour la lutte émancipatrice de la classe ouvrière internationale.
Une lutte régulière et intense contre les organisations sportives bourgeoises et pour la création d’associations sportives ouvrières est également nécessaire. Où il n’y a pas encore d’associations ouvrières de gymnastique et de sport, les JC doivent tâcher d’en fonder.
Dans les associations sportives ouvrières existantes, elles ont à développer une vive propagande pour l’Internationale Rouge des Sports. §8. Il faut accorder une attention systématique et grande à la propagande parmi les jeunes ouvrières et paysannes, pour les gagner davantage que jusqu’ici à l’organisation des JC
Il faut accorder une grande attention au travail parmi les enfants, dont les JC sous-estiment encore aujourd’hui souvent l’importance.
Ce travail doit être accompli d’après les principes de l’éducation communiste, qui veut entraîner les enfants prolétariens dans la participation à la lutte de leur classe. Les groupes d’enfants communistes doivent être dirigés par les JC
§9. Toutes ces tâches ne pourront être complètement accomplies par l’ICJ et par ses Sections que si les PC lui prêtent le concours nécessaire. L’appui de l’ICJ et de ses Sections sera dans l’avenir prochain une des tâches les plus urgentes de l’IC et des PC Les accomplir c’est gagner les grandes masses de la jeunesse travailleuse pour le communisme et faire entrer au PC de nouveaux cadres de léninistes fermes et conscients.
En détail, ces tâches doivent consister à entraîner les JC et leurs membres à la participation, à l’activité politique du PC et aux luttes ouvrières et les aider à collaborer à la solution des problèmes du PC et de l’IC Partout où il y a des Cellules d’usines, des Sections, des Fédérations du Parti, et où il doit se créer ses organisations pour la JC, la JC doit soutenir, à son tour, activement la formation du Parti là où il n’y a pas encore d’organisations du Parti.
Les Cellules du PC dans les usines et les fractions du PC dans les Syndicats doivent soutenir le plus énergiquement les JC dans leur lutte économique et dans l’accomplissement de leurs autres tâches. Il est surtout important et nécessaire de soutenir les JC et l’ICJ dans leur travail dans l’armée et contre les nouvelles guerres.
L’accomplissement de ces travaux qui une des conditions les plus importantes de la victoire de la révolution prolétarienne ne pourra être garantie que par la participation dirigeante du PC La tâche la plus urgente de l’éducation léniniste des jeunes communistes dépend également de l’aide constante et énergique du PC.
§10. Les JC doivent faire tout pour réaliser avec les PC une liaison de plus en plus étroite et ferme. Ils doivent soutenir le PC de toutes leurs forces, non seulement dans son activité quotidienne, mais aussi par une éducation systématique de leurs membres pour le PC et veiller à ce que leurs membres entrent au PC lorsqu’ils auront atteint l’âge nécessaire.
Ainsi, les JC et l’ICJ rempliront leurs devoirs envers les PC et l’IC, et elles seront là même de répondre aux espérances de l’Internationale. Elles seront, dans l’avenir comme par le passé, les meilleurs défenseurs de la ligne et des décisions de l’IC.
=>Retour au dossier sur le cinquième congrès
de l’Internationale Communiste