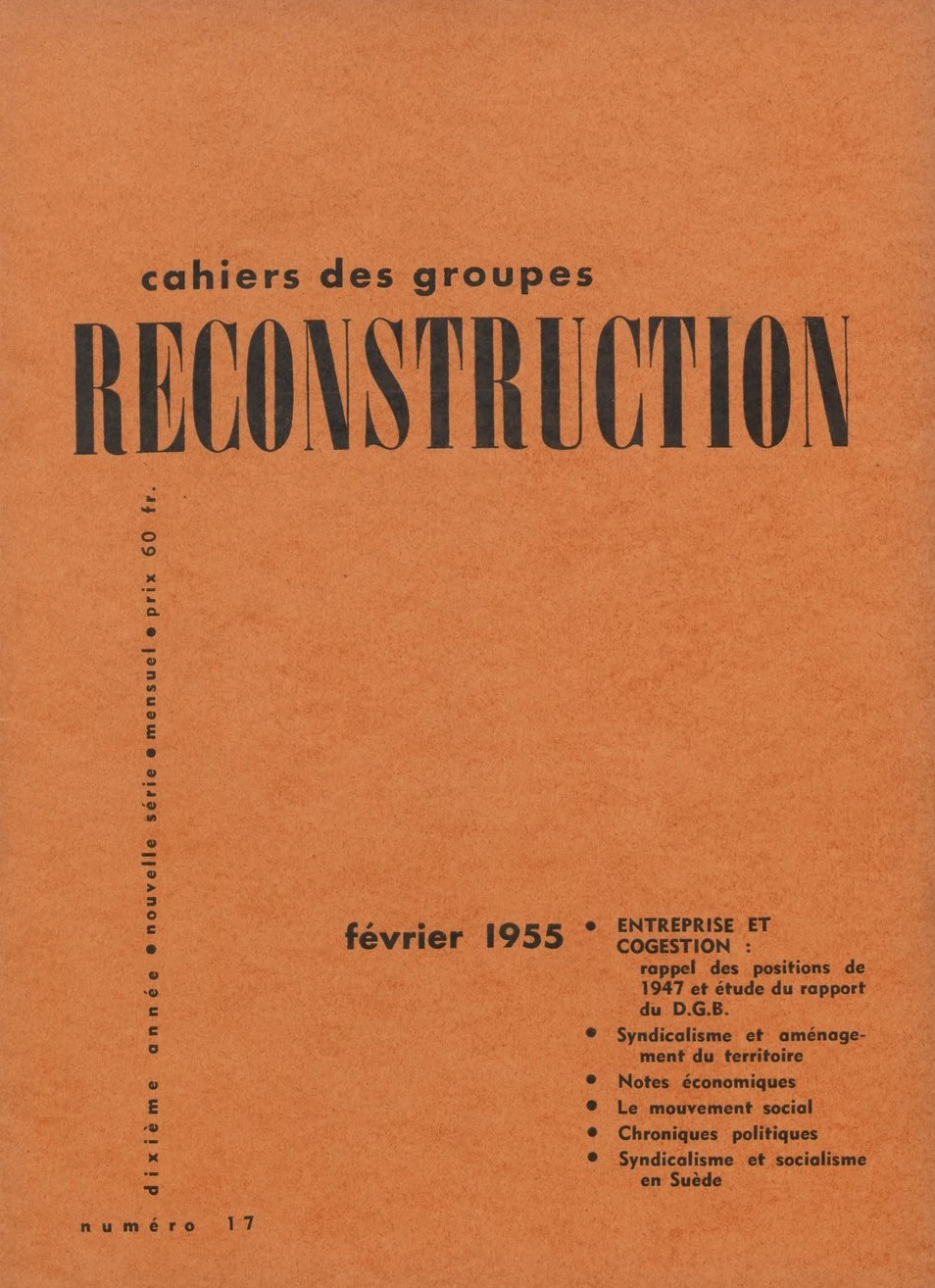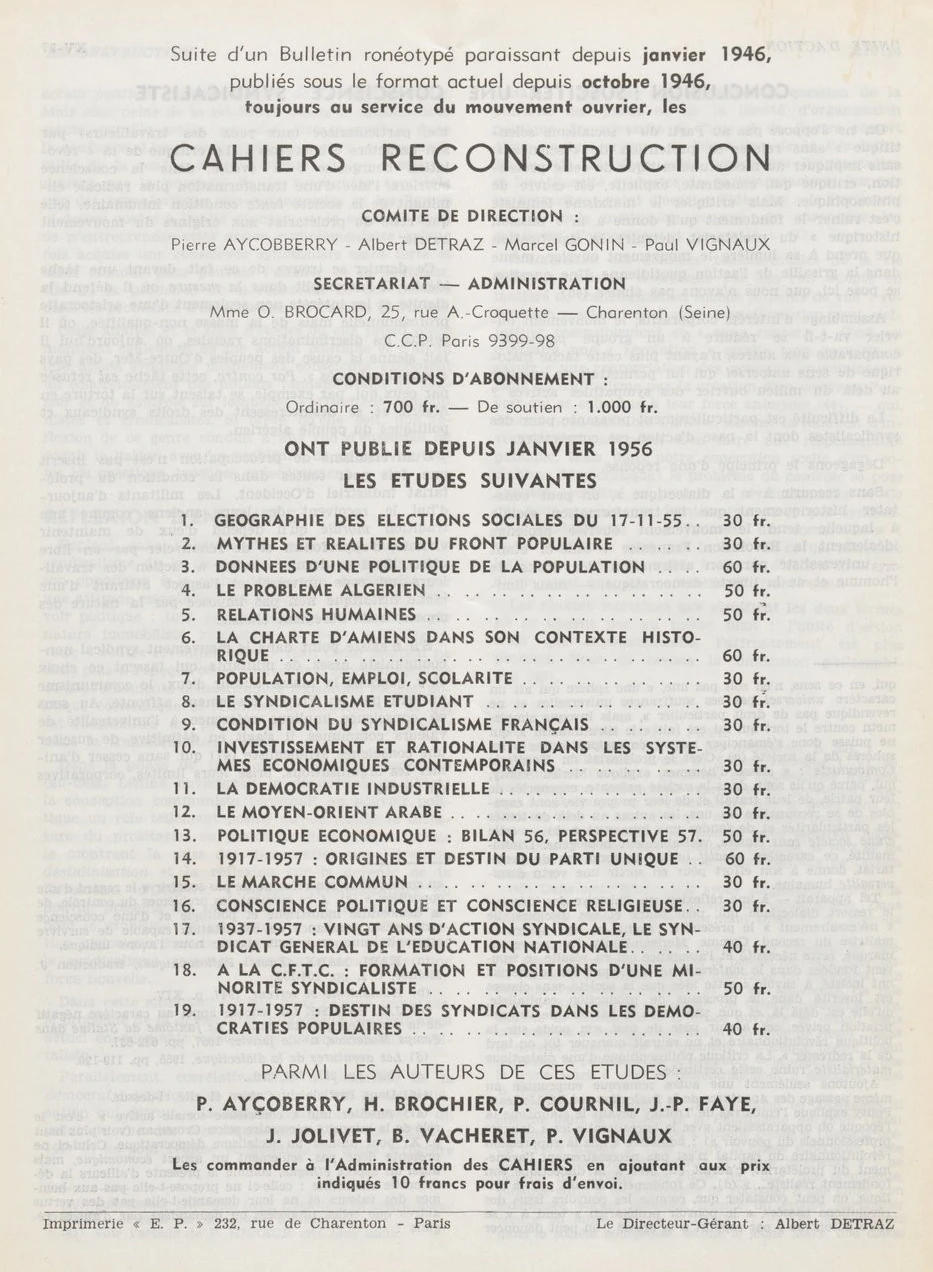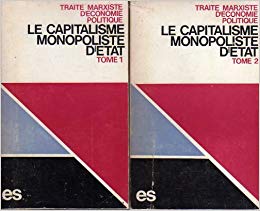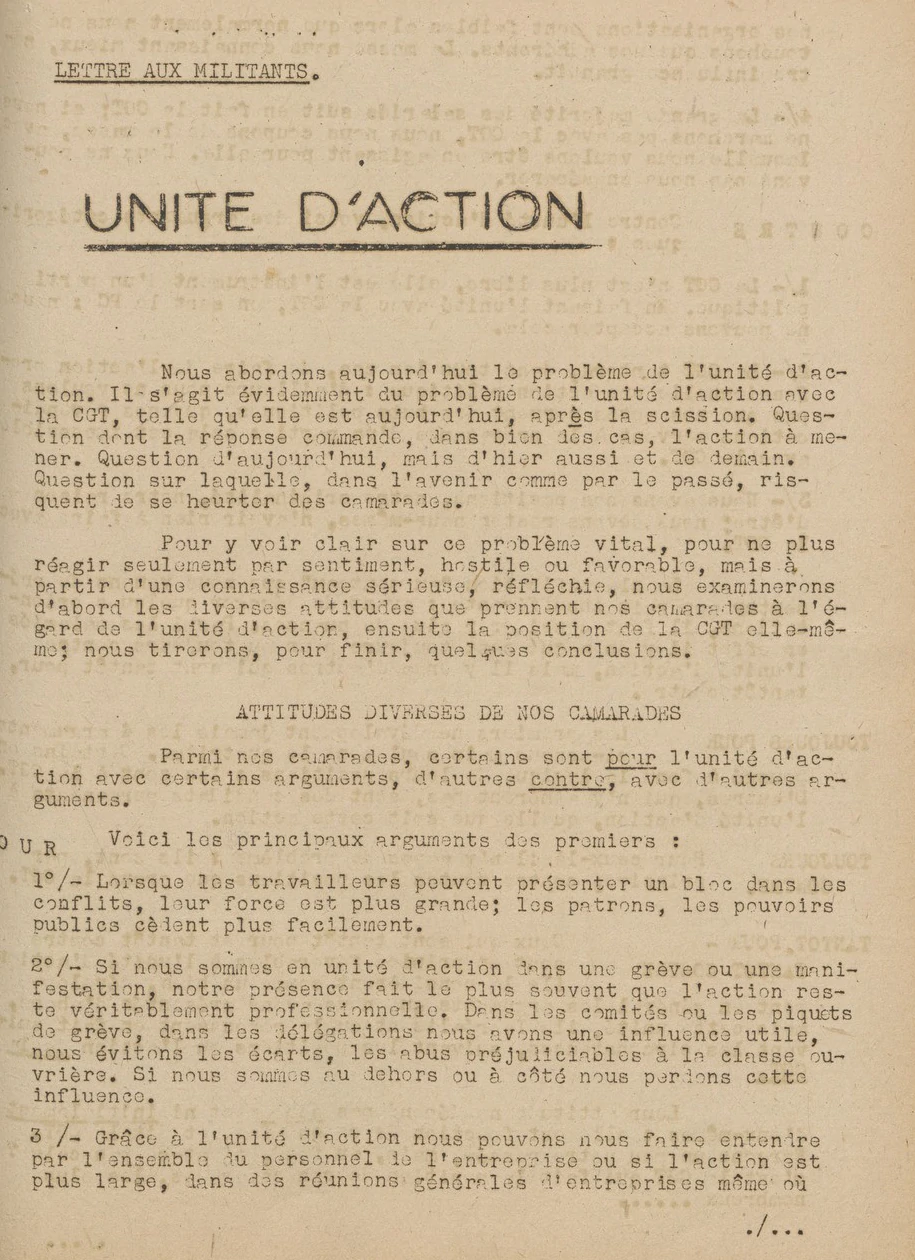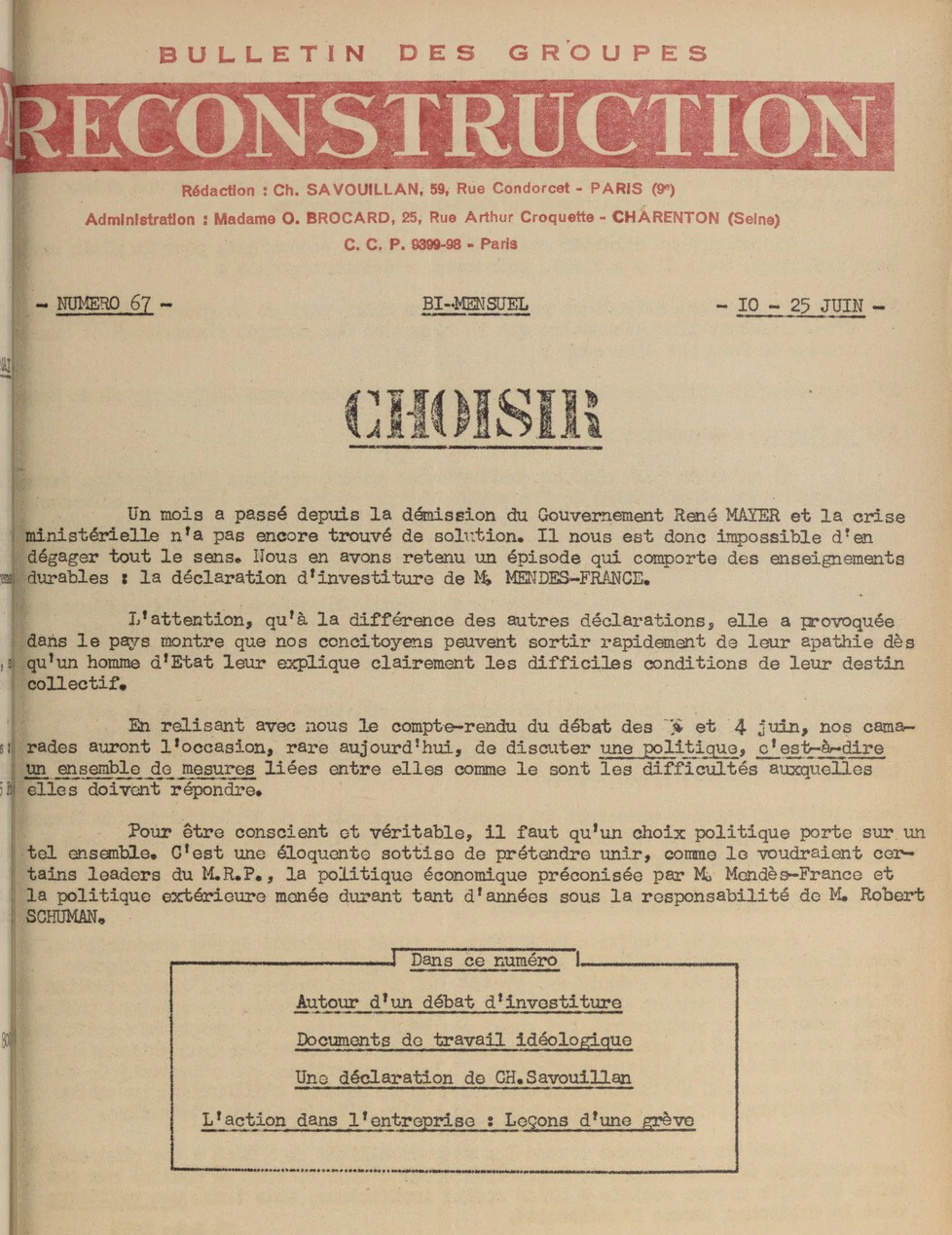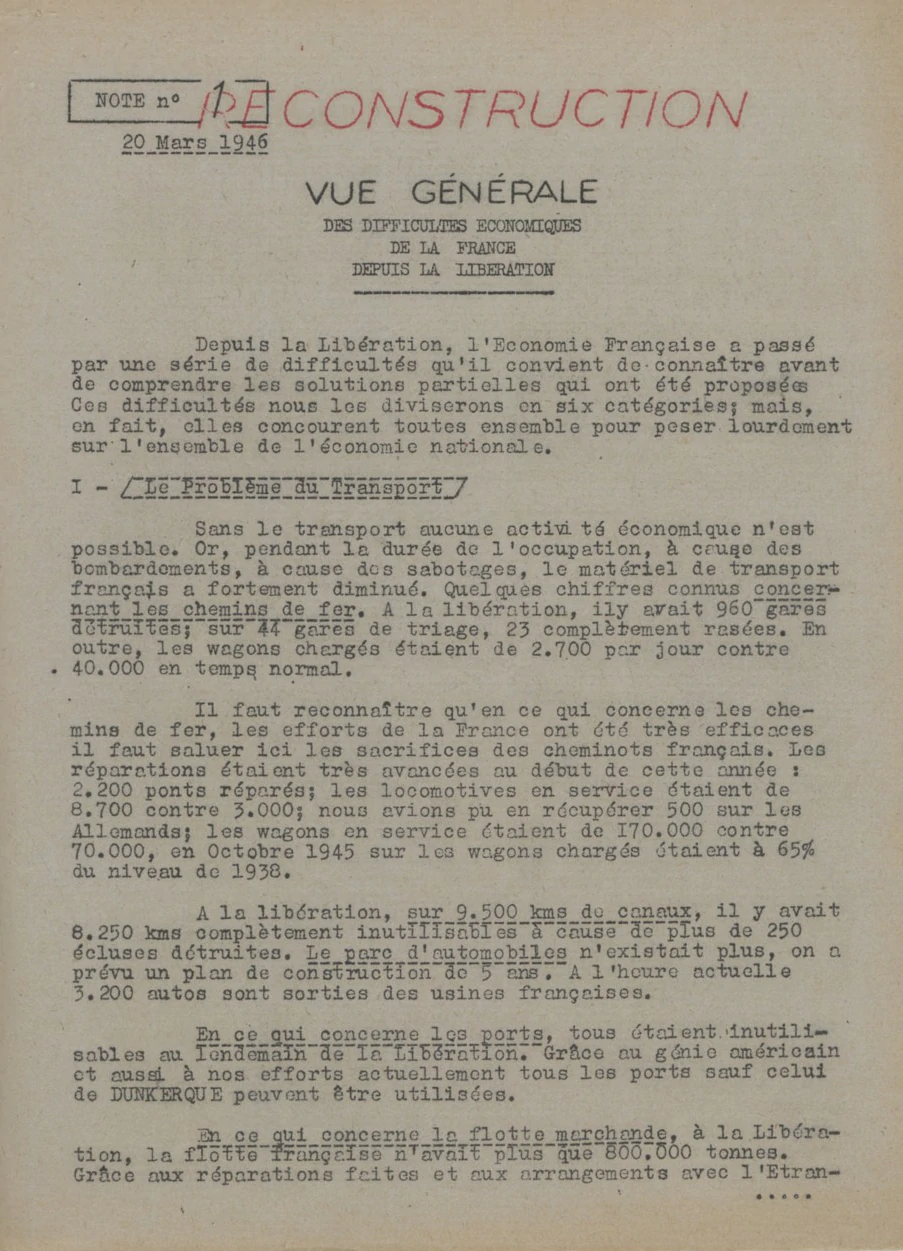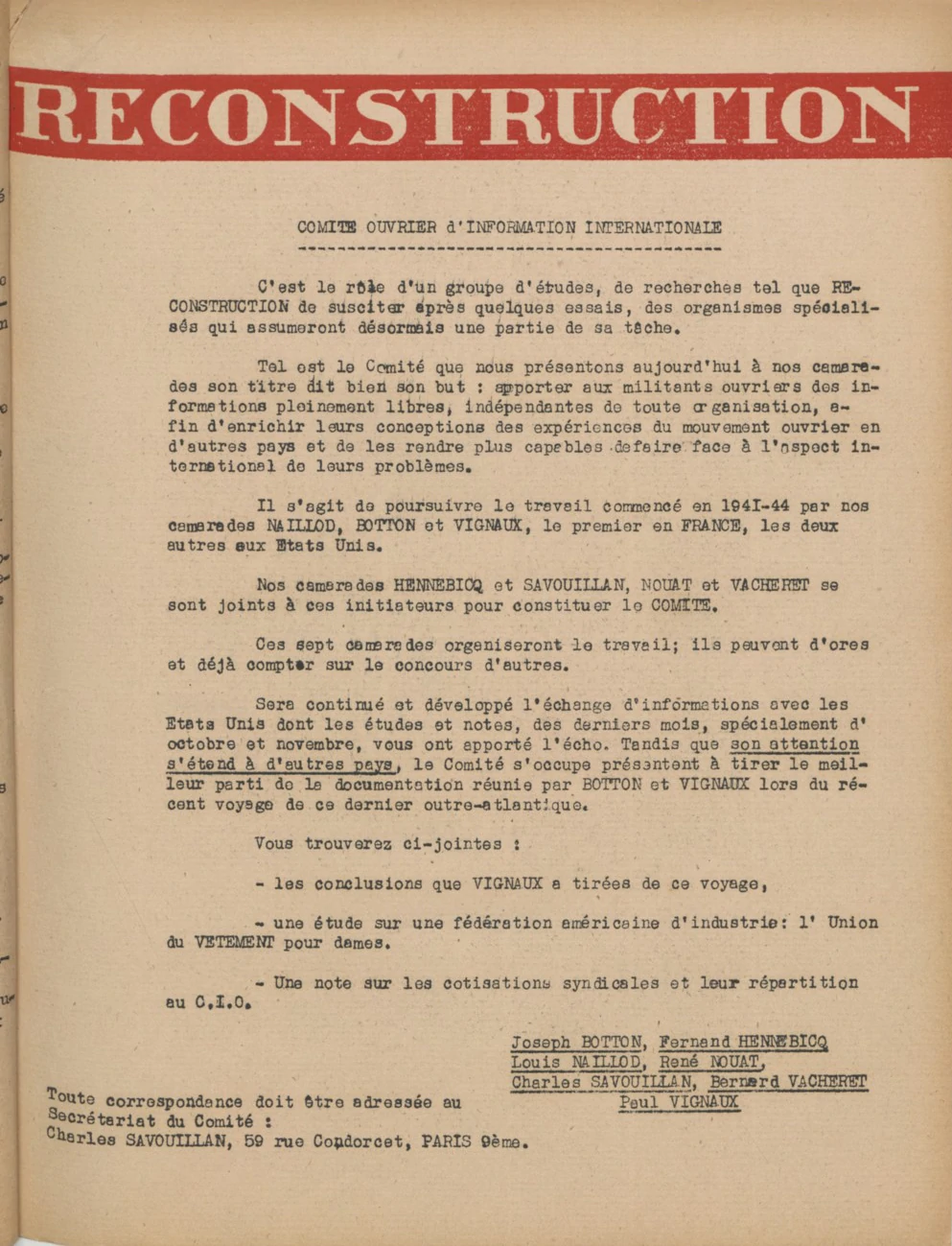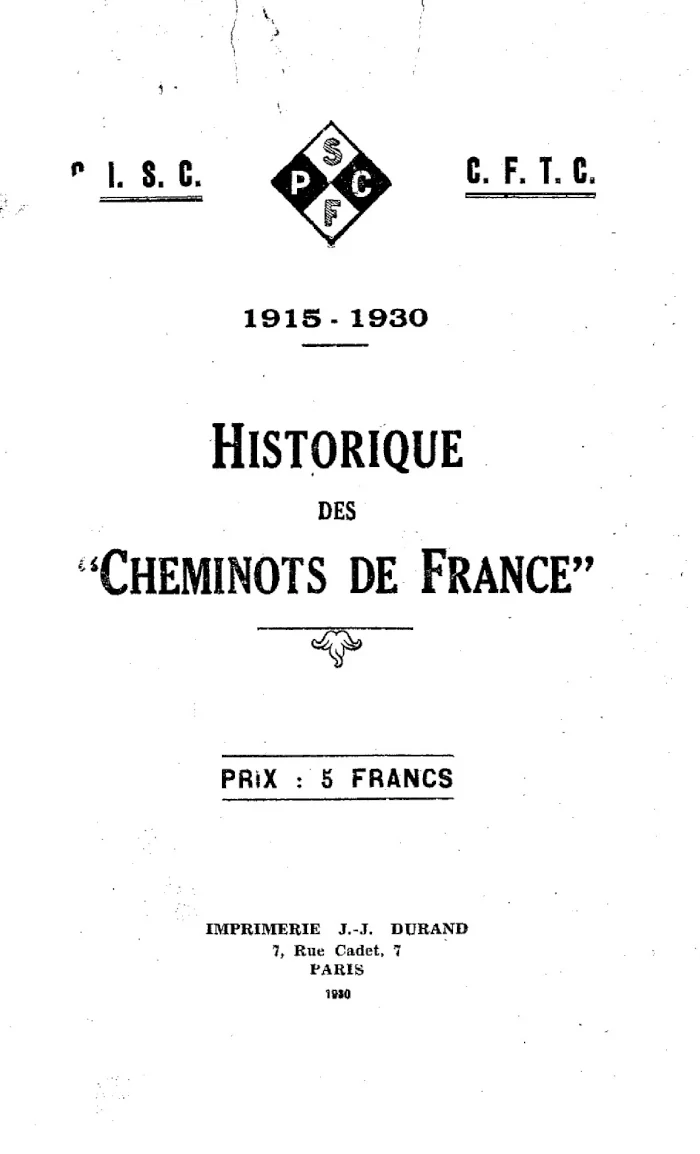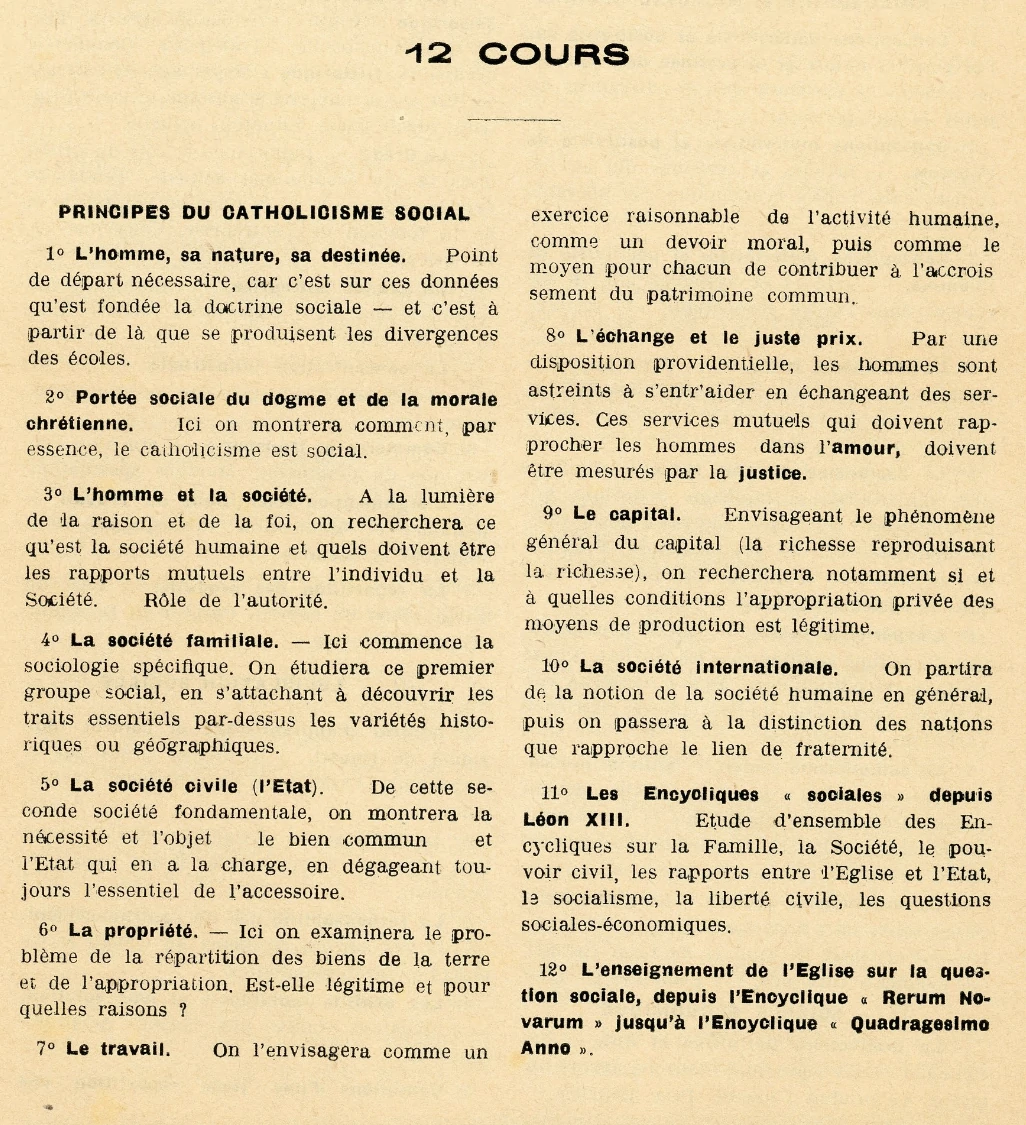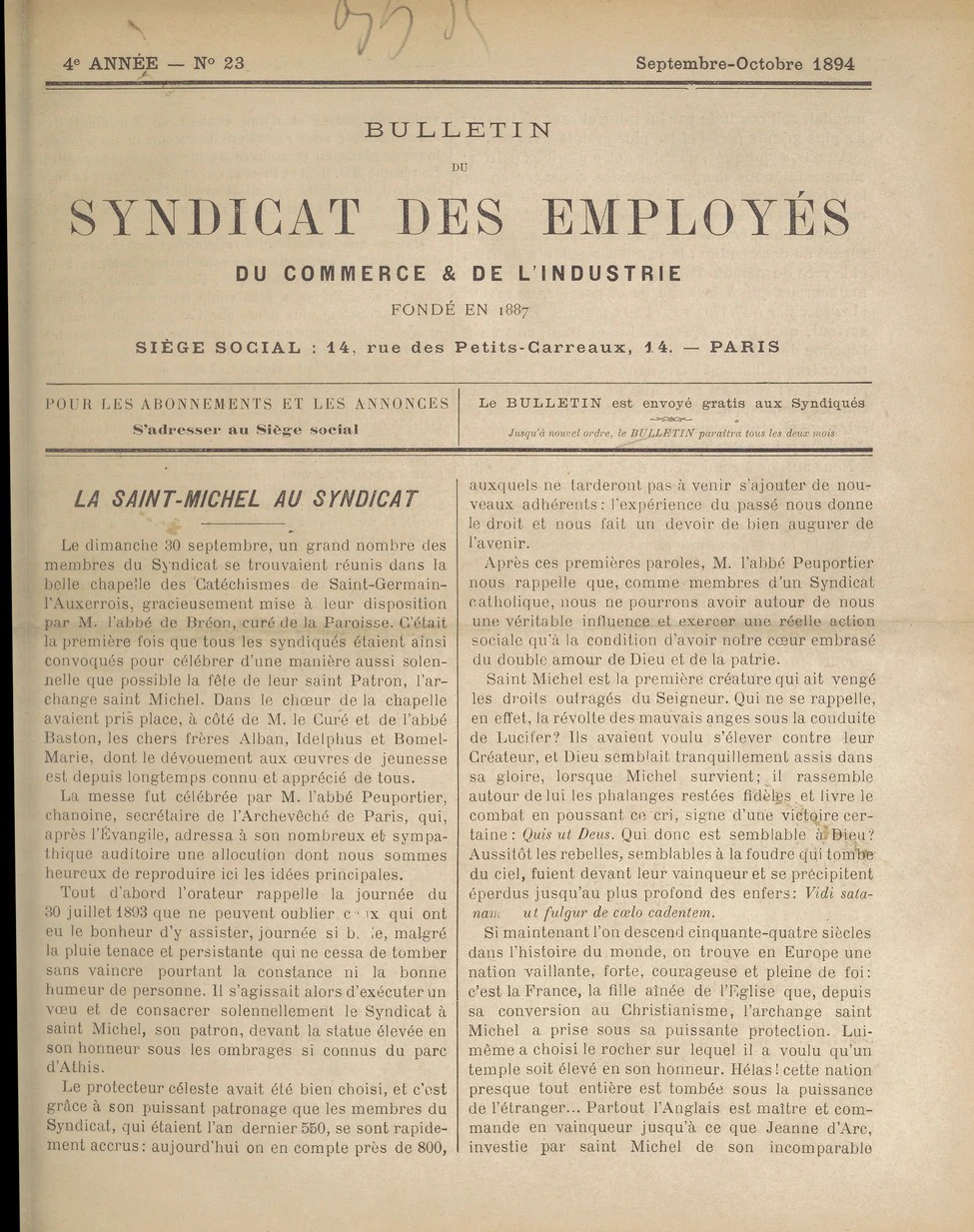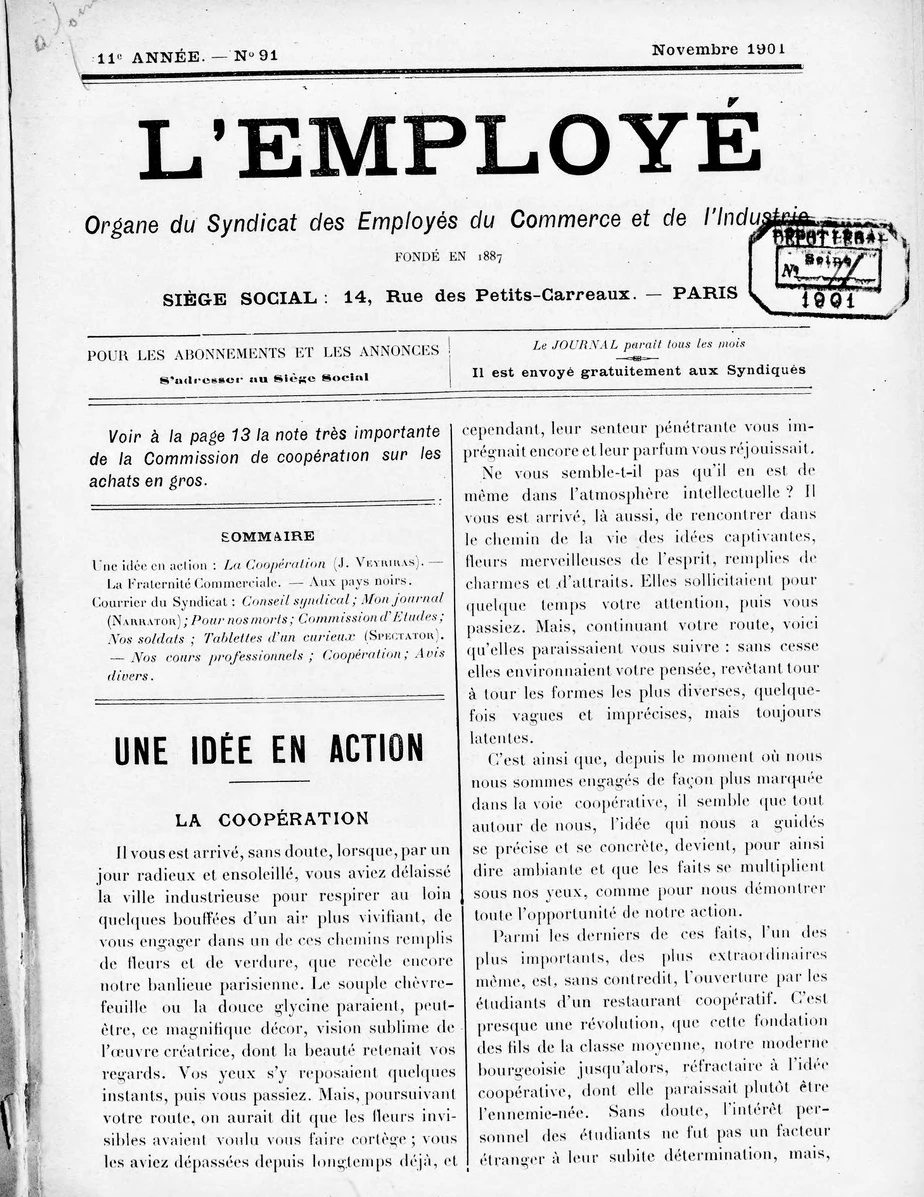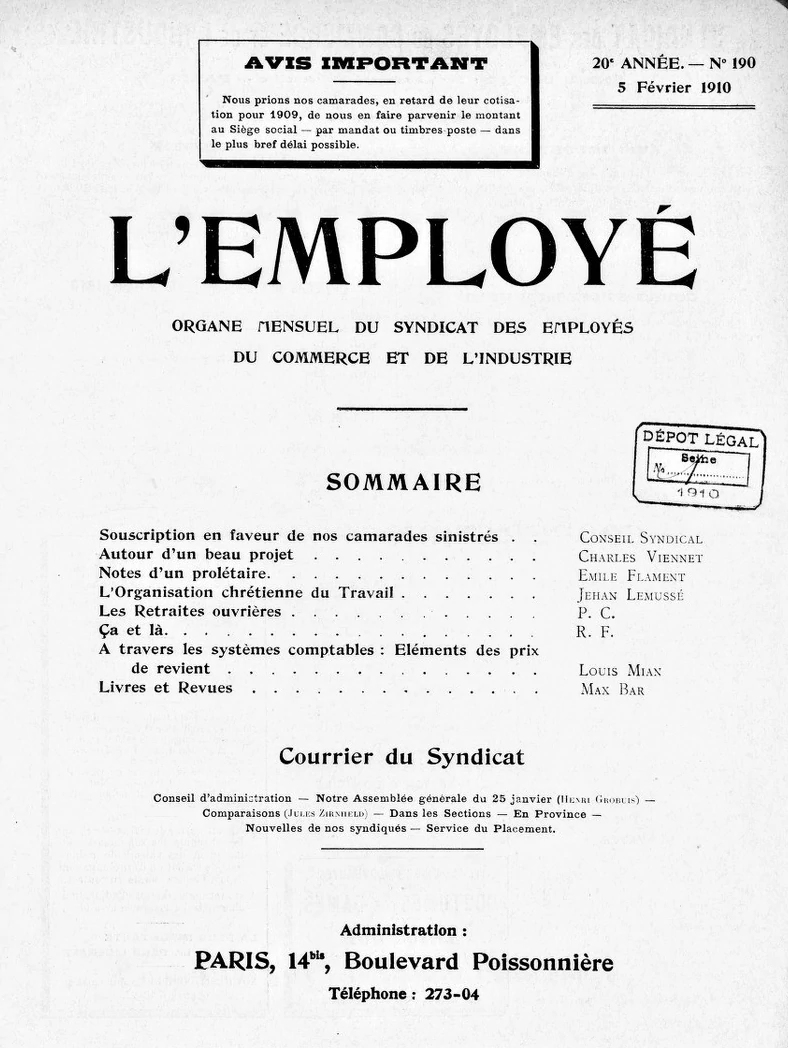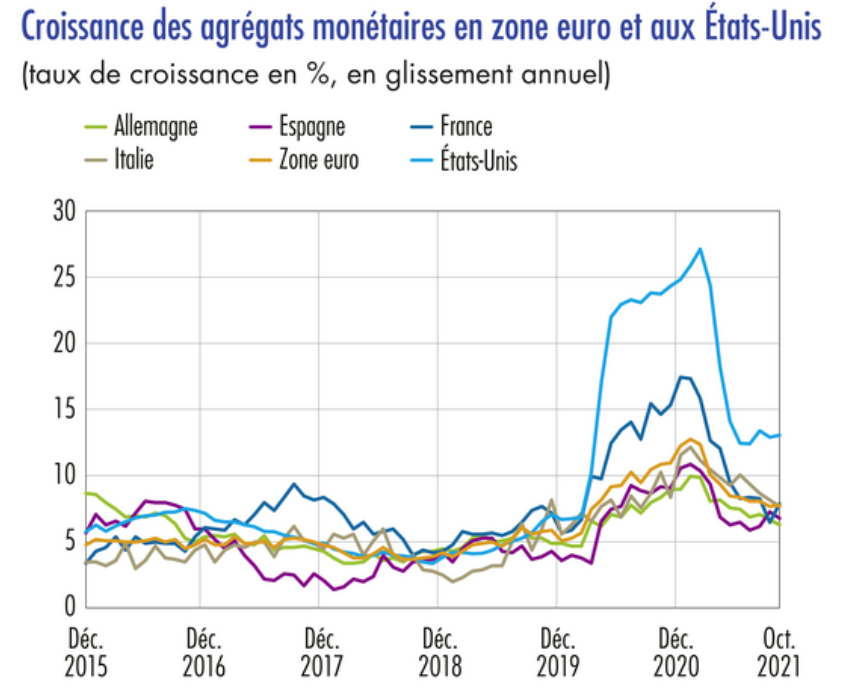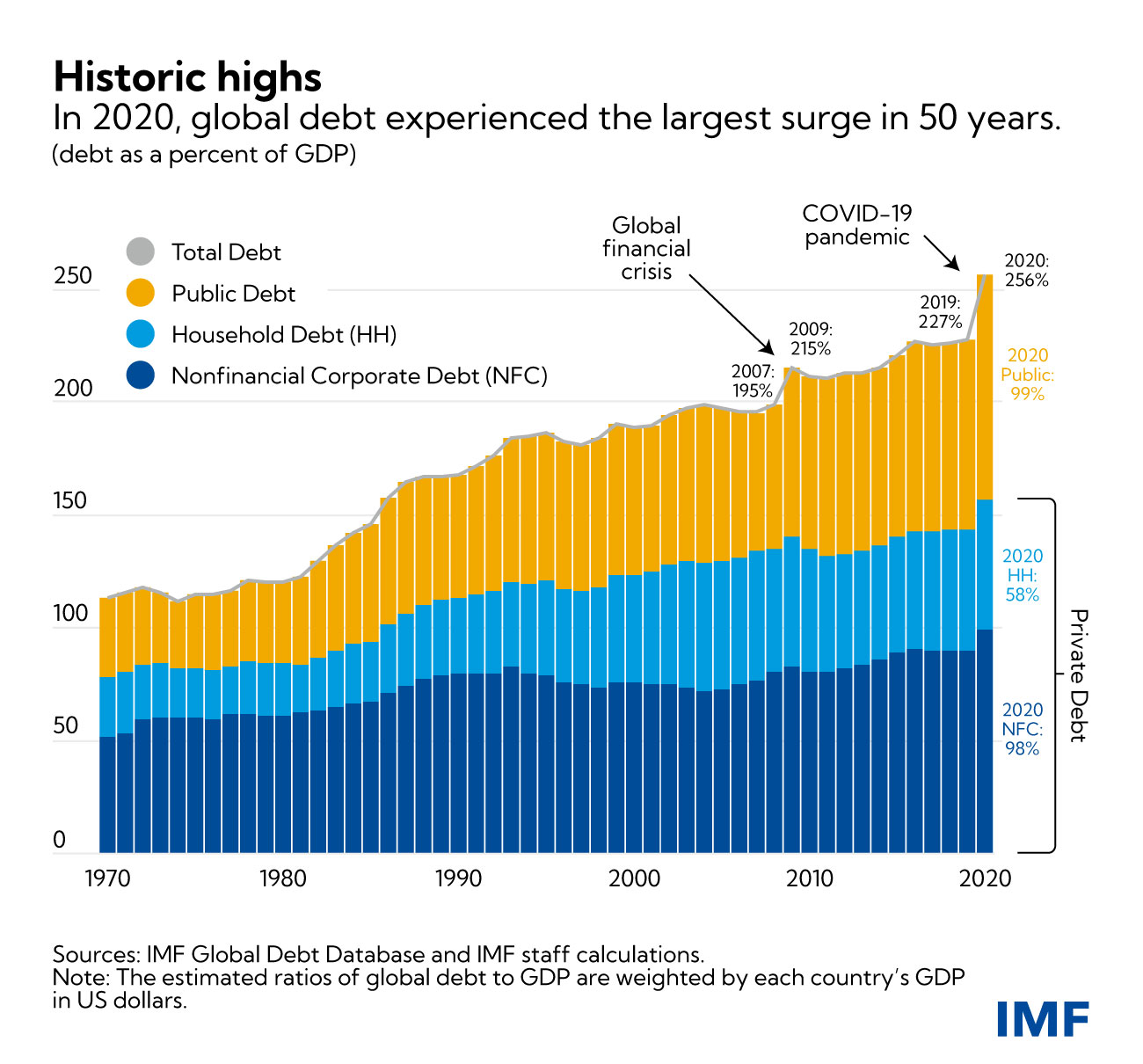Les 6 et 7 novembre 1964 se tient le congrès extraordinaire de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), avec 3000 délégués à Issy-les-Moulineaux en banlieue parisienne.
Il approuve par 70,11 % des voix la modification de la nature du syndicat confédéral, donnant naissance à la Confédération française démocratique du travail (CFDT).
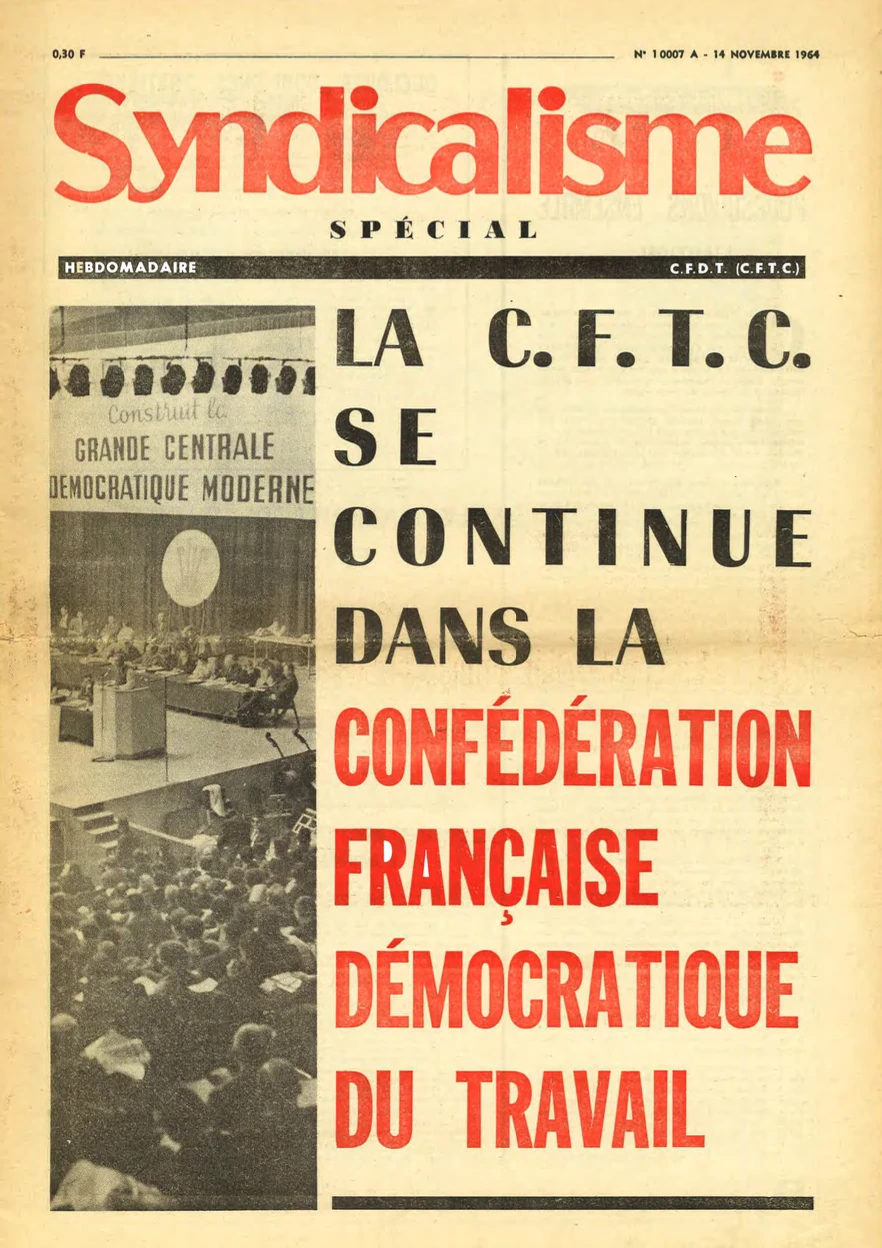
Si la totalité des délégués n’a pas voté en faveur de la transformation, une partie significative des opposants accepte toutefois de rester dans les rangs, la direction faisant d’incessants appels en ce sens.
Seulement moins de 10 % des membres de la CFTC scissionnent, maintenant le nom de CFTC pour leur structure, sous la direction de deux mineurs, Jean Bornard et Joseph Sauty, qui reflètent une affection profonde chez les mineurs du Nord pour le syndicalisme chrétien.
La CFDT, qui s’appelle au départ CFDT (cftc), cherchera par tous les moyens juridiques à empêcher l’utilisation du nom CFTC.
Si sur le plan matériel, elle conservera tous les biens syndicaux, elle ne parviendra toutefois pas à empêcher l’existence d’une CFTC « maintenue ».
Les quatre premiers paragraphes du préambule de la CFDT suffisent en soi pour comprendre la nature du nouveau syndicat remplaçant l’ancienne CFTC.
Le premier paragraphe assume le mouvement ouvrier, alors que la CFTC est née en dehors du celui-ci ; néanmoins, au lieu de la lutte des classes, on a un humanisme-existentialisme.
« Tout le combat du mouvement ouvrier pour la libération et la promotion collective des travailleurs et des travailleuses est basée sur la notion fondamentale que tous les êtres humains sont doués de raison et de conscience et qu’ils naissent libres et égaux en dignité et en droits. »
Suivant les conceptions humanistes-existentialistes, les problèmes ne sont pas les classes, mais l’organisation sociale, les « structures » qui tendent à l’emporter dans une société toujours plus complexe.
« Dans un monde en évolution, marqué par les progrès techniques qui devraient servir à son épanouissement, le travailleur est plus que jamais menacé par des structures et des méthodes déshumanisantes ou technocratiques qui font de lui un objet d’exploitation et d’asservissement. »
Ce qui est fondamental dans cette démarche, c’est le côté repli humaniste-existentialiste sur soi, typiquement français.
Et cela à l’époque de l’affirmation du tiers-monde et du maoïsme.
« Face aux conflits qui déchirent le monde, aux menaces de destruction de l’humanité par les armes nucléaires, les exigences de justice, de fraternité et de paix entre les peuples sont plus impérieuses que jamais. »
Tout ramène à l’idéologie « syndicaliste ».
« Le syndicalisme est pour les travailleurs l’instrument nécessaire de leur promotion individuelle et collective et de la construction d’une société démocratique. »

Prenant la parole, le secrétaire général Eugène Descamps le souligne assez : la CFDT est opposée au communisme, dans sa définition même, et il s’agit de récupérer les adhérents de la CGT, ce qui est dit à demi-mot bien entendu.
« Ce que demande votre Confédération, c’est d’être les uns et les autres des hommes de dialogue et de tolérance.
L’effort de convergence est aussi indispensable pour le Mouvement ouvrier. D’autres hommes ont autant de générosité que nous. Il faut détruire les barrières qui existent entre démocrates.
Nous ne croyons pas au déterminisme de l’histoire et c’est pourquoi nous ne sommes pas des marxistes.
La Centrale que nous voulons construire sera humaniste, elle sera démocratique. Il faut faire une « terre des hommes » [allusion au titre d’un recueil d’essais autobiographiques de l’auteur humaniste-existentialiste chrétien Antoine de Saint-Exupéry]. »
C’est en ce sens qu’il faut comprendre les paroles de toute fin de congrès, qui sont en apparence très engagées.
« Partons d’ici avec la conscience d’avoir fait notre devoir. Fidèles au passé et marchant vers l’avenir, vous ferez de la CFDT l’instrument de libération de la classe ouvrière. »
C’est Maurice Bouladoux qui prononça ces derniers mots qui sont clairement une simulation de discours révolutionnaire.
On parle ici en effet d’un cadre historique du syndicalisme chrétien, qui avait adhéré aux centristes du Mouvement républicain populaire après 1945 et était une figure de l’unification européenne, de fait sous supervision américaine.
On retrouve ici le « modèle américain » cher à Reconstruction.
Et si Maurice Bouladoux ne fait pas partie de Reconstruction, en pratique il ne s’y est pas opposé et a joué le rôle de passeur fournissant la CFTC clef en main à celle-ci.

Cela explique que Maurice Bouladoux, qui a été secrétaire de la CFTC de 1948 à 1953, puis président de 1953 à 1961, est devenu ensuite président honoraire, le restant au sein de la CFDT jusqu’en 1997, année de son décès.
Qui plus est, Maurice Bouladoux était, au moment de sa prise de parole finale, pas moins que… le président de la Confédération internationale des syndicats chrétiens (il l’a été de 1961 à 1973).
Quant au reste de son parcours, on le voit membre pendant de longues années d’innombrables institutions françaises et internationales (Conseil économique, Conseil économique et social, Banque française pour le commerce extérieur, Conférences internationales du travail…).
Il fut également nommé commandeur de la Légion d’Honneur en France, et a reçu l’ordre Saint-Grégoire-le-Grand de la part du Vatican.
Cela fait beaucoup pour quelqu’un annonçant que la CFDT devient « l’instrument de la classe ouvrière ».
->Retour au sommaire du dossier
De la CFTC à la CFDT