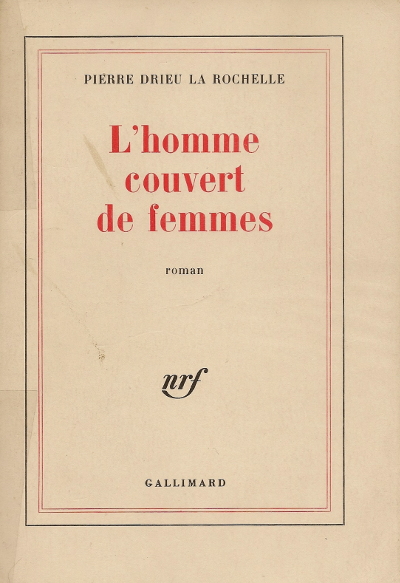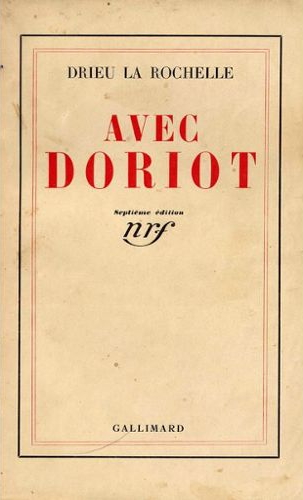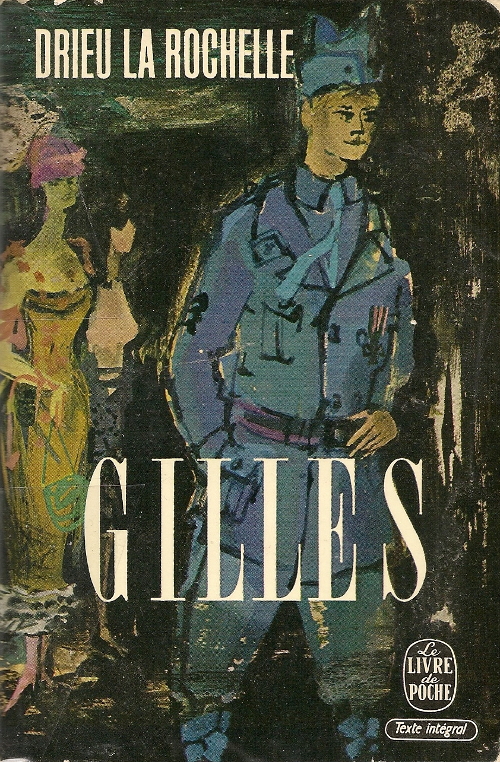Extraits du roman Les chiens de paille, de 1944.
« Il arriva à la longue allée qui menait à la Maison des Marais. Il sauta à terre et alluma une cigarette. « Encore une, il y en a toujours une. »
L’allée d’arbres formait chaussée et du côté droit, vers le nord-ouest, c’était déjà le marais. Il passa entre les arbres pour se rapprocher du bord.
La chaussée se déhanchait un peu et on apercevait, au-delà de l’eau plate, le terre-plein et la maison. Une longue maison basse, de briques et de pierre, bien encapuchonnée sous des pentes gondolées de tuiles anciennes. C’était vieux, solide, solitaire, tout à fait étranger au temps présent et pourtant complice de tous les écoulements du temps.
— C’est bien, c’est bien, fit-il à haute voix. Je pourrai rester là un bout de temps. Voilà une bonne halte.
La cigarette était odorante dans le gris et le calme. Le marais s’étendait assez loin, coupé de chaussées et de haies et de lignes d’arbres. »
*
« — Au fond, je te comprends, dit Salis à Constant, tu es un anarchiste. Je l’ai été, je peux te comprendre, mais je ne le suis plus. Toi, tu es trop vieux pour changer, faut te foutre la paix.
Constant sourit avec dédain mais ne protesta pas ; il y avait des années qu’il n’avait plus entamé une querelle de langage avec qui que ce soit.
Il se mouvait dans un ordre de pensées qui n’avait rien à faire avec l’anarchisme ; quant à ce qui l’intéressait, il ne voulait pas en parler, surtout à des hommes enchaînés, asservis comme Préault et Salis. Il avait plus de sympathie pour Salis que pour Préault, il s’était toujours senti étranger aux bourgeois. »
*
« Il se rencognait avec volupté dans le Creux, près du petit bois. Il n’était pas dérangé par cette silhouette de femme qui glissa entre les sapins deux, trois fois. Cette silhouette semblait aussi familière de cet endroit.
Qu’y venait-elle chercher ? Si elle y venait chercher le monde et l’au-delà du monde comme Constant, ce ne devait pas être dans la foison des images convoquées pour être saisies, broyées, sublimées, anéanties par la puissance du rêve, ce devait être dans une seule image, immédiate, momentanée, exclusive et toute brute.
Elle devait avoir un rendez-vous, la silhouette, quelque part dans ce bois de sapins ; la silhouette devait s’accoupler avec une autre silhouette, soupirer, gémir, composer dans le sable une instance de murmures et de torsions.
Le Creux n’en changeait point pour cela de caractère et les livres de l’obstination spirituelle se lisaient avec autant de calme. »
*
« Il y avait dans Préault une passion qui pour être pétrie de colère et de haine n’en était pas moins douloureuse, au contraire. Il était complètement buté, plus il s’enfonçait dans l’asservissement et plus il se croyait libre, ou en voie de le devenir.
Il était enchaîné à son poste de T.S.F. ; la vie lui arrivait par là. Fuyant la présence des Allemands, il s’identifiait aux Anglais qui étaient libres des Allemands, mais il ne s’apercevait pas que dans cette identification il perdait la qualité de Français qu’il voulait justement sauver.
C’était exactement le phénomène inverse de celui qui se produisait pour d’autres qui, s’assimilant aux Allemands, ne se considéraient pas comme occupés. Et, en effet, ils ne l’étaient pas, mais alors ils n’étaient plus français, ce qu’ils prétendaient demeurer avec le même entêtement absurde que Préault.
Salis montrait une conscience beaucoup plus vive, une hypocrisie beaucoup plus active, un cynisme beaucoup plus dur. Il savait au moins qu’il n’était plus français et qu’il ne faisait plus semblant de l’être.
Il savait au moins que son patriotisme n’était qu’un mot d’ordre. Il croyait que les Russes et lui se confondaient dans un type d’homme commun où le Russe se dépouillait tout autant que lui. »
*
« Comme il se rendait au Creux dans ses sandales de silence, Constant fut arrêté par des voix qui venaient. Il se cacha. Il se trouvait au revers d’une butte qui dominait une petite conque de sable.
La silhouette s’y jeta avec l’autre silhouette prévue. Cela fit une femme et un homme. Ils s’offraient aux regards de Constant, terriblement ingénus, terriblement livrés.
S’il remuait, il causerait en eux ce qu’il y a de plus laid : ce geste de honte qui dit soudain l’asservissement de l’homme à l’homme, cette rougeur, ce désordre du visage et des mains qui dit que l’homme est toujours coupable devant l’homme.
Il ne pouvait pas remuer sans être entendu, car il était en plein dans les plantes grasses dont les racines étaient craquantes et il n’y a qu’au cinéma et dans les livres qu’une vie se déplace auprès d’une autre vie sans se déceler.
Cette femme et cet homme étaient dans un charme, ils étaient pour le moment dans l’état de grâce, dans l’état gracieux.
Ne pas jeter le désordre dans cet ordre fragile, attendre, cela ne durerait jamais bien longtemps.
Un autre spectateur aurait apporté, certes, un élément de trouble secret, aurait fait une présence blessante et malveillante, une malédiction.
Il aurait été la société qui sans cesse réclame son dû et, par exemple, considère comme des obscénités, beaucoup de gestes qui sans cesse échappent en toute innocence à l’individu qui sans cesse oublie cette société.
Mais Constant ne sentait en lui aucun de ces venins ; ces venins étaient dissous en lui depuis longtemps. Il n’était pas Constant, mais le monde. Le monde est le spectateur inévitable de ce qui se passe dans le monde. »
*
« Constant était étreint par une profonde mélancolie quand il considérait le voisinage de ces énormes et solitaires engins qu’étaient le pont et l’usine et de cette nature demeurée primitive, sables et marais.
La désolation naturelle et la désolation artificielle s’affrontaient dans une confidence sinistre.
Certes, la notion d’artificiel est un mensonge et tout ce que fait l’homme sort de la nature, pourtant Constant ne pouvait arriver à croire avec ses sens que cette fonte et cette brique étaient de la même matière que la vase et le sable.
Les longs bâtiments de briques pesaient sur l’embouchure de la rivière.
Leur couleur, à peine altérée par la fumée et les embruns, faisait de longs traits durs sur le fond mol des eaux, du ciel, des sables et des tourbes ; sa terrible sécheresse tranchait sur toute l’humidité naturelle de ce paysage du nord-ouest.
Mais sans doute un camp romain ou un château fort avaient dû produire au même endroit un effet aussi rébarbatif : ce qui étonne le plus l’homme, c’est lui-même, ce qu’il fait. »
*
« Il savait que dans tout ce qu’il avait pensé se préparait une réalisation centrale qui vraiment confirmerait sa vie, y introduirait cet élément sacré et définitif sans lequel il lui semblait qu’elle n’aurait pas été vécue et n’aurait pas trouvé son caractère propre d’éternité.
Était-ce pour trouver la piste de cette réalisation que lui qui était fort au-delà du christianisme et bien plus familier de la mystique arabe ou du Védanta que des Pères de l’Église grecque que pourtant il fréquentait encore, relisait depuis quelques temps les Évangiles, avec l’acharnement maniaque d’un lecteur de romans policiers ? »
*
« S’il était plus occupé, il n’oubliait pas pourtant les longues promenades, de cela il n’aurait jamais pu se passer. Il n’avait jamais été un plus grand errant qu’après qu’il avait été au bagne, c’était alors que ce grand voyageur était devenu précisément méditatif.
La méditation et la marche étaient pour lui la même chose. Qu’il fût dans une grande ville ou ailleurs, il marchait souvent la nuit. Encore maintenant, il ne perdait pas cette habitude et il aimait à déboucher des marais sur les dunes au petit jour. »
*
« Cette fresque livrait le sentiment même qu’il étreignait de plus en plus dans la vie : « Ici, un parfait athéisme engendre le plus pur sentiment du divin. » Selon son habitude, il avait dit cela plus qu’à demi-voix.
Bouddha avait à sa droite Osiris et Dionysos et à sa gauche le Christ et Athys. Il y avait en marge Orphée et Mahomet.
Le petit peintre aux yeux pâles dit cela d’une voix égale, douce, avec une mélancolie où il n’y avait aucune amertume et une absence d’inquiétude qui n’engendrait pas l’indifférence.
Constant et le petit peintre parlaient tranquillement, nonchalamment, comme s’ils s’étaient toujours connus. »
*
« Constant regrettait de n’avoir pas été peintre et moine comme Fra Angelico. La vie n’allait pas pour lui sans la religion et la religion sans la vie, un extrême sans l’autre extrême ; l’extrême abstrait n’était possible que dans l’extrême concret ; on ne pouvait spéculer sur le non-être qu’un pinceau à la main et en portant au bout du pinceau une de ces délicieuses couleurs qui sont le comble de l’éphémère et du réel. »
*
« Voici comment Constant avait connu Susini.
Le bistrot était mélangé comme le quartier : il y avait des pauvres et des moins pauvres, des plus rangés et des moins rangés. Les rangés sont un peu dérangés et les dérangés sont assez rangés.
Qui pourrait dire que celui-ci ou celui-là est exactement un ouvrier ou un employé ou un petit bourgeois ? Il y a tant de métiers dans Paris et tant de combines. Et puis sont-ils parisiens ou provinciaux ou étrangers ?
Et les femmes sont-elles putains ou autre chose ? Souvent un peu des deux. Le patron faisait aussi le restaurant : il se débrouillait bien et savait que sa clientèle ne pouvait supporter que des prix raisonnables.
D’ailleurs, une partie de cette clientèle était en combine avec le patron dans tel ou tel genre d’affaires.
Qu’est-ce qu’un bistrot ? C’est une officine où se traitent toutes les affaires matérielles et morales d’un coin de quartier et d’une coterie.
Il y a un secret auquel participent plus ou moins tous ceux qui entrent et qui boivent un verre ou prennent leur repas.
Il y en a qui passent et qui ne reviennent pas parce qu’ils sont refoulés par le secret, d’autres qui reviennent et qui ne sont jamais dans le secret mais qu’on garde parce qu’ils meublent le lieu.
Le réseau de la confiance et de la méfiance est plus lâche ici, plus resserré là. Tout cela est très stable, bien que de temps en temps il y ait des changements.
La règle s’appuie sur les exceptions : Constant était un peu à part et pourtant tout le monde avait admis d’emblée qu’il était dans le bain. »
*
« Quelquefois il se disait qu’il aurait pu se passer des gens ; il savait pourtant que les choses ne vivent que par les gens et que jouer des choses est le dernier moyen de communiquer avec les gens : à travers les choses on échange des messages. »
*
« Ce jour-là, Constant s’attardait dans le bistrot un peu plus tard que de coutume parce qu’il avait des cigarettes et qu’il s’était perdu dans la rare et mince béatitude qui sortait de ces petits tuyaux de papier qui contenaient quelques grains de poussière chaude. »
*
« Constant passa une journée agréable. Il rentra chez lui et, après s’être lavé, compara un passage du Zohar avec un passage de la Brihad Aranyaka Upanishad. Sur du beau papier, il transcrivit face à face les deux textes.
Il avait une belle écriture ferme qui lui donnait un peu du plaisir du dessin, lequel lui était interdit. Il écrivit le texte juif en noir et en rouge le texte indien, à qui allait sa préférence. En dessous, il marqua un bref commentaire. »
*
« — Je me suis aperçu depuis deux ans que les Allemands sont très faibles eux-mêmes. L’hitlérisme n’a été que le sursaut de quelques-uns d’entre eux, qu’ils ont pu imposer à la masse parce que celle-ci était aux abois. Les Allemands n’étaient pas assez jeunes pour se jeter dans le communisme et y faire peau neuve.
Au fond, l’hitlérisme, en dépit de son côté héroïque, n’a été pour eux que le juste milieu entre le capitalisme et le communisme, entre le nationalisme et l’internationalisme. Mais ils se sont avérés incapables de faire vraiment l’Europe socialiste, ce qui aurait été leur justification.
— Alors ?
— Alors, soupira amèrement Bardy, je ne crois pas plus aujourd’hui au national-socialisme qu’à la démocratie. Je crois que le national-socialisme qui a essayé de se dégager de la démocratie s’y résorbera et que tout cela pêle-mêle sera écrasé par la Russie.
Et ce sera bien, car mon idéal d’autorité et d’aristocratie est au fond enfoui dans ce communisme que j’ai tant combattu. Je recevrai la mort des communistes avec une amère satisfaction. »
*
« Ici encore, Constant intervenait :
— Vous êtes patriote contre les Anglais, lui l’est contre les Allemands. Vous n’êtes plus du tout patriotes les uns ni les autres. L’époque du patriotisme, finie !
Il s’agit d’une guerre civile mondiale, une guerre de religions. Bardy aime mieux que la France soit allemande que menée par Préault et Préault aime mieux que la France soit anglaise ou américaine qu’aux mains de Bardy. Ainsi, les protestants livraient la France aux Allemands et aux Anglais et les catholiques aux Espagnols. »
*
« Constant, qui avait passé sa vie hors de France, n’en était pas moins tombé chez les Eskimos ou les Patagons dans les plus sordides manies françaises.
Il le savait ; nul mieux que lui ne savait que les recherches mystiques ne vous font pas sortir du camp de concentration de la comédie humaine dont une des sections est la comédie des caractères nationaux, et c’était peut-être pour cela qu’il était rentré en France en 1938 pour bien constater que le plus large ne l’avait pas guéri du plus étroit ni le plus profond du plus superficiel et qu’un ermite planétaire reste toujours digne de figurer dans un guignol de canton.
Son maître, Nietzsche, le subtil germanoslave, lui avait aussi enseigné cela que la métaphysique ne doit jamais perdre la tête et doit savoir se pincer et se piquer pour se rappeler sa concrète condition.
« Corriger toujours Pascal par La Fontaine et Molière comme ceux-ci par celui-là. » D’ailleurs, le mythe du surhomme était ineffablement intime, comme ne pouvaient guère le soupçonner de primaires disciples politiques. »
*
« Du moment que la France était au ciel, aussi bien vivre au ciel et ne se soucier plus que des dieux, et au-delà des dieux qui sont presque aussi particuliers que les patries (Jésus et Marie, le Sacré Cœur et Saint Joseph, en face de Vishnou ou de Çiva) de Dieu, et, au-delà de Dieu qui n’est qu’une pénible abstraction de toutes les choses concrètes, de l’indicible que les Upanishads, les Sutras bouddhiques, le Tao, le Zohar s’appliquent à dépouiller de toute catégorie.
Nietzsche, qui mieux que Kant et Schopenhauer, Hume ou Berkeley, avait atteint l’extrême mobilité et l’extrême souplesse de la pensée et rejoint les modèles indiens, thibétains et chinois, avait été là encore un bon maître. Quelle merveilleuse combinaison il avait proposée de l’extrême détachement bouddhique ou taoïste avec l’indélébile pragmatisme de l’Occident. »
*
« — Cela dépend des pays. Dans les pays de formation vraiment germanique et protestante, la démocratie est un vêtement solide, presque une armure, parce que c’est une démocratie modérée avec des éléments autoritaires profondément balancés, dissimulés et hypocrites. En fait, dans ces pays-là, il n’y a pas démocratie mais libéralisme, c’est tout à fait différent.
— Ah, vous êtes de mon avis : l’Allemagne est à demi slave, c’est pourquoi elle n’a pas pu plus que la Russie acclimater le libéralisme.
— La France souffre de la démocratie, c’est un pays qui oscille sans cesse entre l’anarchie et la dictature policière. Ce n’est pas un pays libéral, mettons à part la licence intellectuelle. L’Italie, l’Espagne sont des pays trop primitifs pour le libéralisme, comme l’Allemagne et la Russie. »
*
« La séduction quand elle est seulement physique ne va pas souvent bien loin ; mais il est une séduction d’un ordre nerveux plus subtil et plus efficace. »
*
« Cormont n’était pas un bourgeois comme Préault, pas un ouvrier comme Salis.
Moi-même, si j’étais pour quelque chose, je serais pour une internationale. Seulement, aucune envie de prendre parti, les idéologies n’existent pas, il n’y a que des empires qui sont tous de proie, comme de bien entendu, et qui cachent mal leur puissante obscénité sous des haillons idéologiques. Pourquoi prendrais-je parti pour Washington, Berlin ou Moscou ? J’aime mieux la philosophie thibétaine. »
*
« Abraham voulait zigouiller lui-même son Isaac. Mais les religions antiques étaient tombées en décadence… La décadence, toujours la décadence. La vie est une perpétuelle décadence depuis le début… on tuait des béliers et non plus des hommes. La vraie religion c’est la religion mexicaine : fendre un homme par le milieu et lui arracher le cœur. Qu’un cœur d’homme palpite dans une main d’homme, voilà toute la vie. »
*
« — Alors, au fond, j’étais votre seul ennemi, dit Cormont.
— Oui, petit con, fit Susini.
— Alors, tu vois, j’ai raison sur ce plan-là aussi, jubila Constant. J’ai réuni, dans mes deux ennemis, les deux extrêmes ; l’extrême vérité de demain, l’extrême vérité d’hier – le nationalisme agonisant, la nécessité internationale de demain. Je veux supposer pour la beauté de mon geste que ce margoulin du marché noir était le serviteur des Empires… Mais duquel, l’Américain ou le Russe ?
— L’empire mondial ne peut être qu’un empire juif, les Juifs gagnent sur les deux tableaux : Washington et Moscou.
— Tu n’es pas juif.
— Non, je suis le contraire d’un Juif, Corse.
— Curieux, curieux… En tout cas, vous ne trouvez pas que je suis beau : je suis le Melchisédech, le Grand Prêtre éternel. Je vais achever, de mes mains, la France. »