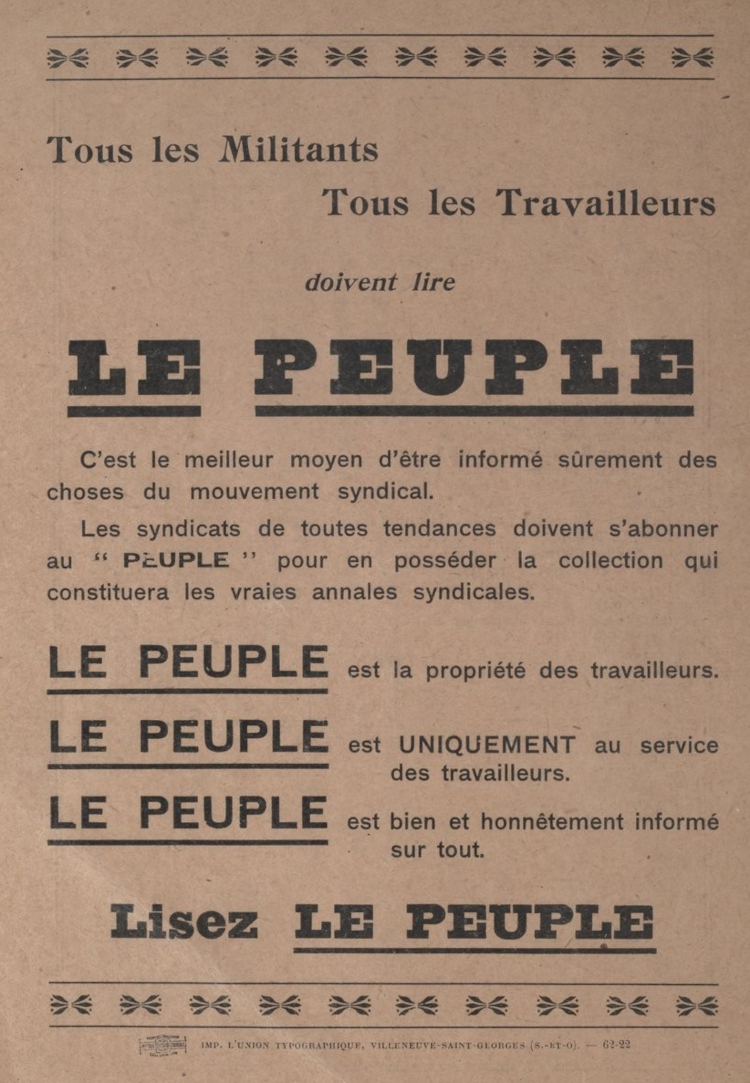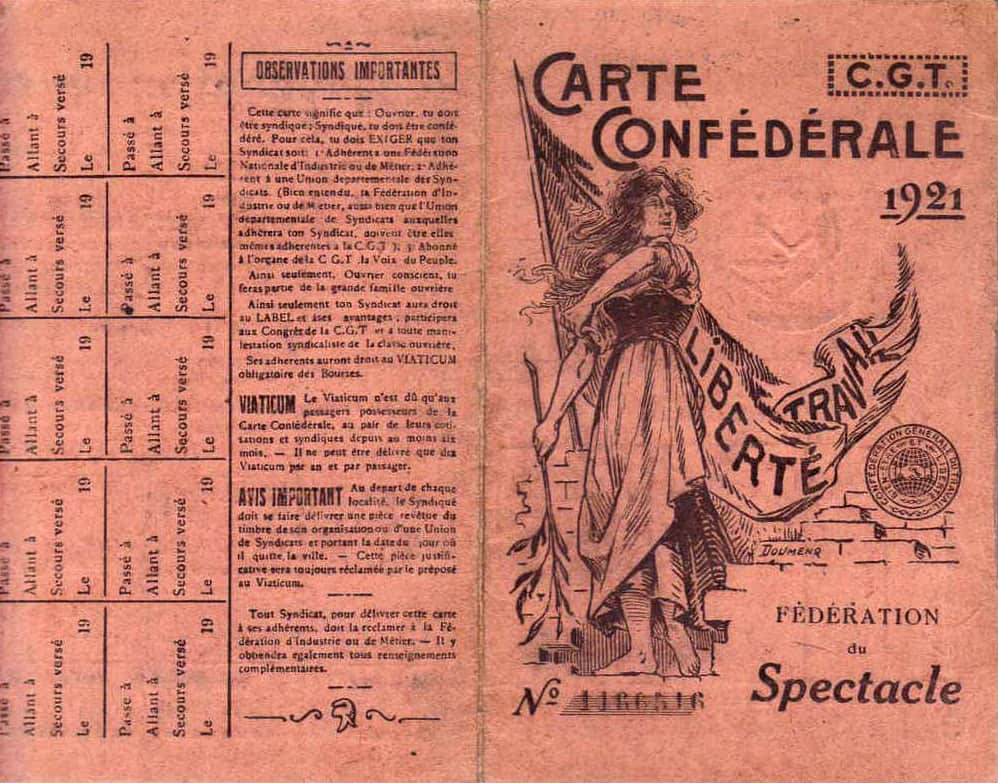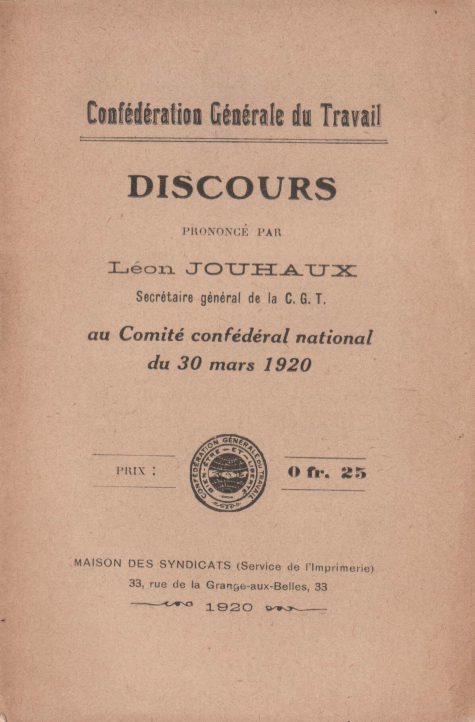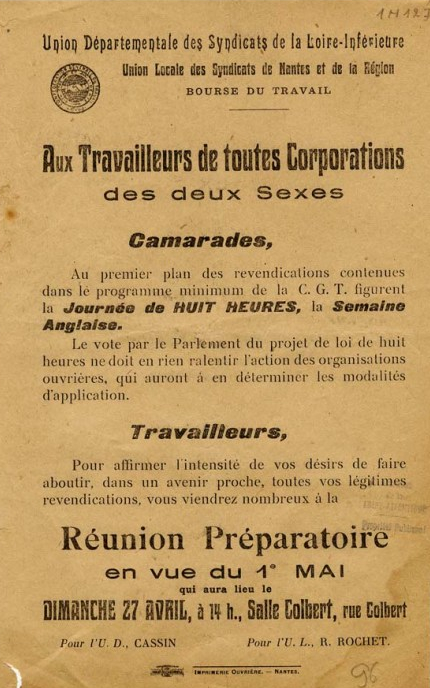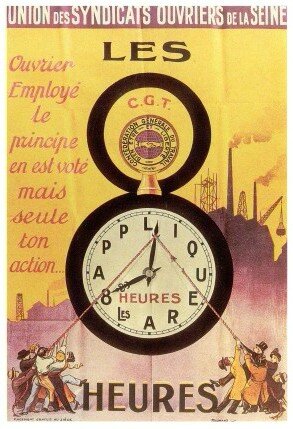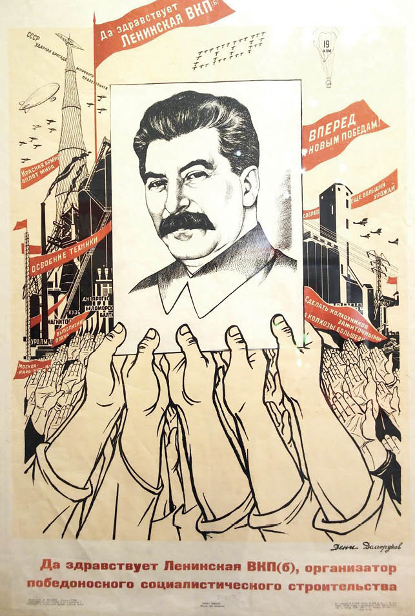
Le matérialisme dialectique considère qu’il n’y a aucune différence entre le corps et l’esprit, au sens où il n’y a pas d’esprit : les activités cérébrales forment une synthèse de la réalité matérielle d’une personne, sous la forme d’une réflexion par la matière grise.
Cette réflexion est plus ou moins imparfaite, selon la capacité de synthèse de la personne, en raison de la contradiction entre l’espace et le temps. La démarche réflexive ou, si l’on veut, intellectuelle, est en retard sur le processus matériel ; la place de la personne dans le processus découvert est en contradiction avec le rythme propre à ce processus.
C’est ce qu’on appelle l’expérience : il y a d’abord l’expérience, ensuite le reflet de l’expérience sous forme de réflexion, dans l’intellect. Toute connaissance réelle n’est pas « neutre », « extérieure », mais au contraire partie prenante de la réalité.
Mao Zedong résume cela en nous disant que :
« Si l’on veut acquérir des connaissances, il faut prendre part à la pratique qui transforme la réalité.
Si l’on veut connaître le goût d’une poire, il faut la transformer : en la goûtant.
Si l’on veut connaître la structure et les propriétés de l’atome, il faut procéder à des expériences physiques et chimiques, changer l’état de l’atome.
Si l’on veut connaître la théorie et les méthodes de la révolution, il faut prendre part à la révolution. Toutes les connaissances authentiques sont issues de l’expérience immédiate. »
Il n’y a toutefois pas que le décalage entre l’expérience et la réflexion. L’expérience est la constatation d’un phénomène qui est lui-même, au sens où il est seulement ce qu’il est, même si sur le long terme il se transforme (tel le soleil se levant tous les jours, ce qu’on peut constater pareillement, même si le soleil s’éteindra un jour).
Cependant, la réflexion est ce qu’elle est tout en n’étant pas ce qu’elle est. Toute réflexion est en effet contradictoire, de par la tension entre le particulier (du phénomène) et le général (de la connaissance), entre le particulier (de celui qui réfléchit) et le général (qui est la Nature où se produit le phénomène), entre le particulier (d’une connaissance précise) et le général (d’une activité réfléchie), etc.
Une réflexion est un processus, qui aboutit à une synthèse, sous la forme d’un concept. Mao Zedong nous présente cela de la manière suivante.
« La continuité de la pratique sociale amène la répétition multiple de phénomènes qui suscitent chez les hommes des sensations et des représentations.
C’est alors qu’il se produit dans leur cerveau un changement soudain (un bond) dans le processus de la connaissance, et le concept surgit.
Le concept ne reflète plus seulement l’apparence des choses, des phénomènes, leurs aspects isolés, leur liaison externe, il saisit les choses et les phénomènes dans leur essence, dans leur ensemble, dans leur liaison interne.
Entre le concept et la sensation, la différence n’est pas seulement quantitative mais qualitative. »
Toutefois, et c’est là un aspect essentiel, le rythme de la synthèse dans la réflexion n’est pas le rythme de la synthèse du phénomène observé. La compréhension de l’envol d’un oiseau par le cerveau est une synthèse dont le rythme est différent de l’envol de l’oiseau, lui-même une synthèse matérielle d’un phénomène particulier.
Cela est conforme à la loi du développement inégal. Si toutes les synthèses de produisaient de manière uniforme, cela serait unilatéral et il n’y aurait pas de contraste, pas de contradiction.
C’est en raison de ce développement inégal que l’humanité, pendant des millénaires, a cru qu’il existait une différence majeure entre le « corps » et « l’esprit ». Constatant le décalage entre les rythmes synthétiques de part et d’autre, l’humanité a considéré que puisque le rythme était qualitativement différent, alors la différence entre les deux était qualitative.
Il y aurait le corps d’un côté, l’esprit de l’autre, ayant chacun leur propre nature.
C’est unilatéral, car l’activité cérébrale est bien en décalage avec le reste du corps, mais également avec l’ensemble des phénomènes. Aristote avait bien vu cela et c’est pourquoi il faisait du philosophe authentique un grand contemplateur de la Nature, tout en considérant que la pensée n’était pas individuelle, mais une Pensée universelle et anonyme flottant en-dehors de la matière.
Il maintenait la différence qualitative entre le « corps » et « l’esprit », mais en refusant d’abandonner le matérialisme et de considérer qu’il y aurait une multitude d’esprits individuels en rupture complète avec la Nature (comme le fait inversement Platon avec « l’âme » éternelle dont disposerait chacun).
On remarquera ici que la hantise de robots prenant leur indépendance et supprimant l’humanité relève également précisément d’un fétichisme opposant de manière idéaliste le « corps » et « l’esprit ». Cette hantise est une simple inversion du rapport idéalisé entre le « corps » et « l’esprit », au sens où le corps serait le support de « l’esprit » pour les humains et un « esprit » nouveau, menaçant, serait le support du corps pour les robots.
Le matérialisme dialectique permet de saisir les choses de manière adéquate, en saisissant que les modalités de la synthèse sont différentes entre un phénomène et une réflexion intellectuelle. Que non seulement toute réflexion est un reflet, qui est forcément en retard sur le phénomène puisque reflet, mais que même toute réflexion relève d’un développement synthétique sur le long terme, possédant son propre rythme.
Cela pose la question du rapport entre l’espace et le temps lors de l’activité cérébrale et lors de l’activité corporelle. Il est évident que les réflexions ne sont pas de même nature, justement, si elles portent sur des micro-secondes d’un phénomène, sur des secondes, sur des minutes, sur des heures, des années, des millénaires, etc.
Sans doute peut-on ici aller dans le sens d’une typologie des esprits, en considérant que l’affinité avec tel ou tel domaine de la connaissance humaine, de la synthèse – les arts, les sciences, les jeux, etc. – repose précisément sur la focalisation de la réflexion sur telle ou telle contradiction de l’espace et du temps dans un phénomène et dans sa propre réflexion.
Il y a ici une différence de mode opératoire, qui n’est visible que si l’on distingue les modalités spatio-temporelles du phénomène et de la réflexion intellectuelle de ce phénomène.
>>Revenir au sommaire des articles sur le matérialisme dialectique