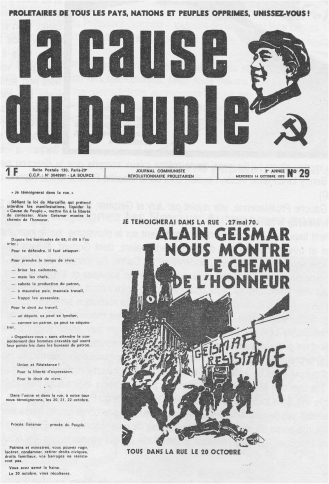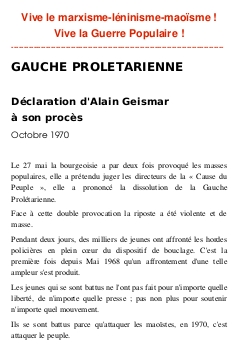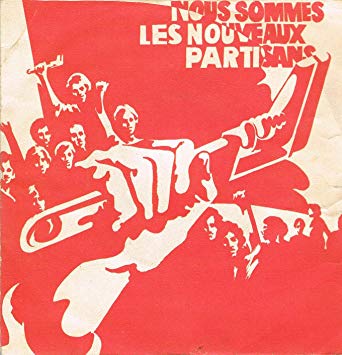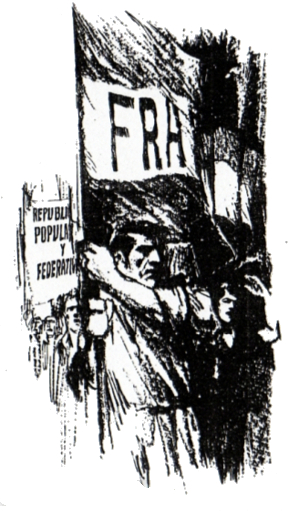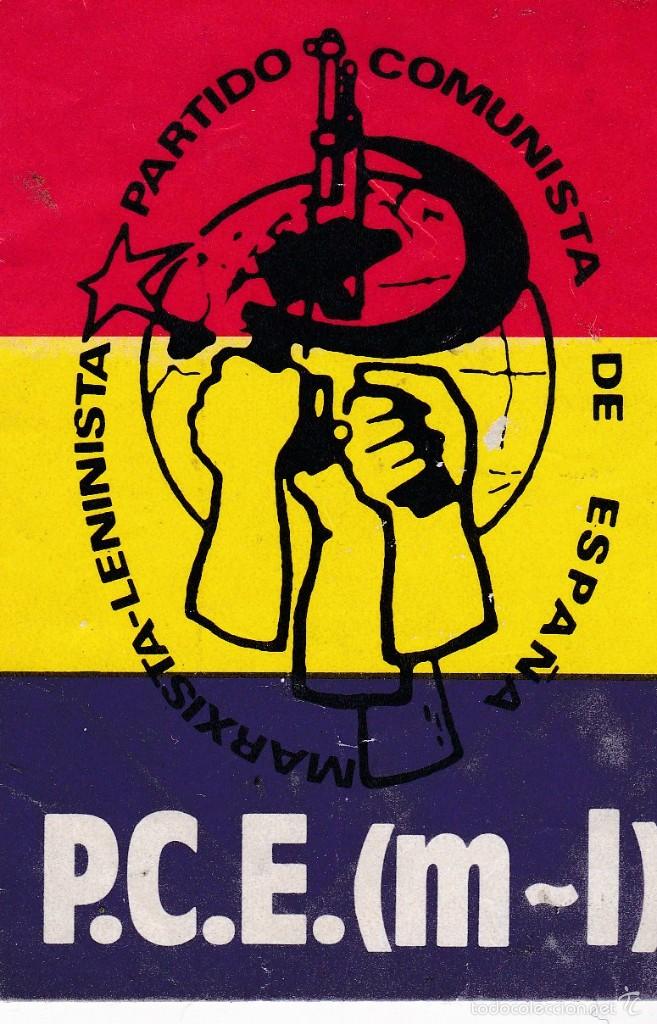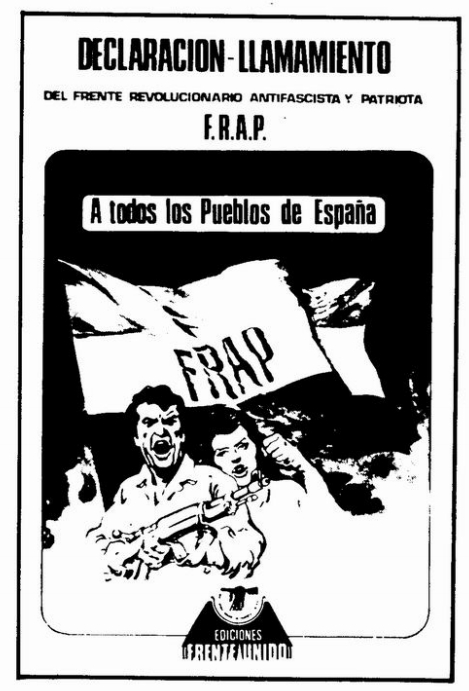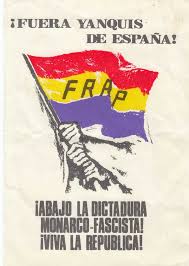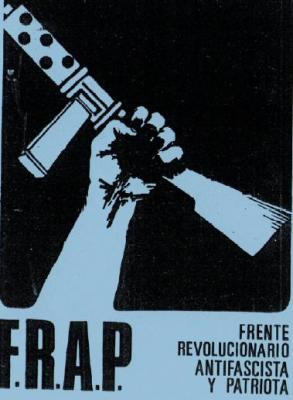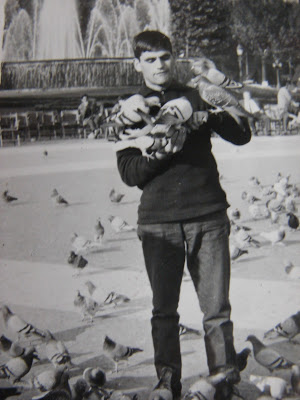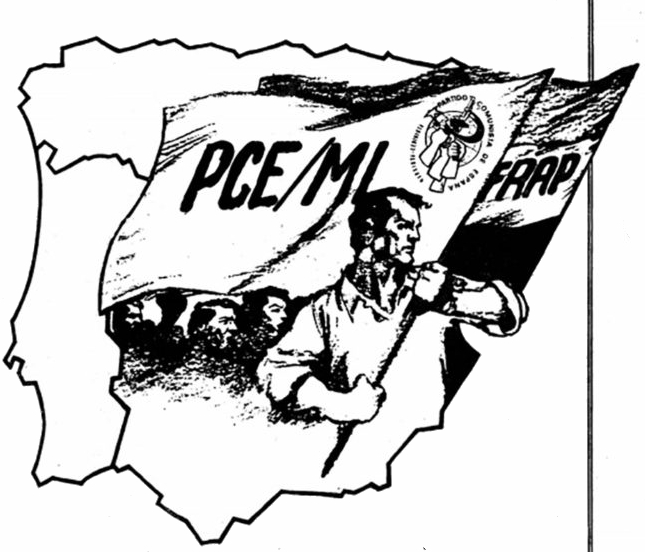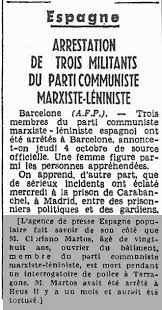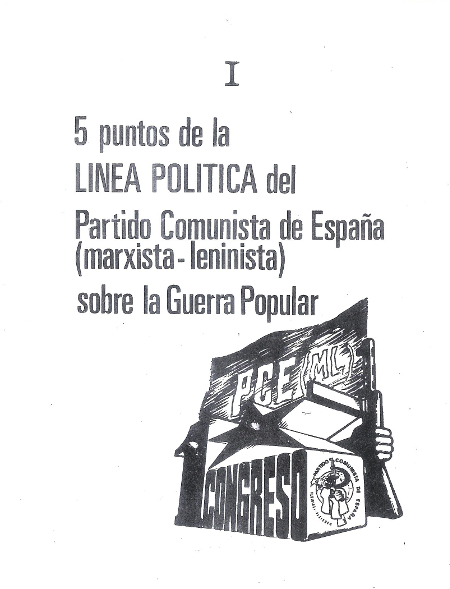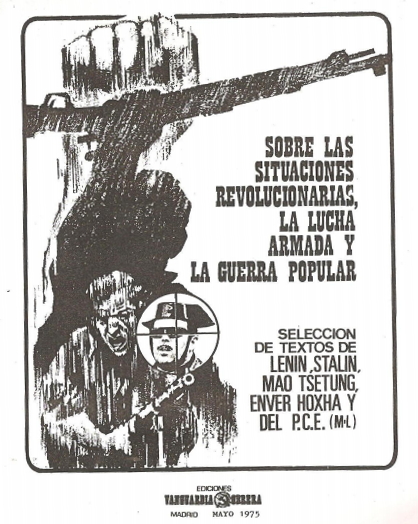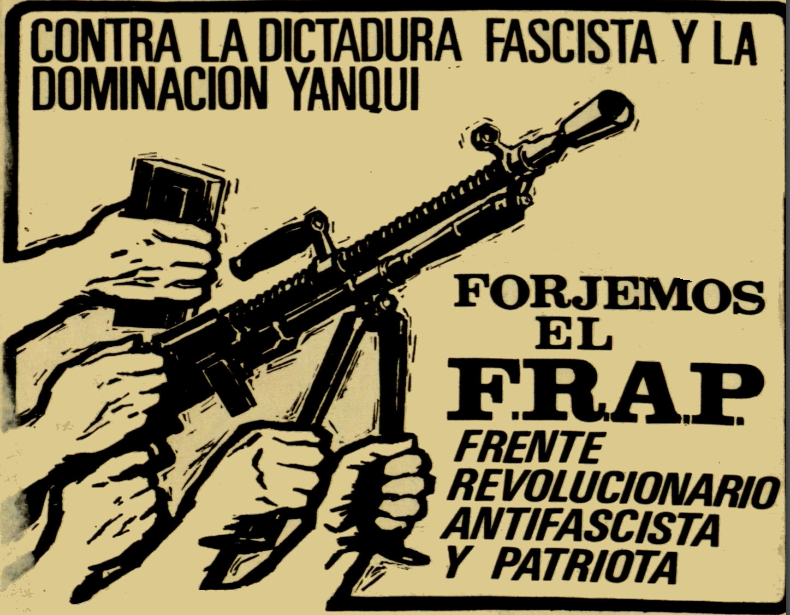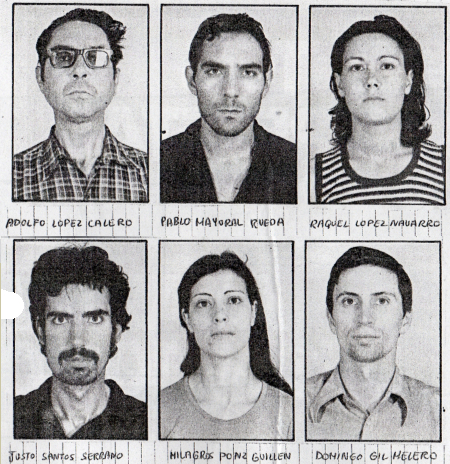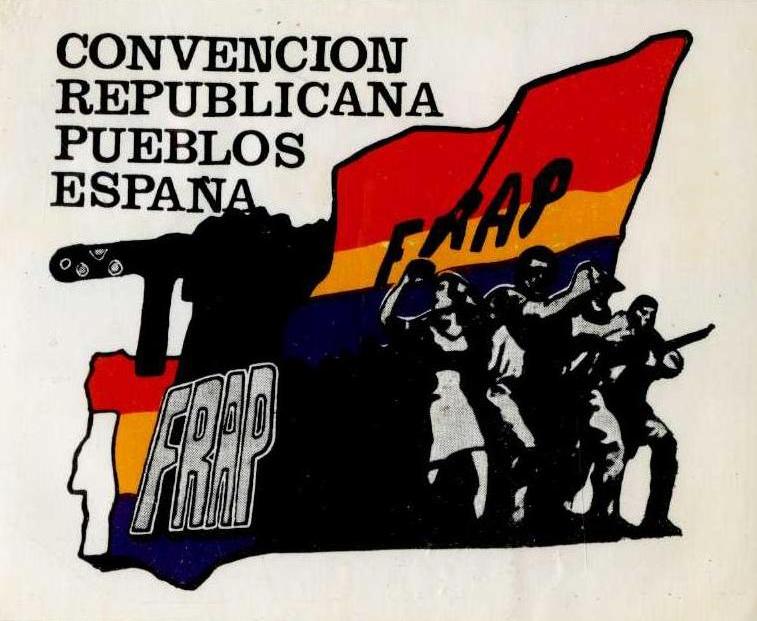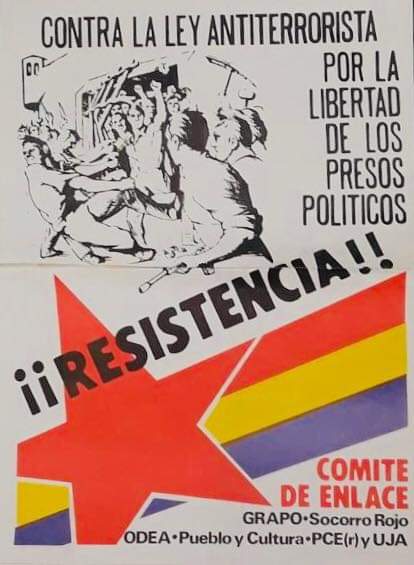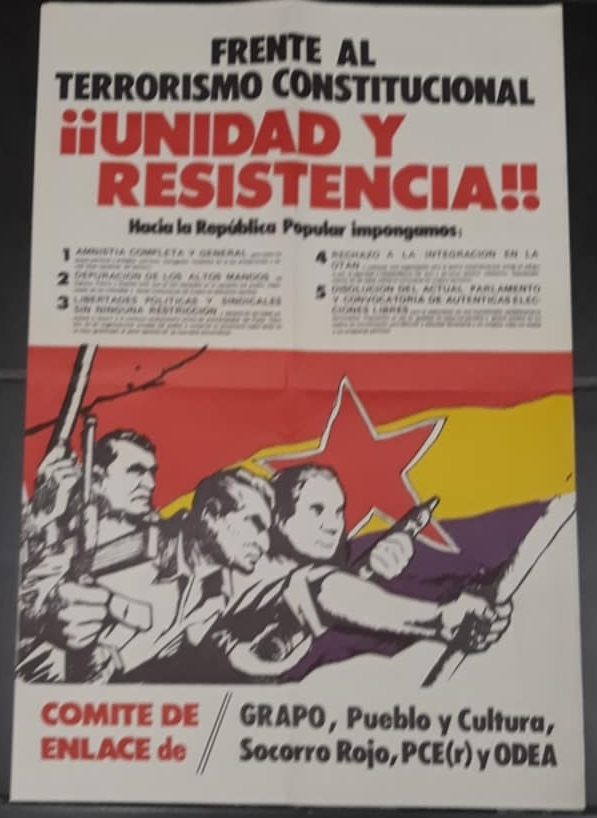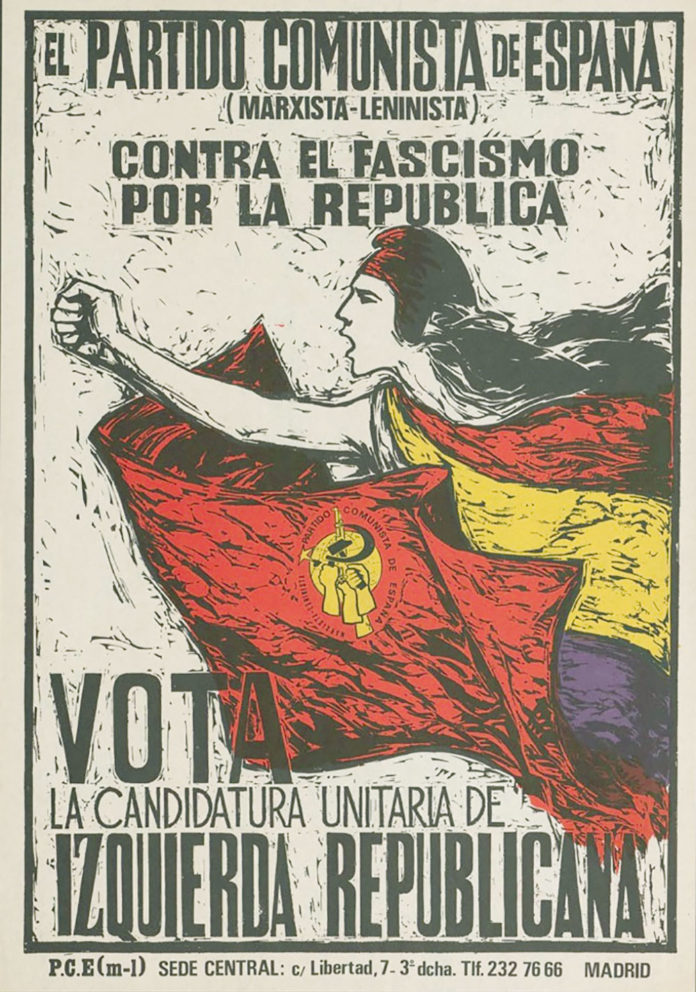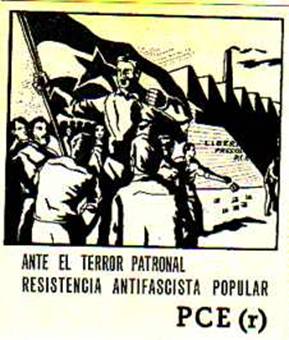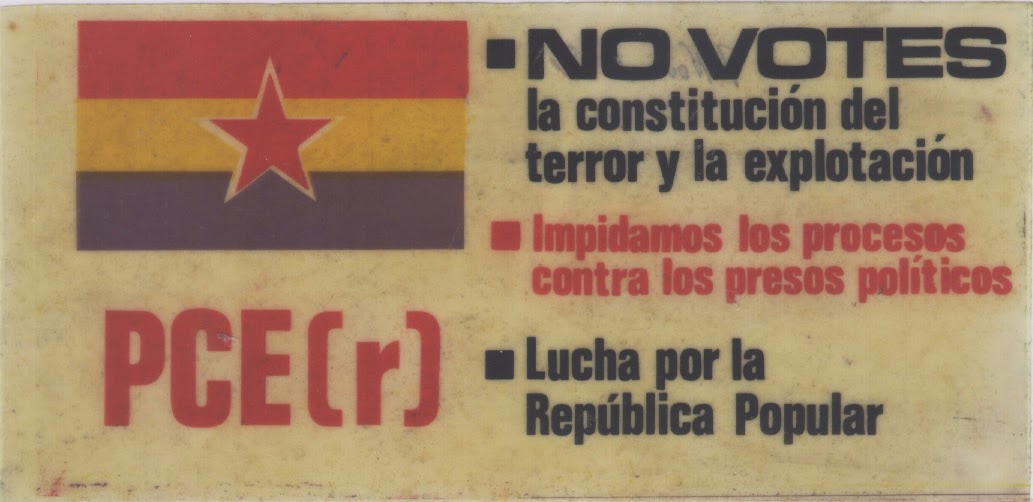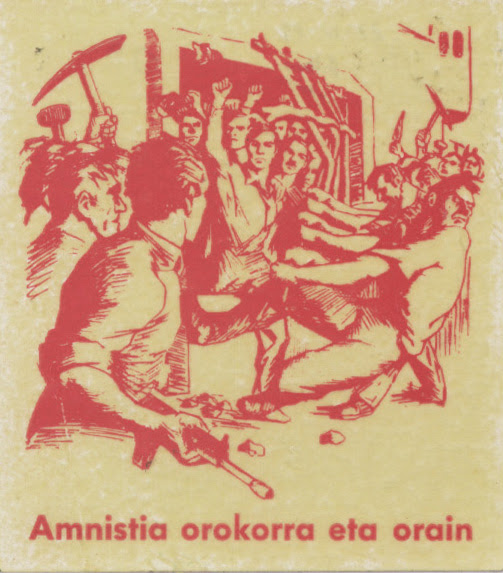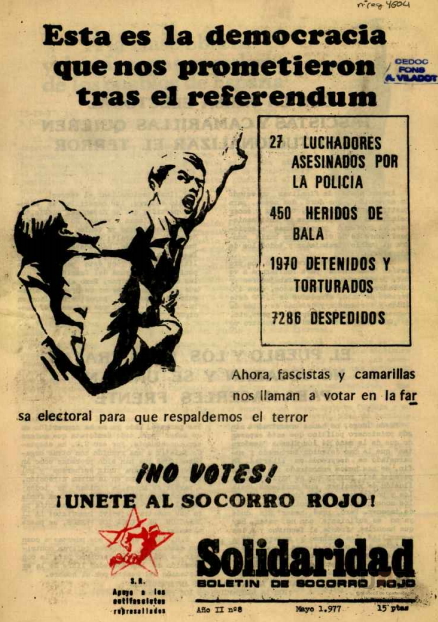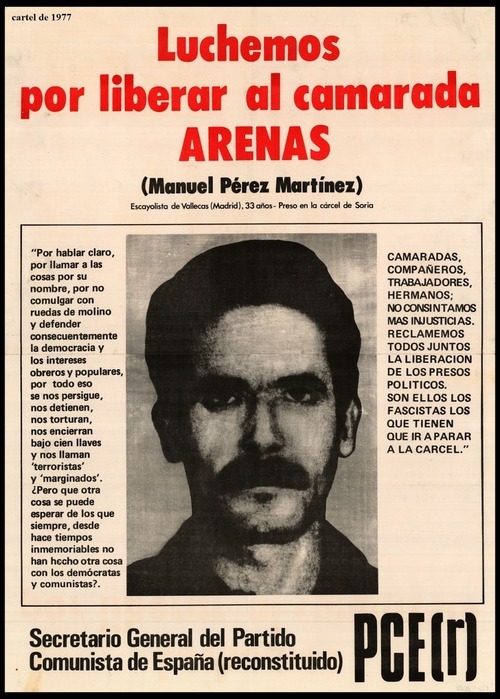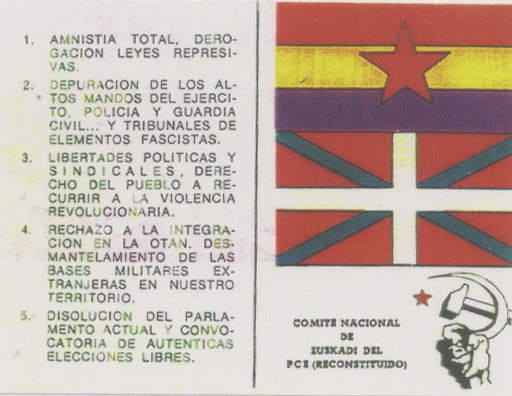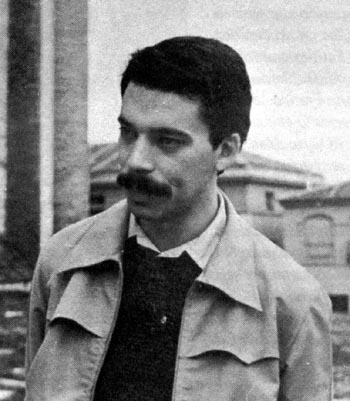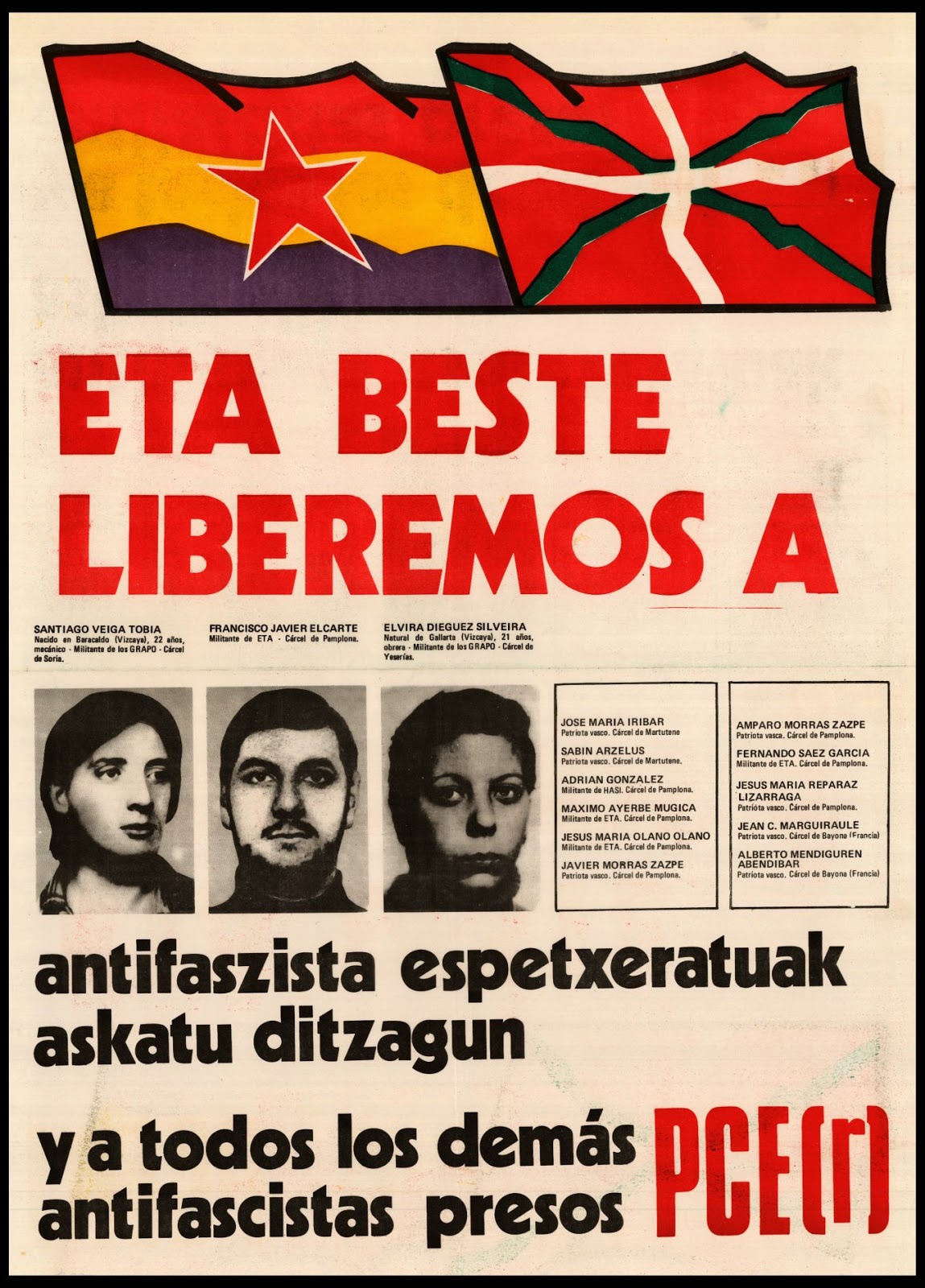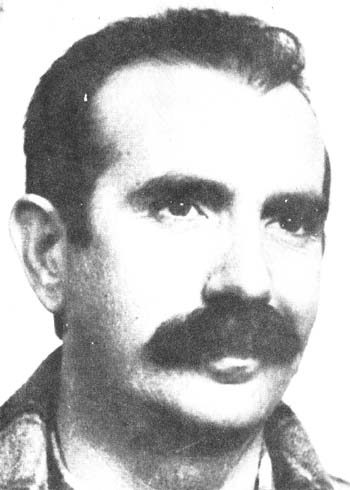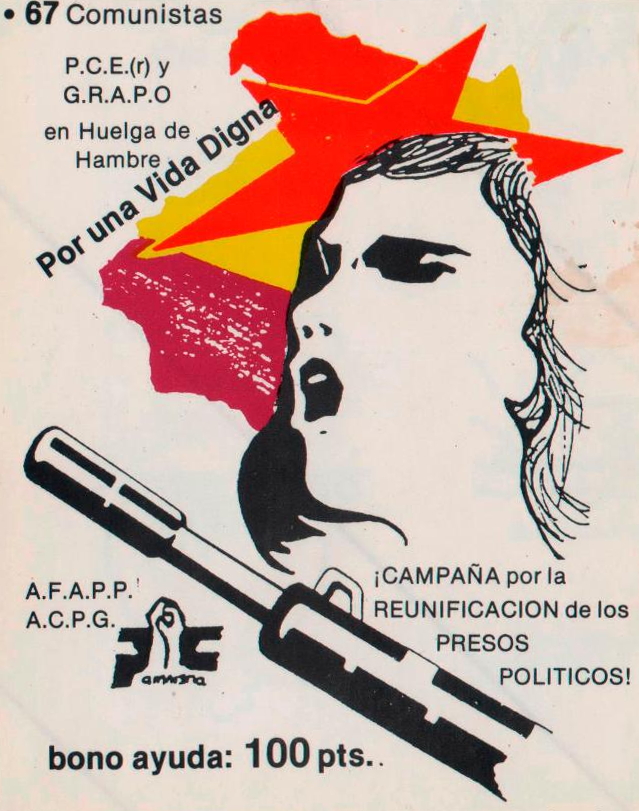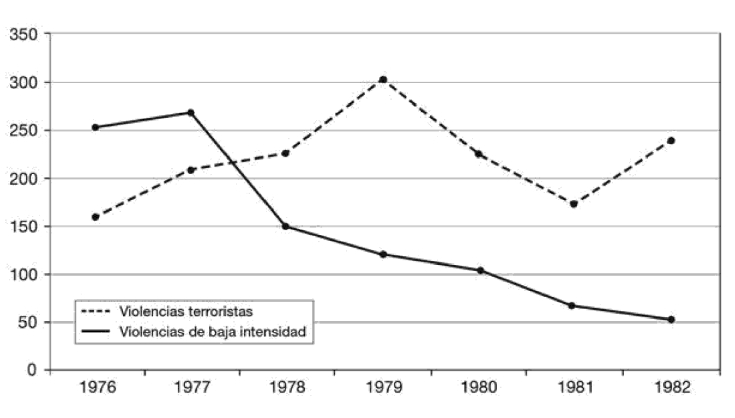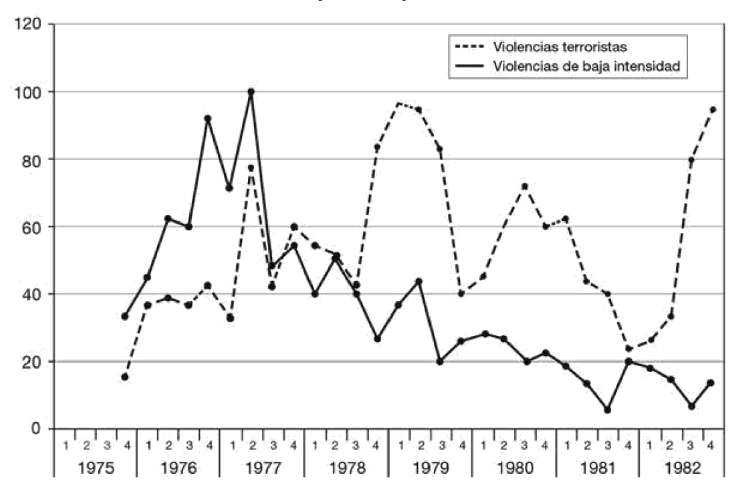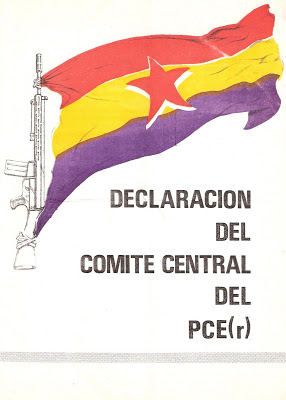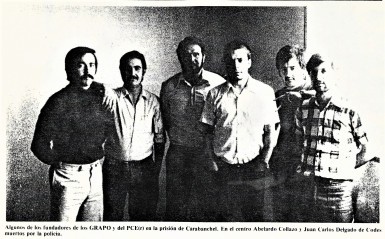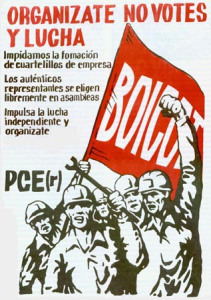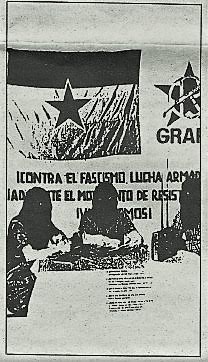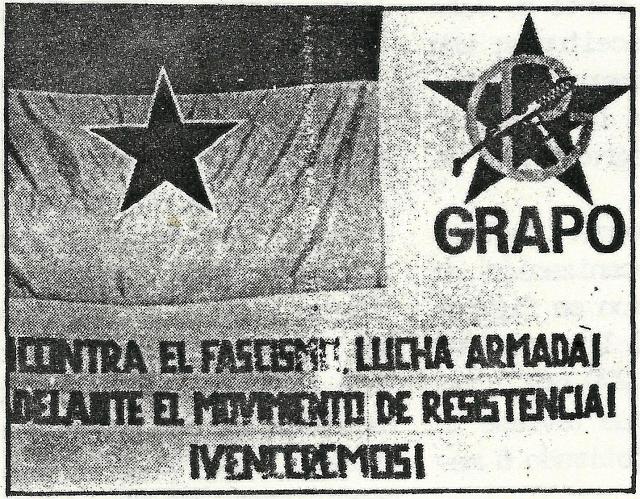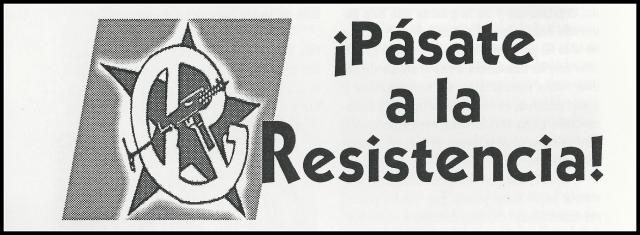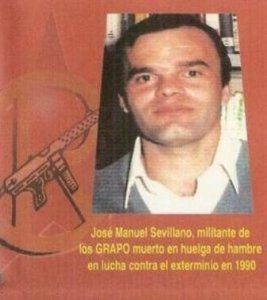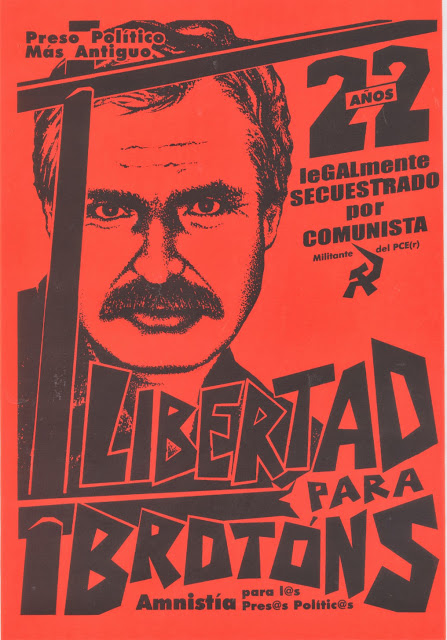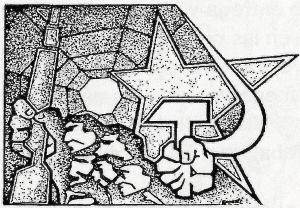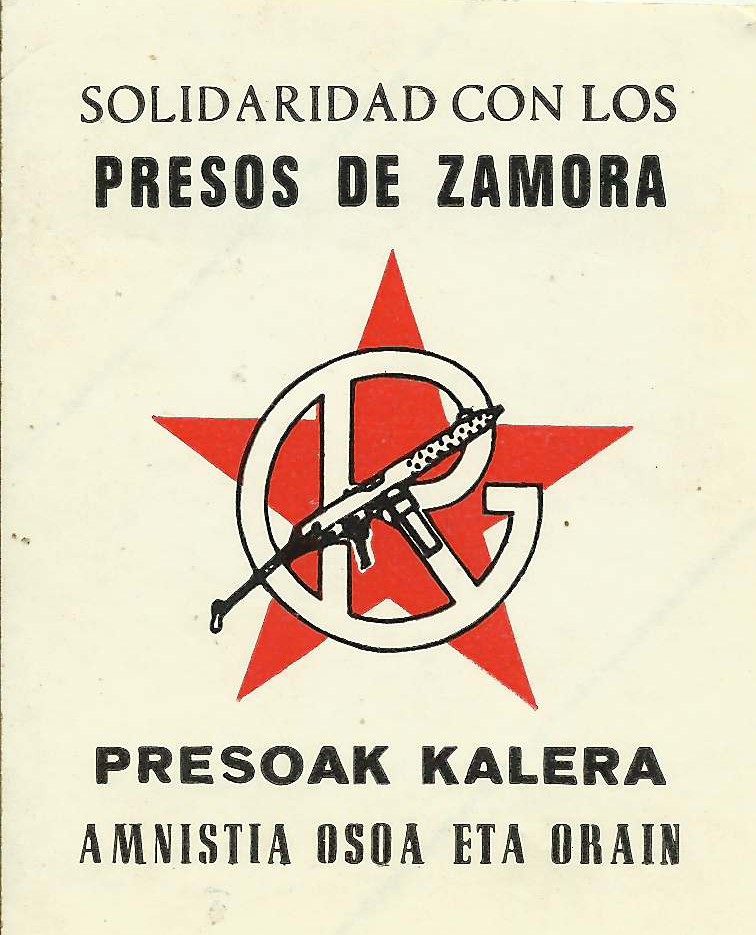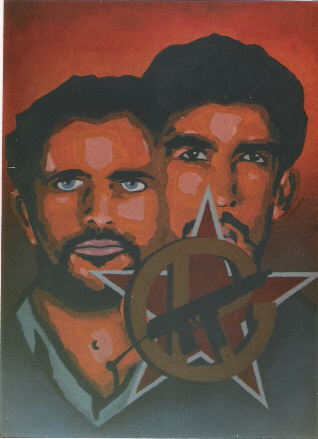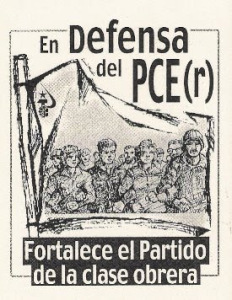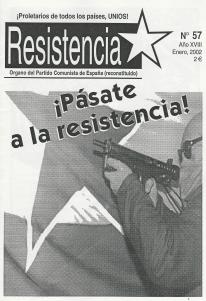[Cette enquête date de 1971, juste après l’auto-dissolution de la Gauche Prolétarienne. Les membres de la GP voulaient s’éparpiller dans les masses pour contribuer à la naissance du Parti. L’enquête consiste en des interviews des membres de l’ex-GP, sur leur parcours, leur interprétation de la ligne de masse, sur comment fonctionnent les structures, etc.
Ici, Victor est en fait Benny Lévi, le dirigeant historique de la GP.]
VICTOR. – Je n’ai pas découvert la politique juste avant Mai 1968.
Déjà en 65-66, nous étions plusieurs à décider d’entrer dans les grandes écoles d’État pour avoir un salaire qui nous permette de militer.
Je n’appartenais pas à une famille où l’on parlait politique ou si l’on en parlait, c’était du mauvais côté.
Ce qui a été déterminant pour moi, cela a été, je crois, la découverte de la réalité des pays dominés par l’impérialisme. Le nombre de camarades qui se sont très vite lancés dans la bagarre parce qu’ils étaient passés par les pays africains ou arabes est assez important.
– La découverte du tiers monde?
VICTOR. – Oui, mais directement, pour y être passés. On a commencé le travail vraiment organisé, après la guerre d’Algérie, à l’intérieur de l’UEC (Union des Etudiants Communistes).
D’abord, c’était dans le secteur de lettres, et puis on a démarré sur Ulm (l’Ecole Normale Supérieure), à l’époque d’Althusser.
La tactique qu’on a eue alors était d’organiser le maximum d’étudiants sur la base de la défense presque théorique du marxisme, donc très rapidement la contradiction entre cette fraction et la direction officielle de l’U.E.C. s’est aiguisée.
Ça a débouché sur la scission et donc sur la création de l’U.J.C.M.L. à laquelle j’ai participé. Quelques semaines après la création de l’U.J.C.M.L. on a commencé à créer les premiers comités Vietnam de base.
– Avant Mai 68, pensiez-vous qu’il allait se passer quelque chose assez rapidement, ou étiez-vous partis pour une aventure de longue haleine?
VICTOR. – On partait pour une aventure de très longue haleine.
Il y a eu chez certains d’entre nous, quelques semaines avant Mai 68, après Caen et Redon surtout, le sentiment qu’il y aurait de très fortes explosions ouvrières. On partait pour une alliance avec les syndicats. C’était incontestablement l’idée dominante.
– L’idée de rétablissement existait déjà?
VICTOR. – Avant Mai 68, il y avait déjà une dizaine de groupes d’établissement.
On favorisait l’établissement par petits groupes, pour que lek gars ne se retrouvent pas seuls dans une situation entièrementv nouvelle.
A l’époque on les appelait des » syndicalistes prolétariens « . Ils devaient militer à l’intérieur de la C.G.T., être très durs sur les positions de la lutte des classes, durcir les mouvements, radicaliser toujours et défendre la C.G.T. au nom de sa tradition.
– Ils ne se faisaient pas exclure?
VICTOR. – L’expérience de toute façon a été brève puisque le premier groupe de syndicalistes prolétariens que nous avons formé a commencé dans le Sud-Est en janvier 68.
Du mois de janvier à mai 68, il n’y a pas eu beaucoup de temps et pas un seul exemple de conflit ouvert entre ces groupes et une partie des masses, ou la direction de la C.G.T.
Il y a eu des exemples où on est intervenu lors de mouvements de masse qui étaient bradés par une union locale ou une union départementale.
Lors de ces trahisons on aidait à constituer des groupes de syndicalistes prolétariens, mais on n’était pas assez.
Le premier groupe syndicaliste prolétarien qui a été créé existe encore, plus en tant que syndicaliste prolétarien, mais les gars sont encore les dirigeants du syndicat C.G.T. dans leur boîte.
Ils ne se sont pas fait exclure, ils ont mené encore plusieurs grèves importantes.
– Quel était ton rôle?
VICTOR. – Mon rôle, c’était d’être un peu le professionnel de la barque. On avait une commission qui faisait circuler l’information venue des établissements, et qui aidait à la formation des premiers groupes syndicalistes prolétariens.
On essayait d’aider les camarades à l’intérieur des usines, à systématiser leur expérience et à dégager certaines règles pour un art de combat.
Nous étions quatre ou cinq à faire ça.
– Sur quoi vous appuyiez-vous, à l’époque, pour prendre vos décisions? Sur la pensée de Marx? celle de Mao?
VICTOR. – Non, pas exactement.
Il y a eu une première étape de l’U.J.C.M.L. fortement marquée par l’emprise théorique d’Althusser.
A ce moment-là, oui, on partait des livres, en règle générale; parce que c’est quand même à cette époque-là, qu’on a créé les comités Vietnam de base qui étaient une réelle organisation à caractère de masse.
Ce qu’il faut voir avec Althusser, c’est à quel moment il apparaît : fin de la guerre d’Algérie, le désarroi est très important dans le milieu étudiant.
Il y a bien sûr, dès cette époque, des courants théoriques gauchistes au sens strict, c’est-à-dire renouant avec la tradition théorique du gauchisme : on lit Lukacs, les premiers textes de Marcuse, les premiers de Lapassade, mais c’était un courant qui n’arrivait pas à donner aux étudiants oppositionnels une vue d’ensemble de la crise du mouvement communiste international.
Dans cet état de désarroi les premiers articles d’Althusser apparaissent un peu comme un mirage.
Pour pas mal d’entre nous, ça a été un formidable appel d’air : le retour à la lettre, aux origines, aux principes du marxisme, qui allait nous permettre de surmonter les difficultés pratiques.
Grosso modo, Althusser disait : il y a un révisionnisme et la nature du révisionnisme, c’est de réviser un certain nombre de principes du marxisme, donc si on les restaure, ces principes, on fait œuvre révolutionnaire.
Il faut comprendre 1° l’état de désarroi où nous étions, 2° le fait que de toute façon, on était dans un milieu coupé de la pratique de production et qui depuis la fin de la guerre d’Algérie était coupé de la pratique de la lutte de classes.
Althusser nous donnait du boulot et puis une certaine conscience de ce qui se passait. Une possibilité d’analyses. Tout le monde s’est précipité dessus.
Très rapidement, il y a eu deux tendances : celle qui partait d’Althusser pour vraiment faire de la théorie, la tendance qui a donné Les Cahiers pour l’analyse, et la tendance qui a pris comme point de départ Althusser, mais pour aller vers Mao. Les deux tendances se sont d’ailleurs retrouvées en Mai 68.
– Est-ce qu’Althusser parlait de Mao?
VICTOR. – Oui, dès ses premiers textes il parlait de Mao.
C’est ce qu’il avait de subtil. Le petit livre rouge n’était pas traduit en français. On avait les Œuvres choisies des Éditions sociales.
Nous avons commencé par les textes philosophiques de Mao, puisque c’était eux qui étaient étudiés par Althusser et puis, très rapidement, il a quand même fallu un an, on s’est emparés de toutes les œuvres choisies de Mao.
Althusser en parlait très élogieusement, mais dans un secteur déterminé : ses premiers articles portaient sur la contradiction, d’où il citait l’ouvrage du président, De la contradiction, mais il ne disait pas, alors qu’on était en pleine polémique sino-soviétique, Mao Tsé-toung c’est la vérité, et les Russes c’est le révisionnisme.
Il ne disait pas ça. Mais il faut rendre à César ce qui est à César, Althusser a été quand même un moyen d’accès à Mao Tsé-toung.
– La première fois que tu as lu ces textes de Mao, comment t’ont-ils semblé?
VICTOR. – Vu notre trajectoire, quand on arrive à Mao, on a déjà lu Le Capital, Lénine et tout ça, ce qui fait que la lecture de Mao, à ce moment-là, c’est un peu le délice théorique!
Quelque chose de grandiose qui parachève ce qu’on a pu lire dans Marx et dans Lénine. Ensuite, il a fallu tout relire.
Après la Révolution culturelle, tout change. Il a fallu complètement nous laver le cerveau.
Donc la première lecture de Mao est une lecture théorique très belle, qui comble d’aise, mais pour notre pratique il a fallu passer par une crise très importante, qui justement nous a amenés à l’établissement.
– Quand avez-vous pensé que la pratique de Mao pouvait vous être directement utile en France?
VICTOR. – On a commencé vraiment dans l’été 67.
Avant, évidemment il y avait eu les comités Vietnam de base. Leur différence avec le Comité Vietnam national était très simple.
D’une part, du point de vue de l’orientation, les comités Vietnam de base respectaient rigoureusement la ligne vietnamienne, c’est-à-dire que le soutien politique était total.
On reprenait intégralement les analyses et la ligne des Vietnamiens.
Première différence avec le Comité Vietnam national, puisque le C. V. N., où les trotskystes étaient la force la plus dynamique, n’hésitait pas à introduire sa propre marchandise sur le Vietnam.
Leur fameux coup : » II n’y a pas deux étapes de la révolution dans les pays dominés et la révolution au Vietnam est socialiste. «
Cela peut paraître archéologique, mais cela a été des débats qui nous ont divisés.
On ne se cognait pas à l’époque mais c’était très intense. Quand quelqu’un disait dans un meeting : » la révolution socialiste vietnamienne « , on poussait des hurlements!
Pour nous c’était une révolution qui avait un caractère démocratique, national, et ce n’était pas du tout la révolution socialiste. Ça peut paraître un débat oiseux, cela ne l’est pas, ça a une certaine importance.
Même si pour le moment, c’est relégué à l’arrière-plan.
La différence la plus importante était dans le style de travail. Nous voulions faire un travail de masse – premières formes d’implantation dans les quartiers, avec les panneaux, les tracts, la régularité, l’assiduité.
Chaque fois qu’il y avait des nouvelles qui venaient du Vietnam, toutes les semaines avec Le Courrier du Vietnam, on faisait des panneaux, pour décrire l’état de l’offensive du front, les nouvelles sur les atrocités américaines, tout ça.
Ce qui fait que les gens, dans certains quartiers de Paris (à l’époque nous militions surtout dans les quartiers de Paris) s’étaient habitués à nous. Une nouvelle image du militant, puisque déjà on ne voyait plus très souvent les gars de l’Humanité-Dimanche, et que les communistes n’allaient plus sur les marchés.
Chez les gauchistes, on était les premiers à faire cette apparition-là. On appelait ça : le style de travail de masse.
Et ce qu’on reprochait au Comité Vietnam national, c’était le style spectacle, grands gadgets : six heures pour le Vietnam mais pas de travail vraiment prolongé.
A l’époque il y avait des tensions redoutables, entre le comité Vietnam de base et le Comité national.
Les comités Vietnam de base avaient un journal, Victoire pour le Vietnam, qui faisait le point des expériences des comités et de ce qui se passait au Vietnam.
– D’où venait l’argent ?
VICTOR. – Des militants. Un journal comme ça se fait facilement. On tirait à six ou dix mille exemplaires. Les C.V.B. étaient une organisation réelle. Il y avait beaucoup de militants stables.
– Il y en avait dans toute la France ?
VICTOR. – Non.
La région parisienne, quelques régions de province, mais ce n’était pas vraiment toute la France. Comme le C.V.N. d’ailleurs.
Cela dit, quelques semaines avant Mai 68, cela s’était considérablement développé. Je me souviens au congrès national des C.V.B., on sentait une multiplication.
– Comment Mai 68 vous est-il arrivé?
VICTOR. – Un coup de tonnerre. A partir du moment où à Nanterre on a chassé Juquin [député communiste chargé de la question de l’éducation et de la jeunesse au « PCF »], on a senti qu’il y avait quelque chose qui se développait, ce qui fait que le 3 mai n’était pas un coup de tonnerre, mais du 3 au 10 mai alors là, on a complètement dérapé.
Même le 22 mars et la contestation, on est passé à côté. On ne voyait pas.
Le point de vue qu’on avait, c’était : les étudiants forment une composante importante, mais qui doit se lier aux masses, si elle ne se lie pas aux masses, elle n’a pas d’avenir.
Lié aux masses, au sens le plus physique du terme.
– Et quand avez-vous commencé à vous lier aux masses?
VICTOR. – A l’automne 67.
Tous les camarades issus des facs, tous les camarades étudiants, ont créé ce qu’on a appelé, à l’époque, un mouvement de soutien aux luttes du peuple.
Dès qu’il y avait un mouvement de grève quelque part, ils fonçaient, ils allaient aux portes des boîtes, etc. De ce point de vue-là, on savait aller à une porte de boîte.
Pour nous, Mai 68 n’était pas la découverte de la porte d’usine. Ce qui nous a permis, à nous, de comprendre un certain nombre de choses, mais un certain nombre de choses dans les boîtes.
Vis-à-vis du mouvement étudiant on était très profondément méprisant. Franchement méprisant. On avait un point de vue prolétarien très, très étroit.
On disait : les étudiants s’ils ne vont pas à la porte des boîtes, ils n’ont pas d’avenir, ou leur avenir c’est la bourgeoisie. Ce qui fait que la première semaine de mai a été l’épreuve de vérité.
– Comment l’avez-vous vécue?
VICTOR. – Oh là! Sur le moment comme pour tout le monde, c’était quelque chose qui nous débordait complètement.
Pour nous, plus particulièrement, puisque précisément, on était peu liés aux aspirations du mouvement étudiant. A posteriori c’est d’une manière critique qu’on repense à ces journées-là.
– Que faisiez-vous ? Alliez-vous dans les facs ?
VICTOR. – Pas vraiment.
On était dans les manifs, même la nuit des barricades où pourtant un certain nombre de dirigeants de l’U.J.C.M.L. avaient formellement condamné le développement des manifs au quartier Latin.
La thèse était : il faut partir du quartier Latin pour aller manifester dans les quartiers populaires.
Pourtant malgré ces condamnations très sévères, franchement réactionnaires, on allait aux manifestations.
On s’est même aperçus, quand on a fait l’union avec les camarades issus du 22 mars, quand on a pu faire avec eux le bilan de ces journées de mai, que pour la gauche étudiante de l’époque, l’U.J.C.M.L. apparaissait comme l’organisation qui avait le plus d’expérience militaire.
En fait, les premières manifestations étudiantes violentes avaient été menées sur le Vietnam et nous en avions été les organisateurs. On attendait beaucoup de nous du point de vue militaire, dans les manifs de la première semaine de mai.
Et on n’a évidemment rien apporté cette semaine-là, puisqu’on était en décalage…
Au cours de cette semaine il y a eu toutes sortes d’analyses théoriques pour justifier la position prise à l’égard du mouvement étudiant. Du 5 au 7 mai, par exemple, l’analyse c’était : attention il y a un véritable complot des forces social-démocrates pour s’emparer du mouvement étudiant, à leurs propres fins, aux fins de Mendès, Mitterrand, etc.
C’était encore l’analyse la moins farfelue, elle était fausse, mais elle avait une certaine vraisemblance.
– A quoi attribues-tu cette erreur d’analyse?
VICTOR. – Une méfiance à l’égard du mouvement étudiant du point de vue des classes.
La contestation proprement étudiante, l’existence des aspirations propres des étudiants, et de la jeunesse intellectuelle on n’y croyait pas.
Pour nous, il fallait sortir de l’Université. Seul le mouvement de sortie de l’Université pouvait constituer un objectif pour le mouvement étudiant qui devait être nécessairement un mouvement de soutien aux luttes du peuple.
– Et vous avez changé d’avis ? Pourquoi avez-vous rallié le 22 mars ?
VICTOR. – Après la nuit des barricades, on s’est aperçus qu’on s’était trompés.
Il n’y a pas eu le temps de faire un bilan, qui aurait entraîné un puissant mouvement de critique et de rectification dans nos rangs, pour la bonne raison qu’après le 10 mai, il y a eu le 13 mai et après le 13 mai, il y a eu la grève générale.
Donc, pas le temps de faire ça et tout de suite, on s’est trouvés pris dans les problèmes nés de l’apparition de la grève dans les boîtes.
Donc on a marqué le coup, après le 10 mai, se rendant compte qu’il y avait eu erreur, et tout de suite, on a foncé en/avant avec ceux dont on disposait à l’époque, c’est-à-dire les syndicalistes prolétariens, on a foncé dans les boîtes.
A ce moment-là, puisque c’était devenu un mouvement de révolte populaire, on s’est retrouvés avec les camarades avec lesquels on avait eu des divergences pendant la première semaine de mai, particulièrement les camarades du 22 mars, on s’est retrouvés avec eux le 24 mai et puis surtout on s’est retrouvés avec eux au moment où on a lancé les mots d’ordre de résistance prolétarienne à la reprise du travail, à la collusion gaulliste-C.G.T.
On s’est retrouvés avec eux, à Flins et c’est là, dans la pratique, que se sont tissés les premiers liens entre une partie du 22 mars et une partie de l’U.J.C.M.L., huit mois après Mai 68.
C’est seulement huit mois après, qu’on s’est unifiés dans la Gauche Prolétarienne, mais le baptême, le lieu de naissance ça a été, incontestablement, qu’on se soit rencontrés à Flins.
– Que s’est-il passé pendant ces huit mois ?
VICTOR. – Tout simplement, comme pour tout le monde, il fallait faire les comptes, le bilan.
Comme d’une part on avait commis des erreurs, dont certaines très graves – le mépris du mouvement étudiant – comme d’autre part, on était une organisation qui avait déjà des aspects maoïstes, c’est-à-dire un certain rapport à la réalité, qui fait que quand on est coupés de la réalité il y a apparition de grandes critiques, on a commencé au sein de l’U.J.C.M.L., après la dissolution officielle, un mouvement critique.
Et ce mouvement de critique a très vite, pendant l’été 68, abouti à une cassure en deux camps.
Il y avait un camp qui était très très minoritaire, et un camp qui était très très très majoritaire. Nous étions dans le camp très minoritaire!
C’est vraiment un tout tout petit groupe issu de l’U.J.C.M.L. qui a constitué la Gauche Prolétarienne au départ.
Si on se place en septembre 68, c’est-à-dire à la rentrée, au moment où tout le monde pensait ce octobre rouge, il y avait, sorti de l’U.J.C.M.L. et du mouvement de soutien aux luttes du peuple, quelque chose comme quatre à cinq mille militants.
L’écrasante majorité de ces militants se trouvait sur des positions opposées à celles qu’a adoptées le petit groupe qui allait devenir la Gauche Prolétarienne.
Le camp majoritaire avait des idées, que nous jugions liquidatrices. Ils expliquaient l’issue de Mai 68 de la manière suivante : il y a eu un mouvement de masse, il était révolutionnaire, et comme il n’y avait pas de parti révolutionnaire, ce mouvement de masse ne pouvait pas prendre le pouvoir.
C’était la thèse la plus dogmatique, la plus plate et la plus vulgaire, d’expliquer la grande carence de Mai 68 par le fait qu’il n’y avait pas de parti révolutionnaire. Nous considérions, à juste titre, comme la suite l’a montré, que faire cette analyse-là c’était liquider les principaux acquis idéologiques de Mai.
Dans le sillage, c’était aussi liquider une organisation assez importante, pas simplement l’organisation ancienne de l’U.J.C.M.L., mais ce que l’U.J.C.M.L. avait créé dans les usines – c’est-à-dire un nombre assez impressionnant de groupes syndicalistes prolétariens.
Résumé des thèses liquidatrices : » Maintenant qu’on a compris qu’en Mai, ce qui nous avait manqué c’était un parti, il faut tout de suite construire un parti. » Comment on construit un parti? en regroupant les éléments d’avant-garde. Comment on regroupe les éléments d’avant-garde? En les formant. Comment on les forme? A partir des livres.
Tout ceci devait nécessairement amener la rupture des contacts avec la pratique et avec les groupes d’usines qui existaient. Et de fait, ça a été un énorme massacre.
– Les établis sont revenus ?
VICTOR. – C’est ça, les établis ont quitté leurs usines.
– Le besoin de retourner dans les livres ?
VICTOR. – Enorme, c’était incroyable. Ça a dû être la période en France où on a le plus lu Que faire? de Lénine! Un phénomène universel. En Italie ça s’est passé comme ça. En Belgique aussi il y a deux camps : ceux qui disent : » Faut partir de la pratique des masses » et les autres qui disent : » Non, il faut partir de Que faire?... » Et ça se bagarre! En Allemagne, ça a été pareil.
– Et Mao?
VICTOR. – II n’intervenait plus vraiment. Ils se disaient encore pour Mao, mais vraiment ils le lisaient à travers les lunettes Que faire? Je dis tout de suite que nous estimons que Que faire? est un grand ouvrage, mais qu’il est daté d’une autre époque. On ne peut plus s’appuyer sur toutes les thèses qui y sont.
En particulier les thèses sur la connaissance (importées par les intellectuels dans /le mouvement ouvrier). C’est pour ça qu’on dit que Mao Tsé-toujng c’est une époque nouvelle.
– Vous vous disiez maoïstes, à ce moment-là ?
VICTOR. – C’est à ce moment-là qu’on s’est dits carrément maoïstes. Quand on parlait de nous en disant ce marxistes-léninistes « , on prenait ça pour une insulte.
On revendiquait le terme » maoïste « , le portrait de Mao. Cela dit, on était bien évidemment pour le marxisme, le léninisme, mais on voulait marquer la nouveauté du maoïsme.
– C’était la première apparition d’un groupe maoïste en France ? Ou y avait-il déjà eu quelque chose ?
VICTOR. – II y avait eu le P.C.M.L.F. *. Mais qui était de plus stricte obédience léniniste.
– Un jour vous vous êtes dit, nous, la Gauche Prolétarienne, on est des maoïstes.
VICTOR. – On ne se l’est pas dit » un jour « . La lutte contre l’autre courant qu’on caractérise comme ce liquidateur » a duré de juin 68 à février 69. Ça fait pas mal de temps.
Donc, on a vraiment eu le temps, à travers cette lutte, d’affermir et de clarifier nos positions.
Surtout qu’au départ, ce qu’on disait était extrêmement simple : » Bien sûr on a fait des erreurs, cela dit c’est tout à fait normal parce qu’on était inexpérimentés. La meilleure manière de rectifier ces erreurs, c’est de renouer avec la pratique et de trouver des idées dans la pratique. Donc, en avant de nouveau dans les boîtes, tirons les leçons de Mai 68 dans les usines et dans la rue. «
Évidemment, on se faisait traiter de tous les noms. C’est là, en particulier, que la notion de ce mao-spontex « , que le mot ce spontex » est apparu.
Ça voulait dire qu’on ne respectait pas Que faire? Qu’on était des spontanéistes. Le terme spontanéiste est populaire dans la tradition marxiste parce que dans Que faire ? Lénine critique un courant russe qu’il appelle « spontanéiste ».
Comme nous, on disait que le parti ça ne se crée pas comme ça, et que de toute façon la création d’un parti dépend de l’état du mouvement des masses, hop, on nous a traités de spontanéistes, – et puis comme mao-spontex, ça sonnait bien, ça a été assez populaire.
De toute façon comme une dizaine de milliers de gauchistes étaient sous l’emprise de ces idées ossifiées sur le parti, c’est un quolibet qui a eu du retentissement. Ça a duré très longtemps, jusqu’à la dissolution de la Gauche Prolétarienne, on nous traitait encore de spontanéistes.
– D’où venait votre conviction d’avoir raison? Quand on s’est aperçu qu’on pouvait se tromper au point de ne pas comprendre le mouvement étudiant, n’est-on pas un peu inquiet sur les nouveaux risques d’erreur?
VICTOR. – Absolument. Il y a eu des angoisses, à une époque!
– Comment en sort-on, si on en sort?
VICTOR. – Quand on s’accroche, on retrouve un ancrage dans la réalité. Pour nous, ce qui a été décisif, ça a été Sochaux.
Pendant l’été 68, nous sommes allés là-bas, nous avons discuté avec des ouvriers de Sochaux, et nous avons appris ce qui s’était passé, c’est-à-dire les affrontements de juin 68.
– Tu parles toujours de « s’ancrer dans la réalité », d’aller vers la réalité, de retrouver la réalité… Mais tout le monde pense être dans la réalité! Il y a très peu de gens à dire : on n’y est pas!
VICTOR. – Là tu te trompes! A l’époque il y avait une petite série de gens qui voulaient vraiment partir des livres…
– Parce que tu fais une opposition entre livres et réalité?
VICTOR. – Non, pas entre livres et réalité, mais entre la démarche qui consiste à partir d’un livre où on te dit de faire ceci, cela, et la démarche de ceux qui partent de la pratique, qui essayent de comprendre dans la pratique, et puis qui lisent des livres pour les aider à mieux comprendre.
Après Mai 68, il y avait philosophiquement, deux camps. Ce n’est pas moi qui interprète : je donne les points de vue tels qu’ils étaient exprimés par chacun des camps.
Le camp caractérisé comme » liquidateurs « , disait : » Partir de la réalité c’est empiriste, c’est spontanéiste « , etc. Pour eux, il fallait partir d’un certain nombre de thèses. Il fallait élaborer une ligne!
Alors comment élabore-t-on une ligne ? Cela revient à faire une analyse de classes de la société, alors on fait une analyse de classes de la société, on prend des bouquins de Raymond Aron qu’on critique, des statistiques du ministère du Travail, etc.
Nous, on disait : il faut partir de la réalité. Ça veut dire quoi? L’expérience qui nous a marqués le plus c’est Flins 68. Une expérience à laquelle nous participions directement.
La deuxième expérience, que certains d’entre nous découvrent pendant l’été, c’est Sochaux où les affrontements étaient bien plus violents et de portée stratégique peut-être encore plus importante que Flins 68.
Alors qu’est-ce qu’on a tiré de là? La conviction profonde qui a été une puissante arme pour rabattre l’angoisse, puisque ce angoisse « , il y avait! la conviction que la thèse du » pouvoir est au bout du fusil « , était valable et d’une certaine manière actuelle, dans un pays comme la France, comme pour tout autre pays.
On en était convaincus, en septembre 68, vraiment convaincus. C’est ça qui nous a permis, alors qu’on ne voyait pas clair sur des tas de questions, qu’on était très peu nombreux, et que ceux qui nous étaient hostiles étaient vraiment l’écrasante majorité, c’est ça^qui nous a permis de nous battre et de nous battre sans problèmes.
Non pas qu’on croyait qu’on avait la vérité infuse, ce n’est pas ça.
On n’était pas du tout sectaires, on était très ouverts, la meilleure preuve c’est que huit mois après, on a fait une expérience inédite et qui ne s’est pas renouvelée depuis : l’union avec un courant parti de tout autres prémisses que nous.
Parce que Alain Geismar et les éléments venus du 22 mars avaient eu, au départ, une tout autre démarche que nous. Lorsqu’on s’est unifiés organiquement, ça marquait de leur point de vue, aussi bien que du nôtre, une large ouverture d’esprit et une profonde volonté d’unir tous ceux qui voulaient continuer Mai 68.
La Gauche Prolétarienne est donc née formellement en septembre 68, mais elle n’a commencé à avoir une vraie physionomie qu’après l’union avec des camarades venus du 22 mars, c’est-à-dire en février-mars 69.
– Quelles étaient vos dissensions de base avec les éléments du 22 mars?
VICTOR. – Eux n’étaient pas maoïstes.
Dans nos premières discussions, ils disaient : » Bien sûr, c’est très important la Révolution culturelle, Mao Tsé-toung et tout ça, mais enfin on ne se sent pas lié par le maoïsme. On ne sait pas trop ce que c’est mais on ne voit pas pourquoi, a priori, c’est le maoïsme qui doit être la doctrine de base pour les révolutionnaires de Mai 68. «
C’était quand même un point de départ différent.
– Qu’avaient-ils eux comme doctrine?
VICTOR. – Ils n’en avaient pas du tout. C’était vraiment l’effort avec les moyens du bord pour comprendre Mai 68. Il n’y a qu’à voir leur bouquin sur la guerre civile.
– C’était quand même » le pouvoir au bout du fusil » ?
VICTOR. – C’est bien pour ça qu’on s’est unis! S’il n’y avait pas eu accord sur les thèses fondamentales, on n’aurait pas pu s’unir.
– Pourquoi dis-tu que Sochaux a été si important?
VICTOR. – II y a quand même eu de huit à onze C.R.S. tués, de l’aveu des ouvriers.
Pas de l’aveu du ministère de l’Intérieur, mais absolument tous les camarades dans leurs discussions avec les gars de Sochaux qui ont participé à juin 68 confirment ce chiffre.
C’était important, parce que c’était une violence proprement ouvrière. Flins, il faut bien voir que c’est la violence étudiants-ouvriers avec les étudiants d’une certaine manière aux premières lignes, entreprenant le déclenchement.
Là, c’était vraiment de l’usine que surgissait cette violence, et le bilan qu’en ont tiré les ouvriers de Sochaux était plus développé que celui qu’en ont tiré les ouvriers de Flins.
Pour les gars de Sochaux, la leçon qu’ils en ont tirée se voit encore maintenant en 71, ils disent : » La prochaine fois, c’est avec les flingues, qu’on accueille les C.R.S. «
Les premières discussions qu’on avait eues avec les ouvriers révolutionnaires, là-bas, c’était : » Ce qu’il nous faut, c’est des groupes armés. «
Alors que dans la majorité des usines, les premières questions qui étaient discutées, c’était : » Est-ce qu’on reste encore au syndicat, est-ce qu’on fait autre chose, un comité d’action, le parti? « , etc.
– Qui sont les ouvriers révolutionnaires dans ces discussions, surtout des jeunes?
VICTOR. – A Sochaux, c’est inédit par rapport à ce qu’on voit ailleurs. Nantes-Batignolles est un peu dans ce cas.
On rencontre énormément d’anciens qui sont activement et ouvertement révolutionnaires.
Il y a d’énormes potentialités révolutionnaires chez les vieux ouvriers partout, mais généralement ce sont surtout les jeunes ouvriers qui constituent la force ouvrière la plus rapidement mobilisable.
Sochaux est un de ces cas particuliers où les sympathies actives que nous avons obtenues venaient très souvent d’ouvriers âgés.
– Pourquoi est-ce spécialement ainsi à Sochaux?
VICTOR. – L’expérience de Sochaux, comme expérience proprement ouvrière, a été la plus avancée. A Renault-Billancourt, par exemple, l’occupation a été très inerte, très bureaucratique, et les jeunes, pour briser avec cette occupation, sortaient de la boîte pour aller dans les manifs étudiantes.
Résultat, ce sont les jeunes qui ont tiré le plus de ce qu’il y avait de nouveau dans Mai 68. A Sochaux, jeunes et vieux ensemble ont affronté la répression, d’où ils ont pu tirer ensemble des leçons et réactiver leurs vieilles traditions.
– Quels contacts avez-vous en ce moment avec ces grandes usines ?
VICTOR. – II n’y a plus trop d’établis.
– Ce n’est plus la peine?
VICTOR. – Je ne dis pas ça. Mais nos premiers établissements étaient des établissements pour connaître la réalité, pour pénétrer idéologiquement dans le milieu ouvrier, alors que maintenant nos établissements sont plus politiques.
On s’établit en fonction d’objectifs politiques précis. De préférence, on établit des militants ayant une expérience politique.
Dans certains cas, uniquement des camarades ayant une expérience de cadres politiques. L’établissement est conçu maintenant comme l’entrée d’un camarade qui va aider à l’organisation du groupe ouvrier, parce que manque à l’intérieur quelqu’un qui permette de lier les gars entre eux.
– Toi, comment restes-tu en relation avec ce qui se passe, avec la » réalité « ?
VICTOR. – La méthode est toujours la même, les enquêtes continuelles, les liaisons.
– Tu n’y vas pas?
VICTOR. – Je ne suis pas à l’intérieur d’une boîte.
– Comment se constitue l’organisation?
VICTOR. – II y a eu plusieurs moments dans la naissance effective de la Gauche.
Il y a eu d’abord le baptême du feu, juin 68. Ensuite, il y a une constitution formelle en septembre 68, et on sort La Cause du peuple reprenant le titre du Mouvement de soutien aux luttes du peuple.
Septembre 68, donc, qu’est-ce que cela signifie? A Paris un groupe de camarades, pas plus d’une quarantaine, unifiés sur la base de la lutte contre les positions liquidatrices, caractérisées tout à l’heure, et qui décident de sortir La Cause du peuple avec pour thèses : » De nouveau dans la pratique, prolétarisation au maximum « , et application de la thèse ce le pouvoir est au bout du fusil » dans les conditions concrètes de la France.
C’était grosso modo notre programme. Il n’y avait pas beaucoup d’autres idées, c’était une direction. On s’engage et puis on voit. C’est une phrase qu’on appréciait beaucoup à l’époque!
Donc, on était un groupe de trente, quarante camarades sur Paris, dont une partie constitue de fait un groupe dirigeant – ni élu, ni nommé, ni rien du tout – simplement le groupe de ceux qui ont combattu avec le plus de conséquence les thèses majoritaires et autour desquels se retrouvent ceux qui ne veulent pas rompre avec la pratique.
– Les cadres se définissent alors comme les plus clairvoyants ?
VICTOR. – Oui, les plus clairvoyants. Ceux qui avaient réussi à clarifier les positions du groupe qui allait naître, et à critiquer ce qu’on appelait le léninisme ossifié. Les plus actifs, aussi.
Ceux qui proposaient les premières initiatives pratiques et qui commençaient à coordonner les groupes qui en province apparaissaient et résistaient au courant liquidateur.
Il y a eu un certain nombre de groupes, pas très nombreux, qui, comme à Paris, ont résisté ajr courant liquidateur de la majorité. Il y en a eu à Sochaux, en Lorraine, à Marseille, dans le Nord.
A ce moment-là, on avait une organisation avec un groupe dirigeant et des militants qui étaient sur certaines facs, ou dans certains quartiers de Paris et des militants qui étaient dans le Nord, à Marseille, à Besançon, où on pouvait.
– Concrètement, il y avait des réunions?
VICTOR. – Il y avait des assemblées générales.
A cette époque-là, étant donné le petit nombre, on pouvait s’en sortir avec des assemblées générales!
On faisait des assemblées générales dans des écoles supérieures, des facs.
– Vous n’étiez pas particulièrement poursuivis?
VICTOR. – Dans la confusion qu’il y avait à l’époque, il était difficile à Marcellin d’y reconnaître les siens! Il a progressé depuis… De toute façon, au départ on n’était pas les plus dangereux, puisqu’on était vraiment le groupe le plus restreint.
– De quoi discutait-on dans ces assemblées générales?
VICTOR. – Pendant les premiers mois uniquement de la lutte idéologique, clarification, textes critiques, etc., et puis les premières initiatives : à l’automne, il y eut des événements au Mexique. Nous, on a foncé, mais la Ligue communiste et tous les courants liquidateurs ont bloqué. Alors, on a fait le bilan de ces réactions.
Il y a eu d’autres initiatives, on voulait faire un meeting à Citroën où il y avait eu des centaines de licenciements.
– Comment ressentiez-vous le fait d’être si peu nombreux?
VICTOR. – On s’en foutait un peu, à vrai dire. En plus, on n’appréciait pas clairement le rapport numérique.
Il faut voir que le bloc majoritaire n’était pas un bloc, cela partait dans tous les sens. Chacun avait ses propres idées sur la manière d’appliquer des lignes, enfin d’appliquer, d’élaborer! Ils nous encerclaient quand même.
On s’en foutait un petit peu mais eux, ils ne se foutaient pas de nous. Ils étaient toujours là, à attaquer, à essayer de récupérer les types. C’était très violent, activé par des agents provocateurs. Les calomnies circulaient qui ont d’ailleurs aidé Marcellin à l’époque. Il a constitué pas mal de dossiers à partir de ce bordel-là. On en a eu des preuves par la suite.
– Vous ont-ils rejoints depuis?
VICTOR. – En 70, avec les premiers succès de la pratique de la Gauche, tous ces groupes sont entrés en crise et se sont décomposés. Beaucoup de militants intellectuels issus de ces groupes ont voulu nous rejoindre mais, dans l’ensemble, un tel afflux n’est pas bon du point de vue du rapport de force social à l’intérieur des maos. Souvent ces militants ont pris de très mauvaises habitudes de travail, de réflexion, de pratique.
On s’en aperçoit, ils ont besoin d’une importante rééducation.
– Tu veux dire qu’ils sont dans les livres ?
VICTOR. – Ils n’ont pas un esprit très ouvert, très net, très acéré. Ils admettent un certain nombre de choses qui ont été éprouvées par la pratique, mais, par rapport aux choses nouvelles, ils gardent encore un esprit dogmatique.
– Comment cela se passe lorsqu’ils veulent entrer dans votre organisation ?
VICTOR. – En règle générale, tous ceux qui ont été des cadres, des chefs, de ce qu’on a appelé le mouvement de la liquidation, ne sont pas entrés.
– Ils en ont manifesté le désir?
VICTOR. – II leur était difficile d’en manifester le désir parce qu’ils ne s’attendaient pas à ce qu’on les accepte. Donc, eux, ne sont pas entrés.
Pour les militants, il n’y avait pas de critères d’exclusion. Il y a eu un principe politique de grande prudence sur le recrutement de militants venus de groupes liquidateurs, mais c’était un principe général qui n’excluait personne en fonction de telle ou telle particularité.
En dehors de ce principe, sur quoi ça se jugeait? Sur la pratique. Prolétarisation et militarisation.
– Revenons à la quarantaine de la rentrée 68.
VICTOR. – A partir de sa position de départ, – prolétarisation et militarisation – » la force ce gauchiste » naissante s’est attachée à réunir les ouvriers qui pouvaient être réunis, donc, tout de suite, les militants ont eu comme tâche centrale de renouer avec les boîtes où ils avaient travaillé, celles avec lesquelles on pouvait renouer.
Il était inutile de renouer avec les boîtes où avaient disparu les militants. On a renoué avec Citroën, avec Renault.
Tout ça nous a amenés en janvier 69, à une assemblée ouvrière nationale où on a réuni les militants ouvriers des différentes boîtes avec lesquelles on avait repris contact, pour faire le bilan de l’expérience et voir un peu où on en était au point de vue de la tactique.
Ça a été une très importante réunion parce que ça nous a permis de nous dégager totalement de la ligne » syndicaliste prolétarienne « .
Au sortir de cette séance de travail, on savait qu’on ne militerait plus à la C. G. T. C’était un pas décisif vers des conceptions sur la constitution d’une force ouvrière totalement autonome. Il y avait encore des équivoques.
On avait un peu dans la tête qu’on allait vers la création d’un syndicat nouveau, un syndicalisme vraiment rouge, quoi. Mais le courant principal, c’était : autonomie par rapport au syndicalisme officiel.
Il y avait dans nos têtes l’idée – pas dans toutes les têtes, mais chez les vieux militants ouvriers – de recréer un peu la C.G.T.U. Mais le courant principal de la réunion était de se dégager complètement de la C.G.T.
Pour faire quoi? On ne savait pas encore très bien. Pour résumer : première étape de la Gauche : unir dans la lutte contre le courant liquidateur tous les militants qui pouvaient être unis, et donner comme objectif à ces militants-là : unir tout ce qui pouvait être uni comme ouvriers révolutionnaires.
Et à partir de là dégager les premiers éléments d’une orientation de travail et de combat dans les boîtes. Cette étape, on peut dire qu’elle s’achève avec cette réunion ouvrière qui définit les premières thèses sur la constitution d’une force autonome dans les usines.
Deuxième étape du développement de la Gauche, marquée par l’union avec le 22 mars dont on a parlé tout à l’heure : on s’aperçoit que pour régler la constitution d’une force autonome dans les boîtes, il faut s’appuyer sur le mouvement de masse, de la jeunesse.
Il était difficile d’édifier des groupes ouvriers autonomes, et de les unir sans qu’il y ait intervention de ce puissant allié qu’avait été pour eux le mouvement de la jeunesse.
D’où on se préoccupe, dans cette deuxième étape, de clarifier les idées sur la jeunesse et d’y commencer une pratique autonome.
C’est l’étape où on achève avec les camarades issus du 22 mars le bilan de Mai et où on définit les thèses qui sont dans le n° 1 des Cahiers de la Gauche Prolétarienne qui date d’avril 69.
Ces thèses sont contenues dans le titre : » De la révolte anti-autoritaire à la révolution prolétarienne. «
D’où l’on comprenait qu’il fallait unir les aspirations anti-autoritaires telles qu’elles s’étaient exprimées et continuaient à s’exprimer dans la jeunesse, et les nouvelles formes de luttes dans la classe ouvrière, des formes de luttes antidespotiques.
Dans cette étape, on fonce dans la pratique de masse au sein de la jeunesse et spécialement dans les lycées.
C’est le moment où on développe une série de luttes dans les lycées Louis-le-Grand, Henri-IV…
L’époque où Lagarde [proviseur du lycée] se faisait descendre dans Louis-le-Grand.
Ça n’avait pas la même profondeur que le mouvement lycéen de cette année.
Il s’agissait de noyaux de gauche, cent, deux cents lycéens, mais un peu partout.
Cette deuxième étape s’achève en juin 69.
A ce moment-là, on s’aperçoit qu’on a quelques débuts d’éléments nouveaux de pratique dans les usines, et qu’on a créé à travers les luttes lycéennes, une force de jeunes qu’il faut absolument lancer à l’assaut des boîtes d’une manière nouvelle pour renforcer les premiers éléments naissants dans les boîtes.
En juin, à l’occasion de l’anniversaire de Mai, de l’anniversaire de l’assassinat de Gilles Tautin de Flins et aussi à l’occasion des élections – ce qu’on appelait » la bataille du boycott actif des élections » – on mène notre première opération qui allait introduire une étape nouvelle du développement de la Gauche : l’opération à Flins de juin 69.
Tout ce qui avait été mobilisé dans les lycées après un intense travail de propagande sur la région parisienne, se concentre pour une opération antimaîtrise aux portes des usines, en accord avec le groupe d’ouvriers qui s’appelait à l’époque ce Comité d’action révolutionnaire « .
Cette opération est vraiment la première opération de grande envergure.
Après un travail de propagande, qui dépasse la diffusion de tracts, des accrochages avec les flics dans certains marchés, des interventions sur les lycées, en particulier au lycée Mallarmé, des accrochages aussi à certaines portes de boîtes avec les révises, toutes les forces militantes de la région parisienne se concentrent à Flins et se retrouvent aux portes de l’usine.
– Comment cela est-il vu par la presse? Comme une action maoïste ?
VICTOR. – Comme une action de fascisme rouge! On dit : » Descente des lycéens dans les usines pour casser la gueule aux ouvriers. » L’Huma disait ce les fascistes « ; la Régie évidemment : » les fascistes « ; la grande presse, je ne sais plus.
– Et les réactions chez les gauchistes ?
VICTOR. – Tout le monde nous attaque!
Il faut voir qu’un tabou était littéralement violé. C’était une opération de groupe, une opération antimaîtrise, contre toute la maîtrise de Flins; en plus c’était une opération militairement préparée, pas un truc spontané.
Il avait fallu regrouper cent cinquante gars et les replier après l’opération.
C’était vraiment l’introduction de l’opération de partisans qui troublait les schémas.
On pensait à l’époque que les actions de petits groupes, ça allait bien pour les Vietnamiens, pour les Chinois, éventuellement pour les Irlandais, mais pas en France.
Pourtant ça a fait tilt. Dans les groupes organisés, cela a renforcé les attaques contre nous, mais cela a provoqué un début de sympathie dans la force gauchiste sauvage.
C’est le début de la troisième étape.
A partir de Flins 69, les choses vont s’accélérer pour les définitions de notre orientation générale. On fait une seconde conférence de travail importante, de représentants de tous les groupes d’usines, où est analysée la signification de cette opération sur Flins.
A ce moment-là les premières idées concernant la lutte antidespotique dans les boîtes, la lutte anticadences se précise, cela nous permet pendant l’été 69 une généralisation à d’autres usines : les militants dans toutes les boîtes commencent à utiliser les armes de la lutte antichefs.
Pendant cet été-là, en 69, les premières expériences types commencent à apparaître. L’expérience la plus importante a été à La Redoute de Roubaix-Tourcoing, dans le Nord : une expérience de sabotage de masse des cadences, une lutte massive antichefs.
C’était un mouvement qu’on appelait un mouvement « raslbol ». Ce terme s’est répandu depuis. C’était la première fois qu’on en parlait, on avait pris le terme aux lycéens. Les lycéens 69, à Louis-le-Grand, avaient fait une énorme affiche » RASLBOL « .
A la fin de l’été, on définit (septembre-octobre 69) ce que veut dire l’orientation dite de la résistance.
Un texte est paru dans le n° 2 de La Gauche Prolétarienne, un texte dit ce Texte d’octobre « , qui fait le point sur ces différentes expériences et qui introduit systématiquement l’idée d’un type de luttes de partisans non armés, mais violents, à caractère symbolique, adaptés à la situation française d’après Mai 68.
Pour que cette orientation devienne une force matérielle importante, on définit les objectifs d’un mouvement de réforme dans les rangs des militants.
Mot d’ordre : » Se jeter dans le monde. » Ce qui voulait dire : lancer les militants issus des lycées et des facs, soit directement dans les boîtes – il y a beaucoup d’établissements de lycéens dans les boîtes – soit dans les bidonvilles ou sur les banlieues ouvrières, pour mener la résistance, mener la lutte violente.
C’est là que se situe l’expérience d’Argenteuil. C’est là que paraît La Cause du peuple historique. L’expérience d’Argenteuil était une expérience de résistance à la destruction des bidonvilles.
Particularité : cela a été la première bataille prolétarienne antirévisionniste. Sur le grand marché d’Argenteuil, il y a eu un affrontement violent avec les révisionnistes. Là on ne s’attaquait pas, comme à Flins en 69, aux chefs, à la maîtrise, mais carrément à des nervis du P.C.F.
Inutile de dire que les accusations de » fascistes » ont été multipliées par dix! Si on était déjà des fascistes parce qu’on s’attaquait aux/chefs, a fortiori, si on s’attaquait aux nervis de la mairie d’Argenteuil!
Ça a été très très important parce que c’était un nouveau tabou qui tombait, le tabou des mairies ouvrières.
Très important, il faut voir un peu pour les gauchistes ce que représentait ce qu’on appelait le bastion du P.C.F., les mairies du Nord, la banlieue Nord, Billancourt, tout ça c’était le bastion du P.C.F.
S’attaquer à ces bastions c’était s’attaquer à des ce maillons forts » et comme chacun sait depuis Lénine, il faut s’attaquer aux maillons faibles.
C’était donc vraiment un nouveau tabou qui était violé avec Argenteuil.
A partir de cette expérience d’Argenteuil et du mot d’ordre : » Se jeter dans le monde « , il commence à y avoir une multiplication d’expériences.
A ce moment-là, les militants de la Gauche Prolétarienne voient clair, sont très adaptés à la pratique et commencent à être habiles, c’est-à-dire à multiplier les expériences.
Jusqu’alors, il y avait surtout concentration d’énergie pour réaliser une expérience type, pour voir clair, pour avoir de nouvelles idées, et définir de nouvelles idées politiques.
A partir d’octobre 69, il y a une orientation, certains militants savent comment se battre, ont certains objectifs, et cela permet de multiplier les expériences.
Chacun prend de l’initiative.
On en arrive ainsi à différentes batailles importantes.
Celles qui ont beaucoup compté pour le développement de la Gauche et le perfectionnement des armes de la lutte violente ont été les campagnes de la rentrée 70 : la campagne sur les assassinats d’ouvriers et la campagne sur le métro.
Il ne s’agissait plus là d’une bataille, mais d’une série de batailles liées entre elles, selon les principes d’une campagne.
Dans le cas de la campagne sur les assassinats d’ouvriers, il s’agissait de quelque chose qui n’était pas strictement localisé en un point déterminé.
L’assassinat des cinq travailleurs africains d’Aubervilliers a été l’occasion d’une campagne importante parce qu’il y avait une sensibilisation de l’opinion sur la question, mais, chaque fois qu’il y avait des cas de soi-disant accidents du travail, les militants s’en emparaient.
C’était plus ou moins important; il y a eu des boîtes où cela a simplement été une propagande virulente et peut-être un cassage de gueules d’un chef ici ou là, mais l’important c’est que les principes d’une lutte généralisée sur les cas d’ »accidents du travail » sur les assassinats d’ouvriers était largement pris en main par les militants.
Cela multiplie les initiatives, et aussi le nombre de militants!
Là, il y a eu un fort afflux, et surtout une nette prolétarisation : on commence à avoir des militants jeunes ouvriers, soit issus des banlieues, soit directement issus des premières boîtes, par exemple Billancourt.
L’exemple le plus marquant de cette campagne s’est trouvé aux Chantiers navals de Dunkerque.
A Aubervilliers, la campagne sur les assassinats d’ouvriers prenait appui sur les événements qui concernaient les travailleurs mais qui étaient extérieurs aux travailleurs organisés dans une grande usine, puisque le foyer d’Aubervilliers n’est pas une boîte.
Avec les Chantiers navals, on entrait dans le cœur du grand prolétariat. Le caractère important de l’expérience des Chantiers c’est que c’était une grande base d’usines.
Le grand prolétariat, la capacité, la force d’un prolétariat concentré, c’est quelque chose d’irremplaçable.
Le rôle de Billancourt comme base d’appui, apport non seulement en militants ou en cadres, mais apport en idéologie, en idées, en initiatives, est incomparable.
Il y a une intense vie politique autonome dans les grosses boîtes et plus encore dans les grosses boîtes à forte tradition.
Première particularité, donc, de l’expérience des Chantiers navals : c’est sur une grande base d’usines.
Deuxième particularité : le travail qui a été fait a été admirable.
Il n’y a pas eu simplement des opérations de groupes de partisans à l’occasion des différents accidents sur les chantiers, il y a eu surtout un rapport totalement inédit entre ces groupes de partisans et les larges masses ouvrières.
Soutien de masses dans les actions contre le directeur des Chantiers, dans le sabotage de grues à l’intérieur des Chantiers, soutien de masses du camarade qui avait été établi longtemps sur les Chantiers et qui, là, était à l’extérieur.
Il a été littéralement protégé, pendant toute cette période, par les gars des Chantiers.
Il y avait régulièrement des meetings où le principe des sabotages était collectivement admis etmême élaboré par trois cents ou quatre cents ouvriers.
C’était répercuté à l’intérieur et la première opération de sabotage des grues a été après reproduite spontanément par des petits groupes d’ouvriers ignorés même des camarades en tant que tels, c’est-à-dire en tant que groupes.
Troisième particularité de cette expérience : elle a provoqué l’apparition de la tactique répressive de Marcellin contre nous.
D’une part on a commencé à beaucoup parler de nous; il y avait des articles partout, dans L’Express, dans L’Observateur, Le Monde, L’Huma, etc.
D’autre part, il y a eu les premières provocations, c’est-à-dire les faux sabotages qui pouvaient attenter à la vie des ouvriers, des provocations criminelles où des accidents furent évités de justesse.
La deuxième campagne importante de ce mouvement de réforme dont je parlais tout à l’heure est celle, assez connue, lancée sur le métro.
Là aussi, on s’appuie sur une grande usine, Billancourt, et aussi Citroën, et les succès sont à l’origine d’une poussée dans la jeunesse.
Ces deux grandes batailles d’usines, notre position sur le mouvement des petits commerçants, le fait qu’on se retrouve avec eux, qu’on se bagarre à leurs côtés à Grenoble, tout ça provoque un essor dans le mouvement de la jeunesse.
Cette attitude vis-à-vis des petits commerçants, on en parlera après. Même Sartre n’a pas compris notre position.
C’est là que commence la chasse au militant maoïste.
Les premières arrestations datent de cette époque. Les saisies de La Cause du peuple et l’arrestation de Jean-Pierre Le Dantec. La première saisie de La Cause du peuple doit dater de mars 70.
– Comment se fait-il que tu aies tout cela si clairement à l’esprit? Par mémoire, ou par principe? Est-ce nécessaire de s’appuyer ainsi sur les étapes historiques?
VICTOR. – C’est absolument vital. Il faut toujours, toujours partir de l’expérience historique, ne rien perdre de l’expérience.
On est en 71, mais quand on a à discuter à fond d’un problème, on revient toujours à 68, à 67, à nos erreurs.
Il y a des leçons sur lesquelles il faut toujours revenir.
– Reprendre le passé avec l’éclairage du présent?
VICTOR. – Tout le temps. Reprendre le passé avec l’éclairage du présent, c’est à peu près une citation du Président.
La jonction des premières batailles ouvrières, des petits commerçants, Nanterre et le renouveau étudiant allaient provoquer le 27 mai et la dissolution de la G.P.
Le 27 mai, c’est le procès de Le Dantec et Le Bris. Il y a deux jours de bagarres dans les rues de Paris, il y a les premières arrestations dans le Nord : celles des camarades d’Hénin-Liétard, qui allaient être brillamment acquittés à la Cour de Sûreté de l’État.
Il y avait des arrestations depuis 69, mais des arrestations, d’une semaine, d’un mois, deux mois. Pas grand-chose encore.
– A ce moment Geismar devient le porte-parole du mouvement. Pourquoi?
VICTOR. – Parce qu’il le mérite!
– Mais comment cela se passe-t-il puisqu’il n’y a pas de hiérarchie?
VICTOR. – Le choix de Geismar est dicté par deux considérations.
L’une du point de vue des masses, et l’autre du point de vue de l’ennemi.
La considération du point de vue des masses : Geismar, c’est celui qui exprime le mieux la continuité profonde entre l’étape de Mai et l’étape d’après Mai; il avait concentré une importante expérience en Mai 68.
Le point de vue de l’ennemi : on ne voyait pas pourquoi on donnerait à l’ennemi quelqu’un qui n’était pas déjà brûlé.
Puisqu’on avait besoin d’un porte-parole et qu’Alain était déjà brûlé, on ne voyait pas pourquoi on en choisirait un autre.
Cette question du porte-parole ne s’est d’ailleurs posée pour nous qu’au printemps 70, quand il a fallu expliquer nos positions, donner des interviews, faire des meetings.
Avant, on l’ignorait superbement. On se l’est posée au moment des petits commerçants, et cela a eu un sens très précis que Geismar qui représentait le mouvement de Mai 68, soit là au combat avec eux, à Grenoble.
C’était très important. Avant ce printemps 70, personne ne parlait de nous. On ne tenait pas d’ailleurs à faire parler de nous. Avant le printemps 70, on ne faisait pas de meeting.
Avant le meeting des » Amis de la Cause du peuple » (janvier 71), on n’avait jamais fait de meeting. On avait essayé d’en faire un, mais il a été interdit. Il n’y a pas eu de meeting de la Gauche Prolétarienne.
– Et maintenant que Geismar est arrêté, pas d’autre porte-parole?
VICTOR. – On n’en veut pas pour le moment.
– On en est à la dissolution de la G.P. après deux jours de bagarres dans les rues.
VICTOR. – II faut bien voir qu’à l’origine, on avait préparé le 27 mai, non dans la stricte perspective de la défense de la liberté d’expression, mais dans celle de l’union de toutes les couches contestatrices descendant dans la rue et manifestant violemment leur opposition à l’ordre social.
Un gros effort avait été fait pour l’union entre le mouvement de la jeunesse, la gauche ouvrière et la dernière en date des classes contestatrices : le mouvement des petits commerçants et des petits artisans, élément important dans la préparation du 27 mai.
Les manifs de Grenoble ont été répercutées à Paris dans différentes facs où l’on a tenu pas mal de meetings, avec des petits commerçants et Alain qui expliquait un peu cette question de l’unité populaire.
– Qui a été assez mal comprise?
VICTOR. – Oui, on y reviendra.
Il y avait un effort pendant toute cette période pour implanter l’idée de ce qu’on allait appeler les » campagnes pour l’unité populaire « .
Les couches sociales contestatrices trouvaient des formes de jonction, en particulier dans la rue.
Ça a été un premier élément de préparation du 27 mai.
Dans ce contexte-là aussi, l’opération Fauchon, qui a eu une importance qu’au départ on n’avait pas perçue.
L’opération Fauchon avait été conçue pour unifier profondément les idées de gauche des petits commerçants et des petits artisans et les idées de gauche de la G.P. puisque c’était une opération contre un grand magasin, non pas grand au sens de la surface, mais au sens du » magasin de luxe « , un symbole.
Donc au départ, opération visant à unifier les petits commerçants qui luttent contre la ruine, avec la gauche ouvrière et la jeunesse contestatrice.
En fait, Fauchon a touché beaucoup plus profondément puisque c’était le symbole richesse/pauvreté qui était atteint.
Récupérer certains produits de Fauchon pour les distribuer aux bidonvilles a touché très largement.
Incontestablement, le procès de Frédérique Delange a été le plus populaire, il a eu plus d’échos que le procès de La Cause du peuple.
Je ne crois pas me tromper en disant cela.
Les gars dans la rue, le 27 mai, associaient le cas de Frédérique avec Le Dantec et Le Bris.
Ça a eu une énorme résonance.
Tout ça a été préparé le 27 mai, cela peut paraître curieux, mais c’est comme ça. Il y a des choses qui ne sont pas strictement conçues en vue d’un objectif et qui peuvent puissamment préparer la réalisation de cet objectif.
Les différentes actions d’unité populaire à la veille du 27 mai avaient bien préparé l’opinion.
Évidemment, quand le 27 mai s’est produit on a commencé à comprendre des choses nouvelles, tout particulièrement sur la question de la démocratie.
On a vu ce qu’avait représenté comme alliance, le mouvement en faveur des directeurs de la C.D.P.
On a compris que sur le thème de la liberté d’expression, il y avait énormément de choses à faire. Toutes les idées qu’on a défendues par la suite, sur la démocratie, partent du 27 mai.
Avant de voir les conséquences du 27 mai, il faut un peu dire ce que ça a été.
On est loin d’avoir organisé les combats du 27 et du 28. Ils étaient largement à l’initiative de ceux qui sont descendus dans la rue.
C’était la réoccupation de la rue.
Depuis 68, on n’avait pas encore retrouvé des formes de combat dans la rue, qui permettent de tenir plus d’un quart
d’heure et surtout de tenir sans qu’il y ait sept cents mecs virés tout de suite à Beaujon.
Là, on a vu la formation, de petits groupes qui se centrent autour d’un, objectif partiel, puis se dispersent, puis se reconcentrent et ainsi de suite, la forme que les journaux ont appelée guérilla urbaine, forme devenue maintenant classique pour les affrontements avec les flics.
Au Palais des Sports [meeting d’Ordre Nouveau], après la première charge offensive des manifestants, au moment de la contre-charge des C.R.S., c’est ainsi que ça s’est paisse : des groupes se sont dispersés, reformés, qui ont harcelé avec les moyens du bord les forces de police.
C’était profondément nouveau au point de vue politico-militaire le 27 et le 28 mai.
Enfin, la conséquence politique la plus importante, c’était la possibilité d’un front démocratique en France.
Un front démocratique qui élargirait considérablement les luttes contestatrices qui avaient marqué les années tout de suite après 68.
On l’appelait comme ça, après le 27 et le 28 on parlait d’un front démocratique regroupant tous les éléments issus des milieux intellectuels qui prenaient des positions – avec des formes diverses – contre le durcissement de la répression.
Celui qui a le mieux compris la signification de ce front et en quoi il pouvait être subversif, à l’égard du pouvoir, c’est Sartre. Il a bien vu comment on pouvait exploiter à fond la contradiction entre le légalisme du pouvoir et les violations de sa propre légalité.
Sartre prenant la direction de la C.D.P., ne se faisant pas arrêter, puis diffusant la C.D.P. sur les boulevards, alors que les diffuseurs se faisaient arrêter et récoltaient des mois de prison, tout ça n’est pas » utiliser Sartre comme vedette ou comme gadget « , c’est Sartre exploitant au maximum une contradiction propre au pouvoir qui prétendait respecter la loi quand il réprimait les gauchistes.
Par ses interventions, Sartre montrait clairement que le respect de la loi par le pouvoir était relatif, limité.
Dans la mesure où le pouvoir ne s’attaquait pas à Sartre, le pouvoir marquait, par là, que la répression n’était pas égale pour tous et permettait de comprendre que la répression qui s’abattait sur les maos pouvait être, elle aussi, illégale.
Cette conséquence politique du 27 mai, la naissance du front
démocratique, va être décisive pour la compréhension du développement des luttes en 71.
Il y a eu, à ce moment-là, la dissolution de la Gauche.
On s’y attendait, non pas le 27 au matin, mais on s’y attendait.
On y était idéologiquement préparés.
Depuis le début de notre pratique de la lutte violente, nous savions bien qu’on allait essayer de nous anéantir.
Alors, dissolution, arrestation, tout le bazar, on le savait, mais dans le domaine de l’organisation, on n’était pas fin prêts.
On savait aussi qu’on ne serait pas fin prêts au moment où ils nous attaqueraient.
On ne pouvait pas à l’époque prendre toute une série de dispositions qui par exemple nous auraient permis tout de suite après le 27 mai de nous reconvertir, de nous adapter à la situation nouvelle.
Je crois que certains ont été frappés par le fait que Geismar s’est fait arrêter particulièrement vite.
Ça se passerait cette année, il ne se ferait pas arrêter aussi vite.
Nous pensions profondément qu’il fallait faire le plus rapidement possible le maximum de travail ouvert qui permette de dégager, en France, l’idée de la lutte violente.
Au moment de la répression, il y aurait pas mal de pertes, et on ne pourrait pas éviter ce moment.
A ce moment-là, on aurait à se réadapter. Le faire avant aurait limité l’essor de la lutte.
C’est un point qui me paraît important, parce que certains peuvent se dire : quand on commence la lutte violente, il faut avoir des organisations clandestines, etc.
Ce n’est pas tout à fait exact.
Dans la situation française, il était très important que la lutte violente se développe, que face à la lutte violente apparaissent les formes de répression du pouvoir, afin que la situation se transforme et que de nouvelles organisations s’adaptent à la situation ainsi créée.
Il n’y avait pas, avant que la lutte violente telle qu’on l’a stimulée ne se soit développée, à limiter le mouvement, à ralentir notre rythme en fonction de principes qui sont ceux d’organisations strictement clandestines.
On peut comparer la situation française à la situation d’autres pays, comme par exemple l’Uruguay.
Comment les Tupamaros se sont-ils développés?
Il est clair que lorsqu’ils ont commencé leurs opérations de partisans, ils avaient déjà des organisations clandestines.
Dans leurs premières années d’activités, on remarque un rythme d’opérations très lent.
Nous, ce dont nous avions besoin en France, c’est qu’apparaisse le plus ouvertement, le plus massivement possible, l’idée que la lutte violente était nécessaire pour le développement de la contestation.
Il fallait qu’il y ait ça d’abord pour passer à l’effort supérieur de la lutte violente qui exige que certaines opérations soient faites par des organisations régies par les principes stricts de la clandestinité.
Nos premières opérations, même si elles ont été faites dans un esprit de stricte protection, – évidemment, il y a eu de très nombreuses opérations sans aucune perte où les flics se sont cassé le nez – étaient faites à partir d’une organisation, dans l’ensemble ouverte.
Donc, des risques étaient pris.
Les dernières opérations devenaient de plus en plus coûteuses parce que le dispositif se resserrait.
– Après le 27 mai, il y a eu l’été, puis la rentrée. Quelle a été l’étape de la rentrée 70-71?
VICTOR. – II y a eu pour nous un tournant. Non parce qu’on a été dissous, par décret. Pour nous, la dissolution marquait dès le 27, 28, un tournant réel, nous devions transformer notre activité. On disait, un peu plus tard : » Marcellin nous donne un sacré coup de main. «
De fait, la G.P. avait fait son temps; il fallait la dissoudre et faire quelque chose de plus adapté à la situation. On a senti le tournant, à partir du 27, 28; une chose est de le sentir, une autre, de le passer! On n’en est pas encore sortis! Ça fait à peu près un an.
On dit : II faut réajuster notre travail. En gros, cela veut dire : il faut que maintenant les militants qui étaient groupés dans la G.P., qui, à partir d’elle, avaient promu un certain style d’action et de travail, se dispersent dans les différentes couches contestatrices et aident chacune de ces couches à se doter d’organisations représentatives autonomes.
Le principe de ce réajustement est de créer des organisations de masse, dans la jeunesse, dans les usines, chez les petits commerçants, chez les petits paysans; des organisations de masses, autonomes, qui systématisent leur expérience propre.
– Comment s’est passée, par exemple, votre approche des lycées ?
VICTOR. – En 69, ça n’était pas bien compliqué, il y avait au départ quelques militants lycéens, de l’équipe initiale qui avait créé la Gauche. Des élèves des terminales, par exemple.
Ces militants de 69, par le boulot qu’ils ont fait, ont laissé de nouveaux militants. Il y a la chaîne. Eux sortaient du lycée, allaient en facs ou dans les usines.
De nouveaux militants apparaissaient, et ce sont eux qui sont dans les lycées pendant les journées Guiot, eux ou encore une nouvelle génération.
Les groupes de base dans la jeunesse se renouvellent très vite. De toute manière, un gars qui milite deux ans dans le mouvement de la jeunesse, il faut qu’il s’en tire.
On s’est fixés comme règle, une constante rotation dans l’encadrement, sur les facs ou les lycées. Cela se résout presque spontanément dans le cas des lycées.
– Ce mouvement des lycées, vous le reconnaissez comme un mouvement lié à vous? Autonome? Spontané?
VICTOR. – Tout mouvement de masse authentique, on peut l’appeler spontané.
Un mouvement vraiment massif n’est pas » dirigé » comme peut l’entendre un esprit, soit étroit, soit policier, comme celui de Marcellin.
Prenons le cas des journées Guiot : il y avait, dans une quarantaine de lycées de Paris, des militants qui depuis pas mal de temps faisaient de l’agitation latente, importante parce qu’elle fait mûrir les esprits.
Arrive la fin de la grève de la faim, la manif du 9 février à Clichy. Un lycéen, Guiot, est arrêté. Il ne faut pas être un gigantesque stratège politique pour se rendre compte que Guiot, étant lycéen, la riposte à la répression de la manif de Clichy doit être centrée, essentiellement sur les lycées.
Pas sur les facs. D’où les camarades militants dans les lycées agitent systématiquement à l’occasion de Guiot. Et, dans certains cas, déclenchent une série de grèves.
Ils stimulent mais le mouvement a ses propres lois de développement. Il y avait une série de lycées » agités » où il n’y avait pas de militants. Je ne parle même pas de militants de l’ex-G.P., mais de militants tout simplement.
– Nous en sommes restés à la veille des vacances 70.
VICTOR. – C’est la campagne de l’ » été chaud « , après l’arrestation de Geismar.
On a compris pas mal de choses sur la question des mots d’ordre et des méthodes dans les campagnes populaires.
Cette campagne correspondait à une idée très largement répandue dans la population : l’injustice, pendant les mois d’été, entre les classes.
Sur la base de cette idée populaire, dans les différentes régions, on a lancé un certain nombre d’actions. Par exemple, en Lorraine.
– Dans l’ensemble, ça n’a pas été très spectaculaire, on a l’impression que c’est tombé un peu aplat.
VICTOR. – C’est l’autre leçon qu’on a tirée de la campagne, à savoir le danger qu’il y avait à lancer des mots d’ordre qui pouvaient être faussés par le gouvernement.
A partir de ces mots d’ordre le gouvernement pouvait manipuler l’opinion et on n’était pas capables de réagir.
Par exemple, quand on disait : » Pas de vacances pour les riches « , le gouvernement manipulait sur le thème : » Les gauchistes s’attaquent aux vacanciers « ; il accréditait l’idée qu’il y aurait partout des actions sabotant les vacances et qu’il s’y préparait.
Il va de soi qu’on n’était pas capables,- ce n’était pas notre objectif d’empêcher que tous les riches prennent leurs vacances.
Cette campagne signifiait pour nous qu’il y aurait un certain nombre d’actions… de 50 à 100, qui dégageraient une opinion publique progressiste : l’idée de l’opposition de classes pendant les vacances.
Le jeu du gouvernement a été, à la fin de ces vacances, de dire : » Au fond, il y a peu de chose, donc ils ont lancé un mot d’ordre qu’ils n’ont pas réussi à matérialiser. «
On voit la complexité : du point de vue de notre objectif, on ne peut pas dire que c’est un échec puisqu’on ne prévoyait pag plus, mais on n’a pas réussi à contrer la manipulation du gouvernement et ça, c’est l’aspect d’échec.
Là, on a eu un autre exemple après la rentrée, avec le mot d’ordre : » Tous dans la rue pour le procès Geismar. «
On voit que lorsqu’on appelle à une manifestation pour mobiliser, on est obligé de s’adresser à tous, donc on a spontanément tendance à dire : » Tous dans la rue « ; mais il faut justement, à la lumière de l’expérience, résister à la tendance spontanée que l’on a parce que l’on sait que le gouvernement pourra l’utiliser pour hausser les enchères et dire s’il n’y a que deux-trois mille manifestants : » Ah, voici deux-trois mille manifestants, il y a quarante millions de Français. «
On en tire la leçon positive qu’en aucun cas les mots d’ordre des campagnes ne doivent prêter à des possibilités de manipulation de gouvernement, que le caractère réaliste du mot d’ordre doit être inhérent dans la définition.
Il faut expliquer maintenant ce qui en gros va couvrir l’explication de l’année écoulée (70-71).
La Gauche Prolétarienne, avant sa dissolution, traduisait la volonté d’action des noyaux de gauche dans la jeunesse intellectuelle et dans les grandes usines, et aussi sous une forme plus lâche, chez les paysans, chez les petits commerçants.
Dans l’orientation et la pratique de la Gauche Prolétarienne, il y avait une correspondance avec ce que voulaient immédiatement ces petits noyaux de gauche, ce qui a permis sa progression très rapide.
Quand ces noyaux de gauche et par là même, la Gauche Prolétarienne, ont commencé avec ces idées, à transformer la réalité, quand le gouvernement a réagi et donc mis en place de nouvelles formes de répression, il s’est posé pour les noyaux de gauche et pour la G.P. la question : » Comment faire pour briser la répression? » ce qui veut dire : » Quels sont nos points faibles visés par la répression et donc quels sont les points qu’il nous faut corriger pour résister à cette répression? «
On a vu tout de suite que la réponse fondamentale c’était : élargir les pratiques qui faisaient participer cette petite minorité de gauche, de telle manière que des couches plus larges dans les usines puissent y reconnaître leurs préoccupations et donc participer.
Très vite, on a vu qu’il fallait élargir la pratique dite de ce résistance « , la faire passer du stade des actions impulsées par les petits noyaux de gauche à des actions entraînant une autre fraction des masses : celles qui auparavant sympathisaient ou se posaient des questions sur les actions des petites minorités de gauche sans intervenir directement.
Ça a été le thème de cette fin d’année 70-71 : élargir la résistance.
Comment élargir la résistance? On avait construit un instrument, la G.P., adapté à une mobilisation des noyaux de gauche.
Pour ce élargir la résistance « , on ne pouvait pas le faire en élargissant la Gauche Prolétarienne. Il fallait donc détruire un instrument qui avait été adapté avant, pour construire un nouvel instrument.
C’est un processus très complexe.
Il ne s’agissait pas de se disperser à tous les vents, en se disant : » Maintenant, on doit penser plus large. «
On n’aurait jamais eu la capacité de coordonner les initiatives et les expériences nouvelles qu’on commençait à accumuler en une orientation de travail commune pour tous les noyaux de gauche, dans toutes les régions, si on avait, au sens strict, tout détruit.
Il fallait donc qu’on garde un minimum de l’ancien instrument idéologique, politique et organisationnel et qu’à partir de ce minimum, on expérimente et systématise des choses nouvelles, puis qu’à partir de là on construise, pas après pas, le nouvel instrument.
Cela ne se fait pas sans lutte de classes intense.
Je précise tout de suite qu’il n’est pas fréquent de parler de lutte de classes à l’intérieur d’une organisation communiste.
Pour pas mal de gens, le modèle est le P.C.F. et quand on parle de lutte à l’intérieur du P.C.F., il s’agit nécessairement de luttes entre cliques ou entre fractions.
Pour nous, la lutte de classes est la réaction la plus saine qui soit, le moteur du développement d’une organisation communiste. La forme que la lutte des classes revêtait, chez nous, n’était pas une constitution de tendances, ou de fractions, c’était la lutte entre les idées anciennes et les idées nouvelles.
Chaque unité militante avait affaire à un problème nouveau, se trouvait face à un début d’expérience, avait des réactions différentes.
Il fallait que ces réactions s’affrontent et que le nouveau triomphe de l’ancien.
Ça ne va pas tout seul. Il faut constamment mener une lutte idéologique dans chaque unité militante pour que soit discerné ce qui est nouveau et utile et ce qui est la conservation de l’ancien : la routine.
L’objectif d’ensemble du nouvel instrument a été donné : les militants de la G.P., qui avaient été comme un poing refermé, devaient s’ouvrir et se disperser dans les différentes couches contestatrices pour essayer de traduire idéologiquement et dans des formes d’organisations à caractère de masse, les aspirations de chacune des couches contestatrices.
Avant, il y avait la Gauche Prolétarienne qui intervenait dans les différentes couches, maintenant, il fallait qu’il y ait dans chaque couche, une organisation à caractère de masse qui s’édifie.
Il y a eu des formes d’organisations dans les banlieues de la région parisienne, – puisque nous nous sommes toujours portés sur les banlieues – qu’on appelait le ce détachement de banlieue » qui pouvait travailler sur une usine, soit passer d’une usine à une cité.
C’était le groupe de base.
Maintenant il fallait qu’une partie de ce groupe de militants travaillent directement à l’intérieur de l’usine pour aider à l’organisation de groupes à l’intérieur de l’usine.
Une autre partie des militants du détachement travaillant dans le mouvement de la jeunesse de la zone en question avaient pour tâche de développer le mouvement de masse de la jeunesse.
Une autre partie devait travailler sur toutes les organisations démocratiques populaires qui peuvent être créées dans la zone, comme le Secours Rouge et à partir du Secours Rouge, toutes sortes d’organisations populaires fondées sur les expulsions, le prix de l’eau, etc.
Dans le Nord, par exemple, l’organisation des femmes de mineurs ou l’association des silicoses, etc.
Les militants qui, avant, étaient regroupés et qui ensemble allaient dans les différentes directions, éclatent maintenant entre les différentes composantes du mouvement populaire sur une zone, et ont pour tâche, dans chacune de ces fractions du mouvement populaire, de stimuler les organisations de masse autonomes.
Quand ce travail a porté ses fruits, quand un réel travail de masse est engagé dans l’usine principale de la zone, dans les cités de la zone, dans le mouvement de jeunesse de cette zone, on unifie les leaders les plus actifs de ces trois mouvements de masse dans des formes d’organisations à caractère de parti qui sont les Comités de base de l’organisation qui va naître de la destruction de la G.P.
II y a eu pas mal d’organisations de Front démocratique à caractère de masses que nous avons aidé à créer.
La plus importante par rapport à ses objectifs est le Secours Rouge. L’idée est née avant l’été 70 : l’idée, le plan d’édification et la naissance du comité d’initiative. Mais le Secours Rouge de base a commencé à se créer pendant l’été.
En fait la percée du Secours Rouge date de Burgos et du tribunal de Lens. Dans le cadre nouveau, il y a eu aussi, à la rentrée, le projet de » J’accuse « , comme journal d’alliance entre les militants issus de la Gauche Prolétarienne et ceux qui s’étaient regroupés pour la défense de La Cause du peuple, essentiellement ce les Amis de la Cause du peuple « .
D’ailleurs, » les Amis de la Cause du peuple » a été aussi une organisation de masse : pas nombreuse mais extrêmement efficace, puisqu’elle a rempli les objectifs qu’elle s’était fixés.
C’était vraiment un modèle d’organisation de masse avec une orientation, des dirigeants reconnus et représentatifs et des objectifs qu’elle a atteints.
A cette mentalité nouvelle, à ces pratiques nouvelles, il y a eu résistance de l’ancien, des pratiques et des mentalités anciennes.
A l’heure actuelle, fin 71, ce n’est même pas encore extrêmement résolu dans tous les esprits. J
e précise que l’on peut, chez nous, critiquer avec violence un camarade pour telle ou telle, idée, ou telle ou telle pratique mais il n’est pas pour autant ni exclu ni déchu de ses fonctions s’il a des fonctions de responsabilité, c’est vraiment la lutte idéologique.
Cette lutte idéologique extrêmement intense ne reflétait strictement aucun désaccord politique de fond, a fortiori aucune constitution de fractions.
Si j’insiste tellement, c’est qu’à la rentrée 71, semble-t-il, les journaux bourgeois ont eu vent qu’on avait engagé un mouvement de rectification et ils l’ont traduit à leur manière par une crise au sein des maoïstes, des dissensions, des tendances, etc.
Au contraire, on n’est jamais mieux unis que quand on lutte.
A part l’exclusion de l’élément provocateur Fofana, il n’y a eu aucune exclusion.
Il y a eu bien sûr des repliements partout, des camarades qui changent d’affectation, des responsables qui reviennent à la base; il y a évidemment toute une série de changements mais ça se fait précisément à mesure que progresse l’unité.
– Les militants avaient tendance à considérer le travail auprès des démocrates comme droitier…
VICTOR. – Oui, les idées erronées dans la phase nouvelle se sont manifestées dans la séparation entre le travail révolutionnaire, et le travail ce démocratique « , essentiellement conçu comme un rassemblement d’intellectuels, avocats, médecins, journalistes, etc., autour des maos.
On a mené une série de luttes idéologiques parties d’expériences de campagnes.
Les camarades ont eu des rapports avec ceux qui étaient appelés des ce démocrates » et à partir de ces luttes on a réussi à s’éclair-cir les idées.
Nous pensons qu’il y a des démocrates bourgeois. Ce sont les démocrates attachés aux principes de la démocratie bourgeoise, c’est-à-dire aussi bien à la défense des libertés fondamentales qu’au respect des institutions, à tout le moins au respect de la légalité. Avec eux, on peut faire des alliances dans certaines conditions déterminées.
Par exemple, au moment de la lutte contre les saisies de La Cause du peuple, on pouvait parfaitement trouver progressiste que le directeur du Monde fasse un éditorial dans Le Monde pour s’élever contre cette atteinte à la liberté d’expression. Même en termes extrêmement voilés, c’était positif.
Mais le directeur du Monde n’a jamais caché qu’il soutenait la légalité dite républicaine et même le gouvernement, puisque plusieurs fois il l’a soutenu. Ces démocrates bourgeois sont des alliés indirects, des alliés secondaires comme disent les Chinois.
Dans certaines conjonctures, on peut, sur un objectif déterminé, faire une alliance avec eux. Sur tous les autres points, il y a évidemment un fossé.
Pour les autres, ceux que plus généralement on appelle les démocrates, ou les amis, ou les progressistes, leurs caractéristiques objectives font qu’ils luttent pour la démocratie mais pour une démocratie nouvelle par rapport au système démocratique ancien, au système démocratique bourgeois.
En particulier qu’ils s’opposent à la légalité. Dans le développement du Front Démocratique, même les actes initiateurs sont des actes profondément illégaux, des actes éminemment subversifs.
La diffusion de La Cause du peuple par Sartre et tout le mouvement démocratique qui s’en est suivi présente toujours la même caractéristique : il rompt avec le système légal en un point de ce système; pas forcément sur tous les points, pas nécessairement avec des formes violentes ouvertes.
Ces démocrates illégalistes démontrent d’eux-mêmes qu’ils sont des démocrates d’un type nouveau puisque le démocrate bourgeois, le démocrate de type ancien, est un démocrate qui respecte la légalité.
Ceci est fondamentalement nouveau, et fondamentalement subversif dans la situation française actuelle.
– Même les policiers parlent de sortir de la légalité.
VICTOR. – Exactement. La grande démocratie est un processus historique qui a connu son avènement avec la Révolution française; c’est essentiellement la conquête des libertés fondamentales.
Cela dit, la démocratie a un caractère de classe : selon les époques elle change de contenu.
En France, en 1789, la classe qui devait diriger, parce que c’était la seule qui avait les moyens historiques, était la classe bourgeoise.
Par ses intérêts de classe, elle a donc marqué de son empreinte la démocratie.
Elle a simplement associé à l’idée des libertés conquises par les émeutes populaires, son propre système de représentation politique. La démocratie bourgeoise née avec la Révolution française a donné naissance à une pensée démocratique qui est éminemment contradictoire.
C’est-à-dire qu’il y a un élément de cette pensée qui est la théorie des libertés.
Mais il faut bien voir que cet élément-là n’est pas bourgeois, il a été conquis par un mouvement populaire.
Et l’autre élément de la pensée démocratique c’est son système de représentation, ses lois, son mode électoral, çac’est à elle.
Et la meilleure preuve qui montre que la pensée démocratique c’est l’unité de ces deux éléments, et une unité contradictoire, c’est que chaque fois qu’il y a eu un mouvement populaire qui remettait en question les intérêts de classe de la bourgeoisie, donc en partie son système de représentation (toutes les révolutions du XIXème siècle), la première chose que la bourgeoisie faisait, c’était de violer les libertés, ce qui montre bien que pour elle ce qui est fondamental dans la pensée démocratique, ce qui est primordial, ce n’est pas du tout les libertés, c’est son système de représentation, c’est-à-dire ses intérêts de classe.
Alors ce qui est pour nous, nouveau dans la situation française actuelle, et c’est ça qu’on doit développer et renforcer, c’est l’idée que les libertés n’appartiennent pas du tout à la bourgeoisie, que ce qui lui appartient c’est son système représentatif, ça on les lui donne, les institutions de la Ve, institutions de la IVe aussi on les lui laisse si elle les veut encore, et leur fond, c’est-à-dire le système représentatif, électoral, parlementaire ou alors parlementaire dégénéré, c’est-à-dire parlementaire technocratique de la Ve république, tout ça, on les lui abandonne à la bourgeoisie.
Mais ce qu’on leur reprend, parce que ça ça nous appartient, c’est les libertés.
Alors ça devient quoi notre démocratie à nous?
Ça devient les libertés, avec un nouveau système de représentation politique, celui qu’on appelle, depuis Mai 68, la » démocratie directe » qui convient aux masses populaires, qui permet d’avoir une représentation directe, contrôlable, révocable à tout moment, le bon vieux principe de la révolution, alors elle, populaire, prolétarienne.
Les démocrates qui luttent pour les libertés mais qui luttent aussi pour ce nouveau système de représentation politique pour les masses, sont donc des démocrates de type nouveau.
Il est donc exclu qu’on dise d’un côté, les révolutionnaires et de l’autre, les démocrates.
Il y a d’un côté les révolutionnaires prolétariens qui ont un système idéologique de travail politique complet avec une certaine cohérence, qui sont animés d’une certaine discipline y compris dans le domaine de l’organisation et il y a des démocrates révolutionnaires, qui peuvent faire un travail parfois supérieur à celui de certains révolutionnaires prolétariens.
Cet embarras terminologique (sur le terme » démocrate « ) a engendré beaucoup de monstres : le démocrate venu à la pratique de masses illégalistes, à partir de la défense des libertés, pouvait être cent fois plus actif, cent fois plus ingénieux, avoir des idées cent fois plus justes, le mao s’estimait quand même cent fois supérieur à lui puisque lui était un » révolutionnaire « , et l’autre un » démocrate « , sous-entendu la classe en dessous d’un révolutionnaire.
Le terme ce démocrate « , outre qu’il a été chargé de pas mal d’équivoques, dans la situation française, n’est pas suffisamment explicite, puisque le P.C.F. se prétend démocrate et prétend lutter pour la démocratie.
Il y a une difficulté dans la terminologie politique qu’on n’a pas encore résolue.
– Pendant cette période, que se passe-t-il, dans les usines ? Les comités de lutte.
VICTOR. – La grande vague de séquestration déferle indépendamment de l’intervention immédiate tactique des maos, c’est incontestable et nous paraît positif : cela montre la correspondance entre les idées nées de la pratique des niasses et ce qu’on essaye de systématiser, mais il ne faut pas passer sous silence une expérience aussi cruciale que la « Grande Lessive » à Nantes-Batignolles, où notre intervention a été autre qu’idéologique et qui nous a énormément marqués, puisque là le déclenchement idéologique et pratique est le fruit du travail de mobilisation (pas uniquement, il y a les lois propres de mobilisation des masses), mais notre travail amène quand même à une forme de lutte extraordinaire qui a marqué la situation française.
Comment la suite a échappé à l’intervention active des noyaux maos est aussi une expérience intéressante qui nous a permis de tirer pas mal de règles utiles par la suite.
En particulier, au moment de l’offensive de printemps chez les métallos.
– Est-ce possible de définir les règles d’une manière concise ?
VICTOR. – On vient de donner à imprimer une brochure : Vingt-cinq règles de travail en usine, qui représente une cinquantaine de pages!
Il vaut mieux essayer de voir les choses dans l’ensemble.
Le jugement d’ensemble qu’on porte sur cette période, jusqu’au printemps 71, c’est qu’il y a eu/très nettement deux voies :
1. L’une qui pousse vers l’avant, vers la réalisation de l’objecif : réunifier les noyaux maos capables d’impulser de nouvelles organisations de masse et créer ces organisations.
2. L’autre qui tire vers l’arrière.
C’est ce qui dégage l’incertitude de la pratique de l’ex-Gauche Prolétarienne, vue même de l’extérieur.
On ne l’a compris qu’au sortir du printemps 71, quand on a pu faire le bilan de nos capacités d’intervention devant l’initiative prise, essentiellement, par les métallos [Grève des OS du Mans puis de toute la Régie Renault pendant 5 semaines].
Le courant qui allait en avant était celui qui, dans les usines, faisait progresser la création des » comités de lutte » et des formes nouvelles de pratique violente à caractère de masse dans les ateliers, ce qu’on a appelé à partir de Boulogne-Billancourt les » G.O.A.F. » (Groupes Ouvriers Anti-Flics) qui sont la force protectrice face à la répression des masses ouvrières.
C’est l’aspect le plus important du courant nouveau, mais il y a eu des freins un peu partout, des tendances de courant ancien, à dire : » Bon, la situation devient compliquée, on ne peut plus faire comme avant « , et au lieu de conquérir des terrains nouveaux et d’affronter une situation compliquée et nouvelle, on a fait du surplace : le travail de masse s’est sclérosé et les initiatives de lutte avec un certain degré de violence se sont rétrécies considérablement.
Ces deux caractéristiques :
– sclérose du travail de masse,
– perte progressive de l’initiative dans les luttes sont des
caractéristiques de droite, ce qu’on appelle les ce tendances opportunistes de droite « .
Sur plusieurs grandes bases d’usine, les camarades auraient pu aider l’offensive ouvrière, et ils ne l’ont pas fait.
C’est la définition même de l’opportunisme de droite : être en arrière par rapport au mouvement de masse.
Quand on en a pris conscience, on a décidé un mouvement de rectification, qui a démarré au mois de juin, qui est loin d’être encore terminé (octobre 71).
Il s’appelle ce Mouvement d’assainissement idéologique, de critique politique de la droite et de préparatif de la rentrée populaire « .
Pour que le sens de ce mouvement de rectification soit clair, je prends un exemple, le plus avancé, le plus significatif : celui de Lyon.
Lyon est une grande région où les tendances de droite s’étaient développées l’an dernier (70-71).
Comme toujours les tendances de droite se localisent d’abord et avant tout dans les usines, et particulièrement dans les usines où la répression est la plus dure : les usines de type fasciste, de type Citroën, ce qui est le cas de l’usine Brandt.
Les camarades se concentrent donc sur cette usine pour « rectifier « .
Grande mobilisation idéologique des camarades sur le thème: » Faut liquider tout ce qui a été droitier, faut retrouver la grande inspiration et on fonce. «
Très vite, de fait, il y a des résultats dans le travail de masse.
Différentes initiatives sont prises par rapport au licenciement d’un groupe d’ouvriers à la veille des vacances, sous forme de lutte de masse dans deux ateliers et d’une série de sabotages. Là, se produit l’emballement.
Les camarades veulent précipiter les événements.
La tête leur tourne.
Ils oublient toutes les choses nouvelles apprises depuis la dissolution de la G.P., à savoir le lien indispensable avec les larges masses, la nécessité d’assurer toujours ses arrières : ils organisent un sabotage qui n’est pas à la portée des masses, pas du tout comme les petits sabotages qui encouragent l’initiative.
Un sabotage qui devait être organisé par un petit groupe, et arrêter plusieurs chaînes.
Ce sabotage devait être réalisé selon des règles extrêmement strictes puisqu’il se situait à l’intérieur de l’usine mais pas sous le contrôle direct des masses; il fallait le préparer, même militairement.
Or, dans l’atmosphère idéologique d’emballement, tous ces préparatifs ne sont pas minutieusement pris en main.
Quand le sabotage se fait, il est au-dessus du niveau de conscience des masses et préparé dans ces conditions de précipitation, on ne peut pas éviter qu’il y ait une répression très rapide, et que des ouvriers soient piqués.
On voit, à ce moment, que la seule critique du travail groupusculaire ne suffit pas.
Critiquer la droite ne veut pas dire retourner à la vieille Gauche Prolétarienne.
Critiquer la droite, c’est aussi critiquer l’ancien, quelque chose qui est purement gauchiste.
Critiquer la droite ne signifie pas simplement faire des actions violentes, ce qui nous ramènerait à l’ancien; et comme l’ancien n’est pas conforme à la situation actuelle, ce serait aussi mauvais.
Grâce à l’expérience chinoise et aux camarades qui sont rentrés de Chine, on comprend que les positions de droite et les positions gauchistes, c’est du pareil au même, c’est aussi dangereux.
Ce n’est pas mieux d’être gauchiste que d’être droitier, il faut lutter sur les deux fronts.
D’où, après mobilisation sur le thème : » Faut liquider le courant droitier « , autre phase sur le thème : » Attention, on liquide le courant droitier mais on ne tolère pas qu’il y ait des courants gauchistes qui reviennent. «
D’où les camarades comprennent qu’il faut se mettre à la hauteur de la situation, qu’on ne peut pas faire l’économie de la réflexion ni de l’analyse du point de vue des larges masses qui n’est pas le même à Lyon ou à Renault-Billancourt.
Après cette erreur, les camarades s’accrochent et commencent la rectification de manière extrêmement énergique.
Au lieu de sanctionner l’erreur, par exemple, en quittant la boîte – la répression était telle qu’ils auraient pu se barrer, quitter Lyon aussi pourquoi pas?
Il y a d’autres villes industrielles -, ce qui aurait été une liquidation catastrophique, ils décident de remonter le courant.
Pas passivement, mais en contre-attaquant.
Ils préparent le procès de Brandt, le transforment évidemment en procès populaire contre le directeur de l’usine et mettent au point des méthodes de travail de masse remarquables, tant du point de vue des ouvriers à qui il fallait redonner confiance par de petites initiatives prudentes et progressives qu’à l’extérieur, dans le quartier, qu’avec les amis démocrates.
Forcément, quand on est gauchiste dans une usine, on est aussi gauchiste avec les amis démocrates, gauchiste dans le Secours Rouge.
Il fallait donc rectifier là aussi, convaincre tout le monde dans l’usine, dans le quartier autour de l’usine, tous les amis lyonnais regroupés dans le Secours Rouge, faire un travail politique sans précédent.
Et ils l’ont fait, en écoutant toutes les questions, en répondant à toutes les demandes d’explications, pendant plus d’un mois, et les résultats sont très bons.
C’est la première fois que le jour du procès dont la date est annoncée par la bourgeoisie, seulement cinq jours à l’avance, il y a un débrayage, de 100 à 150 ouvriers à l’intérieur de l’usine, pendant le temps de l’audience.
(Le premier procès parce qu’après, il y a eu ajournement.)
Et le verdict du procès est une victoire : deux mois avec sursis.
Pour nous, c’est la preuve que le mouvement de rectification va dans le bon sens.
Le mouvement de rectification n’est pas terminé.
On a fait un gros effort dans notre travail politique, pour étendre les leçons tirées de Billancourt; les camarades de Billancourt sont allés faire des causeries, des échanges d’expériences avec les ouvriers d’autres boîtes pour faire passer les idées les plus avancées qu’ils avaient acquises.
On a réuni les représentants des grandes bases d’usine pour que la lutte contre la tendance de droite conduise au resserrement des liens entre les bases d’usine et à la progression de l’initiative à l’intérieur des bases d’usine, tout en ne négligeant pas les autres organisations de masse, mais incontestablement en mettant l’accent principal sur les bases d’usine.
Cela aurait été facile pour nous, à la rentrée, de faire quelques coups.
II y en avait même de très simples à faire sur les poli-ciers, sur les représailles à l’attentat contre Christian Riss, etc.
Organiser des coups, des actions qui fassent parler, n’est pas un problème : si nous ne le faisons pas, c’est un choix qui renvoie à une certaine conception de la progression de notre travail politique.
On s’est refusé à faire différentes campagnes, par exemple Rives-Henrys.
Il n’y a aucune objection de fond, c’est populaire de faire des actions sur le logement, sur les crapules de l’immobilier, mais comme ça ne correspond pas à un développement bien enraciné de notre travail politique, on le refuse pour le moment.
– Ce qui fait dire : » Les maoïstes sont dans le creux de la vague… «
VICTOR. – S’il y a eu » creux de la vague « , c’était en fait à des moments où on faisait parler de nous.
Par exemple janvier-février avec la campagne sur les emprisonnés, Guiot, etc.
Il y a même eu pas mal d’actions assez spectaculaires dans le cadre de la campagne sur la grève de la faim mais c’était précisément là qu’on était dans le creux de la vague, mais le moment de la lutte la plus aiguë entre l’ancien et le nouveau, ne se voit pas de l’extérieur.
Maintenant il n’y a plus de page » Agitation » dans Le Monde et c’est pourtant en ce moment que les actions’les plus importantes sont en train de se faire.
– » Que la contestation latente se transforme en forme matérielle organisée, pour ne pas être récupérée par la bourgeoisie… «
VICTOR. – Entendons-nous sur : » récupérée « . » Récupérée » par les partis de gauche, comme dit Jean Daniel [DIrecteur du « Nouvel Observateur »], pas un seul instant.
Récupérée par la bourgeoisie parce qu’il y a un certain découragement dans les masses, une paralysie parce qu’on n’a pas envie de revenir aux formes traditionnelles et qu’on ne voit pas les formes nouvelles, ça oui.
Mais le danger de récupération par les partis de gauche en France, est nul. Si on prend l’exemple des transports, les partis de gauche gagnent un point. Ils font, en plein mois d’août, une manifestation d’usagers. Bon. Mais ils reperdent tout avec la grève [d’une semaine] du métro, en octobre.
Qu’ont-ils récupéré sur le métro? Zéro, parce que s’ils parlent dans les prochaines manifestations, de l’unité des agents de la R.A.T.P. et des usagers, ils vont faire rire.
En Italie, la récupération par les syndicats a un certain sens. Chez nous, c’est une récupération passive : les syndicats exploitent nos erreurs uniquement parce que la force qu’ils auraient à combattre en face d’eux ne s’organise pas.
Le problème est de savoir à quelle étape on en est de la construction de cette force matérielle. De la construction du parti.
– Qu’est-ce qui différenciera ce parti?
VICTOR. – II sera lié aux masses.
– Mois tous les partis s’imaginent qu’ils sont liés aux masses!
VICTOR. – Oui, mais justement, nous, on veut des critères objectifs de liaison avec les masses. De fait, on aurait pu s’appeler : ce parti » quand on était la G.P. mais on savait qu’on avait un rapport seulement avec une fraction limitée et déterminée des masses.
C’était un rapport avec des noyaux de la Gauche ouvrière dans certaines grandes usines, ou de la Gauche étudiante ou lycéenne.
Et on ne pense pas que ça suffise pour faire apparaître un parti qui ne soit pas un sigle, un parti qui soit réellement un instrument dans lequel les masses ouvrières, principalement, se reconnaissent, aient confiance.
Surtout qu’elles sortent d’une longue période où elles ont été écrasées par le parti en qui elles ont eu confiance.
Elles ne vont pas redonner cette confiance n’importe comment.
– Comment comptez-vous la gagner?
VICTOR. – En d’autres termes : quand est-ce qu’on pense qu’on peut construire le parti?
Très précisément quand on aura fait la preuve dans certaines grandes usines stratégiques qu’on est capables d’être un noyau dirigeant effectif de mouvement de masse, autonome par rapport à la C.G.T., alors les conditions principales de la construction du parti seront réunies.
Il y en a d’autres : une ossature de cadres liés aux masses.
Ces deux conditions doivent être liées : pour que l’on ait cette ossature de cadres liés aux masses, il faut précisément que l’on ait réussi à créer cet embryon d’organisation de niasse dans certaines usines considérées comme stratégiques.
– Où en êtes-vous par rapport à cet objectif?
VICTOR. – On a créé les germes effectifs d’une organisation de masse autonome, mais c’est la pratique qui doit trancher.
Il n’y a pas encore d’exemple de mouvement de masse conduit pendant tout son développement, selon les méthodes entièrement nouvelles et autonomes par rapport à la C.G.T.
Il y a des exemples d’autonomie partielle réalisés dans des boîtes importantes.
L’exemple le plus important étant le mouvement du 22 janvier chez Renault [le mouvement des cinq semaines de grève], mais ça ne suffit pas.
L’autonomie n’est encore que partielle, elle n’a pas couvert l’usine, elle n’est pas l’occasion d’un mouvement d’ensemble. De plus, c’est un mouvement bref au cours duquel les embryons de cadres de niasses ne se sont pas éprouvés assez longtemps.
Ils n’ont pas eu à répondre à toutes les questions que pose un mouvement de masses sur un temps suffisamment long. Il faut cette expérience-là pour éprouver les cadres et les organisations.
Et par là même pour gagner une confiance solide, pas simplement idéologique.
– Ces mouvements de masses se reconnaissent-ils comme maoïstes ?
VICTOR. – II faut analyser cas par cas.
Dans le cas de Batignolles, l’initiative de départ est très fortement préparée et travaillée par l’activité du noyau mao.
Mais le développement du mouvement, les suites de la grande lessive, après la contre-offensive du gouvernement, du patronat et du syndicat, a complètement échappé aux initiatives de ce noyau mao et de la fraction des masses qui aurait été prête à se dégager de la tutelle syndicale. Ce qui est la preuve, dans le cas des Batignolles, que la force autonome n’est pas encore suffisamment mûre.
Dans le cas de Férodo, c’est un mouvement totalement autonome; il n’y avait pas de travail antérieur d’un groupe prolétarien qui aurait préparé par exemple la séquestration.
Si on considère le nombre de mouvements de masses, du type spontané d’une part et d’autre part, les mouvements
dans lesquels des noyaux de gauche prolétariens ont travaillé, on tire la conclusion que nous n’en sommes pas encore au stade où on peut prétendre avoir créé l’embryon d’une ossature d’organisation de masses autonome dans les usines les plus importantes.
Pourquoi? Parce qu’il y a énormément de mouvements autonomes où les camarades n’ont pas été présents, ou bien n’ont pas fait un travail conséquent.
Dans le cas où les camarades ont fait ce travail, il n’a pas encore la maturité suffisante.
Le bilan, c’est que si nous pensons disposer d’un certain nombre d’armes pour aider à la création de cette force autonome, nous pensons que nous n’en sommes pas encore au stade où on peut dire qu’elle a été créée.
Or, c’est la condition décisive pour la construction d’un parti nouveau.
– Sur quel modèle sera ce parti ?
VICTOR. – Le parti sera-t-il régi par le centralisme démocratique? Il faut savoir ce qu’on entend par là.
Si on prend l’interprétation de Marchais, on a un parti qui fonctionne à partir d’une ligne politique fixée par le bureau politique de ce parti (dans le cas de Marchais, c’est une politique qui n’est même pas fixée par le bureau politique du P.C.F. mais par Moscou), et la manière de faire adopter cette politique est de la proposer à toutes les organisations du parti qui en discutent et se trouvent d’accord, plus ou moins, à l’unanimité.
C’est l’image du centralisme démocratique en France. Image très repoussante puisque si on voit bien ce qu’il y a de centralisé, on ne voit pas ce qui vient de la base, non seulement de la base militante mais des masses elles-mêmes. La ligne est fixée d’en haut et on l’applique.
Ça donne le monolithisme qui permet de toujours trouver un moyen pour exclure démocratiquement, c’est-à-dire en respectant les règles, quelqu’un qui n’est pas d’accord.
Tous ceux qui ont tenté de s’opposer à la ligne officielle du parti, se sont trouvés éliminés du parti.
Ça, c’est une conception caricaturale du centralisme démocratique, qui s’appuie à la lettre sur les thèses de Lénine, mais ce n’est pas difficile de démontrer que ça en dénature l’esprit.
Pour dire les choses le plus clairement du monde, nous pensons que, de toute façon, l’interprétation vivante, pas caricaturale des thèses de Lénine, est insuffisante à notre époque.
On est à une époque différente, on a eu toute l’expérience de la dégénérescence de la IIIe Internationale, et on ne peut pas faire comme si toute cette époque historique n’avait pas existé.
Heureusement pour nous, il y a eu un parti communiste dans le monde qui a fait le bilan de cette expérience dans ses grands traits, c’est le parti communiste chinois.
Il ne s’est pas contenté d’écrire des textes contre l’Union soviétique ou contre l’interprétation qu’en faisait le parti communiste, pour démontrer que l’Union soviétique révisait ou dénaturait les principes de Lénine.
Il a fait autre chose : il a résolu dans la pratique les problèmes que la IIIe Internationale avait laissés en suspens, il a fait la Révolution culturelle et de la Révolution culturelle présente une interprétation toute nouvelle des partis politiques.
Lorsque nous disons : on veut créer un parti politique nouveau, cela veut dire : on veut créer un parti politique de l’époque de la Révolution culturelle.
Est-ce que cela signifie que l’on abandonne le principe du centralisme démocratique? A dire vrai : pas du tout – mais le contenu du centralisme démocratique est tout à fait différent de ce que croit Marchais et d’autre part développe ce qu’écrivait Lénine.
En quoi? Grosso modo, la base de cette conception nouvelle, c’est l’idée selon laquelle les idées justes viennent de la pratique des masses.
A l’époque de Lénine, cette conception n’était pas évidente. Les partis qui ont été formés à l’époque de Lénine avaient une conception philosophique différente.
Le rôle des intellectuels porteurs des connaissances sur la société était différent du rôle qu’on assigne aux intellectuels à notre époque.
Lénine, dans son texte qui présente les principes du centralisme démocratique, disait – je schématise – que les intellectuels apportaient la science, et que la classe ouvrière apportait la pratique et qu’il fallait qu’il y ait fusion de cette science produite à l’extérieur de la masse ouvrière, du mouvement ouvrier, avec l’expérience pratique de la classe ouvrière. Cette conception est démentie par la vie.
Quand Mao Tsé-toung dit : » les idées justes viennent de la pratique sociale « , c’est différent de ce que Lénine avait pensé à l’époque précédente.
Cela a des répercussions directes, décisives, sur la construction du parti et il faut entendre d’une autre manière la centralisation.
La centralisation devient la centralisation des idées justes qui viennent de la pratique des masses.
D’où le rapport d’organisation entre le centralisme et la démocratie est modifié.
Il y a nécessairement si on veut avoir une orientation correcte, c’est-à-dire centraliser les idées justes, à se mettre avant tout à l’école de la pratique des masses.
Pour présenter les choses de la manière la plus claire qui soit, l’exigence d’écoute directe des masses est beaucoup plus forte que dans la conception léniniste.
Un maoïste conséquent sait qu’il ne pourra pas avoir d’orientation juste, d’idées justes sur les rapports entre les forces de classe si ces idées ne viennent pas du bilan de l’expérience des niasses.
A l’époque de Lénine, on pensait avoir des idées justes sur la paysannerie russe, en faisant un énorme travail théorique de la situation du développement du capitalisme dans l’agriculture.
Le parti bolchevik est certainement le parti qui a le plus écrit sur l’agriculture, il y a un nombre impressionnant de travaux de Lénine sur l’agriculture, et pourtant avant 1917 le parti bolchevik était très peu implanté dans la paysannerie.
Il y avait beaucoup de textes et très peu de pratique.
Ce qui explique en particulier qu’en 17, quand le mouvement paysan a pris son essor, Lénine, qui était un prodigieux homme politique prolétarien, a oublié certains des textes écrits et s’est emparé tout de suite des revendications nouvelles, quitte à paraître aux yeux des intellectuels qui ne voyaient que les livres comme quelqu’un qui avait renié ses ouvrages antérieurs.
– L’ » écoute « , depuis quand cette notion existe-t-elle en politique ?
VICTOR. – Systématiquement, c’est la philosophie de notre travail – cela vient de Mao Tsé-toung.
Il ne faut pas qu’il y ait un malentendu, je ne dis pas que Lénine n’écoutait pas les masses russes.
Il était intégré dans la classe ouvrière russe et il l’a montré, mais les thèses philosophiques de départ, la base de la construction du parti bolchevik, donnaient à la connaissance venue de l’extérieur du mouvement des masses, une importance qu’elle n’a pas à l’époque actuelle.
Cela a eu énormément de conséquence sur le développement du parti bolchevik, surtout au moment où il a pris le pouvoir.
Pour la formation de la nouvelle classe bourgeoise, certaines des idées du parti bolchevik sur le rôle des intellectuels ont été négatives.
Évidemment, le centralisme démocratique n’est que le point de départ mais s’il n’y a pas ce point de départ, il n’y a pas d’authentique parti prolétarien, il faut le dissoudre, le détruire, scissionner, pas que ça dure, c’est mauvais.
A partir de là, si l’orientation du parti est fixée selon ce principe – partir du mouvement de masses – systématiser l’expérience des masses – il y a des règles de fonctionnement du parti : soumission des groupes de bases aux instances supérieures, respect de la discipline.
Mais c’est une discipline consciente : tout militant qui, à partir de sa pratique de masse, se trouve en désaccord avec l’orientation peut et doit marquer son désaccord à l’intérieur de son unité de base, faire appel aux instances supérieures.
Dans les statuts du P.C. chinois depuis la Révolution culturelle, un des articles précise que tout militant du P.C. communiste peut faire appel au président du Comité central.
– Et on l’écoutera?
VICTOR. – C’est dans les statuts… C’est publié dans les statuts.
– Cela appelle des réajustements continuels ?
VICTOR. – Continuels.
Il faut continuellement provoquer des crises à l’intérieur du parti.
Je m’explique : dès qu’un parti ne connaît plus la lutte, c’est un parti dégénéré.
S’il n’y a plus de lutte dans le parti ça veut dire qu’il est mort, qu’il est du côté de la bourgeoisie.
– Qu’appelles-tu une idée juste ? Par définition, les masses ne se tromperaient jamais ?
VICTOR. – Le courant principal du mouvement de masses est toujours raisonnable. C’est notre base philosophique.
– Il ne lui arrive jamais de se tromper, par exemple d’être défaitiste? De renoncer à la lutte?
VICTOR. – Ce n’est pas le courant principal d’un mouvement de masse.
On ne dit pas que toutes les idées des masses sont justes.
On dit que le courant principal d’un mouvement de masse est juste.
Il y a une grande émeute à Bruxelles, on peut tout dire sur cette émeute : que c’étaient les gros agra-riens qui avaient organisé la manifestation, qu’il y a eu des revendications qui servaient les gros et pas les petits, qu’il y a eu des tractations, etc., on peut tout dire.
Mais si on dit que la grande jacquerie de Bruxelles, le mouvement de masses qui a conduit vingt à trente mille agriculteurs à l’assaut de la ville bourgeoise, si on dit que ça, c’était mauvais – on est dans le camp de la bourgeoisie.
– Alors tout ce qui se réunit est un mouvement de masse et a un courant principal juste ?
VICTOR. – Si on prend l’exemple de la journée de la police, il y a eu un mouvement de masses qui a mis des flics dans la rue et incontestablement le courant de ce mouvement de masse essayait de manifester que l’ensemble des policiers ne voulait pas se solidariser avec les éléments totalement fascistes de l’appareil policier.
Ce courant-là était positif et nous devions le soutenir, ce que l’on a fait.
Il y a eu d’ailleurs des équivoques : certains sont descendus dialoguer avec la police mais pour la ridiculiser!
Ce n’était pas notre position : on a diffusé un tract signé » les maos » où nous prenions très au sérieux le courant dans la police qui résistait à la fascisation et nous disions qu’à l’égard des policiers qui résistaient nous aurions une attitude correcte, qu’on n’attaquerait pas ces policiers-là comme on attaque les brigades d’intervention ou Ceccaldi-Reynaud à Puteaux.
Cela dit, la journée n’était pas au sens strict un mouvement de masses.
Il faut s’entendre sur la notion de mouvement de masses de manière très précise : des manifestations de cadres supérieurs ne sont pas des manifestations de masses.
Les cadres supérieurs ne font pas partie du peuple.
– Pour beaucoup de gens, la masse des travailleurs des usines qui, lors d’une grève, veut reprendre le travail, c’est aussi un mouvement de masses. On dit aussi que les ouvriers ne sont pas la majorité, et que la masse, après tout, c’est peut-être aussi bien la bourgeoisie? Quel pourcentage de la population représente le prolétariat?
VICTOR. – De 35 à 40 %.
– Les 60 % de l’autre côté, ça n’est pas une masse?
VICTOR. – Le prolétariat, les couches de paysans, de petits commerçants, artisans, ruinés par le développement capitaliste, la jeunesse intellectuelle et d’importantes fractions des salariés intellectuels qui subissent la crise idéologique, ça fait la majorité non seulement réelle de la population mais l’écrasante majorité numérique.
– N’est-ce pas un concept un peu dépassé de dire que la classe ouvrière et le prolétariat, c’est la même chose?
VICTOR. – Oui.
Ça rejoint un débat théorique dont les termes doivent être quand mêmes précisés.
Dans la terminologie marxiste proprement dite, il n’y a pas de différence entre classe ouvrière et prolétariat.
Dans les premiers textes de Marx, il y avait un certain nombre d’attributions données au prolétariat au sujet de l’histoire, différentes des caractéristiques économico-politiques que donna Marx après, de la classe ouvrière.
Cette distinction s’est faite surtout en s’appuyant sur les premiers textes de Marx.
On voit, en gros, ce que ça recouvre : on essaye de distinguer la classe ouvrière définie économico-politiquement et la force révolutionnaire, mais ce qui est certain par expérience directe, c’est que la force la plus révolutionnaire est incontestablement composée de ceux qui dans leurs conditions économico-politiques sont le plus ce ouvriers » au sens de classe ouvrière.
Il est incontestable que les ouvriers spécialisés, les producteurs par excellence de la plus-value, recèlent les plus grandes potentialités de révolte.
Ce qui ne veut pas dire que d’autres catégories, elles-mêmes ouvrières, comme les ouvriers professionnels, n’ont pas d’énormes qualités révolutionnaires ou qu’on ne les retrouve pas très souvent à la tête des luttes.
Exemple : Nantes-Batignolles.
En fait la question se pose chez beaucoup de gens, au niveau des forces révolutionnaires autres que les forces ouvrières telles qu’elles sont définies économico-politiquement.
On ne nie pas qu’il y ait d’autres forces révolutionnaires et pour cause! que les ouvriers proprement dits.
La jeunesse intellectuelle recèle une grande force révolutionnaire.
Chez les paysans, que ce soit les paysans pauvres totalement ruinés, ou ceux qui sont entrés dans le mécanisme du développement du capitalisme dans l’agriculture et qui ne tiennent pas le coup, il y a une force révolutionnaire potentielle fantastique.
(Quand je dis » fantastique « , elle s’exerce en actes dans l’Ouest, dans la Drôme ou dans les Vosges actuellement.)
Il y a des forces révolutionnaires, même chez les petits commerçants.
Je dis » même » puisqu’ils ne sont pas, dans l’ensemble, très aimés, vu leur tradition politique antérieure, dans la mythologie de l’intellectuel de gauche.
Je n’ai pas besoin d’appeler toutes ces forces révolutionnaires : le prolétariat.
Ce sont d’autres forces révolutionnaires définies de manière différente du point de vue de leurs conditions socio-économiques.
Elles sont révolutionnaires parce qu’elles ont intérêt au renversement de l’ordre social actuel : ce sont donc des alliés de la classe ouvrière, mais incontestablement c’est encore la classe ouvrière, la bonne vieille classe ouvrière, les producteurs de plus-value, qui sont directement exploités à travers le système le plus répressif, c’est-à-dire à l’intérieur de l’entreprise, ce sont les ouvriers proprement dits qui sont la force révolutionnaire la plus conséquente.
On ne voit pas ça par les livres, on aurait rien contre le fait que ce soit les jeunes les plus révolutionnaires.
De fait, ce ne sont pas eux qui ont le plus de conséquences dans leur effort révolutionnaire.
– Les nombreux journalistes, qui sont allés en Chine cette année, ont tous écrit des reportages enthousiastes. Ils ont conclu : ce qui se passe en Chine est étonnant mais absolument inapplicable en France. Comment peut-on par exemple imaginer un système de production par petites unités dans un pays industriellement avancé, etc.?
VICTOR. – Conséquence de l’offensive diplomatique chinoise, de la politique, comme on dit – en direction des différents pays et même des super-puissances, les images issues de l’encerclement de la Chine sont en train de se décomposer -.
C’est un gigantesque progrès que l’on dise : » La Chine, c’est bien mais le modèle chinois n’est pas applicable en France. «
Avant, on disait : » La Chine, c’est de la merde. «
Maintenant,du point de vue de la lutte idéologique, en France, il faut démolir cette idée que ce qui se passe en Chine n’a pas de portée universelle.
Je ne veux pas démontrer que ce qui se passe en Chine va se produire tel quel, en France, mais démontrer que ce qui se passe en Chine dépasse les frontières de la Chine.
Pourquoi? Parce que la Chine a résolu fondamentalement la question d’un pouvoir populaire à caractère de masse, question qui domine le débat du mouvement ouvrier socialiste et révolutionnaire dans les pays occidentaux.
Ça veut dire qu’il existe un certain nombre de contradictions sociales non résolues dans les pays « socialistes » traditionnels, qui constituent la difficulté principale pour les élaborations théoriques et stratégiques des socialistes et des révolutionnaires occidentaux.
Ces contradictions sociales sont les contradictions de classe au sein de l’entreprise malgré l’appropriation juridique collective des entreprises, malgré la nationalisation.
Deuxième type de contradictions sociales : les contradictions entre les producteurs immédiats et les porteurs des fonctions de coordination, de connaissance, de gestion, etc., qui se traduisent en Union soviétique par un éventail de salaires très ouvert et des relations oppressives.
Contradictions sociales aussi, plus complexes, entre la ville et la campagne, entre le travail manuel et le travail intellectuel, qui sont au centre du débat du mouvement occidental et trouvent leur solution positive en Chine, grâce à la Révolution culturelle.
A l’heure actuelle, en France, dans les milieux de gauche honnêtes, on arrive à reconnaître, ce qui peut être déjà une base d’accord scientifique, que les principales questions sont les mêmes là-bas et ici, malgré la différence de développement économique.
Il s’agit ensuite de savoir si les réponses concrètes qu’apporté la Chine à ces questions que nous nous posons ont une portée générale.
Pour nous, c’est oui.
D’abord, sur la planification de l’ensemble des relations économiques dans un pays comme la France, que nous apporte l’exemple chinois?
La Chine apporte la combinaison de l’initiative centrale et de l’initiative locale; combinaison harmonieuse qui ne signifie pas la fin de toute lutte entre initiative locale et initiative centrale, mais une méthode pour diriger correctement cette lutte, et qui est tout à fait applicable en France.
Même le technocrate bourgeois se pose actuellement la question de combiner les indications centrales et les sollicitations locales.
Les planificateurs technocratiques soi-disant socialistes de l’Union Soviétique cherchent à résoudre le rapport entre l’initiative locale, qu’ils appellent l’autonomie des entreprises, et le plan central.
Mais c’est dans les limites de la pensée bourgeoise qu’ils réfléchissent le problème.
En Chine, les orientations d’ensemble du plan sont proposées aux différentes unités de production qui les discutent à partir de leur expérience pratique ou qui donnent leurs propres propositions qui sont centralisées.
Par ce mouvement de haut en bas, de bas en haut, les plans généraux d’ensemble de l’économie sont élaborés.
En quoi est-ce inapplicable à l’économie française quand on aura un vrai plan?
Pas l’actuel plan bidon qui est simplement la coordination du grand capital en France.
Tout ce qui est posé dans les termes bourgeois ou réformistes : ce décentralisation « , ce régionalisation « , problème épineux en France actuellement, est résolu pour l’essentiel, je ne dis pas qu’il n’y a pas de problèmes, en Chine.
Deuxième question que tous les socialistes révolutionnaires (ou pas révolutionnaires) se posent à propos de la construction du socialisme en France, c’est la différence entre les rapports de propriété et les rapports de gestion.
Même le nouveau parti socialiste de Mitterrand (c’est dire!) se pose cette question.
Même le P.C.F., dans son dernier programme de gouvernement, gauchit un peu son langage là-dessus.
Or le seul pays où ce problème a été résolu de manière révolutionnaire et conforme à l’intérêt populaire, c’est la Chine qui a dit de manière systématique : » Le tout n’est pas de changer les rapports de propriété.
Les formes idéologiques, politiques et d’organisation des anciens rapports de production, il faut les détruire par mouvements de masse successifs. «
Faut détruire les appareils bureaucratiques légués par les vieux rapports de production, par le moyen des mouvements de masse.
Faut régler le gaspillage capitaliste, par des mouvements de masse.
Faut régler la pléthore de parasites dans les entreprises ou dans les unités de production, par des mouvements de masse. Faut régler la question des rapports entre la production et la gestion ou entre la production et les bureaux, par des mouvements de masse.
Cet événement historique mondial, à savoir la transformation radicale des rapports de production en Chine s’applique directement chez nous.
S’il y a bien un mot d’ordre dont les masses se foutent complètement, c’est celui de la nationalisation.
Les masses voient bien qu’il n’y a pas de différence, dans les Mines ou à Renault-Billancourt, entre un patron privé ou un directeur ce nationalisé « .
Quand les anciens apprennent – ce qui s’est passé pendant la Révolution culturelle – comment les masses ont été mobilisées pour arracher le pouvoir réel dont elles avaient l’exercice formel – quand ils apprennent que le mot d’ordre, à tous les ouvriers était : ce Arrachez le pouvoir dans votre entreprise », ils recomprennent tout de la libération.
Comment ils ont été trompés, comment il faut s’organiser pour ne plus être trompés.
Une série d’autres questions concernant le socialisme en France trouvent leur réponse en Chine, avec une portée générale.
Il y a en Chine une politique consciente de limitation du développement anarchique et monstrueux des agglomérations urbaines, de rapprochement entre la campagne et la ville, aussi bien dans l’espace que sur le plan des relations des paysans et des ouvriers.
Il y a un effort systématique pour que la verdure reste un élément dominant du paysage urbain, y compris du paysage des usines.
Il y a une politique systématique pour combiner l’élément créateur qu’apporté la vie de campagne avec l’élément créateur qu’apporté l’industrie moderne.
Ça vaut aussi pour nous. On fera avec le pouvoir populaire un reboisement systématique, on transformera complètement l’urbanisme.
Du point de vue de la circulation automobile, il y aura forcément une limitation de la production automobile, ne serait-ce qu’en supprimant la concurrence entre les marques.
On montrera, par une lutte idéologique, comment l’automobile, telle qu’elle est utilisée, développe monstrueusement l’égoïsme et qu’un certain type de transports en commun ou l’usage en commun de la voiture dite individuelle, transforme complètement les relations sociales au sein de la ville.
– Est-il possible que les gens renoncent à leur égoïsme, sans passer par vingt-cinq ans de guerre civile et sans partir d’un état de total sous-développement?
VICTOR. – En Mai 68, il y avait une immense volonté d’en finir avec une vie marquée, précisément, par cet égoïsme monstrueux.
Les faits, en France, montrent qu’il y a une très grande révolte.
– Est-ce une révolte suffisante pour mener une guerre prolongée? Les gens seront-ils prêts à se battre vraiment?
VICTOR. – On n’a aucun goût particulier pour des révolutions sanglantes.
Il est expérimenté dans les faits qu’il y a déjà une série de luttes violentes indispensables même pour le bifteck, alors a fortiori pour conquérir une société nouvelle et que ces luttes finiront par devenir beaucoup plus dures, par devenir des luttes violentes armées.
On n’a jamais vu de changement de société sans accouchement par la violence progressiste.
Mais en s’appuyant sur la volonté d’une autre vie – de changer la vie comme on a dit depuis Mai 68 -, qui est une volonté collectiviste de dissoudre les différents égoïsmes au niveau de l’entreprise, de l’H.L.M. ou de la rue, et en progressant dans la lutte contre les différentes cibles qui marquent ce système oppressif, donc en progressant aussi dans la lutte violente, l’égoïsme, dans les différentes couches sociales, sera, pas à pas, affaibli, sapé.
Cela n’implique pas nécessairement une guerre civile sanglante du type espagnole ou a fortiori du type des guerres civiles qui peuvent se déclencher dans les pays dominés par l’impérialisme.
Cela n’implique pas nécessairement la famine, la débâcle complète de l’appareil productif.
Cela implique certainement effusion de sang, cela implique certainement désorganisation de l’appareil productif mais toute grève désorganise l’appareil productif, et forcément plus qu’une grève : une révolution politique.
– Comment vois-tu la Révolution culturelle?
VICTOR. – Les communistes chinois ont vu, à partir de la lutte armée qu’ils ont menée contre les Japonais et les Komintern que si on ne créait pas dans le cours de la révolution un homme nouveau – s’il n’y avait pas une transformation profonde des mentalités, les relations sociales qui sont la conséquence des rapports de lutte de classes constituaient une sollicitation continuelle à la restauration des vieux rapports de classes.
Pour le dire plus scientifiquement, une fois qu’où a changé les relations de propriété, dans les grands secteurs économiques, les vrais problèmes commencent.
Nationaliser la grande industrie, ce n’est rien, il faut deux heures. Une fois la prise du pouvoir en 17, Lénine a dû se mettre dans un coin du Palais d’Hiver pour signer un décret disant que la grande industrie était devenue propriété du peuple soviétique.
Là, où les vrais problèmes commencent c’est quand il y a à changer les rapports de production effectifs dans les secteurs économiques proprement dits, les usines, les campagnes, et à transformer complètement les relations sociales entre les différentes catégories sociales.
Les vrais problèmes sont là et n’ont pas été résolus en U.R.S.S. Les Chinois se sont attaqués à ce problème et ils l’ont résolu.
Ils ont dit : la révolution socialiste est la destruction de fond en comble des rapports de classes.
Donc, il faut détruire tout ce qui est l’environnement dans l’usine, la campagne, les cités, l’ensemble de la vie sociale – dans le cas de la Chine, les rapports anciens, à la fois capitalistes et féodaux.
Il fallait détruire dans les usines les rapports entre les producteurs et les différents porteurs de fonctions de gestion, de coordination, de production etc.
En clair, il fallait transformer les rapports entre l’ouvrier, le technicien, l’ingénieur, le cadre, le directeur. Dans le cas des campagnes, il fallait transformer les rapports entre le paysan et la direction de la coopérative.
Dans le cas de l’université, il fallait transformer les rapports non seulement entre l’élève et le professeur, mais le rapport entre l’élève, le professeur et ce qui est en dehors de l’université, à savoir le producteur.
Parce que le rapport qui met au premier plan le stimulant matériel et au bas de l’échelle le gars qui est à la machine, est un rapport d’exploitation bourgeois. Même si l’usine est nationalisée, si l’usine est en titre une usine d’État, si ce rapport existe encore, l’ouvrier, le producteur, celui qui est en bas de l’échelle souffre encore de l’exploitation et de la répression.
C’est tout cet ensemble de relations qu’il fallait détruire.
– Et qui se réinstitue naturellement ?
VICTOR. – Oui, tant que ça n’est pas attaqué.
La grandeur du P.C. chinois est d’avoir trouvé la méthode pour détruire cela. Les derniers textes de Lénine sont poignants parce qu’il sent que ce n’est pas tout d’avoir nationalisé l’industrie, il sent comme le passé tsariste, capitaliste, pèse encore sur la Russie.
L’État est encore très profondément bureaucratique, les rapports sont encore aux trois quarts ceux du tsarisme. Dans les usines, les rapports des ouvriers avec des ingénieurs nommés et des directeurs, n’ont pas fondamentalement changé.
Lénine sent tout ça mais n’arrive pas à trouver les méthodes pour transformer. La méthode du P.C. chinois a été de s’appuyer sur tous les sentiments de révolte de ceux qui sont au bas de l’échelle, pour que même après la prise du pouvoir par l’armée rouge, tout cet ensemble de relations qui sont la marque du passé continuent à être attaqués.
Le principe des mouvements de masses ininterrompus, c’est la solution. Par quelle orientation sont guidés ces mouvements de masses? Elle a été définie par la fameuse motion : lutte contre l’égoïsme, critique du révisionnisme.
Il n’y a pas de critique radicale du révisionnisme si la lutte contre l’égoïsme n’est pas menée. Une lutte ininterrompue dans les esprits de chacun, ouvrier, paysan, intellectuel, cadre, sur la base de la question : qui servir?
Dans chaque acte de ta vie quotidienne ou de ta pratique sociale, tu te poses la question : qui servir? Est-ce que tu vis, tu te bats, tu travailles pour tes propres intérêts, ou pour les intérêts d’une petite poignée? Ou bien est-ce que tu vis, tu te bats, tu travailles pour les intérêts de la grande masse?
Est-ce que tu sers le peuple, ou bien le contraire du peuple, les ennemis du peuple, à savoir la bourgeoisie? Est-ce que tu sers – dans le cas particulier de la Chine – à reconstruire le vieil ordre des choses?
– Est-ce que forcément, il faut servir quelque chose ?
VICTOR. – Ah oui!
– On peut penser et choisir de ne servir à rien ?
VICTOR. – Ça, ça ne marche pas. Il n’y a rien au-dessus des masses, et de la lutte des classes. Il n’y a rien au-dessus.
– Et rien en dehors ?
VICTOR. – Rien. Rien.
– Mais la jeunesse a une envie de liberté, un désir de prendre tout et tout de suite qui apparaît dans ses slogans, exemple : » Jouir tout de suite et sans entraves » et qui semble contraire à l’esprit de sacrifice demandé par les maoïstes ?
VICTOR. – II faut distinguer le rapport qu’a la jeunesse avec la notion de parti et le rapport politique qu’entretient la jeunesse avec les autres couches de la population.
C’est vrai que la jeunesse reste marquée par la pratique révolutionnaire de départ, en Mai 68, sa pratique anti-autoritaire.
Elle est donc assez rebelle à la notion de parti.
Ce n’est pas le plus grave dans la mesure où elle peut parfaitement s’organiser indépendamment et sans que ce soit selon les normes de parti, comme mouvement de masse ayant ses propres formes de vie démocratique, ses propres formes d’organisation.
Seulement ce à quoi renvoie cette rébellion contre le parti dans le domaine de la mentalité, de la conception politique, est beaucoup plus grave.
C’est là, la difficulté principale qui renvoie à une méconnaissance, assez grande encore, dans la jeunesse des contraintes du combat révolutionnaire d’ensemble.
Une méconnaissance de la politique à avoir vis-à-vis des autres catégories de la population et vis-à-vis de la politique du gouvernement qui tend à diviser les catégories de la population les unes par rapport aux autres.
Il y a effectivement une série de contradictions au sein du peuple provoquées par les initiatives de la jeunesse – il y a des contradictions au sein du peuple, de toutes manières, provoquées aussi bien par les initiatives ouvrières, par les initiatives des paysans ou des petits commerçants – le fond de la politique révolutionnaire, c’est de résoudre ces contradictions au sein du peuple de même que le fond de la politique contre-révolutionnaire, de la politique gouvernementale c’est d’exploiter ces contradictions au sein du peuple pour avoir en face de lui un front dispersé, divisé.
La jeunesse doit comprendre qu’un certain nombre de ses initiatives qui choquent, ne sont pas forcément des initiatives à 100 % justes, et que ce n’est pas parce que ce sont des initiatives qui correspondent à quelque chose d’assez profond dans la jeunesse que prises telles quelles, elles ne présentent pas des aspects négatifs dans la mesure où elles ne sont pas comprises, pas intégrées dans les aspirations des autres couches populaires.
Il est capital d’aider la jeunesse à comprendre ce point politique déterminant : savoir résoudre les contradictions au sein du peuple.
C’est essentiellement par la progression dans ce domaine qu’il y aura par voie de conséquence une progression sur la question des formes d’organisation propres à la jeunesse.
Alors comment faire pour qu’il y ait dans la jeunesse, une conscience politique concernant les contradictions au sein du peuple?
Il y a plusieurs moyens.
Il faut, de toute façon, de la patience parce qu’il faut mettre en œuvre des moyens différents.
Le premier moyen, pour les militants qui sont convaincus de la nécessité de cette unité populaire, est de ne pas se couper de la masse des jeunes.
C’est une manière erronée de résoudre les contradictions au sein du peuple que d’éliminer un de ses aspects.
C’est éliminer un de ses aspects que de se couper de la masse de la jeunesse.
Il faut donc unir la masse de la jeunesse, à la niasse des autres couches populaires.
Il faut que les militants qui travaillent dans la jeunesse soient des jeunes, dans les lycées, dans les C.E.T., parmi les jeunes de banlieue, qu’ils aient un style de vie qui ne les coupe pas de la jeunesse.
Le principal danger dans ce domaine-là, c’est le professionnalisme.
Pas tellement en jouant aux adultes face aux jeunes – ils ne le peuvent pas puisqu’ils sont eux aussi des jeunes, et partagent d’une certaine manière leurs aspirations – mais en devenant des professionnels de la politique, en ne sachant plus aller au bal avec les jeunes pour prendre des exemples très caricaturaux.
Donc premier remède, la liaison avec les niasses de jeunes.
Deuxième moyen de remédier à une situation qui n’est pas totalement saine : aider les jeunes à toucher du doigt les contradictions au sein du peuple et les mécanismes par lesquels le gouvernement, les contre-révolutionnaires se servent de ces contradictions au sein du peuple pour enrayer les progrès de la révolution idéologique en France.
Exemple : les aider à lutter contre les provocations dans les manifestations.
Débattre de la question du pillage d’un café sous prétexte que le café est tenu par un réactionnaire.
On leur apprend que ce patron de café est peut-être réactionnaire mais qu’il y aura des dizaines d’autres milliers de patrons de cafés et de petits commerçants qui ne sont pas sensés savoir que c’est un réactionnaire et que France-Soir ne va pas leur dire que c’est un patron de café réactionnaire…
Il faut éduquer les jeunes un peu dans cet esprit-là, qu’ils comprennent que le tout n’est pas seulement de suivre ses impulsions, point à la ligne.
Un exemple plus significatif encore : les samedis du quartier Latin en mai-juin 71.
Tous les jeunes ont été extrêmement concernés par cette provocation au quartier Latin.
Ils ont touché du doigt le mécanisme par lequel les flics ont singé les jeunes sous leurs aspects négatifs et en quoi ça pouvait servir les intérêts réactionnaires, mais la provocation était plus ou moins éventée.
Le plus important encore, pour leur faire toucher du doigt les contradictions au sein du peuple, est de les mettre en contact direct avec les autres catégories de la population.
C’est le cas dans les » longues marches « , quand les jeunes vont chez les paysans et sont obligés de mettre à l’épreuve leurs notions immédiates, leurs aspirations immédiates, aussi bien sur la famille, les relations sexuelles, le bonheur, l’absence de contraintes, etc.
Quand ils sont avec des paysans et qu’ils les respectent – parce que s’ils les méprisent, ça ne marche pas – ils sont obligés de dialectiser un peu leurs notions immédiates, de voir que s’il y a des éléments vrais dans leur lutte contre la famille, il faut aussi qu’ils tiennent compte des rapports des autres couches avec la famille.
Leurs idées et les idées des paysans entreront alors en conflit mais en conflit progressiste.
Il y a un moment où la jeunesse a besoin de se regrouper en des mouvements propres, pour développer son essor propre, en tant que force sociale en France, dont le rôle est important pour la transformation des relations sociales et pour le processus révolutionnaire mais il faut que la jeunesse se ramifie, tisse des liens avec les autres catégories de la population pour que précisément son essor ne soit pas immédiatement encerclé par le pouvoir utilisant les ignorances, les préjugés, etc. ou même les idées justes d’autres catégories de la population, pour coincer la jeunesse.
Donc, on n’est pas contre l’idée des Palavas, on est contre une organisation de la jeunesse qui ferait des Palavas tout le temps.
On n’est pas contre les communautés, contre les expériences de collectivisme au sein de la jeunesse, même maintenant.
Il ne faut pas attendre la prise du pouvoir central pour tenter des transformations des relations sociales, mais nous sommes contre les communautés hors du temps et de l’espace qui sont une fuite devant les exigences du combat révolutionnaire.
Chou En-laï a dit justement cette année une phrase fantastique : » Les jeunes ont raison de vouloir le bonheur, mais ils comprendront par expérience qu’il ne peut pas y avoir de bonheur si ce n’est pas voulu par la majorité de la population. «
Voilà les deux éléments fondamentaux : c’est juste de vouloir le bonheur mais encore faut-il l’atteindre.
D’ailleurs les communautés, aux États-Unis ou en France, s’aperçoivent vite, qu’on ne peut pas saisir le bonheur, en petits groupes fermés, face aux sollicitations des mouvements de l’ensemble de la population.
Troisième remède : il faut absolument que les militants adhèrent à cette politique d’unité populaire, n’hésitent pas, au sein de la masse des jeunes, à développer la lutte contre les idées erronées : celles qui exaltent l’égoïsme de chaque couche et qui s’opposent à la lutte pour la résolution des contradictions au sein du peuple.
Cette lutte idéologique exige qu’on rejette un certain suivisme par rapport à des courants de masse dans la jeunesse.
Il faut avoir le courage de parler des aspects négatifs de la drogue.
Il faut avoir le courage de dire aux jeunes que ceux qui pensent s’émanciper alors que la masse des Français sont des cons, ont des positions erronées.
Il faut mener la lutte énergiquement contre ces idées-là.
Les moyens fondamentaux pour que la jeunesse progresse, c’est qu’elle rejette sa réticence actuelle à la notion de parti et à la notion d’unité populaire mais on n’importera pas la politique de l’unité populaire, de l’extérieur dans la jeunesse.
On ne peut qu’aider la jeunesse, par sa propre expérience, à élargir son point de vue, à rejeter donc ce qui est étroit, voire franchement égoïste, voire franchement réactionnaire pour suivre un courant de progrès, le courant vers l’unité populaire.
– N’est-ce pas imposer une ligne plutôt que de la définir avec les masses?
VICTOR. – C’est un reproche qui n’est pas fondé sur la réalité. On est aussi capable que n’importe quel groupe politique – force politique traditionnelle ou groupuscule – de définir une ligne politique, de faire comme on dit, un programme de gouvernement ou de transition.
Mobiliser des architectes, des ingénieurs, pour dessiner les plans de la société future et les moyens d’y parvenir, c’est vraiment à la portée de tout le monde.
C’est précisément cette conception-là, de la ligne politique que nous rejetons catégoriquement.
Nous ne pensons pas que les masses ont besoin pour s’émanciper d’adhérer à un programme que les représentants politiques fabriqueraient en dehors d’elles.
Nous pensons que progressivement à partir de leurs expériences propres, nous devons aider les masses à dégager ce qui est essentiel, ce qui a valeur générale, universelle.
En clair l’élaboration du programme, qui est une préoccupation centrale pour nous communistes, du programme du pouvoir c’est-à-dire du programme qui marquera que nous sommes une force candidate au pouvoir, comme toute force politique digne de ce nom, donc, la manière dont on élaborera ce programme, en multipliant les programmes particuliers de lutte, en commençant par les programmes particuliers d’ateliers, un programme fait avec les ouvriers dans les mines ou les chantiers de bâtiments pour imposer la sécurité du travail, me paraît bien plus important que cent cinquante pages rédigées par les ingénieurs à la sécurité, fussent-ils du parti socialiste.
Multipliant ces programmes particuliers sur les différents aspects de la condition ouvrière, de la condition populaire, il y aura une base matérielle expérimentale issue vraiment de la volonté immédiate des masses.
Il faudra alors faire un travail de systématisation, traduit d’abord sous forme de thèses qui seront renvoyées aux masses, discutées par les masses, puis élaborées de manière définitive sous la forme d’une petite brochure de plusieurs pages avec les différents objectifs, les moyens d’y parvenir, etc., le programme enfin : le programme général des communistes en France.
C’est d’ailleurs pourquoi ce n’est pas à nous de décider de faire le programme.
Nous pouvons juste décider d’aider les masses à multiplier les embryons de programme particulier.
On voit bien là qu’il y a un rapport entre nos efforts et les idées produites par les masses elles-mêmes mais ce n’est pas parce qu’on aura décidé de faire le programme qu’il sera fait, du moins le programme tel qu’on l’entend et nous pensons qu’on l’entend de la seule manière qui vaille, dans la mesure où, pour nous, le tout n’est pas de prendre le pouvoir et surtout pas n’importe quel pouvoir.
A partir de l’expérience des pays socialistes qui ont dégénéré, la question essentielle reste le caractère de masse, le caractère populaire du pouvoir pris.
Essentiel donc, que le programme concret de construction du pouvoir populaire, de la société qui sera édifiée à partir de la construction de ce pouvoir populaire, soit vraiment lié à la mobilisation politique des travailleurs eux-mêmes.
On ne pense pas que si grâce à une conjoncture un peu exceptionnelle, crise, etc., une minorité ayant sa propre théorie prenait le pouvoir et adoptait un certain nombre de décrets qui transforment les rapports de propriété en France, ce serait le socialisme.
Pour les masses qui ont été marquées par l’expérience des pays de l’Est et en particulier pour l’Union soviétique, c’est zéro.
A juste titre, parce qu’on ne crève pas pour avoir un régime à la polonaise ou à la russe.
Donc en apparence, nous sommes ce en retard » par rapport au programme de gouvernement du P.C.F., en apparence seulement.
Le programme du P.C.F. est juste fait pour préparer les élections législatives. Ce qui est parfaitement vrai c’est qu’il faut faire ce programme.
On n’est pas du tout contre l’idée d’élaborer une ligne politique, on dit simplement qu’elle doit avoir un caractère de masse.
Les masses doivent lire le projet de socialisme qu’elles pratiquent de manière embryonnaire, même de manière utopique, à partir de leur lutte.
Ça, on y tient comme à la prunelle de nos yeux.
Cela dit, tout ça s’inscrit dans une série d’organisations.
Pour faire un programme particulier d’atelier, on a besoin d’une organisation de masse dans l’atelier.
On ne peut évidemment pas faire un programme sur la sécurité, en voyant ce qui ne va pas dans l’atelier et en le rédigeant.
On est obligé d’enquêter, donc d’écouter les masses, de voir quelles sont leurs principales préoccupations.
Et à ce moment-là, on peut, avec deux trois gars, rédiger un petit quelque chose, un petit projet que l’on soumet autour de soi.
Alors on a les premières réactions et on fait un projet plus définitif, qui donne par exemple le programme particulier sur la sécurité du travail dans le chantier Maine-Montparnasse.
On multiplie ça par dix, quinze, vingt et on a déjà une base expérimentale sur la sécurité du travail.
Pareil pour les cadences, pareil pour le système répressif à l’intérieur des boîtes.
Pareil pour les salaires, le système de rémunération, la hiérarchie…
– Les masses n’ont-elles pas besoin d’un projet plus global?
VICTOR. – Oui, bien sûr, là c’est une description analytique. Il n’y a pas seulement ce qui se passe à l’intérieur de l’usine.
C’est aussi bien la circulation automobile, le métro, la pollution, la culture sous des aspects dits de » loisir « .
C’est vrai que la lutte contre la hiérarchie, les salaires ou contre les cadences est beaucoup plus riche que l’expérience de la lutte contre la pollution ou même contre la circulation automobile, mais il y a des éléments de projets socialistes délivrés par des luttes, depuis Mai 68, sur à peu près tous les fronts de la vie sociale.
Partir d’en bas, monter en haut, revenir en bas, pour élaborer le programme, ne serait-ce que pour^pouvoir le diffuser.
Un programme qui a été élaboré comme un tract par des ouvriers est mieux diffusé, mieux expliqué, donc devient une force matérielle beaucoup plus grande.
Les masses populaires n’ont pas l’habitude de faire leur propre programme : elles ont l’habitude des délégués, d’une institution à laquelle on délègue son pouvoir d’expression même si ce pouvoir d’expression est finalement mis au service d’une autre classe et pas de la classe ouvrière qui a délégué son pouvoir.
L’habitude n’est pas prise dans les ateliers de faire des tracts, c’est une habitude qui est simple à acquérir.
Les ouvriers, en large majorité, écrivent facilement des tracts, mais pour qu’il y ait cette initiative, il y a un travail à faire.
De même il est difficile que les masses ouvrières se réapproprient la notion d’organisation. Elles en ont plein le dos de l’organisation parce qu’elles ont été flouées. Ce sont les ouvriers les plus courageux, les plus révolutionnaires, qui ont donné vingt ans ou trente ans de leur vie à travailler dans le P.C.F.
Ça marque, et pas simplement au niveau des individus.
Au niveau de la conscience collective de classe, il y a une sorte de méfiance à l’égard de la possibilité d’une nouvelle organisation qui serait cette fois-ci vraiment l’organisation ouvrière dont on a besoin.
Pas mal de gens s’impatientent parce qu’ils ne voient pas rapidement depuis Mai 68, une force nouvelle à la gauche du P.C.F.
Cela renvoie à cette donnée objective que les masses ne sont pas des moutons, pas des veaux.
Les masses auront besoin de voir sur pièce comment s’édifie une organisation nouvelle, en quoi son programme est radicalement nouveau, en quoi les garanties démocratiques, prolétariennes que donne cette organisation sont vraiment réelles avant d’accorder pleinement leur adhésion et alors là de se mobiliser par centaines de milliers d’hommes.
– Quelle est la perspective immédiate de la lutte des maoïstes en France?
VICTOR. – Notre plan d’action depuis la rentrée 71 part de la donnée objective fondamentale de la situation française : à savoir que l’état de crise atteint par la société française est tel, que celle-ci est à la merci d’une explosion qui peut venir de n’importe quel aspect de la société française, d’une lutte ouvrière – on était à deux doigts d’un affrontement radical avec la grève du métro, d’un scandale, type Rives-Henry, des retombées de la crise de l’impérialisme à l’échelle internationale sur la société française.
Hier, Giscard d’Estaing disait lui-même, en présentant le budget, qu’il ne savait pas de quoi demain sera fait.
Pour une majorité qui prétend s’appuyer sur l’instinct de sécurité des Français, il est assez désastreux de reconnaître que toute la politique actuelle est grevée d’une incertitude et d’une insécurité fondamentales.
Partant de cette donnée objective, nous pensons que le plus important est d’être prêts pour une crise sociale ouverte quelque forme qu’elle prenne, étant entendu que toute crise sociale ouverte pose objectivement la question du pouvoir.
Nous devons être prêts à proposer des solutions à la crise sociale qui peut survenir du jour au lendemain, même si ce n’est pas demain que les forces populaires autonomes prendront le’ pouvoir.
En d’autres termes, nous pensons que les exigences de programme, dont on parlait tout à l’heure, sont des exigences vitales.
Bien que l’explosion ne présentera pas la même forme que Mai 68, n’aura pas ni ce degré de surprise, ni de précipitation, ni de généralité, on ne veut pas se retrouver dans une situation comme en Mai 68 où on est tout désarmés quand la question du pouvoir est objectivement posée comme elle l’a été, à partir du 24 mai 68.
On était incapables d’articuler le moindre mot, sinon » Ce serait bien de prendre le pouvoir » ou » Le pouvoir est à prendre » qui ne sont pas des mots d’ordre pouvant rallier des millions de Français.
Ce programme général des communistes, à partir des méthodes que j’ai explicitées, doit être pris en charge par une nouvelle organisation qui mettra fin à la phase de dissolution de la Gauche Prolétarienne et sera capable de prendre des initiatives tactiques qui ne soient pas simplement une agitation.
L’année qui s’ouvre verra une série de nouvelles initiatives tactiques sur tous les fronts de la vie sociale, certains qui ont déjà été ouverts l’an dernier, comme la défense des libertés qui reste une partie fondamentale de notre programme d’action immédiate.
Comme la vie chère ou le chômage, parce que c’est une des préoccupations les plus graves pour la population à l’heure actuelle.
A travers ces initiatives tactiques sera tracée systématiquement et progressivement la perspective stratégique, c’est-à-dire le programme général des communistes qui coordonnera la signification politique de toutes ces initiatives et expliquera aux masses comment à partir des différentes expériences, il y a des objectifs d’ensemble qui se dégagent clairement et des moyens pour atteindre ces objectifs.
Le programme général des communistes a pour fonction de mettre noir sur blanc ce qui n’est jamais qu’en germe ou en puissance dans les différentes luttes immédiates.
– Dans ce projet de prise du pouvoir, le terme de » mao » dont vous vous servez n’est-il pas mauvais?
VICTOR. – Si, sûrement. La question de notre dénomination se pose à différents titres.
D’abord, est-ce que l’organisation qui va naître sera appelée parti?
Nous n’allons pas attendre d’être un puissant parti reconnu par les larges masses de tout le pays pour choisir le terme « parti ».
Si on pense que l’instrument qu’on va construire est relativement adapté à la situation nouvelle, que tout un ensemble d’indices objectifs l’attestent et qu’il correspond au point de vue, non seulement des militants mais des masses directement mobilisées, alors incontestablement on choisira le terme » parti « .
C’est une des questions qui sera en discussion dans nos rangs.
Et enfin, la question du nom de ce parti.
Reprendra-t-on le terme » communiste » dans la mesure où il est assez dévalué pour une partie des masses, vu ce qu’en a fait le parti de Marchais, mais vraisemblablement, on le gardera parce que ce n’est pas un mot qu’on abandonnera aux salopards.
» Mao « , ce maoïste « , » marxiste « , » léniniste « , toutes ces questions doivent être revues.
On n’a aucune position pour le moment, sauf qu’on constate que, de fait, ce « mao » c’est chinois, et que de plus les Chinois n’apprécient pas tellement le terme de « mao « .
Enfin, ils ne comprennent pas comment, ça peut être utilisé en France.
Donc, aussi bien du point de vue des larges masses en France que même du. point de vue des Chinois qui ont quand même leur mot à dire sinon en France, du moins leur mot à dire sur la révolution mondiale et l’usage même du terme de mao ou de « maoïsme « , il y a quelque chose à changer incontestablement dans notre dénomination actuelle.
– La fin de cette appellation marquera donc une nouvelle étape?
VICTOR. – C’est parce qu’une étape sera dépassée qu’il faudra de nouveaux mots.
Février, avril, novembre 1971.
=>Retour au dossier sur la Gauche Prolétarienne