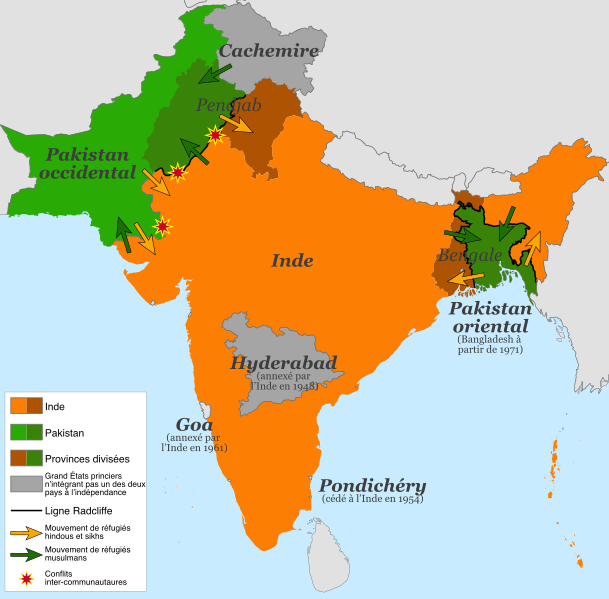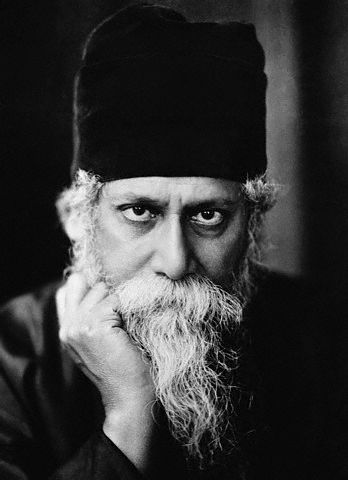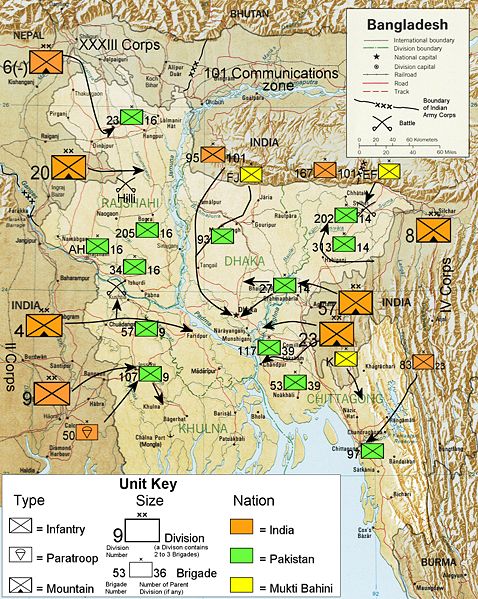Mars 1927
L’IMPORTANCE DE LA QUESTION PAYSANNE
Au cours de mon récent voyage dans le Hounan, j’ai fait une enquête sur place concernant la situation dans cinq districts : Siangtan, Sianghsiang, Hengchan, Liling et Tchangcha. Pendant trente-deux jours, du 4 janvier au 5 février, dans les villages et les chefs-lieux de district, j’ai convié à des entretiens des paysans ayant de l’expérience ainsi que des militants du mouvement paysan, et j’ai écouté attentivement ce qu’ils me rapportaient ; cela m’a permis de recueillir un ample matériel.
Bien des aspects du mouvement paysan se sont révélés être l’exact contraire de ce que j’avais eu l‘occasion d’entendre de la bouche des hobereaux à Hankeou et à Tchangcha. J’ai vu et entendu bien des choses étonnantes dont je n’avais jamais eu connaissance jusque-là. Je pense qu’on peut en observer de semblables en beaucoup d’endroits.
Nous devons, au plus vite, mettre un terme à tous les propos contre le mouvement paysan et corriger les mesures erronées prises par les autorités révolutionnaires à l’égard de ce mouvement. C’est seulement ainsi qu’on pourra contribuer au développement futur de la révolution. Car l’essor actuel du mouvement paysan est un événement d’une extrême importance.
Dans peu de temps, on verra dans les provinces du centre, du sud et du nord de la Chine des centaines de millions de paysans se dresser, impétueux, invincibles, tel l’ouragan, et aucune force ne pourra les retenir. Ils briseront toutes leurs chaînes et s’élanceront sur la voie de la libération.
Ils creuseront le tombeau de tous les impérialistes, seigneurs de guerre, fonctionnaires corrompus et concussionnaires, despotes locaux et mauvais hobereaux. Ils mettront à l’épreuve tous les partis révolutionnaires, tous les camarades révolutionnaires, qui auront à prendre leur parti. Nous mettre à la tête des paysans et les diriger ?
Rester derrière eux en nous contentant de les critiquer avec force gestes autoritaires ? Ou nous dresser devant eux pour les combattre ? Tout Chinois est libre de choisir une de ces trois voies, mais les événements obligent chacun à faire rapidement ce choix.
ILS S’ORGANISENT
Dans le mouvement paysan du Hounan, on peut grosso modo distinguer deux périodes, du moins pour les districts du centre et du sud de la province, où il a pris de l’ampleur. La première, qui va de janvier à septembre de l’année dernière, a été une période d’organisation. Elle se divise en une phase d’activité clandestine, de janvier à juin, et une phase d’activité au grand jour, de juillet à septembre, lorsque l’armée révolutionnaire avait chassé Tchao Heng-ti.
A cette époque, les unions paysannes comptaient seulement 300.000 à 400.000 membres, et les masses qui se trouvaient sous leur direction immédiate dépassaient à peine un million d’individus ; il n’y avait encore pratiquement pas de lutte à la campagne, et c’est pourquoi l’on n’avait guère critiqué les unions paysannes dans les différents milieux du pays. Comme les membres des unions paysannes apportaient leur aide à l’armée engagée dans l’Expédition du Nord en lui servant de guides, d’éclaireurs et de porteurs, il arrivait même que des officiers s’exprimaient en termes favorables à l’égard de ces unions.
La seconde période, qui va d’octobre de l’an passé à janvier de cette année, est celle de l’action révolutionnaire. Les effectifs des unions paysannes montèrent en flèche, atteignant 2 millions de membres ; quant aux masses placées sous leur direction immédiate, elles s’élevèrent à 10 millions d’individus.
En effet, dans la plupart des cas, un seul nom est inscrit pour chaque famille qui adhère aux unions paysannes ; à 2 millions de membres correspond donc une masse englobée dans les unions d’environ 10 millions d’individus. Presque la moitié des paysans du Hounan se sont maintenant organisés.
Dans des districts tels que Siangtan, Sianghsian, Lieouyang, Tchangcha, Liling, Ninghsiang, Pingkiang, Siangyin, Hengchan, Hengyang, Leiyang, Tchenhsien et Anhoua, presque tous les paysans sont entrés dans les unions paysannes et ont passé sous leur direction. Groupés dans de vastes organisations, les paysans se sont mis aussitôt à agir, et ces quatre mois ont vu se développer à la campagne une révolution d’une ampleur encore inconnue.
A BAS LES DESPOTES LOCAUX ET LES MAUVAIS HOBEREAUX ! TOUT LE POUVOIR AUX UNIONS PAYSANNES !
Les paysans ont porté leur coup principal contre les despotes locaux et les mauvais hobereaux, contre les propriétaires fonciers ayant commis des forfaits ; mais ils ont frappé par là même les idées et les institutions patriarcales, les fonctionnaires corrompus et concussionnaires dans les villes et les coutumes détestables à la campagne. Par sa puissance, ce coup a été pareil à un ouragan devant lequel tout doit disparaître ou s’incliner.
Finalement, les privilèges millénaires des propriétaires féodaux ont été balayés, et leur dignité, leur prestige complètement détruits. Après le renversement de l’autorité des propriétaires fonciers, les unions paysannes sont devenues les seuls organes existants du pouvoir, et le mot d‘ordre : « Tout le pouvoir aux unions paysannes ! » a passé dans les faits.
On consulte désormais les unions paysannes, même pour des bagatelles comme une dispute entre époux. Aucune affaire ne se règle sans la présence de représentants de l’union paysanne. A la campagne, les unions paysannes exercent leur autorité pratiquement dans tous les domaines. Comme on dit : « Tout ce qu’elles disent, elles le font ».
Et ceux qui n’en sont pas membres ne peuvent dire que du bien d’elles ; personne ne peut en dire du mal. Quant aux despotes locaux et mauvais hobereaux, aux propriétaires fonciers ayant commis des forfaits, ils n’ont absolument pas droit à la parole ; ils n’osent littéralement pas souffler mot.
Devant la puissance des unions paysannes, les plus importants des despotes locaux et des mauvais hobereaux ont fui à Changhai, les moins importants jusqu’à Hankeou, ceux qui le sont moins encore à Tchangcha, les plus petits dans les chefs-lieux de district ; quant à la lie de cette espèce, elle a dû rester dans les villages et s’en est remise à la bonne grâce des unions paysannes.
- Voici dix yans, permettez-moi d’adhérer à l’union, implore le mauvais hobereau de petite envergure.
- Fi donc ! lui répondent les paysans, on n’a que faire de ton sale argent !
Nombre de propriétaires fonciers, petits et moyens, de paysans riches, et même de paysans moyens, qui étaient contre les unions paysannes, cherchent en vain à y entrer. Il m’est souvent arrivé en bien des endroits de rencontrer de ces gens qui sollicitaient mon appui : « Vous êtes mandaté par le chef-lieu de la province, disaient-ils, soyez notre garant ! »
Du temps de la dynastie des Tsing, les autorités locales tenaient pour les recensements deux registres : le registre habituel et le registre spécial. Les gens de bonnes mœurs étaient portés sur le registre habituel, les mauvais éléments comme les bandits et les voleurs sur le registre spécial. Et voilà qu’à cet exemple, on voit les paysans, en certains endroits, menacer ceux qui étaient contre les unions paysannes en disant : « Il faut les inscrire sur le registre spécial ! ».
Ceux qui ont peur d’être portés sur ce registre font tous leurs efforts pour entrer dans l’union paysanne et ne sont tranquilles que lorsqu’il y sont inscrits comme membres. Mais il arrive souvent que les unions paysannes refusent catégoriquement leur admission, aussi vivent-ils dans une frayeur constante ; maintenus à l’écart des unions paysannes, ils se sentent comme des vagabonds sans feu ni lieu ; dans les villages, on les appelle les « gens à part ».
Bref, ces « sociétés paysannes » que beaucoup méprisaient il y a quatre mois sont devenues maintenant des organisations fort honorables. Tous ceux qui, autrefois, s’inclinaient bien bas devant l’autorité des hobereaux s’inclinent maintenant devant le pouvoir des paysans. Il n’est personne qui ne reconnaisse que le mois d’octobre de l’an dernier a marqué la coupure entre deux mondes.
« ÇA VA TRÈS MAL ! » ET « ÇA VA TRÈS BIEN ! »
La révolte des paysans a arraché les hobereaux à leur doux sommeil. Dès que les nouvelles en provenance de la campagne ont atteint les régions urbaines, les hobereaux dans les villes se sont agités. A mon arrivée à Tchangcha, j’ai rencontré toutes sortes de gens et entendu bien des racontars. De la couche moyenne de la société à l’aile droite du Kuomintang, tous s’accordaient à caractériser la situation par ces mots : « Ça va très mal ! ».
Dans l’ambiance tumultueuse créée par ce que disaient les adeptes de l’opinion « ça va très mal », même des gens tout à fait révolutionnaires se sentaient déprimés quand, fermant les yeux, ils imaginaient ce qui se passait à la campagne, et ils jugeaient impossible de nier qu’en effet ça allait « mal ».
Et ceux qui avaient des idées très avancées disaient : « Oui, ça va mal, mais c’est inévitable en période de révolution ». Bref, il n’était possible à personne de nier complètement que ça allait « mal ». La réalité, c’est, comme il l’a été dit plus haut, que les larges masses paysannes se sont soulevées pour accomplir leur mission historique, quand dans les campagnes les forces démocratiques se sont soulevées pour renverser les forces féodales.
La classe patriarco-féodale des despotes locaux, des mauvais hobereaux, et des propriétaires fonciers coupables de forfaits forme la base de cet absolutisme qui dure depuis des millénaires, et c’est sur elle que s’appuient les impérialistes, les seigneurs de guerre et les fonctionnaires corrompus et concussionnaires. Le but véritable de la révolution nationale est précisément de renverser ces forces féodales.
Pendant quarante ans, le Dr Sun Yat-sen a consacré toutes ses forces à la révolution nationale ; ce qu’il a voulu mais n’a jamais pu réaliser, les paysans l’ont accompli en quelques mois. C’est là un exploit extraordinaire qu’on n’avait jamais réussi jusqu’alors, ni en quarante ans ni même au cours des millénaires. Cela va donc très bien. Il n’y a rien là-dedans qui aille « mal », absolument rien qui aille « très mal ». « Ça va très mal ! » est évidemment une théorie de la classe des propriétaires fonciers pour préserver le vieil ordre féodal et empêcher l’établissement d’un nouvel ordre démocratique ; c’est évidemment une théorie contre-révolutionnaire.
Aucun camarade révolutionnaire ne doit répéter cette sottise. Si les conceptions révolutionnaires se sont définitivement affermies en vous et s’il vous est arrivé d’aller à la campagne voir ce qui s’y passe, vous avez dû certainement éprouver une allégresse peu commune. Des milliers et des milliers d’esclaves – les paysans – jettent à terre leurs ennemis qui s’engraissaient à leurs dépens.
Ce que font les paysans est absolument juste ; ils agissent très bien ! « Ça va très bien ! » est la théorie des paysans et de tous les autres révolutionnaires. Les camarades révolutionnaires doivent comprendre que la révolution nationale exige un grand bouleversement à la campagne. La Révolution de 1911 n’a pas amené ce bouleversement, d’où son échec.
Or, un tel bouleversement vient d’avoir lieu et c’est là un facteur important de la révolution, nécessaire à son achèvement victorieux. Tous les camarades révolutionnaires doivent prendre parti pour ce bouleversement, sinon leur position et celle de la contre-révolution.
SUR CE QU’ON APPELLE LES « EXCÈS »
Il y en a d’autres qui disent : « Bien sûr, il faut créer des unions paysannes, mais elles commettent vraiment trop d’excès ». Telle est l’opinion des tenants de la ligne « moyenne ». Or, que se produit-il en réalité ? Il est vrai que dans les villages les paysans « y vont un peu fort ».
Devenues l’autorité suprême, les unions paysannes ferment la bouche aux propriétaires fonciers ; elles ont réduit en poussière leur prestige – cela revient à dire qu’on a jeté à terre le propriétaire foncier et qu’on lui a mis le pied dessus. Menaçant les despotes locaux et les mauvais hobereaux de les porter sur le registre spécial, les paysans les frappent d’amendes, les chargent de contributions et démolissent leurs palanquins.
La foule fait irruption dans les maisons des despotes locaux et des mauvais hobereaux qui sont contre les unions paysannes ; on égorge les cochons, on rafle le grain. Il arrive que des paysans viennent chez les despotes locaux et les mauvais hobereaux et se prélassent un moment sur les lits incrustés d’ivoire de leurs filles et de leurs brus.
Ils arrêtent des gens à la moindre occasion, les coiffent de grands bonnets de papier et les promènent à travers le village, en disant : « Tu sais à présent à qui tu as affaire, sale hobereau ! » Les paysans font ce qu’ils veulent. C’est le monde renversé, et une espèce de terreur règne ainsi à la campagne. C’est ce que certains appellent commettre des « excès », « courber en sens inverse aux fins de redresser », « commettre des actes scandaleux ». En apparence, de tels jugements semblent raisonnables ; en réalité, ils sont tout aussi erronés.
En premier lieu, si les paysans ont commis de tels actes, c’est qu’ils ont été poussés à bout par les despotes locaux, les mauvais hobereaux, les propriétaires fonciers coupables de forfaits. Ces gens ont de tout temps usé de leur pouvoir pour tyranniser et écraser les paysans ; c’est pourquoi ceux-ci ont réagi avec tant de force. Les révoltes les plus violentes, les désordres les plus graves se sont invariablement produits là où les despotes locaux, les mauvais hobereaux, et les propriétaires fonciers coupables de forfaits se sont livrés aux pires outrages. L’œil du paysan voit juste.
Les paysans se rendent parfaitement compte si celui-ci est mauvais et si celui-là l’a été moins, s’il faut traiter celui-ci avec rigueur et celui-là avec clémence ; il est rare que le châtiment ne corresponde pas à la faute. Deuxièmement, la révolution n’est ni un dîner de gala ni une œuvre littéraire, ni un dessin ni une broderie ; elle ne peut s’accomplir avec autant d’élégance, de tranquillité et de délicatesse, ou avec autant de douceur, d’amabilité, de courtoisie, de retenue et de générosité d’âme.
La révolution, c’est un soulèvement, un acte de violence par lequel une classe en renverse une autre. La révolution à la campagne, c’est le renversement, par la paysannerie, du pouvoir féodal des propriétaires fonciers. A moins de déployer les plus grands efforts, la paysannerie n’arrivera jamais à renverser le pouvoir des propriétaires fonciers, qui s’est solidement établi au cours des millénaires. Il faut une puissante poussée révolutionnaire à la campagne pour mettre en mouvement des millions de paysans qui formeront une force considérable.
Les « excès » dont on vient de parler proviennent justement de cette force engendrée chez les paysans par la puissante poussée révolutionnaire qui s’est développée à la campagne.
Dans la seconde période du mouvement paysan (celle de l’action révolutionnaire), ces excès » sont tout à fait nécessaires. Il s’agit alors d’asseoir l’autorité absolue des paysans, d’interdire toute attaque perfide contre les unions paysannes, de renverser complètement le pouvoir des hobereaux, de jeter ces derniers au sol et même de mettre le pied dessus.
Au cours de cette seconde période, tous les actes qualifiés d’ « excès » revêtent une importance révolutionnaire. Pour le dire carrément, il est nécessaire que s’établisse dans chaque région rurale une brève période de terreur.
Sinon, il serait absolument impossible d’y réprimer l’activité des contre-révolutionnaires et de renverser le pouvoir des hobereaux. Pour redresser quelque chose, on est obligé de le courber en sens inverse ; sinon, on ne peut le rendre droit Bien que l’opinion de ceux qui critiquent les « excès » se distingue apparemment de celle du premier groupe, elle procède au fond du même point de vue : c’est la théorie même des propriétaires fonciers, au service des seuls intérêts des classes privilégiées. Aussi devons-nous combattre absolument cette théorie qui fait obstacle à l’essor du mouvement paysan et qui, en dernière analyse, sape la révolution.
LE « MOUVEMENT DES VA-NU-PIEDS »
La droite du Kuomintang affirme : « Le mouvement paysan est un mouvement de va-nu-pieds, de fainéants ». On peut entendre fréquemment de tels propos à Tchangtcha. J’ai eu l’occasion d’entendre à la campagne les hobereaux déclarer : « On peut créer des unions paysannes, mais les gens qui y travaillent actuellement ne valent rien ; il faut les remplacer ! ».
Ces propos ne diffèrent aucunement de ceux que tient la droite du Kuomintang ; ils se ramènent tous à l’affirmation suivante : on peut organiser le mouvement paysan (du moment qu’on a déjà commencé à le faire, personne n’ose plus en contester l’opportunité), mais les gens qui le dirigent ne valent rien. Les hobereaux comme la droite du Kuomintang vouent une haine particulière à ceux qui dirigent les unions paysannes des échelons inférieurs et les traitent de « va-nu-pieds ».
En somme, tous ceux que les hobereaux méprisaient autrefois, qu’ils foulaient aux pieds, tous ceux qui ne pouvaient trouver de place dans la société, qui n’avaient pas le droit d’ouvrir la bouche, redressent maintenant la tête – et voilà que non seulement ils redressent la tête mais prennent le pouvoir en main. Ils sont les maîtres dans les unions paysannes des cantons (l’échelon le plus bas de l’organisation). Ils ont transformé ces unions en une force redoutable.
Ils ont levé la main, leur main calleuse, sur les hobereaux. Ils attachent les mauvais hobereaux avec des cordes, les coiffent de grands bonnets de papier et les promènent à travers le canton (c’est ce qu’on appelle « conduire dans les villages » à Siangtan et à Sianghsiang, « conduire à travers champs » à Liling).
Chaque jour, les accusations publiques, impitoyables qu’ils lancent d‘une voix rude parviennent aux oreilles des hobereaux. Ils donnent des ordres et commandent en maîtres. Autrefois, ils étaient inférieurs à tous, ils sont maintenant supérieurs à tous, et c‘est ce qu’on appelle le monde renversé.
L’AVANT-GARDE DE LA RÉVOLUTION
Des considérations contradictoires sur les choses et les gens découlent nécessairement des jugements contradictoires sur ces choses et ces gens. « Ça va très mal ! » et « Ça va très bien ! », « va-nu-pieds » et « avant-garde de la révolution » en sont des bons exemples.
Il a été dit ci-dessus que les paysans avaient accompli une œuvre révolutionnaire jamais réalisée jusque-là et qu’ils avaient fait un important travail pour la révolution nationale.
Mais peut-on dire que toute la paysannerie a pris part à cette grande oeuvre révolutionnaire, à cet important travail révolutionnaire ? Non.
Il y a trois catégories de paysans : les riches, les moyens et les pauvres. Vivant dans des conditions différentes, ils ont également des idées différentes sur la révolution.
Au cours de la première période, ce qui plaisait aux paysans riches, c’était d’entendre dire que l’Armée de l’Expédition du Nord avait essuyé une cuisante défaite dans le Kiangsi, que Tchiang Kai-chek avait été blessé au pied et avait pris l’avion pour retourner dans le Kouangtong, que Wou Pei-fou avait repris la ville de Yuétcheou, que les unions paysannes ne tiendraient sûrement pas longtemps et que rien ne sortirait des trois principes du peuple, parce qu’on n’avait jamais rien connu de semblable.
Et quand quelqu’un d’une union paysanne de canton (généralement un des « va-nu-pieds ») se rendait chez un paysan riche, registre en main, et lui disait : « Nous vous invitons à adhérer à l’union paysanne », que lui répondait-il ?
Ça fait des dizaines d’années que je vis ici, des dizaines d’années que je travaille la terre, jamais je n’ai entendu parler d’une chose pareille, et ça ne m’a pas empêché de manger à ma faim. Si j’ai un conseil à vous donner, c’est de ne pas vous occuper de toutes ces histoires ! » S’il était franchement hostile, il répondait : « Qu’est-ce que c’est que cette union paysanne ? L’union de tous ceux qui auront la tête coupée ! N’entraînez pas les gens dans une affaire qui peut leur attirer des ennuis ! »
Mais chose étonnante, les unions paysannes sont maintenant établies depuis des mois et elles ont même osé prendre position contre les hobereaux. Dans le voisinage, elles ont arrêté les hobereaux qui refusaient de remettre leur pipe à opium et les ont promenés à travers les villages. Dans les chefs-lieux de district, on a même exécuté d’importants hobereaux, comme Yen Yong-tsieou de Siangtan et Yang Tche-tseh de Ninghsiang.
Pour l’anniversaire de la Révolution d’Octobre et à l’occasion du rassemblement antibritannique et des grandes célébrations de la victoire de l’Expédition du Nord, on a vu dans chaque canton une dizaine de milliers de paysans, avec des drapeaux, des palanches et des houes, se grouper en des cortèges imposants pour participer aux manifestations de masse. C’est alors seulement que les paysans riches sont tombés dans le désarroi.
Aux grandes célébrations de la victoire de l’Expédition du Nord, ils ont entendu proclamer que Kieoukiang avait été prise, que Tchiang Kaï-chek n’était pas blessé et que Wou Pei-fou était finalement défait. Qui plus est, ils ont pu lire, écrits en toutes lettres sur des « affiches rouges et vertes » les mots d‘ordre : « Les trois principes du peuple, wansouei ! » « Les unions paysannes, wansouei ! » « Les paysans, wansouei » etc.
Voilà que les unions paysannes ont pris des airs de maître. Les hommes des unions paysannes ont commencé à dire aux paysans riches : « Vous serez inscrits sur le registre spécial ! » ou « Dans un mois, les droits d’admission seront de dix yuans par personne ! ». Et c’est alors que les paysans riches se sont mis à entrer petit à petit dans les unions paysannes ; certains ont versé leur adhésion un demi-yuan, voire un yuan entier (alors qu’on n’exigeait que cent sapèques), d’autres n’ont réussi à être admis qu’après avoir trouvé quelqu’un pour parler en leur faveur. Mais bien des entêtés parmi eux n’y ont pas adhéré jusqu’à présent.
La majorité de ceux qui adhèrent aux unions paysannes font inscrire les vieillards de leur famille, âgés de soixante ou de soixante-dix ans, parce qu’ils redoutent toujours la « conscription ». Une fois entrés dans l’union, les paysans riches ne montrent aucun enthousiasme à travailler pour elle. Ils restent toujours inactifs.
Et les paysans moyens ? Ils sont indécis. Ils estiment que la révolution ne leur apportera guère de profit. Ils ont de quoi faire bouillir la marmite, personne ne vient en pleine nuit frapper à leur porte pour réclamer le paiement des dettes.
Eux aussi se demandent s’il a jamais existé quelque chose de pareil, et, en eux-mêmes, ils s’interrogent, le sourcil froncé : « Cette union paysanne peut donc tenir ? » « Sortira-t-il quelque chose de ces trois principes du peuple ? » « C’est peu probable ! » concluent-ils. Se figurant que tout dépend de la volonté céleste, ils se disent : « Une union paysanne ? Mais qui sait si cela agrée au Ciel ? »
Dans la première période, lorsque les militants des unions paysannes venaient trouver les paysans moyens avec leur registre et leur disaient : « Nous vous invitons à adhérer à l’union paysanne », ceux-ci leur répondaient : « Rien ne presse ! ». Ils n’ont commencé à y entrer qu’au cours de la deuxième période, lorsque les unions paysannes constituaient déjà une grande force.
Au sein des unions, ils se conduisent mieux que les paysans riches, mais pour l’instant ils ne sont guère actifs et continuent à rester dans l’expectative. Il est absolument nécessaire que les unions paysannes cherchent à faire adhérer les paysans moyens et renforcent leur travail d’explication parmi eux.
La force principale, dans ce combat dur et obstiné qui se poursuit à la campagne, a toujours été constituée par les paysans pauvres. Durant la phase de travail clandestin comme durant la phase d’activité au grand jour, ils ont toujours mené une lutte énergique.
Ce sont eux qui acceptent le plus volontiers la direction du Parti communiste. Ils sont les ennemis jurés des despotes locaux et des mauvais hobereaux et, sans la moindre hésitation, ils prennent d’assaut leurs forteresses. Aux paysans riches, ils déclarent : « Il y a déjà longtemps que nous avons adhéré à l’union paysanne, qu’est-ce que vous attendez pour en faire autant ? »
Et les paysans riches de leur répondre d’un ton moqueur : « Vous qui n’avez pas même une tuile au-dessus de votre tête, pas même un morceau de terre grand comme une pointe d’épingle, qu’est-ce qui pourrait vous retenir d’adhérer à l’union paysanne ? » C’est vrai, les paysans pauvres n’ont rien à perdre. Beaucoup d’entre eux, en effet, « n’ont pas même une tuile au-dessus de leur tête, pas même un morceau de terre grand comme une pointe d’épingle ».
Pourquoi donc n’entreraient-ils pas dans les unions paysannes ? D’après les données recueillies au cours de l’enquête, dans le district de Tchangcha, les paysans pauvres constituent 70 pour cent de la population rurale, les paysans moyens 20 pour cent, les propriétaires fonciers et les paysans riches 10 pour cent. Les paysans pauvres se divisent en deux groupes : les indigents et les pauvres proprement dits.
Les indigents constituent 20 pour cent de la population rurale ; ce sont eux qui manquent de tout, c’est-à-dire qui n’ont ni terre, ni argent, ni aucun moyen d’existence et qui sont contraints de s’engager comme soldats, de chercher ailleurs un travail salarié ou de vagabonder en mendiant.
Les pauvres proprement dits constituent 50 pour cent de la population rurale ; ils comprennent les ouvriers artisanaux, les paysans fermiers (à l’exclusion des paysans fermiers riches) et les paysans semi-propriétaires : ils possèdent peu de chose, en d’autres termes, ils ont un peu de terre et quelques ressources, mais les fruits de leur travail ne suffisent pas à assurer leur subsistance ; toute l’année, ils triment et sont en proie aux pires soucis.
La masse énorme des paysans pauvres, qui représente 70 pour cent de la population rurale, forme l’épine dorsale des unions paysannes, l’avant-garde dans la lutte pour le renversement des forces féodales, les glorieux pionniers de la grande cause de cette révolution restée si longtemps inachevée. Sans les paysans pauvres (les « va-nu-pieds », comme les appellent les hobereaux), la révolution à la campagne n’aurait jamais pu atteindre l’ampleur qu’elle connaît actuellement ; sans eux, il aurait été impossible de renverser les mauvais hobereaux et les despotes locaux et d’accomplir la révolution démocratique.
En tant qu’éléments les plus révolutionnaires, les paysans pauvres se sont assuré la direction dans les unions paysannes. Au cours de la première comme de la seconde période, presque tous les postes de présidents et de membres des comités des unions paysannes du dernier échelon ont été occupés par des paysans pauvres (dans le district de Hengchan, le personnel des unions paysannes de canton se répartit ainsi : 50 pour cent d’indigents, 40 pour cent de pauvres proprement dits et 10 pour cent d’intellectuels dans le besoin).
Il est absolument nécessaire que le rôle dirigeant dans les unions paysannes revienne aux paysans pauvres. Sans eux, il n’y aurait pas de révolution. Se refuser à reconnaître le rôle des paysans pauvres, c’est se refuser à reconnaître la révolution. Les attaquer, c’est attaquer la révolution. La direction générale donnée à la révolution par les paysans pauvres a toujours été juste. Ils ont battu en brèche le prestige des despotes locaux et des mauvais hobereaux. Ils ont jeté à terre grands et petits despotes locaux et mauvais hobereaux et les ont maintenus sous leurs pieds.
Beaucoup de leurs actes qualifiés d’ « excès » pendant la période de l’action révolutionnaire n’ont été, au fond, qu’une nécessité de la révolution.
Les autorités, les comités du parti et les unions paysannes de certains districts de la province de Hounan ont commis des fautes à cet égard ; certains d’entre eux sont allés jusqu’à envoyer des soldats, à la demande des propriétaires fonciers, pour arrêter des membres du personnel des unions paysannes de base. Dans les districts de Hengchan et Sianghsiang, on a jeté en prison nombre de présidents et de membres des comités des unions paysannes de canton.
C’est là une faute extrêmement grave qui encourage l’arrogance des réactionnaires. Pour s’en convaincre, il suffit de constater quelle joie délirante s’empare des propriétaires fonciers locaux coupables de forfaits et combien s’épaissit l’atmosphère de réaction partout où l’on arrête le président ou un membre du comité de l’union paysanne.
Nous devons combattre les propos contre-révolutionnaires sur le « mouvement des va-nu-pieds », sur le « mouvement des fainéants », et veiller en particulier à ne pas aider les despotes locaux et les mauvais hobereaux à attaquer les paysans pauvres. Il est vrai que parmi les paysans pauvres occupant des postes dirigeants il a pu se trouver des gens qui avaient effectivement des défauts, mais d’ores et déjà la majorité d’entre eux se sont corrigés.
D’eux-mêmes, ils interdisent expressément les jeux de hasard et luttent contre le banditisme. Là où l’union paysanne est puissante, les jeux de hasard ont totalement cessé et le banditisme a disparu. Il y a des endroits où réellement, comme on dit, on ne prend pas ce qui a été perdu sur le chemin et on ne ferme pas les portes la nuit. D’après une enquête effectuée dans le district de Henchan, 85 pour cent des paysans pauvres occupant des postes dirigeants sont devenus des éléments entièrement positifs, des hommes capables et énergiques ; 15 pour cent d’entre eux seulement ne se sont pas encore totalement débarrassés de certaines de leurs mauvaises habitudes.
On peut tout au plus considérer qu’il y a parmi eux « quelques éléments malsains », mais il est absolument inadmissible de faire chorus avec les despotes locaux et les mauvais hobereaux en les traitant tout en bloc de « va-nu-pieds ».
Seule l’application du mot d’ordre du renforcement de la discipline, mis en avant par les unions paysannes elles-mêmes, permet de résoudre le problème de ces « quelques éléments malsains » en menant un travail de propagande parmi les masses, en éduquant ces gens, en raffermissant la discipline des unions paysannes. Il ne faut en aucun cas envoyer des soldats pour procéder à des arrestations arbitraires ; ce serait porter préjudice au prestige de paysans pauvres et par là même encourager l’arrogance des despotes locaux et des mauvais hobereaux. Il convient d’accorder une attention particulière à cette question.
QUATORZE CONQUÊTES IMPORTANTES
Ceux qui critiquent les unions paysannes disent en général qu’elles ont fait beaucoup de mal. J’ai déjà montré que lorsque les paysans portent des coups aux despotes locaux et aux mauvais hobereaux, ils accomplissent une œuvre authentiquement révolutionnaire et qu’il n’y a là rien de condamnable.
Les paysans ont fait beaucoup de choses et, pour répondre à ceux qui les condamnent, il convient d’examiner soigneusement une à une toutes leurs actions pour voir à quoi elles ont abouti. Après avoir fait le classement et le bilan de leurs activités au cours des derniers mois, j’ai noté que sous la direction des unions paysannes, ils ont réalisé les quatorze conquêtes importantes que voici :
1. L’ORGANISATION DES PAYSANS DANS LES UNIONS PAYSANNES
C’est la première conquête importante des paysans. Dans des districts comme ceux de Siangtan, de Sianghsiang, de Hengchan, la presque totalité des paysans sont organisés, et il n’existe sans doute pas de « coins perdus » où les paysans ne se soient pas soulevés : ces districts occupent à cet égard la première place. La seconde place est occupée par les districts comme ceux de Yiyang et Houajong où la majorité des paysans sont organisés, mais où il existe encore un petit nombre qui ne le sont pas.
En troisième position viennent des districts comme ceux de Tchengpou et de Lingling où seule une minorité de paysans sont organisés et où la plupart d’entre eux ne le sont pas encore. La quatrième place est occupée par la partie occidentale de Hounan qui se trouve sous l’autorité de Yuan Tsou-ming, région que la propagande des unions paysannes n’a pas encore atteinte et où les paysans de nombreux districts ne sont pas du tout organisés.
En général, du point de vue de l’organisation, les districts de la partie centrale de Hounan, autour de Tchangcha, viennent en tête, suivis de ceux de la partie méridionale ; dans la partie occidentale, l’organisation ne fait que commencer. Selon les données fournies en novembre dernier par l’union paysanne de Hounan, des organisations avec un effectif total de 1.367.727 membres ont été créées dans 37 des 75 districts de la province.
Environ un million de paysans se sont organisés en octobre et en novembre derniers, au moment où les unions paysannes étaient en plein développement, alors qu’en septembre, elles ne comptaient guère que 300.000 à 400.000 membres.
En décembre et en janvier, on a assisté à un vigoureux essor du mouvement paysan, si bien qu’à la fin de janvier le nombre total des membres des unions paysannes n’était pas inférieur à 2 millions. Comme, dans la majorité des cas, un seul membre de chaque famille paysanne se fait inscrire à l’union et qu’une famille se compose en moyenne de cinq membres, c’est donc environ 10 millions de personnes qui se sont organisées dans les unions.
C’est justement cet essor surprenant, accéléré, qui a entraîné l’isolement des despotes locaux et des mauvais hobereaux, des fonctionnaires corrompus et concussionnaires, qui a fait que les gens ont vu avec stupeur un nouveau monde remplacer l’ancien et qui a engendré une grande révolution à la campagne. C’est là la première conquête importante réalisée par les paysans sous la direction de leurs unions.
2. LE COUP POLITIQUE PORTÉ AUX PROPRIÉTAIRES FONCIERS
Ayant créé leurs propres organisations, les paysans ont consacré leurs premiers efforts à dépouiller de son prestige politique la classe des propriétaires fonciers, en particulier les despotes locaux et les mauvais hobereaux, c’est-à-dire à renverser le pouvoir des propriétaires fonciers dans la société rurale et à y établir celui des paysans.
C’est une lutte des plus sérieuses et des plus importantes. Dans la seconde période, celle de l’action révolutionnaire, cette lutte joue un rôle capital. Si elle n’est pas victorieuse, il est à coup sûr impossible de remporter la victoire dans la lutte économique pour la réduction des fermages et du taux d’intérêt, pour l’obtention des terres et des autres moyens de production, etc.
En de nombreux endroits du Hounan, comme les districts de Sianghsian, de Hengchan et de Siangtan, la question ne se pose plus, puisque le pouvoir des propriétaires fonciers a été complètement renversé et que les paysans ont établi leur autorité sans partage. Mais dans des districts comme Liling, il existe encore des endroits (par exemple dans les arrondissements de l’ouest et du sud de Liling) où l’autorité des propriétaires fonciers le cède apparemment à celle des paysans, mais s’oppose en réalité de façon déguisée, du fait que la lutte politique n’y a pas encore atteint l’acuité suffisante.
Dans ces endroits, on ne peut pas encore dire que les paysans on remporté la victoire politique ; il faut y mener la lutte politique avec une énergie redoublée, jusqu’à ce que les paysans aient définitivement renversé le pouvoir des propriétaires fonciers. Pour porter aux propriétaires fonciers des coups politiques, les paysans se servent essentiellement des méthodes suivantes :
Les contrôles. S’occupant des finances publiques locales, les despotes locaux et les mauvais hobereaux ont, le plus souvent, dissipé ces fonds en cachette et maquillé les comptes. Et maintenant les paysans utilisent les contrôles pour mettre à la raison de nombreux despotes locaux et mauvais hobereaux. En bien des endroits, on a créé des commissions de contrôle spécialement chargées d’engager des poursuites contre les despotes locaux et les mauvais hobereaux.
A peine ceux-ci voient-ils apparaître une telle commission qu’ils se mettent à trembler. La campagne de contrôle a pris une ampleur considérable dans tous les districts où s’est développé le mouvement paysan ; son importance ne réside pas tellement dans le recouvrement des sommes détournées que dans la divulgation des crimes des despotes locaux et des mauvais hobereaux, ce qui détruit leur influence politique et sociale.
Les amendes. Ces opérations de contrôle ont permis de déceler des abus comme détournements de fonds, actes de cruauté à l’égard des paysans dans le passé, activités de sape contre les unions paysannes dans le présent, infractions à l’interdiction des jeux de hasard et refus de remettre les pipes à opium.
Dans tous ces cas, les paysans décident que le despote local devra verser telle somme, le mauvais hobereau telle autre. Ces amendes vont de plusieurs dizaines à plusieurs milliers de yuans. Bien entendu, les despotes locaux et les mauvais hobereaux ainsi frappés d’amendes par les paysans perdent complètement la face.
Les contributions en argent. A l’égard des propriétaires fonciers cupides et cruels, on a recours aux contributions en argent ; les sommes ainsi recueillies vont alimenter les caisses de secours aux pauvres, ou servent à l’organisation de coopératives, de caisses de prêts aux paysans ou à d’autres besoins. La contribution en argent constitue également une sorte de châtiment, quoique plus doux que l’amende. Pour éviter des désagréments, nombre de propriétaires fonciers versent d’eux-mêmes de l’argent aux unions paysannes.
Les « interrogatoires ». Si quelqu’un a fait aux unions paysannes, par l’acte ou la parole, un tort de moindre gravité, les paysans font irruption en groupe dans sa demeure et le soumettent à un interrogatoire mené sans rigueur excessive. Il s’en tire généralement en s’engageant par écrit, en termes explicites, à ne plus jamais porter préjudice, en parole ou en actes, au prestige des unions paysannes.
Les « démonstrations de force ». Il arrive assez souvent que les paysans organisent une démonstration massive de force contre un despote local ou un mauvais hobereau restés hostiles aux unions paysannes. Ils mangent dans sa maison et, dans ce cas, l’affaire ne se termine pas sans que quelques cochons passent de vie à trépas et que les réserves alimentaires du maître de céans subissent une bonne saignée.
Récemment à Makiaho, dans le district de Siangtan, une foule groupant près de 15.000 personnes a fait une visite punitive à six familles de mauvais hobereaux. En quatre jours, on égorgea plus de 130 cochons. De telles démonstrations se terminent généralement par l’imposition d’une amende.
Les « défilés en grands bonnets » à travers les villages. C’est là une mesure appliquée partout et très fréquemment. On coiffe les despotes locaux et les mauvais hobereaux de grands bonnets de papier portant cette inscription : despote local. Un tel ou mauvais hobereau. Un tel.
Puis on les attache à une corde, et on les promène ainsi au milieu d’un grand concours de peuple. Parfois, pour attirer l’attention sur le cortège, on tape sur des gongs et on brandit des oriflammes. C’est ce châtiment qui effraie le plus les despotes locaux et les mauvais hobereaux. Celui qui a défilé ainsi, ne fût-ce qu’une fois, affublé de son grand bonnet, n’a plus droit à aucun respect et ne peut jamais plus relever la tête.
C’est pourquoi les richards préfèrent payer une amende plutôt que de coiffer le bonnet. Mais lorsque les paysans leur refusent cette possibilité, ils sont bien obligés bon gré mal gré, de s’en laisser coiffer. Une union paysanne de canton a ainsi fait preuve de beaucoup d’esprit. Elle s’était saisie d’un mauvais hobereau et lui avait déclaré que le jour même on le coifferait d’un bonnet.
Le mauvais hobereau en devint noir de frayeur. Alors l’union paysanne décida de ne pas le coiffer le jour même, estimant que si on lui faisait subir sa peine immédiatement il se raidirait devant son sort et cesserait de redouter le châtiment. Aussi le renvoya-t-on chez lui en ajournant l’exécution de sa peine. Ignorant quel jour exactement on le coifferait du grand bonnet, ce mauvais hobereau ne put retrouver le calme et jour après jour fut en proie aux plus vives alarmes.
Les incarcérations dans les prisons de district. Ce châtiment est bien plus lourd que le port des grands bonnets. Les despotes locaux et les mauvais hobereaux arrêtés sont envoyés dans les prisons de district. On demande au chefs de district de les garder en détention et de les faire passer en jugement. En ce qui concerne les incarcérations, les choses ont donc changé : autrefois, c’étaient les hobereaux qui envoyaient les paysans en prison ; maintenant, c’est l’inverse.
Les « bannissements ». Les paysans ne sont guère enclins à bannir les despotes locaux et les mauvais hobereaux qui ont commis des crimes révoltants, mais cherchent plutôt à les arrêter ou à les exécuter. Aussi, dans la crainte d’un tel sort, ceux-ci prennent-ils la fuite. Presque tous les despotes locaux et les mauvais hobereaux des districts où s’est développé le mouvement paysan se sont enfuis, ce qui équivaut au bannissement.
Les plus importants ont gagné Changhaï, ceux qui le sont moins Hankeou, ceux qui le sont moins encore Tchangcha ; les plus petits se sont réfugiés dans les chefs-lieux de district. Parmi tous ces despotes locaux et mauvais hobereaux, ceux qui se sont réfugiés à Changhaï se trouvent le plus en sécurité. A Hankeou, par exemple, on a arrêté et renvoyé chez eux trois mauvais hobereaux qui s’étaient enfuis du district de Houajong.
Quant à ceux qui se sont réfugiés à Tchangcha, leur situation est encore plus difficile ; ils vivent sous la menace constante d’être appréhendés par les étudiants de leurs districts qui poursuivent leurs études à Tchangcha. Lorsque j’étais dans cette ville, j’ai ainsi assisté moi-même à l’arrestation de deux mauvais hobereaux.
Quant aux petits despotes locaux et mauvais hobereaux qui se sont cachés dans les chefs-lieux de district, il est facile de les découvrir, car la paysannerie y a des yeux et des oreilles en grand nombre. Le gouvernement du Hounan éprouvant des difficultés dans les finances, les autorités intéressées les ont attribuées au fait que les paysans ont chassé les riches de la campagne et que par conséquent il n’était pas facile de faire rentrer l’argent ; on peut se rendre compte par là à quel point était intenable la situation des despotes locaux et des mauvais hobereaux dans leur village.
Les exécutions. Les paysans n’ont recours à cette mesure qu’à l’égard des despotes locaux et des mauvais hobereaux de très grande importance et l’appliquent d’entente avec le reste de la population. C’est ainsi que, sur l’insistance des paysans et d’autres couches de la population, les autorités ont procédé à l’exécution de Yang Tche-tseh (district de Ninghsiang), de Tcheou Kia-kan (district de Yuégang), de Fou Tao-nan et de Souen Po-tchou (district de Houajong). Dans le district de Siangtan, les paysans et les autres couches de la population ont contraint le chef de district à leur livrer le détenu Yen Jong-tsieou, qui fut ensuite fusillé par les paysans.
Dans le district de Ninghsiang, ce sont les paysans eux-mêmes qui ont tué Lieou Tchao. Actuellement, les nommés Peng Tche-fan (district de Liling), Tcheou Tien-tsiué et Tsao Yun (district de Yiyang) attendent l’arrêt que doit rendre le « Tribunal spécial pour les jugements des despotes locaux et des mauvais hobereaux ».
L’exécution de tel ou tel important despote local ou mauvais hobereau met en émoi tout le district et se révèle fort efficace pour l’extirpation des survivances féodales. Chaque district compte plusieurs de ces despotes locaux et mauvais hobereaux de premier plan ; dans certains districts, on en compte même plusieurs dizaines.
Il faut, dans chaque district, exécuter tout au moins quelques despotes locaux et mauvais hobereaux coupables des plus grands forfaits, c’est le seul moyen efficace pour écraser la réaction. Lorsque la force était de leur côté, les despotes locaux et mauvais hobereaux assassinaient les paysans sans sourciller.
Dans le bourg de Sinkang (district de Changcha), le chef des corps de défense Ho Mai-tsiuan a exercé son commandement pendant dix ans. Il a fait périr de sa main près d’un millier de paysans indigents sous le prétexte apparemment louable d’ « exécuter les bandits ». En quatorze ans, c’est-à-dire depuis 1913, Tang Tsiun-yen et Louo Chou-lin, chefs des corps de défense du bourg de Yintien, dans mon district natal de Siangtan, ont assassiné plus de cinquante personnes et en ont enterré vivantes quatre.
Et les deux premières victimes étaient des mendiants absolument innocents. Tang Tsiun-yen déclara : « Commençons toujours avec ces deux vagabonds ! ». Et c’est ainsi que deux hommes sont morts. Si, dans le passé, les despotes locaux et les mauvais hobereaux ont montré une telle cruauté, s’ils ont instauré le régime de la terreur blanche à la campagne, comment pourrait-on maintenant reprocher aux paysans de fusiller quelques despotes locaux ou quelques mauvais hobereaux et d’y faire régner un peu de terreur pour mater la contre-révolution ?
3. LE COUP ÉCONOMIQUE PORTÉ AUX PROPRIÉTAIRES FONCIERS
Interdiction de faire sortir le riz, d’en élever le prix et d’en stocker à des fins de spéculation. C’est là une importante conquête réalisée par les paysans de Hounan, au cours des derniers mois, dans leur lutte économique. Dès octobre dernier, les paysans pauvres ont empêché les propriétaires fonciers et les paysans riches de faire sortir le riz, d’en élever le prix et d’en stocker à des fins de spéculation. Finalement, ils ont pleinement atteint leurs objectifs ; la fuite du riz est arrêtée, les prix ont baissé sensiblement, le stockage clandestin du riz a disparu.
Interdiction d’augmenter les fermages et les dépôts ; agitation en vue de leur réduction. En juillet et août derniers lorsque les unions paysannes étaient encore faibles, les propriétaires fonciers, appliquant les vieilles méthodes d’exploitation féroce, ont, les uns après les autres, averti leurs fermiers qu’ils allaient augmenter sans rémission les fermages et les dépôts.
Mais dès octobre, comme les unions paysannes avaient déjà accru considérablement leur force et que les paysans se prononçaient à l’unanimité contre l’augmentation des fermages et des dépôts, les propriétaires fonciers n’en ont plus osé souffler mot.
Après novembre, les paysans, devenus bien plus forts que les propriétaires fonciers, sont allés plus loin en faisant de la propagande en faveur de la réduction des fermages et dépôts. Ils disent : « Quel dommage que l’automne dernier, quand on a acquitté les fermages, les unions paysannes n’aient pas encore été assez fortes ; nous aurions déjà fait réduire les fermages ».
Dès à présent, ils mènent une large campagne de propagande pour la réduction des fermages payables en automne prochain ; de leur côté, les propriétaires fonciers essaient de savoir comment s’effectuera la réduction des fermages. En ce qui concerne la réduction des dépôts, elle est déjà en cours dans le district de Hengchan et dans quelques autres.
Interdiction aux propriétaires fonciers de reprendre la terre affermée. En juillet et août derniers, il arrivait encore fréquemment que les propriétaires fonciers retiraient à certains fermiers la terre qu’il leur avaient affermée pour la remettre à d’autres. Depuis octobre, aucun n’ose plus le faire. Désormais, il n’est plus question d’une telle pratique ; les difficultés ne surgissent que lorsque le propriétaire foncier reprend la terre affermé pour la cultiver lui-même.
Dans certains endroits, les paysans interdisent au propriétaire foncier de reprendre sa terre, même s’il a l’intention de la cultiver lui-même. En d’autres endroits, les paysans le lui permettent si c’est vraiment lui qui la cultive ; mais dans ce cas les fermiers pourraient être menacés de chômage. Cette question n’a pas encore reçu une solution uniforme.
Réduction du taux d’intérêt. Le taux d’intérêt des prêts a été réduit partout dans le district d’Anhoua, çà et là dans d’autres districts. Néanmoins, là où les unions paysannes sont très fortes, les propriétaires fonciers, qui craignent la « collectivisation », refusent tout prêt aux paysans, et dans les villages on n’a plus guère d’exemples d’octroi de prêts. Actuellement, la réduction du taux des prêts ne s’étend qu’aux anciennes dettes.
Non seulement on en réduit le taux d’intérêt, mais on interdit même aux créanciers d’exiger des débiteurs le remboursement des sommes prêtées. Le paysan pauvre déclare : « Ne m’en voulez pas. L’année est bientôt passé. Je vous paierai l’an prochain ! ».
4. RENVERSEMENT DU POUVOIR FEODAL DES DESPOTES LOCAUX ET DES MAUVAIS HOBEREAUX – LA SUPPRESSION DES TOU ET DES TOUAN
Les anciens organes du pouvoir dans les tou (arrondissements) et les touan (cantons), en particulier à l’échelon du tou qui est juste au-dessous du district, se trouvaient presque entièrement aux mains des despotes locaux et des mauvais hobereaux.
Le tou avait sous sa juridiction une population de 10.000 à 50.000 ou 60.000 habitants ; il possédait ses propres forces armées telles que les corps de défense ; il avait le droit de lever des impôts pour son propre compte, par exemple une contribution foncière supplémentaire ; il avait des pouvoirs judiciaires qui l’habilitaient notamment à arrêter, incarcérer, interroger ou condamner des paysans à sa guise.
Les despotes locaux qui siégeaient dans ces organismes étaient littéralement de petits tyrans ruraux. Les paysans tenaient moins compte du président de la République, des toukium et des chefs de district que de ces souverains locaux qui constituaient leurs véritables « maîtres » ; venaient-ils à toussoter, ces « maîtres », que le paysan savait déjà qu’il devait se tenir sur ses gardes ! Mais maintenant, le soulèvement à la campagne a mis fin partout à la puissance des propriétaires fonciers, et tous les organes administratifs ruraux, qui étaient aux mains des despotes locaux et des mauvais hobereaux, se sont tout naturellement écroulés.
Les chefs de tou et de touan se sont cachés et n’osent même pas montrer le bout de leur nez ; quand des gens s’adressent à eux pour une quelconque affaire d’intérêt local, ils les renvoient à l’union paysanne en déclarant :
« Ça ne me regarde pas ! »
Lorsque les paysans en viennent à parler de ces chefs, ils disent avec colère : « Ces coquins ? Elle est finie leur chanson ! »
Cette expression, « Elle est finie leur chanson ! » caractérise bien la situation des anciens organes administratifs dans les localités rurales balayées par la vague de la révolution.
5. LE RENVERSEMENT DES FORCES ARMÉES DES PROPRIÉTAIRES FONCIERS ET LA CRÉATION DES FORCES ARMÉES DES PAYSANS
Les forces armées des propriétaires fonciers de la province du Hounan, relativement peu nombreuses dans la partie centrale, sont plus importantes à l’ouest et au sud. En comptant en moyenne 600 fusils par district, on arrive à un total de 45.000 pour 75 districts ; en réalité, il y en a peut-être encore plus.
Dans le centre et le sud du Hounan, c’est-à-dire dans les régions où le mouvement paysan est développé, comme, par exemple, dans les districts de Ninghsian, de Pingkiang, de Lieouyang, de Tchangchan, de Hengyang, la paysannerie s’est soulevée avec un élan si puissant que les propriétaires fonciers ont été incapables de se défendre et que leurs détachements armés se sont pour la plupart rendus aux unions paysannes et soutiennent désormais la paysannerie.
Une petite fraction des détachements armés des propriétaires fonciers garde une attitude neutre tout en penchant vers la capitulation devant les paysans ; il en est ainsi, par exemple, dans le district de Paoking. Une autre fraction, peu importante, de ces détachements a une position hostile à l’égard des unions paysannes, comme par exemple dans les districts de Yitchang, de Linwou et Kiaho ; mais vivement attaquée par les paysans, selon toute vraisemblance elle sera bientôt anéantie.
Les forces armées arrachées aux maisons des propriétaires fonciers réactionnaires seront toutes réorganisées en « unités permanentes des milices de ferme » et placées sous l’autorité des nouveaux organismes ruraux autonomes, qui sont des organes du pouvoir politique de la paysannerie. L’incorporation des anciennes forces armées constitue l’un des aspects de la création des forces armées paysannes. Un second et nouvel aspect de ce travail, c’est l’organisation des détachements de piques auprès des unions paysannes.
La pique est formée d’une longue perche dont le bout est garni d’un fer à deux tranchants. Dans le seul district de Sianghsiang, on compte 100.000 de ces piques. Dans d’autres districts (Siangtan, Hengchan, Liling, Tchangcha), leur nombre varie de 70.000 à 80.000, de 50.000 à 60.000 ou de 30.000 à 30.000 par district. Dans tous les districts gagnés par le mouvement paysan, le nombre de ces détachements est en augmentation rapide. Les paysans armés de piques s’organisent en « milices de ferme de premier secours ».
Ces énormes détachements sont plus forts que les anciens détachements armés dont nous avons parlé plus haut ; et cette force qui naît à peine fait déjà trembler tous les despotes locaux et les mauvais hobereaux.
Les autorités révolutionnaires du Hounan doivent étendre effectivement cette forme d’organisation des forces armées aux 20 millions d’habitants et plus qui peuplent les 75 districts de la province et faire en sorte que chaque paysan, jeune ou adulte, ait sa pique ; et elles ne doivent pas limiter les effectifs de ces détachements en les prenant pour quelque chose de redoutable. Il faut être vraiment trop couard pour tomber de frayeur à leur vue. Seuls les despotes locaux et les mauvais hobereaux les craignent ; les révolutionnaires, eux, n’ont rien à en redouter.
6. LE RENVERSEMENT DE L’AUTORITÉ DE L’HONORABLE CHEF DE DISTRICT ET DE SES COMMIS
On ne peut épurer l’administration de district que si les paysans eux-mêmes se soulèvent. C’est ce qu’a déjà montré l’exemple du district de Haifeng, dans le Kouangtong, et, d’une manière plus évidente encore, l’exemple actuel du Hounan.
Dans les districts où les despotes locaux et les mauvais hobereaux détiennent le pouvoir, presque tous ceux qui deviennent chefs de district s’avèrent des révolutionnaires corrompus et concussionnaires, mais dans les districts où les paysans se sont déjà soulevés, les chefs de district, quels qu’ils soient travaillent d’une manière honnête. Dans les districts où j’ai séjourné, les chefs de district sont tenus de consulter d’abord les unions paysannes pour toute affaire qu’ils ont à traiter.
Dans les districts où le mouvement paysan est particulièrement fort, la parole de l’union paysanne est douée d’une force littéralement magique. Si l’union exige l’arrestation d’un despote local ou d’un mauvais hobereau le matin, le chef de district n’ose pas la retarder jusqu’à midi ; si elle l’exige à midi, il n’ose la remettre à l’après-midi.
Au premier stade de l’établissement du pouvoir paysan à la campagne, les chefs de district se sont entendus avec les despotes locaux et les mauvais hobereaux pour s’opposer aux paysans. Lorsque l’autorité des paysans est devenue aussi forte que celle des propriétaires fonciers, les chefs de district ont cherché à complaire aux deux côtés ; ils acceptaient certaines des décisions des unions paysannes et repoussaient les autres.
Ce que j’ai dit précédemment quant à l’effet magique produit par la parole des unions paysannes se rapporte au cas où le pouvoir des propriétaires fonciers était déjà complètement renversé par celui des paysans. Actuellement, la situation politique dans les districts de Sianghsiang, de Siangtan, de Liling et de Hengchan est la suivante :
1) Toutes les affaires sont décidées par le chef de district et les représentants des organisations révolutionnaires de masse réunis en conseil. Les conseils, convoqués par le chef de district, se tiennent au bureau de district. Dans certains districts, on les appelle : « Conseils conjoints des organisations publiques et du pouvoir local » ; dans d’autres : « Conseils des affaires du district ».
A ces conseils participent, outre le chef de district, les représentants des organisations suivantes : l’union paysanne, l’union syndicale, l’union des commerçants, l’union des femmes, l’union du personnel des établissements d’enseignement, l’association des élèves et le comité du Kuomintang. Au cours de ces réunions, le chef de district subit l’influence des opinions exprimées par les représentants des organisations de masse et finit toujours par se soumettre à leur volonté.
Il ne fait donc aucun doute que dans le Hounan, au niveau des organes du pouvoir de district, on peut adopter un système démocratique de comité. Par la forme et par le contenu, les organes actuels du pouvoir, à l’échelon du district, sont devenus fort démocratiques.
Cette situation ne s’est créée qu’au cours des deux ou trois derniers mois, c’est-à-dire depuis que les paysans se sont soulevés dans toute la campagne et ont renversé le pouvoir des despotes locaux et des mauvais hobereaux.
C’est seulement lorsque les chefs de district ont vu que leurs anciens appuis avaient été renversés et qu’ils ne pourraient rester en place sans en trouver de nouveaux qu’ils ont commencé à rechercher les bonnes grâces des organisations de masse, ce qui a abouti à la situation que nous venons d’exposer.
2) Les juges n’ont presque plus de cas à juger. Le système judiciaire au Hounan est encore organisé de telle sorte que le chef de district s’occupe de la justice, le juge l’aidant à mener les procès. Pour s’enrichir, les chefs de district et leurs subalternes se livraient à toutes sortes d’abus dans la perception des impôts et des contributions, dans la levée des recrues, tout en pratiquant faux et chantages dans l’examen des affaires civiles et criminelles.
Cette dernière rubrique leur procurait les bénéfices les plus réguliers et les plus sûrs. Au cours des derniers mois, avec la chute des despotes locaux et des mauvais hobereaux, les professionnels des tractations juridiques ont disparu. Et comme toutes les affaires des paysans, grandes et petites, se trouvent réglées maintenant par des unions paysannes de différents échelons, les juges de l’administration de district n’ont littéralement plus d’affaires à juger.
Un juge du district de Sianghsiang m’a dit : « Lorsqu’il n’y avait pas d’unions paysannes, il arrivait chaque jour une moyenne de 60 affaires civiles ou criminelles à l’administration du district. Depuis la création des unions, il en arrive tout au plus 4 ou 5. » Les chefs de district et leurs subalternes ont dû se résigner à voir leur bourse s’aplatir.
3) Les gardes, les policiers, les commis des administrations de district se sont tous éclipsés et n’osent plus circuler dans les campagnes et se livrer à leurs exactions. Autrefois, c’étaient les campagnards qui redoutaient les gens des villes et maintenant c’est le contraire.
En particulier, cette meute infâme de policiers, de gardes, de commis entretenus par les autorités de district ont peur de circuler dans les campagnes, et lorsqu’ils le font, ils n’osent plus désormais se livrer à leurs exactions ; ils tremblent d’effroi à la seule vue des piques paysannes.
7. LE RENVERSEMENT DE L’AUTORITÉ CLANALE (POUVOIR DU TEMPLE DES ANCÊTRES ET DU CHEF DE CLAN), DE L’AUTORITÉ RELIGIEUSE (POUVOIR FONDE SUR LE DIEU PROTECTEUR DE LA CITE ET LES DIVINITÉS LOCALES) ET DE L’AUTORITÉ MARITALE
Les hommes se trouvent ordinairement soumis, en Chine, à l’autorité de trois systèmes :
1. Le système d’Etat ou le pouvoir politique : les organes du pouvoir à l’échelon de l’Etat, de la province, du district et du canton.
2. Le système du clan ou le pouvoir clanal : le temple des ancêtres du clan, le temple des ancêtres de la lignée, les chefs de la famille.
3. Le système des puissances surnaturelles ou le pouvoir religieux, constitué par les forces souterraines : le Souverain suprême de l’Enfer, le dieu protecteur de la Cité et les divinités locales, par les forces célestes : dieux et divinités, depuis le Souverain suprême du Ciel jusqu’aux esprits de toute espèce ; ensemble, ces forces constituent le système des puissances de l’au-delà. Quant aux femmes, elles se trouvent sous l’autorité des hommes ou le pouvoir marital.
Ces quatre formes de pouvoir – politique, clanal, religieux et marital – représentent l’ensemble de l’idéologie et du système féodalo-patriarcaux et sont les quatre grosses cordes qui ligotent le peuple chinois et en particulier la paysannerie.
On a montré précédemment comment les paysans ont renversé, à la campagne, le pouvoir des propriétaires fonciers. Ce dernier est le pivot autour duquel gravitent toutes les autres formes de pouvoir. Le renversement du pouvoir des propriétaires fonciers a ébranlé les pouvoirs clanal, religieux et marital. Là où l’union paysanne est forte, le chef du clan et les dispensateurs des ressources du temple des ancêtres n’osent plus brimer les membres cadets du clan et détourner les fonds du temple.
Les plus malfaisants d’entre eux ont été renversés en tant que despotes locaux et mauvais hobereaux. Ils n’osent plus infliger ces cruels châtiments corporels, voire ces peines capitales qu’ils appliquaient autrefois, comme la condamnation à la bastonnade, à être noyé ou enterré vivant. La vieille coutume selon laquelle les femmes et les pauvres n’avaient pas le droit de prendre part au repas rituel, dans le temple du clan, a été abolie.
Dans la localité de Paikouo, district de Hengchan, les femmes sont entrées en foule dans le temple, s’y sont installées sans cérémonie et ont participé au repas rituel, et les très respectables anciens du clan n’ont rien pu faire d’autre que de les laisser agir à leur guise.
Dans un autre endroit, les paysans pauvres qui sont exclus de tels banquets ont fait irruption dans le temple et ont bu et mangé à satiété, si bien que les despotes locaux et les mauvais hobereaux, tous ces graves messieurs en longue robe, se sont enfuis terrifiés. A mesure que se développe le mouvement paysan, le pouvoir religieux commence à s’écrouler de toutes parts.
Les unions paysannes occupent en de nombreux endroits les temples des dieux et les utilisent comme sièges des unions. Partout elles réclament la confiscation de la propriété des temples afin d’organiser des écoles paysannes et de couvrir les dépenses des unions paysannes et qualifient ces ressources de « revenus de la superstition ». Dans le district de Liling, le mouvement pour l’interdiction des pratiques superstitieuses et pour la destruction des statues des divinités a déjà pris une ampleur assez considérable.
Dans la partie nord de ce district, les paysans ont interdit les processions qui passent de maison en maison en brûlant de l’encens pour apaiser le dieu de la Peste. Dans le temple taoïste de Foupoling, à Loukeou, il y avait beaucoup de statues de divinités, mais comme le comité d’arrondissement du Kuomintang n’y trouvait pas assez de place pour s’installer, on les a entassées dans un coin, petites et grandes pêle-mêle, et les paysans n’ont fait aucune objection.
Depuis lors, les sacrifices aux dieux, la pratique des rites religieux et l’offrande de lampes sacrées ne se font plus guère quand il se produit un décès dans une famille. L’initiateur de ce mouvement a été Souen Siao-chan, président d’une union paysanne, désormais terriblement haï par les prêtres taoïstes de la localité.
Dans le IIIe arrondissement Nord, paysans et instituteurs ont brisé les statues de divinités du temple de bonzesses de Longfen et en ont fait du bois pour cuire la viande. Dans l’arrondissement Sud, élèves et paysans ont brûlé plus de trente idoles de bois du Temple de Tongfou. Seules deux petites effigies de Pao Kong ont échappé ; un vieux paysan s’en est saisi. « Ce serait un sacrilège ! » a-t-il dit. Dans les endroits où le pouvoir des paysans est prédominant, seuls les vieux et les femmes continuent de croire ; les jeunes et les hommes d’âge moyen, eux, ont cessé.
Et comme les unions paysannes se trouvent justement aux mains de ces derniers, elles effectuent partout un intense travail pour détruire le pouvoir religieux et la superstition.
En ce qui concerne le pouvoir marital, il a toujours été plus faible dans les familles de paysans pauvres, où la situation économique contraint les femmes à prendre une part plus grande au travail que dans les familles des classes aisées ; de ce fait, elles avaient plus souvent droit à la parole et à la décision dans les affaires familiales.
Au cours des dernières années, en raison de la misère croissante de l’agriculture, la base même de l’autorité du mari sur la femme s’est trouvée minée.
Avec l’apparition du mouvement paysan, les femmes ont maintenant commencé, dans bien des endroits, à créer des unions paysannes ; l’heure est venue pour elles de relever la tête, et le pouvoir marital s’affaiblit de jour en jour. Bref, l’ensemble de l’idéologie et du système féodalo-patriarcaux chancelle devant l’autorité croissante des paysans. Mais, actuellement, les efforts des paysans portent principalement sur la destruction du pouvoir politique des propriétaires fonciers.
Là où ce pouvoir a été complètement détruit, les paysans sont passés à l’attaque contre le système clanal, contre le système religieux, contre l’assujettissement de la femme à l’homme au sein de la famille. Néanmoins, cette offensive n’en est encore qu’au stade préliminaire, car on ne pourra en finir avec ces trois formes du mal que lorsque les paysans auront remporté une victoire définitive sur le plan économique.
C’est pourquoi il nous faut conduire actuellement les paysans à porter leurs plus grands efforts sur la lutte politique pour renverser complètement le pouvoir des propriétaires fonciers. Puis, nous devons commencer sans tarder la lutte économique pour résoudre d’une manière radicale le problème de la terre et les autres problèmes économiques de la paysannerie pauvre. En ce qui concerne le système clanal, les superstitions et l’inégalité entre l’homme et la femme au sein de la famille, ils disparaîtront d’eux-mêmes avec la victoire dans les domaines politique et économique.
Si, par contre, nous faisons trop d’efforts pour les abolir arbitrairement et prématurément, les despotes locaux et les mauvais hobereaux ne manqueront pas d’en prendre prétexte pour faire de la propagande contre-révolutionnaire en déclarant que « les unions paysannes ne respectent pas les ancêtres », qu’ « elles bafouent les dieux et détruisent la religion », qu’ « elles veulent collectiviser les femmes », tout cela en vue de saper le mouvement paysan.
Nous en avons un exemple éclatant dans les faits qui se sont produits récemment dans le district de Sianghsiang, province du Hounan, et dans le district de Yangsin, province de Houpei, où les propriétaires fonciers ont exploité l’opposition des paysans à la destruction des statues de divinités. Ce sont les paysans eux-mêmes qui ont érigé ces statues, et le temps viendra où ils les abattront de leurs propres mains ; il n’est nul besoin que d’autres le fassent pour eux prématurément.
La politique en matière de propagande que les communistes doivent suivre dans cette question est celle-ci : « Bander l’arc et ne pas tirer, juste indiquer le geste ». Il faut que ce soient les paysans eux-mêmes qui détruisent les effigies des divinités, les temples des femmes qui n’ont pas voulu survivre à leur mari, les arcs érigés en l’honneur des épouses chastes et des veuves fidèles ; ce serait une erreur de se substituer aux paysans dans cette affaire.
J’ai eu, moi aussi, l’occasion de m’occuper de la propagande à la campagne contre les superstitions. J’ai dit :
« Si on croit aux horoscopes, c’est qu’on espère un sort meilleur ; si on croit à la géomancie, c’est qu’on espère une influence bénéfique de l’emplacement des tombeaux des ancêtres. Cette année, en quelques mois, les despotes locaux, les mauvais hobereaux et les fonctionnaires corrompus et concussionnaires ont tous été renversés.
Se peut-il qu’il y a quelques mois encore la chance leur ait souri et que le bon emplacement des tombeaux de leurs ancêtres leur ait été bénéfique, mais que, subitement, ces derniers mois, la chance ait tourné et les tombeaux de leurs ancêtres cessé d’être bénéfiques ?
Les despotes locaux et les mauvais hobereaux parlent de vos unions paysannes en ces termes : ‘Comme c‘est curieux ! Le monde est aujourd’hui aux membres de comité. Voyez, on ne peut même pas aller uriner sans tomber sur l’un d’eux !’ Et c’est vrai, en ville, à la campagne, dans les syndicats, dans les unions paysannes, au Kuomintang, au Parti communiste, partout on retrouve les siens, membres de comités exécutifs. Le monde est en effet aux membres de comité. Mais est-ce dû aux horoscopes et à l’emplacement des tombeaux des ancêtres ?
Comme c‘est étrange ! Voilà que soudain les horoscopes propres à chacun de ces miséreux de la campagne sont devenus favorables, et que soudain les tombeaux de leurs ancêtres se sont mis à leur être bénéfiques ! Et les dieux ? Vénérez-les tant que vous voudrez.
Mais si vous n’aviez que le dieu Kouan et la déesse de la Miséricorde et pas d’unions paysannes, auriez-vous pu renverser les despotes locaux et les mauvais hobereaux ? Ce sont des dieux et des déesses bien piètres. Vous les avez vénérés pendant des siècles, mais aucun d’eux, pour vous être agréable, n’a jamais renversé un seul despote local, un seul mauvais hobereau !
Maintenant vous voulez qu’on vous réduise les fermages. Permettez-moi de vous poser une question : Comment comptez-vous y parvenir ? En croyant aux dieux ou en croyant dans les unions paysannes ? »
Mes paroles firent éclater de rire les paysans.
8. L’EXTENSION DE LA PROPAGANDE POLITIQUE
Est-ce qu’il aurait été possible, même en créant une dizaine de milliers d’écoles des sciences juridiques et politiques, de donner en si peu de temps à tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, jusque dans les villages les plus éloignés et les coins les plus perdus, une éducation politique, comme l’ont justement fait les unions paysannes ? Je ne le pense pas.
Les mots d’ordre politiques : « A bas l’impérialisme ! » « A bas les seigneurs de guerre ! » « A bas les fonctionnaires corrompus et concussionnaires ! » A bas les despotes locaux et les mauvais hobereaux » volent littéralement sans avoir besoin d’ailes ; ils s’emparent des masses innombrables des campagnes, jeunes, adultes, vieillards, femmes, enfants, se gravent dans leur esprit et finissent par apparaître sur leurs lèvres.
Si vous voyez un groupe d’enfants en train de jouer et que l’un d’entre eux, écarquillant les yeux, tapant du pied, brandissant le poing, se querelle avec un autre, vous entendrez à coup sûr ce cri perçant : « A bas l’impérialisme ! ».
Dans le district de Siangtan, quand les enfants qui gardent les buffles se mettent à jouer à la guerre, l’un d’eux fait Tang Cheng-tche et l’autre Yé Kai-hsin. Un moment après, l’un est vaincu et l’autre le poursuit ; le vainqueur est Tang Chen-tche, le fuyard Yé Kai-hsin. Quant à la chanson : « A bas les puissances impérialistes !… », presque tous les enfants des villes et même de nombreux enfants de la campagne savent la chanter.
A la campagne, certains paysans peuvent même réciter le testament du Dr Sun Yat-sen. Ils extraient de ce testament des mots ou expressions comme « liberté », « égalité », « trois principes du peuple », « traités inégaux » qu’ils appliquent d’une manière assez rigide dans la vie courante. Un beau jour, voilà qu’un individu qui a la mine d’un hobereau rencontre un paysan sur un sentier. Notre homme fait l’important et refuse le passage. Alors le paysan, en colère lui crie : « Va donc, despote local, mauvais hobereau !
Tu ne connais donc pas les trois principes du peuple ? » Les maraîchers des environs de Tchangcha subissait constamment les vexations de la police lorsqu’ils amenaient leurs légumes en ville. Mais maintenant, ils ont trouvé une arme : les trois principes du peuple. Lorsque les policiers s’apprêtent à les injurier et à les matraquer, les maraîchers ont immédiatement recours pour leur défense aux trois principes du peuple et cela ferme le bec aux policiers.
A Siangtan, une union paysanne d’arrondissement ne voulait pas s’entendre avec une union paysanne de canton ; alors le président de cette dernière proclama : « Nous sommes contre les traités inégaux que veut nous imposer l’union paysanne d’arrondissement ! »
Si la propagande politique a gagné toute la campagne, le mérite en revient entièrement au Parti communiste et aux unions paysannes. Des affiches, des dessins et des prises de parole au contenu facilement accessible, voilà ce qui éduque rapidement et en masse les paysans autant que s’ils s’instruisaient dans une école politique.
D’après les informations transmises par les camarades chargés du travail rural, la propagande politique s’est généralisée à l’occasion de trois meetings de masse : les manifestations antibritanniques, la commémoration de la Révolution d’Octobre et les grandes célébrations de la victoire de l’Expédition du Nord.
Au cours de ces meetings, la propagande politique s’est manifestée partout où il y avait des unions paysannes, mettant en mouvement toute la campagne et donnant de grands résultats. A l’avenir, il faudra veiller à utiliser toutes les possibilités pour donner aux mots d’ordre simples dont j’ai parlé plus haut un contenu toujours plus riche et un sens toujours plus clair.
9. LES INTERDICTIONS PRONONCÉES PAR LES PAYSANS
Dès que les unions paysannes dirigées par le Parti communiste eurent établi leur autorité à la campagne, les paysans se mirent à interdire ou à limiter tout ce qui leur déplaisait. Les cartes, les autres jeux de hasard, l’opium se sont vus interdits de la manière la plus rigoureuse.
Les cartes. Là où les unions paysannes sont puissantes, les jeux de cartes, ainsi que le majong et les dominos, ont été complètement interdits.
Dans le VIVe arrondissement du district de Sianghsiang, une union paysanne d’arrondissement a fait brûler deux paniers pleins de plaques de majong.
Si vous allez à la campagne, vous verrez qu’on ne joue plus du tout à cela, et ceux qui enfreignent cette interdiction sont immédiatement punis, sans la moindre indulgence.
Les autres jeux de hasard. Ce sont les joueurs autrefois les plus invétérés qui interdisent eux-mêmes les jeux de hasard ; là où la puissance des unions paysannes est grande, les jeux de hasard ont, eux aussi, totalement disparu.
L’opium. Il est rigoureusement interdit de fumer l’opium. Lorsque les unions paysannes eurent donné l’ordre de remettre les pipes à opium, personne ne s’avisa de désobéir. A Liling, un mauvais hobereau qui n’avait pas remis sa pipe a été arrêté et promené dans les villages.
La campagne de « désarmement » des fumeurs d’opium menée par les paysans ne le cède nullement, par sa rigueur, à la campagne de désarmement des troupes de Wou Pei-fou et de Souen Tchouan-fang par l’Armée de l’Expédition du Nord. Les « wansouei » (c’est ainsi que les despotes locaux appellent par dérision les paysans) ont « désarmé », dans les familles des officiers de l’armée révolutionnaire, beaucoup de vieillards respectés, fumeur d’opium invétérés, qui ne pouvaient se passer de leur pipe.
Les « wansouei » n’interdisent pas seulement de semer le pavot et de fumer l’opium, mais également de le transporter. De grandes quantités d’opium transportées de la province de Kouietcheou dans celle de Kiangsi en passant par Paoking, Sianghsiang, Yeouhsien et Liling ont été interceptées et brûlées.
Mais cela a diminué les revenus du gouvernement. Finalement, l’union paysanne de province, tenant compte de la nécessite d’obtenir des fonds pour assurer le ravitaillement de l’Armée de l’Expédition du Nord, a ordonné aux unions paysannes de base de « différer provisoirement l’interdiction de transporter l’opium ». Les paysans en ont toutefois été fort mécontents.
Ces interdictions et ces limitations ne sont pas les seules, il en existe bien d’autres. Nous en citerons quelques-unes :
Le « houakou ». Ce sont les représentations théâtrales indécentes. Elles sont interdites en bien des endroits.
Les palanquins. Dans beaucoup de districts, et en particulier à Sianghsiang, on a constaté des cas d’agression contre les palanquins. Les paysans détestent qu’on se serve de palanquins, et ils sont toujours prêts à les mettre en pièces, mais les unions paysannes le leur interdisent.
Les hommes des unions paysannes expliquent aux paysans : « En vous attaquant aux palanquins, vous permettez seulement aux riches d’économiser de l’argent et vous condamner au chômage les porteurs. A qui faites-vous du tort, sinon à vous-mêmes ? » Les paysans ont très bien compris et ils ont imaginé un autre moyen de punir les richards : ils ont considérablement élevé le tarif des porteurs de palanquins.
La fabrication des alcools et du sucre. Partout, les paysans ont interdit d’utiliser les céréales à la fabrication des alcools et du sucre, ce qui a provoqué les plaintes incessantes des distillateurs et des raffineurs de sucre. A Foutienpou, district de Hengchan, on n’a pas interdit la fabrication d’alcool, mais son prix de vente a été fixé si bas que les fabricants de vins et spiritueux n’y trouvant plus de profits, se sont vus obligés d’y renoncer.
Les porcs. Le nombre de porcs que chaque famille peut élever a été limité, car il faut du grain pour les nourrir.
Les poules et les canards. A Sianghsiang, l’élevage des poules et des canards a été interdit, mais les femmes ont protesté. A Yangtang, district de Hengchan, on n’autorise que trois poules ou canards par foyer, et à Foutienpou cinq. Dans bien des endroits, l’élevage du canard est absolument interdit, car non seulement ils consomment le grain, mais encore détruisent les pousses de riz, ils sont donc pires que les poules.
Les festins. Les riches festins sont partout interdits. A Chaochan, district de Siangtan, il a été décidé que les hôtes ne prendraient que des plats de poulet, de poisson et de porc. Il est interdit de servir des plats préparés avec des pousses de bambou, des laminaires et du vermicelle méridional.
Dans le district de Hengchen, le nombre des plats à chaque festin ne doit pas dépasser huit. Dans le IIIe arrondissement Est du district de Liling, il est permis de servir seulement cinq plats ; dans le IIe arrondissement Nord, trois plats de viande et trois plats de légumes ; dans le IIIe arrondissement Ouest, les banquets de Nouvel An sont interdits.
Dans le district de Sianghsiang, il est interdit de servir un « banquet gâteaux aux œufs », bien que ce ne soit nullement là un festin somptueux. Lorsqu’une famille du IIe arrondissement de Sianghsiang a donné un pareil banquet pour le mariage du fils, un groupe de paysans a fait irruption dans la demeure de celui qui enfreignait ainsi le règlement et a fait interrompre la fête. Dans le bourg de Kiamo, district de Sianghsiang, on s’abstient de mets recherchés et, pour les sacrifices aux ancêtres, on n’offre que des fruits.
Les bovins. Les bovins sont un trésor pour les paysans. L’aphorisme « Qui tue un bœuf sera un bœuf dans la vie future », est devenu littéralement un précepte religieux ; il ne faut donc jamais abattre un bœuf. Avant que les paysans n’arrivent au pouvoir, ils ne pouvaient que recourir au précepte religieux pour s’opposer à l’abattage des bovins, ils n’avaient pas d’autres moyens de l’interdire.
Lorsque les unions paysannes ont grandi en autorité, elles ont même étendu leur contrôle aux bovins et en ont interdit l’abattage à la ville. Sur les six boucheries établies dans le chef-lieu de Siangtan, cinq sont maintenant fermées et la seule qui reste ne vend que de la viande de buffles ou de bœufs abattus parce qu’ils étaient devenus trop faibles ou impropres au travail. Dans tout le district de Hengchan, l’abattage des bovins est rigoureusement interdit.
Ainsi, le bœuf d’un paysan s’étant cassé une patte, celui-ci n’osa pas l’abattre sans avoir reçu l’autorisation de l’union paysanne. Lorsque la Cambre de Commerce de Tchoutcheou, sans réfléchir aux conséquences, fit égorger un bœuf, les paysans vinrent à la ville et demandèrent des explications ; la Chambre de Commerce dut payer une amende et s’excuser en faisant partir des pétards.
Le vagabondage. A Liling, il est interdit d’aller demander l’aumône de maison en maison en célébrant le Nouvel An ou les divinités locales, ou bien en chantant au son des claquettes. Dans divers autres districts, personne ne pratique plus cette sorte de mendicité, soit qu’elle ait été interdite, soit qu’elle ait disparu d’elle-même.
Les « mendiants-extorqueurs » ou « vagabonds », qui se montraient d’ordinaire très agressifs, ont dû désormais s’incliner devant l’autorité des unions paysannes. A Chaochan, district de Siangtan, les vagabonds avaient fait d’un temple du dieu de la Pluie leur repaire habituel, où ils ne reconnaissaient aucune autorité ; depuis l’apparition des unions paysannes, ils sont tous partis en douce. Dans le même district, l’union paysanne du canton de Houti a arrêté trois vagabonds et les a forcés à charrier de l’argile pour faire cuire des briques. Des résolutions ont aussi été votées, interdisant les ruineuses coutumes liées aux visites de Nouvel An.
En outre, on a prononcé en différents endroits toute une série d’interdictions d’ordre mineur : dans le district de Liling, par exemple, on a interdit d’organiser des processions et de brûler de l’encens en l’honneur du dieu de la Peste, d’acheter des friandises et des fruits pour en faire des présents rituels, de brûler des vêtements de papier le jour de la Fête des Morts pour apaiser les revenants et de coller sur les portes, à la Nouvelle Année, l’image des divinités qui protègent la maison.
Dans la localité de Kouchouei, district de Sianghsiang, on a interdit l’usage de la pipe à eau. Dans le IIe arrondissement du même district, il est défendu de faire usage des pétards et de la fusée à trois charges ; dans le premier cas, l’amende est de 1,20 yuan et dans le second de 2,40 yuans.
La pratique des rites religieux a été interdite dans les VIIe et XXe arrondissements, les présents en argent pour les enterrements l’ont été également dans le XVIIIe arrondissement. On peut désigner tout cela du terme général d’interdictions paysannes et il y a en tant qu’il est impossible de les énumérer toutes.
Ces interdictions revêtent une grande importance à un double titre : premièrement, elles représentent une révolte contre les habitudes sociales nuisibles, telles que les jeux de cartes, les autres jeux de hasard et l’opium, habitudes qui sont nées du milieu politique corrompu de la classe des propriétaires fonciers et disparaissent avec la chute de leur autorité.
Deuxièmement, elles sont une forme d’autodéfense contre l’exploitation par les négociants des villes, par exemple, l’interdiction de faire des festins, d’acheter des friandises et des fruits pour en faire des présents rituels, etc. Le prix des produits industriels étant très élevé et celui des produits agricoles très bas, les paysans sont appauvris et exploités sans pitié par les commerçants ; pour se défendre, ils sont obligés de se restreindre en tout.
Quant à l’interdiction des sorties de grains, elle s’explique par le fait que les paysans pauvres, n’ayant pas assez de grains eux-mêmes, sont obligés d’en acheter sur le marché ; aussi veulent-ils empêcher la hausse de ce produit. Tout cela provient du dénuement des paysans et des contradictions entre la ville et la campagne, mais ne signifie nullement que les paysans boycottent les produits industriels ou se refusent à commercer avec la ville par attachement à ce qu’on appelle la théorie de la civilisation orientale.
Afin de défendre leurs intérêts économiques, les paysans doivent créer des coopératives de consommation pour l’achat en commun de marchandises. L’aide du gouvernement leur est également nécessaire pour que les unions paysannes puissent créer des coopératives de crédit (de prêt).
Alors, bien entendu, les paysans n’auront plus besoin de recourir à l’interdiction des sorties de grains pour en empêcher la hausse, ni de lutter pour protéger leurs intérêts économiques contre l’afflux de certains produits industriels à la campagne.
10. LA SUPPRESSION DU BANDITISME
Je crois que jamais la Chine, depuis Yu, Tang, Wen et Wou jusqu’aux empereurs des Tsing et aux présidents de la République, il n’y a eu de gouvernants disposant d’autant de pouvoir pour liquider le banditisme que les unions paysannes en ont aujourd’hui.
Là où celles-ci sont fortes, il n’y a plus trace de bandits. Il est remarquable qu’en bien des endroits, on ne voit même plus de maraudeurs de légumes. Par-ci par-là, on peut encore trouver des voleurs, mais le banditisme a complètement disparu dans tous les districts où je me suis rendu, même dans ceux qui étaient autrefois infestés de bandits.
Cela s’explique par les raisons suivantes :
1. Les bandits ne savent plus où se cacher, parce que partout, dans les montagnes et les vallées, il y a des membres des unions paysannes ; au premier appel, « les longues piques » et les « courtes matraques » se réunissent par centaines.
2. Avec le développement du mouvement paysan, le prix du grain a baissé – au printemps dernier, le picul de riz non décortiqué coûtait 6 yuans ; cet hiver est il est descendu à 2 yuans – et le problème du ravitaillement de la population ne se pose plus avec tant de gravité.
3. Les membres des sociétés secrètes sont entrés dans les unions paysannes ; ils y peuvent ouvertement et légalement jouer leur rôle de héros et donner libre cours au mécontentement qui s’était accumulé en eux, de sorte que les organisations secrètes « chan, tang, hsiang, chouei » n’ont plus de raison d’être. En égorgeant les porcs et les moutons des despotes locaux et des mauvais hobereaux et en leur imposant de lourdes contributions et de fortes amendes, ils ont suffisamment l’occasion d’exhaler leur colère contre leurs oppresseurs.
4. Les armées ont recruté un grand nombre de soldats, et de nombreux « hors-la-loi » se sont enrôlés. Ainsi, le banditisme a complètement disparu avec l’essor du mouvement paysan. Même les hobereaux et les riches approuvent cet aspect de l’activité des unions paysannes. Ils disent : « Les unions paysannes ? Il faut reconnaître qu’elles peuvent avoir du bon ».
L’interdiction des cartes, des autres jeux de hasard et de l’opium ainsi que la suppression du banditisme ont valu aux unions paysannes la sympathie générale.
11. L’ABOLITION DES IMPOSITIONS ÉCRASANTES
Aussi longtemps que le pays n’a pas été unifié, que la puissance de l’impérialisme et des seigneurs de guerre n’est pas renversée, il est impossible de débarrasser les paysans du lourd fardeau des contributions d’État, ou, en termes plus explicites, du fardeau des dépenses de guerre de l’armée révolutionnaire.
Néanmoins, avec l’essor du mouvement paysan et la chute de l’autorité des despotes locaux et des mauvais hobereaux, les impositions écrasantes, telles que la contribution foncière, qui pesaient sur les paysans lorsque l’administration rurale était aux mains des despotes locaux et des mauvais hobereaux, ont été abolies ou, à tout le moins, réduites.
Il convient de ranger également cela au nombre des mérites des unions paysannes.
12. LE MOUVEMENT CULTUREL
De tout temps, la culture a été en Chine un privilège des propriétaires fonciers ; les paysans n’y avaient point part. Et pourtant, c’est aux paysans que les propriétaires fonciers doivent leur culture, car tout ce qui la constitue est tiré du sang et de la sueur des paysans. Quatre-vingt-dix pour cent de la population de la Chine n’ont pas accès la culture et n’ont reçu aucune instruction ; et dans ce nombre, les paysans forment l’immense majorité.
Avec la chute du pouvoir des propriétaires fonciers à la campagne a commencé le mouvement culturel des paysans. Voyez comme les paysans prennent à tâche maintenant d‘ouvrir des écoles du soir, eux qui avaient toujours détesté les écoles. Les écoles « à enseignement étranger » n’avaient jamais été bien vues des paysans.
Au temps où je faisais mes études, j’avais l’occasion, lors de mon retour au pays natal, de constater l’opposition des paysans à ces écoles, et il m’arriva d’abonder dans le sens des maîtres et élèves des écoles à « enseignement étranger » et de prendre le parti de celles-ci, ayant toujours l’impression que les paysans avaient plus ou moins tort.
C’est seulement en 1925, après avoir passé six mois à la campagne – j’étais déjà communiste et j’avais adopté le point de vue marxiste – que j’ai compris que c’était moi qui m’étais trompé et que les paysans avaient raison. Dans les écoles primaires rurales, les manuels qu’on employait s’inspiraient entièrement des thèmes propres à la ville et ne répondaient pas aux besoins de la campagne.
Et les instituteurs se comportaient très mal à l’égard des paysans ; au lieu de les aider, ils s’en faisaient détester. C’est pourquoi les paysans préféraient aux écoles modernes (qu’ils qualifiaient d’écoles « à enseignement étranger ») les écoles de type ancien (qu’ils appelaient écoles « chinoises ») ; de même, aux instituteurs des écoles modernes, ils préféraient les instituteurs des écoles de type ancien.
On voit actuellement les paysans créer partout des écoles du soir qu’ils appellent écoles paysannes. Dans certains endroits, elles sont déjà ouvertes, dans d’autres, on se prépare à les ouvrir ; en moyenne, on en compte une par canton. Les paysans mettent un grand enthousiasme à les créer et elles sont les seules qu’ils considèrent comme les leurs.
Les frais d’entretien des écoles du soir sont pris sur les « revenus de la superstition », sur le produit des temples des ancêtres et sur d’autres recettes et propriétés non affectées. Tous ces fonds, les bureaux d’éducation de district comptaient les utiliser pour les écoles modernes – c’est-à-dire les écoles « à enseignement étranger », qui ne répondaient pas aux besoins des paysans – tandis que les paysans voulaient les employer pour leurs propres écoles.
Après discussion, il a été décidé de partager ces fonds qui, en certains endroits, ont même été entièrement remis aux paysans. Avec le développement du mouvement paysan, le niveau culturel des paysans s’est élevé rapidement.
Le temps n’est pas loin où l’on verra surgir dans la province des dizaines de milliers d’écoles rurales, et ce sera bien autre chose que les bavardages des intellectuels et des « éducateurs » sur « la généralisation de l’instruction » qui, malgré le bruit fait autour d’elle, n’a jamais été que du vent.
13. LE MOUVEMENT COOPÉRATIF
Les paysans on réellement besoin de coopératives, en particulier de coopératives de consommation, de vente et de crédit. Lorsqu’ils achètent des produits, ils sont exploités par les commerçants, lorsqu’ils empruntent de l’argent et du riz, ils le sont encore une fois ; enfin, quand ils empruntent de l’argent ou du riz, ils subissent l’exploitation des usuriers.
C’est pourquoi ils sont vivement intéressés à la solution des problèmes d’achat, de vente et de crédit.
L’hiver dernier, lorsqu’en raison des opérations militaires sur le Yangtsé les relations commerciales furent interrompues et que le prix du sel monta dans le Hounan, les paysans organisèrent en grand nombre de coopératives pour l’achat du sel. Étant donné que les propriétaires fonciers refusaient de prêter aux paysans, on assistait en de nombreux endroits à des tentatives d’organiser des caisses de crédit. Le gros problème est actuellement l’absence d’un statut type détaillé pour de semblables organisations.
Créées localement sur l’initiative des paysans eux-mêmes, souvent elles ne correspondent pas aux principes des coopératives ; c’est pourquoi les camarades qui s’occupent du mouvement paysan réclament avec insistance un statut. S’il bénéficie d’une direction adéquate, le mouvement coopératif s’étendra partout, à mesure que se développeront les unions paysannes.
14. LA RÉPARATION DES ROUTES ET DES LEVÉES DE TERRE
Le mérite de ces travaux revient aussi aux unions paysannes. Avant l’apparition des unions paysannes, les routes étaient extrêmement mauvaises à la campagne. Sans argent il est impossible d’en entreprendre la réfection.
Et comme les riches refusaient de fournir les fonds indispensables, les routes étaient vouées à l’abandon le plus complet. Si on faisait quelques réparations, c’était à titre de bienfaisance : on collectait de petites sommes chez les personnes désireuses de « faire une bonne œuvre qui leur soit comptée dans l’autre monde », et on construisait quelques méchantes routes fort étroites.
Lorsque apparurent les unions paysannes, elle décrétèrent que chaque propriétaire foncier dont les terres étaient en bordure de route devait entreprendre la réfection de celle-ci sur son secteur ; de plus, on fixa selon les besoins, dans chaque cas, la largeur qu’elle devait avoir : trois, cinq, sept ou dix pieds.
Qui oserait refuser d’exécuter un tel ordre ? En peu de temps, on vit apparaître beaucoup de bonnes routes. Et ce n’est pas une œuvre de bienfaisance, mais l’effet de la contrainte. Un peu de contrainte de cet ordre ne fait pas de mal du tout. Il en allait de même des levées de terre.
L’implacable propriétaire foncier ne pensait qu’à extorquer tout ce qu’il pouvait à son fermier et n’aurait jamais fait la moindre dépense pour la réparation des levées de terre ; il aurait condamné les étangs à l’assèchement et les fermiers à la famine, sans se soucier de rien d’autre que d’encaisser le montant des fermages.
Maintenant qu’il y a des unions paysannes, on peut ordonner, sans cérémonie, aux propriétaires fonciers de réparer les levées de terre. Lorsqu’un propriétaire foncier s’y refuse, l’union paysanne lui dit très gentiment : « Très bien, puisque vous ne voulez pas vous charger de la réparation, vous fournirez le riz : un boisseau par homme et par jour ! ».
Mais comme le propriétaire foncier n’y trouverait pas son compte, il se dépêche de faire réparer la levée de terre lui-même. C’est ainsi qu’un grand nombre de levées de terre qui avaient été laissées à l’abandon ont été remises en état.
Telles sont les quatorze conquêtes réalisées par les paysans sous la direction des unions paysannes. Veuillez y réfléchir, amis lecteurs, et dire s’il y a dans tout cela quelque chose qui soit nuisible dans son esprit général et sa portée révolutionnaire. Seuls, je pense, les despotes locaux et les mauvais hobereaux peuvent les considérer comme un mal.
Aussi est-il bien singulier d’apprendre de Nantchang que MM. Tchiang Kaï-chek et Tchang Tsing-kiang désapprouvent vivement les actions entreprises par les paysans du Hounan. Les leaders de droite du Hounan, Lieou Yu-tche et Cie, qui sont du même avis, ont déclaré : « C’est une véritable bolchévisation ! »
Mais sans ce minimum de bolchévisation, comment parler de révolution nationale !
Tous ces appels quotidiens pour « éveiller les masses populaires » et cette terreur mortelle quand celles-ci se réveillent réellement, n’est-ce pas la célèbre histoire de Maître Cheh et son amour pour les dragons.