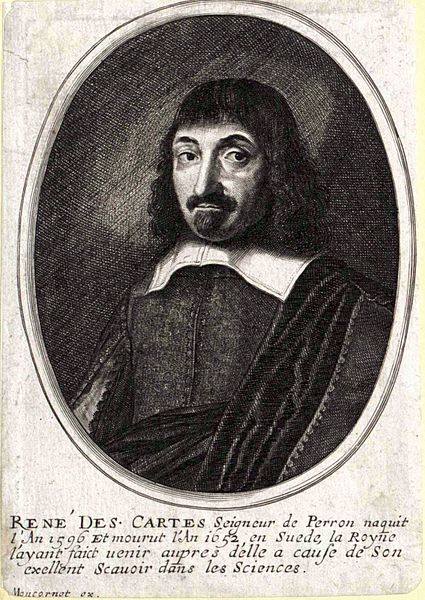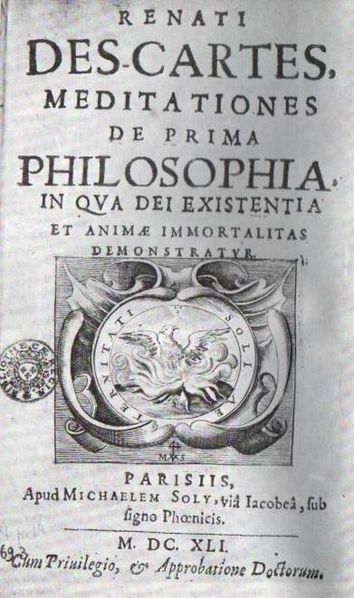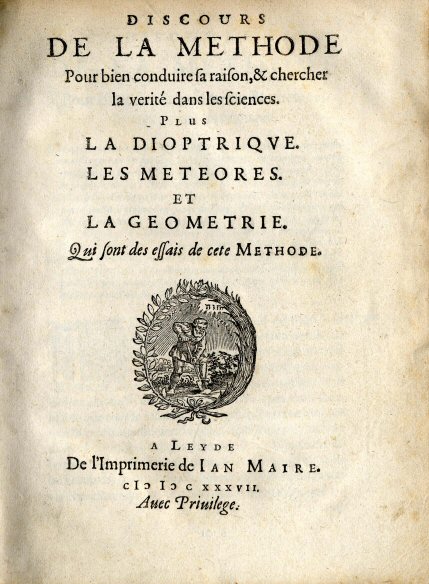Réflexions morales
Nos vertus ne sont, le plus souvent, que des vices déguisés.
1
Ce que nous prenons
pour des vertus n’est souvent qu’un assemblage de diverses actions et
de divers intérêts, que la fortune ou notre industrie savent arranger ;
et ce n’est pas toujours par valeur et par chasteté que les hommes sont
vaillants, et que les femmes sont chastes.
2
L’amour-propre est le plus grand de tous les flatteurs.
3
Quelque découverte que l’on ait faite dans le pays de l’amour-propre, il y reste encore bien des terres inconnues.
4
L’amour-propre est plus habile que le plus habile homme du monde.
5
La durée de nos passions ne dépend pas plus de nous que la durée de notre vie.
6
La passion fait souvent un fou du plus habile homme, et rend souvent les plus sots habiles.
7
Ces grandes et
éclatantes actions qui éblouissent les yeux sont représentées par les
politiques comme les effets des grands desseins, au lieu que ce sont
d’ordinaire les effets de l’humeur et des passions. Ainsi la guerre
d’Auguste et d’Antoine, qu’on rapporte à l’ambition qu’ils avaient de se
rendre maîtres du monde, n’était peut-être qu’un effet de jalousie.
8
Les passions sont
les seuls orateurs qui persuadent toujours. Elles sont comme un art de
la nature dont les règles sont infaillibles ; et l’homme le plus simple
qui a de la passion persuade mieux que le plus éloquent qui n’en a
point.
9
Les passions ont
une injustice et un propre intérêt qui fait qu’il est dangereux de les
suivre, et qu’on s’en doit défier lors même qu’elles paraissent les plus
raisonnables.
10
Il y a dans le
cœur humain une génération perpétuelle de passions, en sorte que la
ruine de l’une est presque toujours l’établissement d’une autre.
11
Les passions en
engendrent souvent qui leur sont contraires. L’avarice produit
quelquefois la prodigalité, et la prodigalité l’avarice ; on est souvent
ferme par faiblesse, et audacieux par timidité.
12
Quelque soin que
l’on prenne de couvrir ses passions par des apparences de piété et
d’honneur, elles paraissent toujours au travers de ces voiles.
13
Notre amour-propre souffre plus impatiemment la condamnation de nos goûts que de nos opinions.
14
Les hommes ne
sont pas seulement sujets à perdre le souvenir des bienfaits et des
injures ; ils haïssent même ceux qui les ont obligés, et cessent de haïr
ceux qui leur ont fait des outrages. L’application à récompenser le
bien, et à se venger du mal, leur paraît une servitude à laquelle ils
ont peine de se soumettre.
15
La clémence des princes n’est souvent qu’une politique pour gagner l’affection des peuples.
16
Cette clémence
dont on fait une vertu se pratique tantôt par vanité, quelquefois par
paresse, souvent par crainte, et presque toujours par tous les trois
ensemble.
17
La modération des personnes heureuses vient du calme que la bonne fortune donne à leur humeur.
18
La modération est
une crainte de tomber dans l’envie et dans le mépris que méritent ceux
qui s’enivrent de leur bonheur ; c’est une vaine ostentation de la force
de notre esprit ; et enfin la modération des hommes dans leur plus
haute élévation est un désir de paraître plus grands que leur fortune.
19
Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d’autrui.
20
La constance des sages n’est que l’art de renfermer leur agitation dans le cœur.
21
Ceux qu’on
condamne au supplice affectent quelquefois une constance et un mépris de
la mort qui n’est en effet que la crainte de l’envisager. De sorte
qu’on peut dire que cette constance et ce mépris sont à leur esprit ce
que le bandeau est à leurs yeux.
22
La philosophie triomphe aisément des maux passés et des maux à venir. Mais les maux présents triomphent d’elle.
23
Peu de gens
connaissent la mort. On ne la souffre pas ordinairement par résolution,
mais par stupidité et par coutume ; et la plupart des hommes meurent
parce qu’on ne peut s’empêcher de mourir.
24
Lorsque les
grands hommes se laissent abattre par la longueur de leurs infortunes,
ils font voir qu’ils ne les soutenaient que par la force de leur
ambition, et non par celle de leur âme, et qu’à une grande vanité près
les héros sont faits comme les autres hommes.
25
Il faut de plus grandes vertus pour soutenir la bonne fortune que la mauvaise.
26
Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement.
27
On fait souvent
vanité des passions même les plus criminelles ; mais l’envie est une
passion timide et honteuse que l’on n’ose jamais avouer.
28
La jalousie est
en quelque manière juste et raisonnable, puisqu’elle ne tend qu’à
conserver un bien qui nous appartient, ou que nous croyons nous
appartenir ; au lieu que l’envie est une fureur qui ne peut souffrir le
bien des autres.
29
Le mal que nous faisons ne nous attire pas tant de persécution et de haine que nos bonnes qualités.
30
Nous avons plus
de force que de volonté ; et c’est souvent pour nous excuser à
nous-mêmes que nous nous imaginons que les choses sont impossibles.
31
Si nous n’avions point de défauts, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer dans les autres.
32
La jalousie se nourrit dans les doutes, et elle devient fureur, ou elle finit, sitôt qu’on passe du doute à la certitude.
33
L’orgueil se dédommage toujours et ne perd rien lors même qu’il renonce à la vanité
34
Si nous n’avions point d’orgueil, nous ne nous plaindrions pas de celui des autres.
35
L’orgueil est égal dans tous les hommes, et il n’y a de différence qu’aux moyens et à la manière de le mettre au jour.
36
Il semble que la
nature, qui a si sagement disposé les organes de notre corps pour nous
rendre heureux ; nous ait aussi donné l’orgueil pour nous épargner la
douleur de connaître nos imperfections.
37
L’orgueil a plus
de part que la bonté aux remontrances que nous faisons à ceux qui
commettent des fautes ; et nous ne les reprenons pas tant pour les en
corriger que pour leur persuader que nous en sommes exempts.
38
Nous promettons selon nos espérances, et nous tenons selon nos craintes.
39
L’intérêt parle toutes sortes de langues, et joue toutes sortes de personnages, même celui de désintéressé.
40
L’intérêt, qui aveugle les uns, fait la lumière des autres.
41
Ceux qui s’appliquent trop aux petites choses deviennent ordinairement incapables des grandes.
42
Nous n’avons pas assez de force pour suivre toute notre raison.
43
L’homme croit
souvent se conduire lorsqu’il est conduit ; et pendant que par son
esprit il tend à un but, son cœur l’entraîne insensiblement à un autre.
44
La force et la
faiblesse de l’esprit sont mal nommées ; elles ne sont en effet que la
bonne ou la mauvaise disposition des organes du corps.
45
Le caprice de notre humeur est encore plus bizarre que celui de la fortune.
46
L’attachement ou
l’indifférence que les philosophes avaient pour la vie n’était qu’un
goût de leur amour-propre, dont on ne doit non plus disputer que du goût
de la langue ou du choix des couleurs.
47
Notre humeur met le prix à tout ce qui nous vient de la fortune.
48
La félicité est
dans le goût et non pas dans les choses ; et c’est par avoir ce qu’on
aime qu’on est heureux, et non par avoir ce que les autres trouvent
aimable.
49
On n’est jamais si heureux ni si malheureux qu’on s’imagine.
50
Ceux qui croient
avoir du mérite se font un honneur d’être malheureux, pour persuader aux
autres et à eux-mêmes qu’ils sont dignes d’être en butte à la fortune.
51
Rien ne doit tant
diminuer la satisfaction que nous avons de nous-mêmes, que de voir que
nous désapprouvons dans un temps ce que nous approuvions dans un autre.
52
Quelque
différence qui paraisse entre les fortunes, il y a néanmoins une
certaine compensation de biens et de maux qui les rend égales.
53
Quelques grands avantages que la nature donne, ce n’est pas elle seule, mais la fortune avec elle qui fait les héros.
54
Le mépris des
richesses était dans les philosophes un désir caché de venger leur
mérite de l’injustice de la fortune par le mépris des mêmes biens dont
elle les privait ; c’était un secret pour se garantir de l’avilissement
de la pauvreté ; c’était un chemin détourné pour aller à la
considération qu’ils ne pouvaient avoir par les richesses.
55
La haine pour les
favoris n’est autre chose que l’amour de la faveur. Le dépit de ne la
pas posséder se console et s’adoucit par le mépris que l’on témoigne de
ceux qui la possèdent ; et nous leur refusons nos hommages, ne pouvant
pas leur ôter ce qui leur attire ceux de tout le monde.
56
Pour s’établir dans le monde, on fait tout ce que l’on peut pour y paraître établi.
57
Quoique les
hommes se flattent de leurs grandes actions, elles ne sont pas souvent
les effets d’un grand dessein, mais des effets du hasard.
58
Il semble que nos
actions aient des étoiles heureuses ou malheureuses à qui elles doivent
une grande partie de la louange et du blâme qu’on leur donne.
59
Il n’y a point
d’accidents si malheureux dont les habiles gens ne tirent quelque
avantage, ni de si heureux que les imprudents ne puissent tourner à leur
préjudice.
60
La fortune tourne tout à l’avantage de ceux qu’elle favorise.
61
Le bonheur et le malheur des hommes ne dépend pas moins de leur humeur que de la fortune.
62
La sincérité est
une ouverture de cœur. On la trouve en fort peu de gens ; et celle que
l’on voit d’ordinaire n’est qu’une fine dissimulation pour attirer la
confiance des autres.
63
L’aversion du
mensonge est souvent une imperceptible ambition de rendre nos
témoignages considérables, et d’attirer à nos paroles un respect de
religion.
64
La vérité ne fait pas tant de bien dans le monde que ses apparences y font de mal.
65
Il n’y a point d’éloges qu’on ne donne à la prudence. Cependant elle ne saurait nous assurer du moindre événement.
66
Un habile homme
doit régler le rang de ses intérêts et les conduire chacun dans son
ordre. Notre avidité le trouble souvent en nous faisant courir à tant de
choses à la fois que, pour désirer trop les moins importantes, on
manque les plus considérables.
67
La bonne grâce est au corps ce que le bon sens est à l’esprit.
68
Il est difficile
de définir l’amour. Ce qu’on en peut dire est que dans l’âme c’est une
passion de régner, dans les esprits c’est une sympathie, et dans le
corps ce n’est qu’une envie cachée et délicate de posséder ce que l’on
aime après beaucoup de mystères.
69
S’il y a un amour
pur et exempt du mélange de nos autres passions, c’est celui qui est
caché au fond du cœur, et que nous ignorons nous-mêmes.
70
Il n’y a point de déguisement qui puisse longtemps cacher l’amour où il est, ni le feindre où il n’est pas.
71
Il n’y a guère de gens qui ne soient honteux de s’être aimés quand ils ne s’aiment plus.
72
Si on juge de l’amour par la plupart de ses effets, il ressemble plus à la haine qu’à l’amitié.
73
On peut trouver des femmes qui n’ont jamais eu de galanterie ; mais il est rare d’en trouver qui n’en aient jamais eu qu’une.
74
Il n’y a que d’une sorte d’amour, mais il y en a mille différentes copies.
75
L’amour aussi
bien que le feu ne peut subsister sans un mouvement continuel ; et il
cesse de vivre dès qu’il cesse d’espérer ou de craindre.
76
Il est du véritable amour comme de l’apparition des esprits : tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu.
77
L’amour prête son
nom à un nombre infini de commerces qu’on lui attribue, et où il n’a
non plus de part que le Doge à ce qui se fait à Venise.
78
L’amour de la justice n’est en la plupart des hommes que la crainte de souffrir l’injustice.
79
Le silence est le parti le plus sûr de celui qui se défie de soi-même.
80
Ce qui nous rend
si changeants dans nos amitiés, c’est qu’il est difficile de connaître
les qualités de l’âme, et facile de connaître celles de l’esprit.
81
Nous ne pouvons
rien aimer que par rapport à nous, et nous ne faisons que suivre notre
goût et notre plaisir quand nous préférons nos amis à nous-mêmes ; c’est
néanmoins par cette préférence seule que l’amitié peut être vraie et
parfaite.
82
La réconciliation
avec nos ennemis n’est qu’un désir de rendre notre condition meilleure,
une lassitude de la guerre, et une crainte de quelque mauvais
événement.
83
Ce que les hommes
ont nommé amitié n’est qu’une société, qu’un ménagement réciproque
d’intérêts, et qu’un échange de bons offices ; ce n’est enfin qu’un
commerce où l’amour-propre se propose toujours quelque chose à gagner.
84
Il est plus honteux de se défier de ses amis que d’en être trompé.
85
Nous nous
persuadons souvent d’aimer les gens plus puissants que nous ; et
néanmoins c’est l’intérêt seul qui produit notre amitié. Nous ne nous
donnons pas à eux pour le bien que nous leur voulons faire, mais pour
celui que nous en voulons recevoir.
86
Notre défiance justifie la tromperie d’autrui.
87
Les hommes ne vivraient pas longtemps en société s’ils n’étaient les dupes les uns des autres.
88
L’amour-propre
nous augmente ou nous diminue les bonnes qualités de nos amis à
proportion de la satisfaction que nous avons d’eux ; et nous jugeons de
leur mérite par la manière dont ils vivent avec nous.
89
Tout le monde se plaint de sa mémoire, et personne ne se plaint de son jugement.
90
Nous plaisons plus souvent dans le commerce de la vie par nos défauts que par nos bonnes qualités.
91
La plus grande
ambition n’en a pas la moindre apparence lorsqu’elle se rencontre dans
une impossibilité absolue d’arriver où elle aspire.
92
Détromper un
homme préoccupé de son mérite est lui rendre un aussi mauvais office que
celui que l’on rendit à ce fou d’Athènes, qui croyait que tous les
vaisseaux qui arrivaient dans le port étaient à lui.
93
Les vieillards aiment à donner de bons préceptes, pour se consoler de n’être plus en état de donner de mauvais exemples.
94
Les grands noms abaissent, au lieu d’élever, ceux qui ne les savent pas soutenir.
95
La marque d’un mérite extraordinaire est de voir que ceux qui l’envient le plus sont contraints de le louer.
96
Tel homme est ingrat, qui est moins coupable de son ingratitude que celui qui lui a fait du bien.
97
On s’est trompé
lorsqu’on a cru que l’esprit et le jugement étaient deux choses
différentes. Le jugement n’est que la grandeur de la lumière de
l’esprit ; cette lumière pénètre le fond des choses ; elle y remarque
tout ce qu’il faut remarquer et aperçoit celles qui semblent
imperceptibles. Ainsi il faut demeurer d’accord que c’est l’étendue de
la lumière de l’esprit qui produit tous les effets qu’on attribue au
jugement.
98
Chacun dit du bien de son cœur, et personne n’en ose dire de son esprit.
99
La politesse de l’esprit consiste à penser des choses honnêtes et délicates.
100
La galanterie de l’esprit est de dire des choses flatteuses d’une manière agréable.
101
Il arrive souvent que des choses se présentent plus achevées à notre esprit qu’il ne les pourrait faire avec beaucoup d’art.
102
L’esprit est toujours la dupe du cœur.
103
Tous ceux qui connaissent leur esprit ne connaissent pas leur cœur.
104
Les hommes et
les affaires ont leur point de perspective. Il y en a qu’il faut voir de
près pour en bien juger, et d’autres dont on ne juge jamais si bien que
quand on en est éloigné.
105
Celui-là n’est
pas raisonnable à qui le hasard fait trouver la raison, mais celui qui
la connaît, qui la discerne, et qui la goûte.
106
Pour bien
savoir les choses, il en faut savoir le détail ; et comme il est presque
infini, nos connaissances sont toujours superficielles et imparfaites.
107
C’est une espèce de coquetterie de faire remarquer qu’on n’en fait jamais.
108
L’esprit ne saurait jouer longtemps le personnage du cœur.
109
La jeunesse change ses goûts par l’ardeur du sang, et la vieillesse conserve les siens par l’accoutumance.
110
On ne donne rien si libéralement que ses conseils.
111
Plus on aime une maîtresse, et plus on est près de la haïr.
112
Les défauts de l’esprit augmentent en vieillissant comme ceux du visage.
113
Il y a de bons mariages, mais il n’y en a point de délicieux.
114
On ne se peut
consoler d’être trompé par ses ennemis, et trahi par ses amis ; et l’on
est souvent satisfait de l’être par soi-même.
115
Il est aussi
facile de se tromper soi-même sans s’en apercevoir qu’il est difficile
de tromper les autres sans qu’ils s’en aperçoivent.
116
Rien n’est
moins sincère que la manière de demander et de donner des conseils.
Celui qui en demande paraît avoir une déférence respectueuse pour les
sentiments de son ami, bien qu’il ne pense qu’à lui faire approuver les
siens, et à le rendre garant de sa conduite. Et celui qui conseille paye
la confiance qu’on lui témoigne d’un zèle ardent et désintéressé,
quoiqu’il ne cherche le plus souvent dans les conseils qu’il donne que
son propre intérêt ou sa gloire.
117
La plus subtile
de toutes les finesses est de savoir bien feindre de tomber dans les
pièges que l’on nous tend, et on n’est jamais si aisément trompé que
quand on songe à tromper les autres.
118
L’intention de ne jamais tromper nous expose à être souvent trompés.
119
Nous sommes si accoutumés à nous déguiser aux autres qu’enfin nous nous déguisons à nous-mêmes.
120
L’on fait plus souvent des trahisons par faiblesse que par un dessein formé de trahir.
121
On fait souvent du bien pour pouvoir impunément faire du mal.
122
Si nous résistons à nos passions, c’est plus par leur faiblesse que par notre force.
123
On n’aurait guère de plaisir si on ne se flattait jamais.
124
Les plus
habiles affectent toute leur vie de blâmer les finesses pour s’en servir
en quelque grande occasion et pour quelque grand intérêt.
125
L’usage
ordinaire de la finesse est la marque d’un petit esprit, et il arrive
presque toujours que celui qui s’en sert pour se couvrir en un endroit,
se découvre en un autre.
126
Les finesses et les trahisons ne viennent que de manque d’habileté.
127
Le vrai moyen d’être trompé, c’est de se croire plus fin que les autres.
128
La trop grande subtilité est une fausse délicatesse, et la véritable délicatesse est une solide subtilité.
129
Il suffit quelquefois d’être grossier pour n’être pas trompé par un habile homme.
130
La faiblesse est le seul défaut que l’on ne saurait corriger.
131
Le moindre défaut des femmes qui se sont abandonnées à faire l’amour, c’est de faire l’amour.
132
Il est plus aisé d’être sage pour les autres que de l’être pour soi-même.
133
Les seules bonnes copies sont celles qui nous font voir le ridicule des méchants originaux.
134
On n’est jamais si ridicule par les qualités que l’on a que par celles que l’on affecte d’avoir.
135
On est quelquefois aussi différent de soi-même que des autres.
136
Il y a des gens qui n’auraient jamais été amoureux s’ils n’avaient jamais entendu parler de l’amour.
137
On parle peu quand la vanité ne fait pas parler.
138
On aime mieux dire du mal de soi-même que de n’en point parler.
139
Une des choses
qui fait que l’on trouve si peu de gens qui paraissent raisonnables et
agréables dans la conversation, c’est qu’il n’y a presque personne qui
ne pense plutôt à ce qu’il veut dire qu’à répondre précisément à ce
qu’on lui dit. Les plus habiles et les plus complaisants se contentent
de montrer seulement une mine attentive, au même temps que l’on voit
dans leurs yeux et dans leur esprit un égarement pour ce qu’on leur dit,
et une précipitation pour retourner à ce qu’ils veulent dire ; au lieu
de considérer que c’est un mauvais moyen de plaire aux autres ou de les
persuader, que de chercher si fort à se plaire à soi-même, et que bien
écouter et bien répondre est une des plus grandes perfections qu’on
puisse avoir dans la conversation.
140
Un homme d’esprit serait souvent bien embarrassé sans la compagnie des sots.
141
Nous nous
vantons souvent de ne nous point ennuyer ; et nous sommes si glorieux
que nous ne voulons pas nous trouver de mauvaise compagnie.
142
Comme c’est le
caractère des grands esprits de faire entendre en peu de paroles
beaucoup de choses, les petits esprits au contraire ont le don de
beaucoup parler, et de ne rien dire.
143
C’est plutôt
par l’estime de nos propres sentiments que nous exagérons les bonnes
qualités des autres, que par l’estime de leur mérite ; et nous voulons
nous attirer des louanges, lorsqu’il semble que nous leur en donnons.
144
On n’aime point
à louer, et on ne loue jamais personne sans intérêt. La louange est une
flatterie habile, cachée, et délicate, qui satisfait différemment celui
qui la donne, et celui qui la reçoit. L’un la prend comme une
récompense de son mérite ; l’autre la donne pour faire remarquer son
équité et son discernement.
145
Nous
choisissons souvent des louanges empoisonnées qui font voir par
contrecoup en ceux que nous louons des défauts que nous n’osons
découvrir d’une autre sorte.
146
On ne loue d’ordinaire que pour être loué.
147
Peu de gens sont assez sages pour préférer le blâme qui leur est utile à la louange qui les trahit.
148
Il y a des reproches qui louent, et des louanges qui médisent.
149
Le refus des louanges est un désir d’être loué deux fois.
150
Le désir de
mériter les louanges qu’on nous donne fortifie notre vertu ; et celles
que l’on donne à l’esprit, à la valeur, et à la beauté contribuent à les
augmenter.
151
Il est plus difficile de s’empêcher d’être gouverné que de gouverner les autres.
152
Si nous ne nous flattions point nous-mêmes, la flatterie des autres ne nous pourrait nuire.
153
La nature fait le mérite, et la fortune le met en œuvre.
154
La fortune nous corrige de plusieurs défauts que la raison ne saurait corriger.
155
Il y a des gens dégoûtants avec du mérite, et d’autres qui plaisent avec des défauts.
156
Il y a des gens
dont tout le mérite consiste à dire et à faire des sottises utilement,
et qui gâteraient tout s’ils changeaient de conduite.
157
La gloire des grands hommes se doit toujours mesurer aux moyens dont ils se sont servis pour l’acquérir.
158
La flatterie est une fausse monnaie qui n’a de cours que par notre vanité.
159
Ce n’est pas assez d’avoir de grandes qualités ; il en faut avoir l’économie.
160
Quelque éclatante que soit une action, elle ne doit pas passer pour grande lorsqu’elle n’est pas l’effet d’un grand dessein.
161
Il doit y avoir
une certaine proportion entre les actions et les desseins si on en veut
tirer tous les effets qu’elles peuvent produire.
162
L’art de savoir
bien mettre en œuvre de médiocres qualités dérobe l’estime et donne
souvent plus de réputation que le véritable mérite.
163
Il y a une infinité de conduites qui paraissent ridicules, et dont les raisons cachées sont très sages et très solides.
164
Il est plus facile de paraître digne des emplois qu’on n’a pas que de ceux que l’on exerce.
165
Notre mérite nous attire l’estime des honnêtes gens, et notre étoile celle du public.
166
Le monde récompense plus souvent les apparences du mérite que le mérite même.
167
L’avarice est plus opposée à l’économie que la libéralité.
168
L’espérance, toute trompeuse qu’elle est, sert au moins à nous mener à la fin de la vie par un chemin agréable.
169
Pendant que la paresse et la timidité nous retiennent dans notre devoir, notre vertu en a souvent tout l’honneur.
170
Il est difficile de juger si un procédé net, sincère et honnête est un effet de probité ou d’habileté.
171
Les vertus se perdent dans l’intérêt, comme les fleuves se perdent dans la mer.
172
Si on examine bien les divers effets de l’ennui, on trouvera qu’il fait manquer à plus de devoirs que l’intérêt.
173
Il y a diverses
sortes de curiosité : l’une d’intérêt, qui nous porte à désirer
d’apprendre ce qui nous peut être utile, et l’autre d’orgueil, qui vient
du désir de savoir ce que les autres ignorent.
174
Il vaut mieux employer notre esprit à supporter les infortunes qui nous arrivent qu’à prévoir celles qui nous peuvent arriver.
175
La constance en
amour est une inconstance perpétuelle, qui fait que notre cœur
s’attache successivement à toutes les qualités de la personne que nous
aimons, donnant tantôt la préférence à l’une, tantôt à l’autre ; de
sorte que cette constance n’est qu’une inconstance arrêtée et renfermée
dans un même sujet.
176
Il y a deux
sortes de constance en amour : l’une vient de ce que l’on trouve sans
cesse dans la personne que l’on aime de nouveaux sujets d’aimer, et
l’autre vient de ce que l’on se fait un honneur d’être constant.
177
La persévérance
n’est digne ni de blâme ni de louange, parce qu’elle n’est que la durée
des goûts et des sentiments, qu’on ne s’ôte et qu’on ne se donne point.
178
Ce qui nous
fait aimer les nouvelles connaissances n’est pas tant la lassitude que
nous avons des vieilles ou le plaisir de changer, que le dégoût de
n’être pas assez admirés de ceux qui nous connaissent trop, et
l’espérance de l’être davantage de ceux qui ne nous connaissent pas
tant.
179
Nous nous plaignons quelquefois légèrement de nos amis pour justifier par avance notre légèreté.
180
Notre repentir n’est pas tant un regret du mal que nous avons fait, qu’une crainte de celui qui nous en peut arriver.
181
Il y a une
inconstance qui vient de la légèreté de l’esprit ou de sa faiblesse, qui
lui fait recevoir toutes les opinions d’autrui, et il y en a une autre,
qui est plus excusable, qui vient du dégoût des choses.
182
Les vices
entrent dans la composition des vertus comme les poisons entrent dans la
composition des remèdes. La prudence les assemble et les tempère, et
elle s’en sert utilement contre les maux de la vie.
183
Il faut
demeurer d’accord à l’honneur de la vertu que les plus grands malheurs
des hommes sont ceux où ils tombent par les crimes.
184
Nous avouons nos défauts pour réparer par notre sincérité le tort qu’ils nous font dans l’esprit des autres.
185
Il y a des héros en mal comme en bien.
186
On ne méprise pas tous ceux qui ont des vices ; mais on méprise tous ceux qui n’ont aucune vertu.
187
Le nom de la vertu sert à l’intérêt aussi utilement que les vices.
188
La santé de
l’âme n’est pas plus assurée que celle du corps ; et quoique l’on
paraisse éloigné des passions, on n’est pas moins en danger de s’y
laisser emporter que de tomber malade quand on se porte bien.
189
Il semble que la nature ait prescrit à chaque homme dès sa naissance des bornes pour les vertus et pour les vices.
190
Il n’appartient qu’aux grands hommes d’avoir de grands défauts.
191
On peut dire
que les vices nous attendent dans le cours de la vie comme des hôtes
chez qui il faut successivement loger ; et je doute que l’expérience
nous les fît éviter s’il nous était permis de faire deux fois le même
chemin.
192
Quand les vices nous quittent, nous nous flattons de la créance que c’est nous qui les quittons.
193
Il y a des
rechutes dans les maladies de l’âme, comme dans celles du corps. Ce que
nous prenons pour notre guérison n’est le plus souvent qu’un relâche ou
un changement de mal.
194
Les défauts de
l’âme sont comme les blessures du corps : quelque soin qu’on prenne de
les guérir, la cicatrice paraît toujours, et elles sont à tout moment en
danger de se rouvrir.
195
Ce qui nous empêche souvent de nous abandonner à un seul vice est que nous en avons plusieurs.
196
Nous oublions aisément nos fautes lorsqu’elles ne sont sues que de nous.
197
Il y a des gens
de qui l’on peut ne jamais croire du mal sans l’avoir vu ; mais il n’y
en a point en qui il nous doive surprendre en le voyant.
198
Nous élevons la
gloire des uns pour abaisser celle des autres. Et quelquefois on
louerait moins Monsieur le Prince et M. de Turenne si on ne les voulait
point blâmer tous deux.
199
Le désir de paraître habile empêche souvent de le devenir.
200
La vertu n’irait pas si loin si la vanité ne lui tenait compagnie.
201
Celui qui croit
pouvoir trouver en soi-même de quoi se passer de tout le monde se
trompe fort ; mais celui qui croit qu’on ne peut se passer de lui se
trompe encore davantage.
202
Les faux
honnêtes gens sont ceux qui déguisent leurs défauts aux autres et à
eux-mêmes. Les vrais honnêtes gens sont ceux qui les connaissent
parfaitement et les confessent.
203
Le vrai honnête homme est celui qui ne se pique de rien.
204
La sévérité des femmes est un ajustement et un fard qu’elles ajoutent à leur beauté.
205
L’honnêteté des femmes est souvent l’amour de leur réputation et de leur repos.
206
C’est être véritablement honnête homme que de vouloir être toujours exposé à la vue des honnêtes gens.
207
La folie nous
suit dans tous les temps de la vie. Si quelqu’un paraît sage, c’est
seulement parce que ses folies sont proportionnées à son âge et à sa
fortune.
208
Il y a des gens niais qui se connaissent, et qui emploient habilement leur niaiserie.
209
Qui vit sans folie n’est pas si sage qu’il croit.
210
En vieillissant on devient plus fou, et plus sage.
211
Il y a des gens qui ressemblent aux vaudevilles, qu’on ne chante qu’un certain temps.
212
La plupart des gens ne jugent des hommes que par la vogue qu’ils ont, ou par leur fortune.
213
L’amour de la
gloire, la crainte de la honte, le dessein de faire fortune, le désir de
rendre notre vie commode et agréable, et l’envie d’abaisser les autres,
sont souvent les causes de cette valeur si célèbre parmi les hommes.
214
La valeur est dans les simples soldats un métier périlleux qu’ils ont pris pour gagner leur vie.
215
La parfaite
valeur et la poltronnerie complète sont deux extrémités où l’on arrive
rarement. L’espace qui est entre-deux est vaste, et contient toutes les
autres espèces de courage : il n’y a pas moins de différence entre elles
qu’entre les visages et les humeurs. Il y a des hommes qui s’exposent
volontiers au commencement d’une action, et qui se relâchent et se
rebutent aisément par sa durée. Il y en a qui sont contents quand ils
ont satisfait à l’honneur du monde, et qui font fort peu de chose
au-delà. On en voit qui ne sont pas toujours également maîtres de leur
peur. D’autres se laissent quelquefois entraîner à des terreurs
générales. D’autres vont à la charge parce qu’ils n’osent demeurer dans
leurs postes. Il s’en trouve à qui l’habitude des moindres périls
affermit le courage et les prépare à s’exposer à de plus grands. Il y en
a qui sont braves à coups d’épée, et qui craignent les coups de
mousquet ; d’autres sont assurés aux coups de mousquet, et appréhendent
de se battre à coups d’épée. Tous ces courages de différentes espèces
conviennent en ce que la nuit augmentant la crainte et cachant les
bonnes et les mauvaises actions, elle donne la liberté de se ménager. Il
y a encore un autre ménagement plus général ; car on ne voit point
d’homme qui fasse tout ce qu’il serait capable de faire dans une
occasion s’il était assuré d’en revenir. De sorte qu’il est visible que
la crainte de la mort ôte quelque chose de la valeur.
216
La parfaite valeur est de faire sans témoins ce qu’on serait capable de faire devant tout le monde.
217
L’intrépidité
est une force extraordinaire de l’âme qui l’élève au-dessus des
troubles, des désordres et des émotions que la vue des grands périls
pourrait exciter en elle ; et c’est par cette force que les héros se
maintiennent en un état paisible, et conservent l’usage libre de leur
raison dans les accidents les plus surprenants et les plus terribles.
218
L’hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu.
219
La plupart des
hommes s’expose assez dans la guerre pour sauver son honneur. Mais peu
se veulent toujours exposer autant qu’il est nécessaire pour faire
réussir le dessein pour lequel il s’exposent.
220
La vanité, la honte, et surtout le tempérament, font souvent la valeur des hommes, et la vertu des femmes.
221
On ne veut
point perdre la vie, et on veut acquérir de la gloire ; ce qui fait que
les braves ont plus d’adresse et d’esprit pour éviter la mort que les
gens de chicane n’en ont pour conserver leur bien.
222
Il n’y a guère
de personnes qui dans le premier penchant de l’âge ne fassent connaître
par où leur corps et leur esprit doivent défaillir.
223
Il est de la
reconnaissance comme de la bonne foi des marchands : elle entretient le
commerce ; et nous ne payons pas parce qu’il est juste de nous
acquitter, mais pour trouver plus facilement des gens qui nous prêtent.
224
Tous ceux qui s’acquittent des devoirs de la reconnaissance ne peuvent pas pour cela se flatter d’être reconnaissants.
225
Ce qui fait le
mécompte dans la reconnaissance qu’on attend des grâces que l’on a
faites, c’est que l’orgueil de celui qui donne, et l’orgueil de celui
qui reçoit, ne peuvent convenir du prix du bienfait.
226
Le trop grand empressement qu’on a de s’acquitter d’une obligation est une espèce d’ingratitude.
227
Les gens heureux ne se corrigent guère ; ils croient toujours avoir raison quand la fortune soutient leur mauvaise conduite.
228
L’orgueil ne veut pas devoir, et l’amour-propre ne veut pas payer.
229
Le bien que nous avons reçu de quelqu’un veut que nous respections le mal qu’il nous fait.
230
Rien n’est si
contagieux que l’exemple, et nous ne faisons jamais de grands biens ni
de grands maux qui n’en produisent de semblables. Nous imitons les
bonnes actions par émulation, et les mauvaises par la malignité de notre
nature que la honte retenait prisonnière, et que l’exemple met en
liberté.
231
C’est une grande folie de vouloir être sage tout seul.
232
Quelque prétexte que nous donnions à nos afflictions, ce n’est souvent que l’intérêt et la vanité qui les causent.
233
Il y a dans les
afflictions diverses sortes d’hypocrisie. Dans l’une, sous prétexte de
pleurer la perte d’une personne qui nous est chère, nous nous pleurons
nous-mêmes ; nous regrettons la bonne opinion qu’il avait de nous ; nous
pleurons la diminution de notre bien, de notre plaisir, de notre
considération. Ainsi les morts ont l’honneur des larmes qui ne coulent
que pour les vivants. Je dis que c’est une espèce d’hypocrisie, à cause
que dans ces sortes d’afflictions on se trompe soi-même. Il y a une
autre hypocrisie qui n’est pas si innocente, parce qu’elle impose à tout
le monde : c’est l’affliction de certaines personnes qui aspirent à la
gloire d’une belle et immortelle douleur. Après que le temps qui consume
tout a fait cesser celle qu’elles avaient en effet, elles ne laissent
pas d’opiniâtrer leurs pleurs, leurs plaintes, et leurs soupirs ; elles
prennent un personnage lugubre, et travaillent à persuader par toutes
leurs actions que leur déplaisir ne finira qu’avec leur vie. Cette
triste et fatigante vanité se trouve d’ordinaire dans les femmes
ambitieuses. Comme leur sexe leur ferme tous les chemins qui mènent à la
gloire, elles s’efforcent de se rendre célèbres par la montre d’une
inconsolable affliction. Il y a encore une autre espèce de larmes qui
n’ont que de petites sources qui coulent et se tarissent facilement : on
pleure pour avoir la réputation d’être tendre, on pleure pour être
plaint, on pleure pour être pleuré ; enfin on pleure pour éviter la
honte de ne pleurer pas.
234
C’est plus
souvent par orgueil que par défaut de lumières qu’on s’oppose avec tant
d’opiniâtreté aux opinions les plus suivies : on trouve les premières
places prises dans le bon parti, et on ne veut point des dernières.
235
Nous nous consolons aisément des disgrâces de nos amis lorsqu’elles servent à signaler notre tendresse pour eux.
236
Il semble que
l’amour-propre soit la dupe de la bonté, et qu’il s’oublie lui-même
lorsque nous travaillons pour l’avantage des autres. Cependant c’est
prendre le chemin le plus assuré pour arriver à ses fins ; c’est prêter à
usure sous prétexte de donner ; c’est enfin s’acquérir tout le monde
par un moyen subtil et délicat.
237
Nul ne mérite
d’être loué de bonté, s’il n’a pas la force d’être méchant : toute autre
bonté n’est le plus souvent qu’une paresse ou une impuissance de la
volonté.
238
Il n’est pas si dangereux de faire du mal à la plupart des hommes que de leur faire trop de bien.
239
Rien ne flatte
plus notre orgueil que la confiance des grands, parce que nous la
regardons comme un effet de notre mérite, sans considérer qu’elle ne
vient le plus souvent que de vanité, ou d’impuissance de garder le
secret.
240
On peut dire de
l’agrément séparé de la beauté que c’est une symétrie dont on ne sait
point les règles, et un rapport secret des traits ensemble, et des
traits avec les couleurs et avec l’air de la personne.
241
La coquetterie
est le fond de l’humeur des femmes. Mais toutes ne la mettent pas en
pratique, parce que la coquetterie de quelques-unes est retenue par la
crainte ou par la raison.
242
On incommode souvent les autres quand on croit ne les pouvoir jamais incommoder.
243
Il y a peu de choses impossibles d’elles-mêmes ; et l’application pour les faire réussir nous manque plus que les moyens.
244
La souveraine habileté consiste à bien connaître le prix des choses.
245
C’est une grande habileté que de savoir cacher son habileté.
246
Ce qui paraît générosité n’est souvent qu’une ambition déguisée qui méprise de petits intérêts, pour aller à de plus grands.
247
La fidélité qui
paraît en la plupart des hommes n’est qu’une invention de
l’amour-propre pour attirer la confiance. C’est un moyen de nous élever
au-dessus des autres, et de nous rendre dépositaires des choses les plus
importantes.
248
La magnanimité méprise tout pour avoir tout.
249
Il n’y a pas
moins d’éloquence dans le ton de la voix, dans les yeux et dans l’air de
la personne, que dans le choix des paroles.
250
La véritable éloquence consiste à dire tout ce qu’il faut, et à ne dire que ce qu’il faut.
251
Il y a des personnes à qui les défauts siéent bien, et d’autres qui sont disgraciées avec leurs bonnes qualités.
252
Il est aussi ordinaire de voir changer les goûts qu’il est extraordinaire de voir changer les inclinations.
253
L’intérêt met en œuvre toutes sortes de vertus et de vices.
254
L’humilité
n’est souvent qu’une feinte soumission, dont on se sert pour soumettre
les autres ; c’est un artifice de l’orgueil qui s’abaisse pour
s’élever ; et bien qu’il se transforme en mille manières, il n’est
jamais mieux déguisé et plus capable de tromper que lorsqu’il se cache
sous la figure de l’humilité.
255
Tous les
sentiments ont chacun un ton de voix, des gestes et des mines qui leur
sont propres. Et ce rapport bon ou mauvais, agréable ou désagréable, est
ce qui fait que les personnes plaisent ou déplaisent.
256
Dans toutes les
professions chacun affecte une mine et un extérieur pour paraître ce
qu’il veut qu’on le croie. Ainsi on peut dire que le monde n’est composé
que de mines.
257
La gravité est un mystère du corps inventé pour cacher les défauts de l’esprit.
258
Le bon goût vient plus du jugement que de l’esprit.
259
Le plaisir de l’amour est d’aimer ; et l’on est plus heureux par la passion que l’on a que par celle que l’on donne.
260
La civilité est un désir d’en recevoir, et d’être estimé poli.
261
L’éducation que l’on donne d’ordinaire aux jeunes gens est un second amour-propre qu’on leur inspire.
262
Il n’y a point
de passion où l’amour de soi-même règne si puissamment que dans
l’amour ; et on est toujours plus disposé à sacrifier le repos de ce
qu’on aime qu’à perdre le sien.
263
Ce qu’on nomme libéralité n’est le plus souvent que la vanité de donner, que nous aimons mieux que ce que nous donnons.
264
La pitié est
souvent un sentiment de nos propres maux dans les maux d’autrui. C’est
une habile prévoyance des malheurs où nous pouvons tomber ; nous donnons
du secours aux autres pour les engager à nous en donner en de
semblables occasions ; et ces services que nous leur rendons sont à
proprement parler des biens que nous nous faisons à nous-mêmes par
avance.
265
La petitesse de l’esprit fait l’opiniâtreté ; et nous ne croyons pas aisément ce qui est au-delà de ce que nous voyons.
266
C’est se
tromper que de croire qu’il n’y ait que les violentes passions, comme
l’ambition et l’amour, qui puissent triompher des autres. La paresse,
toute languissante qu’elle est, ne laisse pas d’en être souvent la
maîtresse ; elle usurpe sur tous les desseins et sur toutes les actions
de la vie ; elle y détruit et y consume insensiblement les passions et
les vertus.
267
La promptitude à
croire le mal sans l’avoir assez examiné est un effet de l’orgueil et
de la paresse. On veut trouver des coupables ; et on ne veut pas se
donner la peine d’examiner les crimes.
268
Nous récusons
des juges pour les plus petits intérêts et nous voulons bien que notre
réputation et notre gloire dépendent du jugement des hommes, qui nous
sont tous contraires, ou par leur jalousie, ou par leur préoccupation,
ou par leur peu de lumière ; et ce n’est que pour les faire prononcer en
notre faveur que nous exposons en tant de manières notre repos et notre
vie.
269
Il n’y a guère d’homme assez habile pour connaître tout le mal qu’il fait.
270
L’honneur acquis est caution de celui qu’on doit acquérir.
271
La jeunesse est une ivresse continuelle : c’est la fièvre de la raison.
272
Rien ne devrait
plus humilier les hommes qui ont mérité de grandes louanges, que le
soin qu’ils prennent encore de se faire valoir par de petites choses.
273
Il y a des gens qu’on approuve dans le monde, qui n’ont pour tout mérite que les vices qui servent au commerce de la vie.
274
La grâce de la
nouveauté est à l’amour ce que la fleur est sur les fruits ; elle y
donne un lustre qui s’efface aisément, et qui ne revient jamais.
275
Le bon naturel, qui se vante d’être si sensible, est souvent étouffé par le moindre intérêt.
276
L’absence diminue les médiocres passions, et augmente les grandes, comme le vent éteint les bougies et allume le feu.
277
Les femmes
croient souvent aimer encore qu’elles n’aiment pas. L’occupation d’une
intrigue, l’émotion d’esprit que donne la galanterie, la pente naturelle
au plaisir d’être aimées, et la peine de refuser, leur persuadent
qu’elles ont de la passion lorsqu’elles n’ont que de la coquetterie.
278
Ce qui fait que
l’on est souvent mécontent de ceux qui négocient, est qu’ils
abandonnent presque toujours l’intérêt de leurs amis pour l’intérêt du
succès de la négociation, qui devient le leur par l’honneur d’avoir
réussi à ce qu’ils avaient entrepris.
279
Quand nous
exagérons la tendresse que nos amis ont pour nous, c’est souvent moins
par reconnaissance que par le désir de faire juger de notre mérite.
280
L’approbation
que l’on donne à ceux qui entrent dans le monde vient souvent de l’envie
secrète que l’on porte à ceux qui y sont établis.
281
L’orgueil qui nous inspire tant d’envie nous sert souvent aussi à la modérer.
282
Il y a des faussetés déguisées qui représentent si bien la vérité que ce serait mal juger que de ne s’y pas laisser tromper.
283
Il n’y a pas quelquefois moins d’habileté à savoir profiter d’un bon conseil qu’à se bien conseiller soi-même.
284
Il y a des méchants qui seraient moins dangereux s’ils n’avaient aucune bonté.
285
La magnanimité
est assez définie par son nom ; néanmoins on pourrait dire que c’est le
bon sens de l’orgueil, et la voie la plus noble pour recevoir des
louanges.
286
Il est impossible d’aimer une seconde fois ce qu’on a véritablement cessé d’aimer.
287
Ce n’est pas
tant la fertilité de l’esprit qui nous fait trouver plusieurs expédients
sur une même affaire, que c’est le défaut de lumière qui nous fait
arrêter à tout ce qui se présente à notre imagination, et qui nous
empêche de discerner d’abord ce qui est le meilleur.
288
Il y a des
affaires et des maladies que les remèdes aigrissent en certains temps ;
et la grande habileté consiste à connaître quand il est dangereux d’en
user.
289
La simplicité affectée est une imposture délicate.
290
Il y a plus de défauts dans l’humeur que dans l’esprit.
291
Le mérite des hommes a sa saison aussi bien que les fruits.
292
On peut dire de
l’humeur des hommes, comme de la plupart des bâtiments, qu’elle a
diverses faces, les unes agréables, et les autres désagréables.
293
La modération
ne peut avoir le mérite de combattre l’ambition et de la soumettre :
elles ne se trouvent jamais ensemble. La modération est la langueur et
la paresse de l’âme, comme l’ambition en est l’activité et l’ardeur.
294
Nous aimons toujours ceux qui nous admirent ; et nous n’aimons pas toujours ceux que nous admirons.
295
Il s’en faut bien que nous ne connaissions toutes nos volontés.
296
Il est
difficile d’aimer ceux que nous n’estimons point ; mais il ne l’est pas
moins d’aimer ceux que nous estimons beaucoup plus que nous.
297
Les humeurs du
corps ont un cours ordinaire et réglé, qui meut et qui tourne
imperceptiblement notre volonté ; elles roulent ensemble et exercent
successivement un empire secret en nous : de sorte qu’elles ont une part
considérable à toutes nos actions, sans que nous le puissions
connaître.
298
La reconnaissance de la plupart des hommes n’est qu’une secrète envie de recevoir de plus grands bienfaits.
299
Presque tout le
monde prend plaisir à s’acquitter des petites obligations ; beaucoup de
gens ont de la reconnaissance pour les médiocres ; mais il n’y a quasi
personne qui n’ait de l’ingratitude pour les grandes.
300
Il y a des folies qui se prennent comme les maladies contagieuses.
301
Assez de gens méprisent le bien, mais peu savent le donner.
302
Ce n’est d’ordinaire que dans de petits intérêts où nous prenons le hasard de ne pas croire aux apparences.
303
Quelque bien qu’on nous dise de nous, on ne nous apprend rien de nouveau.
304
Nous pardonnons souvent à ceux qui nous ennuient, mais nous ne pouvons pardonner à ceux que nous ennuyons.
305
L’intérêt que l’on accuse de tous nos crimes mérite souvent d’être loué de nos bonnes actions.
306
On ne trouve guère d’ingrats tant qu’on est en état de faire du bien.
307
Il est aussi honnête d’être glorieux avec soi-même qu’il est ridicule de l’être avec les autres.
308
On a fait une
vertu de la modération pour borner l’ambition des grands hommes, et pour
consoler les gens médiocres de leur peu de fortune, et de leur peu de
mérite.
309
Il y a des gens
destinés à être sots, qui ne font pas seulement des sottises par leur
choix, mais que la fortune même contraint d’en faire.
310
Il arrive quelquefois des accidents dans la vie, d’où il faut être un peu fou pour se bien tirer.
311
S’il y a des hommes dont le ridicule n’ait jamais paru, c’est qu’on ne l’a pas bien cherché.
312
Ce qui fait que les amants et les maîtresses ne s’ennuient point d’être ensemble, c’est qu’ils parlent toujours d’eux-mêmes.
313
Pourquoi
faut-il que nous ayons assez de mémoire pour retenir jusqu’aux moindres
particularités de ce qui nous est arrivé, et que nous n’en ayons pas
assez pour nous souvenir combien de fois nous les avons contées à une
même personne ?
314
L’extrême
plaisir que nous prenons à parler de nous-mêmes nous doit faire craindre
de n’en donner guère à ceux qui nous écoutent.
315
Ce qui nous
empêche d’ordinaire de faire voir le fond de notre cœur à nos amis,
n’est pas tant la défiance que nous avons d’eux, que celle que nous
avons de nous-mêmes.
316
Les personnes faibles ne peuvent être sincères.
317
Ce n’est pas un grand malheur d’obliger des ingrats, mais c’en est un insupportable d’être obligé à un malhonnête homme.
318
On trouve des moyens pour guérir de la folie, mais on n’en trouve point pour redresser un esprit de travers.
319
On ne saurait
conserver longtemps les sentiments qu’on doit avoir pour ses amis et
pour ses bienfaiteurs, si on se laisse la liberté de parler souvent de
leurs défauts.
320
Louer les princes des vertus qu’ils n’ont pas, c’est leur dire impunément des injures.
321
Nous sommes plus près d’aimer ceux qui nous haïssent que ceux qui nous aiment plus que nous ne voulons.
322
Il n’y a que ceux qui sont méprisables qui craignent d’être méprisés.
323
Notre sagesse n’est pas moins à la merci de la fortune que nos biens.
324
Il y a dans la jalousie plus d’amour-propre que d’amour.
325
Nous nous consolons souvent par faiblesse des maux dont la raison n’a pas la force de nous consoler.
326
Le ridicule déshonore plus que le déshonneur.
327
Nous n’avouons de petits défauts que pour persuader que nous n’en avons pas de grands.
328
L’envie est plus irréconciliable que la haine.
329
On croit quelquefois haïr la flatterie, mais on ne hait que la manière de flatter.
330
On pardonne tant que l’on aime.
331
Il est plus difficile d’être fidèle à sa maîtresse quand on est heureux que quand on en est maltraité.
332
Les femmes ne connaissent pas toute leur coquetterie.
333
Les femmes n’ont point de sévérité complète sans aversion.
334
Les femmes peuvent moins surmonter leur coquetterie que leur passion.
335
Dans l’amour la tromperie va presque toujours plus loin que la méfiance.
336
Il y a une certaine sorte d’amour dont l’excès empêche la jalousie.
337
Il est de
certaines bonnes qualités comme des sens : ceux qui en sont entièrement
privés ne les peuvent apercevoir ni les comprendre.
338
Lorsque notre haine est trop vive, elle nous met au-dessous de ceux que nous haïssons.
339
Nous ne ressentons nos biens et nos maux qu’à proportion de notre amour-propre.
340
L’esprit de la plupart des femmes sert plus à fortifier leur folie que leur raison.
341
Les passions de la jeunesse ne sont guère plus opposées au salut que la tiédeur des vieilles gens.
342
L’accent du pays où l’on est né demeure dans l’esprit et dans le cœur, comme dans le langage.
343
Pour être un grand homme, il faut savoir profiter de toute sa fortune.
344
La plupart des hommes ont comme les plantes des propriétés cachées, que le hasard fait découvrir.
345
Les occasions nous font connaître aux autres, et encore plus à nous-mêmes.
346
Il ne peut y avoir de règle dans l’esprit ni dans le cœur des femmes, si le tempérament n’en est d’accord.
347
Nous ne trouvons guère de gens de bon sens, que ceux qui sont de notre avis.
348
Quand on aime, on doute souvent de ce qu’on croit le plus.
349
Le plus grand miracle de l’amour, c’est de guérir de la coquetterie.
350
Ce qui nous donne tant d’aigreur contre ceux qui nous font des finesses, c’est qu’ils croient être plus habiles que nous.
351
On a bien de la peine à rompre, quand on ne s’aime plus.
352
On s’ennuie presque toujours avec les gens avec qui il n’est pas permis de s’ennuyer.
353
Un honnête homme peut être amoureux comme un fou, mais non pas comme un sot.
354
Il y a de certains défauts qui, bien mis en œuvre, brillent plus que la vertu même.
355
On perd
quelquefois des personnes qu’on regrette plus qu’on n’en est affligé ;
et d’autres dont on est affligé, et qu’on ne regrette guère.
356
Nous ne louons d’ordinaire de bon cœur que ceux qui nous admirent.
357
Les petits esprits sont trop blessés des petites choses ; les grands esprits les voient toutes, et n’en sont point blessés.
358
L’humilité est
la véritable preuve des vertus chrétiennes : sans elle nous conservons
tous nos défauts, et ils sont seulement couverts par l’orgueil qui les
cache aux autres, et souvent à nous-mêmes.
359
Les infidélités
devraient éteindre l’amour, et il ne faudrait point être jaloux quand
on a sujet de l’être. Il n’y a que les personnes qui évitent de donner
de la jalousie qui soient dignes qu’on en ait pour elles.
360
On se décrie
beaucoup plus auprès de nous par les moindres infidélités qu’on nous
fait, que par les plus grandes qu’on fait aux autres.
361
La jalousie naît toujours avec l’amour, mais elle ne meurt pas toujours avec lui.
362
La plupart des
femmes ne pleurent pas tant la mort de leurs amants pour les avoir
aimés, que pour paraître plus dignes d’être aimées.
363
Les violences qu’on nous fait nous font souvent moins de peine que celles que nous nous faisons à nous-mêmes.
364
On sait assez qu’il ne faut guère parler de sa femme ; mais on ne sait pas assez qu’on devrait encore moins parler de soi.
365
Il y a de
bonnes qualités qui dégénèrent en défauts quand elles sont naturelles,
et d’autres qui ne sont jamais parfaites quand elles sont acquises. Il
faut, par exemple, que la raison nous fasse ménagers de notre bien et de
notre confiance ; et il faut, au contraire, que la nature nous donne la
bonté et la valeur.
366
Quelque
défiance que nous ayons de la sincérité de ceux qui nous parlent, nous
croyons toujours qu’ils nous disent plus vrai qu’aux autres.
367
Il y a peu d’honnêtes femmes qui ne soient lasses de leur métier.
368
La plupart des honnêtes femmes sont des trésors cachés, qui ne sont en sûreté que parce qu’on ne les cherche pas.
369
Les violences qu’on se fait pour s’empêcher d’aimer sont souvent plus cruelles que les rigueurs de ce qu’on aime.
370
Il n’y a guère de poltrons qui connaissent toujours toute leur peur.
371
C’est presque toujours la faute de celui qui aime de ne pas connaître quand on cesse de l’aimer.
372
La plupart des jeunes gens croient être naturels, lorsqu’ils ne sont que mal polis et grossiers.
373
Il y a de certaines larmes qui nous trompent souvent nous-mêmes après avoir trompé les autres.
374
Si on croit aimer sa maîtresse pour l’amour d’elle, on est bien trompé.
375
Les esprits médiocres condamnent d’ordinaire tout ce qui passe leur portée.
376
L’envie est détruite par la véritable amitié, et la coquetterie par le véritable amour.
377
Le plus grand défaut de la pénétration n’est pas de n’aller point jusqu’au but, c’est de le passer.
378
On donne des conseils mais on n’inspire point de conduite.
379
Quand notre mérite baisse, notre goût baisse aussi.
380
La fortune fait paraître nos vertus et nos vices, comme la lumière fait paraître les objets.
381
La violence qu’on se fait pour demeurer fidèle à ce qu’on aime ne vaut guère mieux qu’une infidélité.
382
Nos actions sont comme les bouts-rimés, que chacun fait rapporter à ce qu’il lui plaît.
383
L’envie de
parler de nous, et de faire voir nos défauts du côté que nous voulons
bien les montrer, fait une grande partie de notre sincérité.
384
On ne devrait s’étonner que de pouvoir encore s’étonner.
385
On est presque également difficile à contenter quand on a beaucoup d’amour et quand on n’en a plus guère.
386
Il n’y a point de gens qui aient plus souvent tort que ceux qui ne peuvent souffrir d’en avoir.
387
Un sot n’a pas assez d’étoffe pour être bon.
388
Si la vanité ne renverse pas entièrement les vertus, du moins elle les ébranle toutes.
389
Ce qui nous rend la vanité des autres insupportable, c’est qu’elle blesse la nôtre.
390
On renonce plus aisément à son intérêt qu’à son goût.
391
La fortune ne paraît jamais si aveugle qu’à ceux à qui elle ne fait pas de bien.
392
Il faut
gouverner la fortune comme la santé : en jouir quand elle est bonne,
prendre patience quand elle est mauvaise, et ne faire jamais de grands
remèdes sans un extrême besoin.
393
L’air bourgeois se perd quelquefois à l’armée ; mais il ne se perd jamais à la cour.
394
On peut être plus fin qu’un autre, mais non pas plus fin que tous les autres.
395
On est quelquefois moins malheureux d’être trompé de ce qu’on aime, que d’en être détrompé.
396
On garde longtemps son premier amant, quand on n’en prend point de second.
397
Nous n’avons
pas le courage de dire en général que nous n’avons point de défauts, et
que nos ennemis n’ont point de bonnes qualités ; mais en détail nous ne
sommes pas trop éloignés de le croire.
398
De tous nos
défauts, celui dont nous demeurons le plus aisément d’accord, c’est de
la paresse ; nous nous persuadons qu’elle tient à toutes les vertus
paisibles et que, sans détruire entièrement les autres, elle en suspend
seulement les fonctions.
399
Il y a une
élévation qui ne dépend point de la fortune : c’est un certain air qui
nous distingue et qui semble nous destiner aux grandes choses ; c’est un
prix que nous nous donnons imperceptiblement à nous-mêmes ; c’est par
cette qualité que nous usurpons les déférences des autres hommes, et
c’est elle d’ordinaire qui nous met plus au-dessus d’eux que la
naissance, les dignités, et le mérite même.
400
Il y a du mérite sans élévation, mais il n’y a point d’élévation sans quelque mérite.
401
L’élévation est au mérite ce que la parure est aux belles personnes.
402
Ce qui se trouve le moins dans la galanterie, c’est de l’amour.
403
La fortune se
sert quelquefois de nos défauts pour nous élever, et il y a des gens
incommodes dont le mérite serait mal récompensé si on ne voulait acheter
leur absence.
404
Il semble que
la nature ait caché dans le fond de notre esprit des talents et une
habileté que nous ne connaissons pas ; les passions seules ont le droit
de les mettre au jour, et de nous donner quelquefois des vues plus
certaines et plus achevées que l’art ne saurait faire.
405
Nous arrivons tout nouveaux aux divers âges de la vie, et nous y manquons souvent d’expérience malgré le nombre des années.
406
Les coquettes se font honneur d’être jalouses de leurs amants, pour cacher qu’elles sont envieuses des autres femmes.
407
Il s’en faut
bien que ceux qui s’attrapent à nos finesses ne nous paraissent aussi
ridicules que nous nous le paraissons à nous-mêmes quand les finesses
des autres nous ont attrapés.
408
Le plus dangereux ridicule des vieilles personnes qui ont été aimables, c’est d’oublier qu’elles ne le sont plus.
409
Nous aurions souvent honte de nos plus belles actions si le monde voyait tous les motifs qui les produisent.
410
Le plus grand effort de l’amitié n’est pas de montrer nos défauts à un ami ; c’est de lui faire voir les siens.
411
On n’a guère de défauts qui ne soient plus pardonnables que les moyens dont on se sert pour les cacher.
412
Quelque honte que nous ayons méritée, il est presque toujours en notre pouvoir de rétablir notre réputation.
413
On ne plaît pas longtemps quand on n’a que d’une sorte d’esprit.
414
Les fous et les sottes gens ne voient que par leur humeur.
415
L’esprit nous sert quelquefois à faire hardiment des sottises.
416
La vivacité qui augmente en vieillissant ne va pas loin de la folie.
417
En amour celui qui est guéri le premier est toujours le mieux guéri.
418
Les jeunes
femmes qui ne veulent point paraître coquettes, et les hommes d’un âge
avancé qui ne veulent pas être ridicules, ne doivent jamais parler de
l’amour comme d’une chose où ils puissent avoir part.
419
Nous pouvons
paraître grands dans un emploi au-dessous de notre mérite, mais nous
paraissons souvent petits dans un emploi plus grand que nous.
420
Nous croyons
souvent avoir de la constance dans les malheurs, lorsque nous n’avons
que de l’abattement, et nous les souffrons sans oser les regarder comme
les poltrons se laissent tuer de peur de se défendre.
421
La confiance fournit plus à la conversation que l’esprit.
422
Toutes les passions nous font faire des fautes, mais l’amour nous en fait faire de plus ridicules.
423
Peu de gens savent être vieux.
424
Nous nous
faisons honneur des défauts opposés à ceux que nous avons : quand nous
sommes faibles, nous nous vantons d’être opiniâtres.
425
La pénétration a un air de deviner qui flatte plus notre vanité que toutes les autres qualités de l’esprit.
426
La grâce de la
nouveauté et la longue habitude, quelque opposées qu’elles soient, nous
empêchent également de sentir les défauts de nos amis.
427
La plupart des amis dégoûtent de l’amitié, et la plupart des dévots dégoûtent de la dévotion.
428
Nous pardonnons aisément à nos amis les défauts qui ne nous regardent pas.
429
Les femmes qui aiment pardonnent plus aisément les grandes indiscrétions que les petites infidélités.
430
Dans la vieillesse de l’amour comme dans celle de l’âge on vit encore pour les maux, mais on ne vit plus pour les plaisirs.
431
Rien n’empêche tant d’être naturel que l’envie de le paraître.
432
C’est en quelque sorte se donner part aux belles actions, que de les louer de bon cœur.
433
La plus véritable marque d’être né avec de grandes qualités, c’est d’être né sans envie.
434
Quand nos amis
nous ont trompés, on ne doit que de l’indifférence aux marques de leur
amitié, mais on doit toujours de la sensibilité à leurs malheurs.
435
La fortune et l’humeur gouvernent le monde.
436
Il est plus aisé de connaître l’homme en général que de connaître un homme en particulier.
437
On ne doit pas juger du mérite d’un homme par ses grandes qualités, mais par l’usage qu’il en sait faire.
438
Il y a une
certaine reconnaissance vive qui ne nous acquitte pas seulement des
bienfaits que nous avons reçus, mais qui fait même que nos amis nous
doivent en leur payant ce que nous leur devons.
439
Nous ne désirerions guère de choses avec ardeur, si nous connaissions parfaitement ce que nous désirons.
440
Ce qui fait que la plupart des femmes sont peu touchées de l’amitié, c’est qu’elle est fade quand on a senti de l’amour.
441
Dans l’amitié comme dans l’amour on est souvent plus heureux par les choses qu’on ignore que par celles que l’on sait.
442
Nous essayons de nous faire honneur des défauts que nous ne voulons pas corriger.
443
Les passions les plus violentes nous laissent quelquefois du relâche, mais la vanité nous agite toujours.
444
Les vieux fous sont plus fous que les jeunes.
445
La faiblesse est plus opposée à la vertu que le vice.
446
Ce qui rend les douleurs de la honte et de la jalousie si aiguës, c’est que la vanité ne peut servir à les supporter.
447
La bienséance est la moindre de toutes les lois, et la plus suivie.
448
Un esprit droit a moins de peine de se soumettre aux esprits de travers que de les conduire.
449
Lorsque la
fortune nous surprend en nous donnant une grande place sans nous y avoir
conduits par degrés, ou sans que nous nous y soyons élevés par nos
espérances, il est presque impossible de s’y bien soutenir, et de
paraître digne de l’occuper.
450
Notre orgueil s’augmente souvent de ce que nous retranchons de nos autres défauts.
451
Il n’y a point de sots si incommodes que ceux qui ont de l’esprit.
452
Il n’y a point d’homme qui se croie en chacune de ses qualités au-dessous de l’homme du monde qu’il estime le plus.
453
Dans les grandes affaires on doit moins s’appliquer à faire naître des occasions qu’à profiter de celles qui se présentent.
454
Il n’y a guère
d’occasion où l’on fît un méchant marché de renoncer au bien qu’on dit
de nous, à condition de n’en dire point de mal.
455
Quelque
disposition qu’ait le monde à mal juger, il fait encore plus souvent
grâce au faux mérite qu’il ne fait injustice au véritable.
456
On est quelquefois un sot avec de l’esprit, mais on ne l’est jamais avec du jugement.
457
Nous gagnerions plus de nous laisser voir tels que nous sommes, que d’essayer de paraître ce que nous ne sommes pas.
458
Nos ennemis approchent plus de la vérité dans les jugements qu’ils font de nous que nous n’en approchons nous-mêmes.
459
Il y a plusieurs remèdes qui guérissent de l’amour, mais il n’y en a point d’infaillibles.
460
Il s’en faut bien que nous connaissions tout ce que nos passions nous font faire.
461
La vieillesse est un tyran qui défend sur peine de la vie tous les plaisirs de la jeunesse.
462
Le même orgueil
qui nous fait blâmer les défauts dont nous nous croyons exempts, nous
porte à mépriser les bonnes qualités que nous n’avons pas.
463
Il y a souvent
plus d’orgueil que de bonté à plaindre les malheurs de nos ennemis ;
c’est pour leur faire sentir que nous sommes au-dessus d’eux que nous
leur donnons des marques de compassion.
464
Il y a un excès de biens et de maux qui passe notre sensibilité.
465
Il s’en faut bien que l’innocence ne trouve autant de protection que le crime.
466
De toutes les passions violentes, celle qui sied le moins mal aux femmes, c’est l’amour.
467
La vanité nous fait faire plus de choses contre notre goût que la raison.
468
Il y a de méchantes qualités qui font de grands talents.
469
On ne souhaite jamais ardemment ce qu’on ne souhaite que par raison.
470
Toutes nos qualités sont incertaines et douteuses en bien comme en mal, et elles sont presque toutes à la merci des occasions.
471
Dans les premières passions les femmes aiment l’amant, et dans les autres elles aiment l’amour.
472
L’orgueil a ses
bizarreries, comme les autres passions ; on a honte d’avouer que l’on
ait de la jalousie, et on se fait honneur d’en avoir eu, et d’être
capable d’en avoir.
473
Quelque rare que soit le véritable amour, il l’est encore moins que la véritable amitié.
474
Il y a peu de femmes dont le mérite dure plus que la beauté.
475
L’envie d’être plaint, ou d’être admiré, fait souvent la plus grande partie de notre confiance.
476
Notre envie dure toujours plus longtemps que le bonheur de ceux que nous envions.
477
La même fermeté
qui sert à résister à l’amour sert aussi à le rendre violent et
durable, et les personnes faibles qui sont toujours agitées des passions
n’en sont presque jamais véritablement remplies.
478
L’imagination ne saurait inventer tant de diverses contrariétés qu’il y en a naturellement dans le cœur de chaque personne.
479
Il n’y a que
les personnes qui ont de la fermeté qui puissent avoir une véritable
douceur ; celles qui paraissent douces n’ont d’ordinaire que de la
faiblesse, qui se convertit aisément en aigreur.
480
La timidité est un défaut dont il est dangereux de reprendre les personnes qu’on en veut corriger.
481
Rien n’est plus
rare que la véritable bonté ; ceux mêmes qui croient en avoir n’ont
d’ordinaire que de la complaisance ou de la faiblesse.
482
L’esprit
s’attache par paresse et par constance à ce qui lui est facile ou
agréable ; cette habitude met toujours des bornes à nos connaissances,
et jamais personne ne s’est donné la peine d’étendre et de conduire son
esprit aussi loin qu’il pourrait aller.
483
On est d’ordinaire plus médisant par vanité que par malice.
484
Quand on a le
cœur encore agité par les restes d’une passion, on est plus près d’en
prendre une nouvelle que quand on est entièrement guéri.
485
Ceux qui ont eu de grandes passions se trouvent toute leur vie heureux, et malheureux, d’en être guéris.
486
Il y a encore plus de gens sans intérêt que sans envie.
487
Nous avons plus de paresse dans l’esprit que dans le corps.
488
Le calme ou
l’agitation de notre humeur ne dépend pas tant de ce qui nous arrive de
plus considérable dans la vie, que d’un arrangement commode ou
désagréable de petites choses qui arrivent tous les jours.
489
Quelque
méchants que soient les hommes, ils n’oseraient paraître ennemis de la
vertu, et lorsqu’ils la veulent persécuter, ils feignent de croire
qu’elle est fausse ou ils lui supposent des crimes.
490
On passe souvent de l’amour à l’ambition, mais on ne revient guère de l’ambition à l’amour.
491
L’extrême
avarice se méprend presque toujours ; il n’y a point de passion qui
s’éloigne plus souvent de son but, ni sur qui le présent ait tant de
pouvoir au préjudice de l’avenir.
492
L’avarice
produit souvent des effets contraires ; il y a un nombre infini de gens
qui sacrifient tout leur bien à des espérances douteuses et éloignées,
d’autres méprisent de grands avantages à venir pour de petits intérêts
présents.
493
Il semble que
les hommes ne se trouvent pas assez de défauts ; ils en augmentent
encore le nombre par de certaines qualités singulières dont ils
affectent de se parer, et ils les cultivent avec tant de soin qu’elles
deviennent à la fin des défauts naturels, qu’il ne dépend plus d’eux de
corriger.
494
Ce qui fait
voir que les hommes connaissent mieux leurs fautes qu’on ne pense, c’est
qu’ils n’ont jamais tort quand on les entend parler de leur conduite :
le même amour-propre qui les aveugle d’ordinaire les éclaire alors, et
leur donne des vues si justes qu’il leur fait supprimer ou déguiser les
moindres choses qui peuvent être condamnées.
495
Il faut que les
jeunes gens qui entrent dans le monde soient honteux ou étourdis : un
air capable et composé se tourne d’ordinaire en impertinence.
496
Les querelles ne dureraient pas longtemps, si le tort n’était que d’un côté.
497
Il ne sert de rien d’être jeune sans être belle, ni d’être belle sans être jeune.
498
Il y a des
personnes si légères et si frivoles qu’elles sont aussi éloignées
d’avoir de véritables défauts que des qualités solides.
499
On ne compte d’ordinaire la première galanterie des femmes que lorsqu’elles en ont une seconde.
500
Il y a des gens
si remplis d’eux-mêmes que, lorsqu’ils sont amoureux, ils trouvent
moyen d’être occupés de leur passion sans l’être de la personne qu’ils
aiment.
501
L’amour, tout agréable qu’il est, plaît encore plus par les manières dont il se montre que par lui-même.
502
Peu d’esprit avec de la droiture ennuie moins, à la longue, que beaucoup d’esprit avec du travers.
503
La jalousie est le plus grand de tous les maux, et celui qui fait le moins de pitié aux personnes qui le causent.
504
Après avoir
parlé de la fausseté de tant de vertus apparentes, il est raisonnable de
dire quelque chose de la fausseté du mépris de la mort. J’entends
parler de ce mépris de la mort que les païens se vantent de tirer de
leurs propres forces, sans l’espérance d’une meilleure vie. Il y a
différence entre souffrir la mort constamment, et la mépriser. Le
premier est assez ordinaire ; mais je crois que l’autre n’est jamais
sincère. On a écrit néanmoins tout ce qui peut le plus persuader que la
mort n’est point un mal ; et les hommes les plus faibles aussi bien que
les héros ont donné mille exemples célèbres pour établir cette opinion.
Cependant je doute que personne de bon sens l’ait jamais cru ; et la
peine que l’on prend pour le persuader aux autres et à soi-même fait
assez voir que cette entreprise n’est pas aisée. On peut avoir divers
sujets de dégoûts dans la vie, mais on n’a jamais raison de mépriser la
mort ; ceux mêmes qui se la donnent volontairement ne la comptent pas
pour si peu de chose, et ils s’en étonnent et la rejettent comme les
autres, lorsqu’elle vient à eux par une autre voie que celle qu’ils ont
choisie. L’inégalité que l’on remarque dans le courage d’un nombre
infini de vaillants hommes vient de ce que la mort se découvre
différemment à leur imagination, et y paraît plus présente en un temps
qu’en un autre. Ainsi il arrive qu’après avoir méprisé ce qu’ils ne
connaissent pas, ils craignent enfin ce qu’ils connaissent. Il faut
éviter de l’envisager avec toutes ses circonstances, si on ne veut pas
croire qu’elle soit le plus grand de tous les maux. Les plus habiles et
les plus braves sont ceux qui prennent de plus honnêtes prétextes pour
s’empêcher de la considérer. Mais tout homme qui la sait voir telle
qu’elle est, trouve que c’est une chose épouvantable. La nécessité de
mourir faisait toute la constance des philosophes. Ils croyaient qu’il
fallait aller de bonne grâce où l’on ne saurait s’empêcher d’aller ; et,
ne pouvant éterniser leur vie, il n’y avait rien qu’ils ne fissent pour
éterniser leur réputation, et sauver du naufrage ce qui n’en peut être
garanti. Contentons-nous pour faire bonne mine de ne nous pas dire à
nous-mêmes tout ce que nous en pensons, et espérons plus de notre
tempérament que de ces faibles raisonnements qui nous font croire que
nous pouvons approcher de la mort avec indifférence. La gloire de mourir
avec fermeté, l’espérance d’être regretté, le désir de laisser une
belle réputation, l’assurance d’être affranchi des misères de la vie, et
de ne dépendre plus des caprices de la fortune, sont des remèdes qu’on
ne doit pas rejeter. Mais on ne doit pas croire aussi qu’ils soient
infaillibles. Ils font pour nous assurer ce qu’une simple haie fait
souvent à la guerre pour assurer ceux qui doivent approcher d’un lieu
d’où l’on tire. Quand on en est éloigné, on s’imagine qu’elle peut
mettre à couvert ; mais quand on en est proche, on trouve que c’est un
faible secours. C’est nous flatter, de croire que la mort nous paraisse
de près ce que nous en avons jugé de loin, et que nos sentiments, qui ne
sont que faiblesse, soient d’une trempe assez forte pour ne point
souffrir d’atteinte par la plus rude de toutes les épreuves. C’est aussi
mal connaître les effets de l’amour-propre, que de penser qu’il puisse
nous aider à compter pour rien ce qui le doit nécessairement détruire,
et la raison, dans laquelle on croit trouver tant de ressources, est
trop faible en cette rencontre pour nous persuader ce que nous voulons.
C’est elle au contraire qui nous trahit le plus souvent, et qui, au lieu
de nous inspirer le mépris de la mort, sert à nous découvrir ce qu’elle
a d’affreux et de terrible. Tout ce qu’elle peut faire pour nous est de
nous conseiller d’en détourner les yeux pour les arrêter sur d’autres
objets. Caton et Brutus en choisirent d’illustres. Un laquais se
contenta il y a quelque temps de danser sur l’échafaud où il allait être
roué. Ainsi, bien que les motifs soient différents, ils produisent les
mêmes effets. De sorte qu’il est vrai que, quelque disproportion qu’il y
ait entre les grands hommes et les gens du commun, on a vu mille fois
les uns et les autres recevoir la mort d’un même visage ; mais ç’a
toujours été avec cette différence que, dans le mépris que les grands
hommes font paraître pour la mort, c’est l’amour de la gloire qui leur
en ôte la vue, et dans les gens du commun ce n’est qu’un effet de leur
peu de lumière qui les empêche de connaître la grandeur de leur mal et
leur laisse la liberté de penser à autre chose.
Maximes supprimées
1° Maximes retranchées après la première édition
1
L’amour-propre
est l’amour de soi-même, et de toutes choses pour soi ; il rend les
hommes idolâtres d’eux-mêmes, et les rendrait les tyrans des autres si
la fortune leur en donnait les moyens ; il ne se repose jamais hors de
soi, et ne s’arrête dans les sujets étrangers que comme les abeilles sur
les fleurs, pour en tirer ce qui lui est propre. Rien n’est si
impétueux que ses désirs, rien de si caché que ses desseins, rien de si
habile que ses conduites ; ses souplesses ne se peuvent représenter, ses
transformations passent celles des métamorphoses, et ses raffinements
ceux de la chimie. On ne peut sonder la profondeur, ni percer les
ténèbres de ses abîmes. Là il est à couvert des yeux les plus
pénétrants ; il y fait mille insensibles tours et retours. Là il est
souvent invisible à lui-même, il y conçoit, il y nourrit, et il y élève,
sans le savoir, un grand nombre d’affections et de haines ; il en forme
de si monstrueuses que, lorsqu’il les a mises au jour, il les
méconnaît, ou il ne peut se résoudre à les avouer. De cette nuit qui le
couvre naissent les ridicules persuasions qu’il a de lui-même ; de là
viennent ses erreurs, ses ignorances, ses grossièretés et ses niaiseries
sur son sujet ; de là vient qu’il croit que ses sentiments sont morts
lorsqu’ils ne sont qu’endormis, qu’il s’imagine n’avoir plus envie de
courir dès qu’il se repose, et qu’il pense avoir perdu tous les goûts
qu’il a rassasiés. Mais cette obscurité épaisse, qui le cache à
lui-même, n’empêche pas qu’il ne voie parfaitement ce qui est hors de
lui, en quoi il est semblable à nos yeux, qui découvrent tout, et sont
aveugles seulement pour eux-mêmes. En effet dans ses plus grands
intérêts, et dans ses plus importantes affaires, où la violence de ses
souhaits appelle toute son attention, il voit, il sent, il entend, il
imagine, il soupçonne, il pénètre, il devine tout ; de sorte qu’on est
tenté de croire que chacune de ses passions a une espèce de magie qui
lui est propre. Rien n’est si intime et si fort que ses attachements,
qu’il essaye de rompre inutilement à la vue des malheurs extrêmes qui le
menacent. Cependant il fait quelquefois en peu de temps, et sans aucun
effort, ce qu’il n’a pu faire avec tous ceux dont il est capable dans le
cours de plusieurs année ; d’où l’on pourrait conclure assez
vraisemblablement que c’est par lui-même que ses désirs sont allumés,
plutôt que par la beauté et par le mérite de ses objets ; que son goût
est le prix qui les relève, et le fard qui les embellit ; que c’est
après lui-même qu’il court, et qu’il suit son gré, lorsqu’il suit les
choses qui sont à son gré. Il est tous les contraires : il est impérieux
et obéissant, sincère et dissimulé, miséricordieux et cruel, timide et
audacieux. Il a de différentes inclinations selon la diversité des
tempéraments qui le tournent, et le dévouent tantôt à la gloire, tantôt
aux richesses, et tantôt aux plaisirs ; il en change selon le changement
de nos âges, de nos fortunes et de nos expériences, mais il lui est
indifférent d’en avoir plusieurs ou de n’en avoir qu’une, parce qu’il se
partage en plusieurs et se ramasse en une quand il le faut, et comme il
lui plaît. Il est inconstant, et outre les changements qui viennent des
causes étrangères, il y en a une infinité qui naissent de lui, et de
son propre fonds ; il est inconstant d’inconstance, de légèreté,
d’amour, de nouveauté, de lassitude et de dégoût ; il est capricieux, et
on le voit quelquefois travailler avec le dernier empressement, et avec
des travaux incroyables, à obtenir des choses qui ne lui sont point
avantageuses, et qui même lui sont nuisibles, mais qu’il poursuit parce
qu’il les veut. Il est bizarre, et met souvent toute son application
dans les emplois les plus frivoles ; il trouve tout son plaisir dans les
plus fades, et conserve toute sa fierté dans les plus méprisables. Il
est dans tous les états de la vie, et dans toutes les conditions ; il
vit partout, et il vit de tout, il vit de rien ; il s’accommode des
choses, et de leur privation ; il passe même dans le parti des gens qui
lui font la guerre, il entre dans leurs desseins ; et ce qui est
admirable, il se hait lui-même avec eux, il conjure sa perte, il
travaille même à sa ruine. Enfin il ne se soucie que d’être, et pourvu
qu’il soit, il veut bien être son ennemi. Il ne faut donc pas s’étonner
s’il se joint quelquefois à la plus rude austérité, et s’il entre si
hardiment en société avec elle pour se détruire, parce que, dans le même
temps qu’il se ruine en un endroit, il se rétablit en un autre ; quand
on pense qu’il quitte son plaisir, il ne fait que le suspendre, ou le
changer, et lors même qu’il est vaincu et qu’on croit en être défait, on
le retrouve qui triomphe dans sa propre défaite. Voilà la peinture de
l’amour-propre, dont toute la vie n’est qu’une grande et longue
agitation ; la mer en est une image sensible, et l’amour-propre trouve
dans le flux et le reflux de ses vagues continuelles une fidèle
expression de la succession turbulente de ses pensées, et de ses
éternels mouvements.
2
Toutes les passions ne sont autre chose que les divers degrés de la chaleur, et de la froideur, du sang.
3
La modération
dans la bonne fortune n’est que l’appréhension de la honte qui suit
l’emportement, ou la peur de perdre ce que l’on a.
4
La modération est comme la sobriété : on voudrait bien manger davantage, mais on craint de se faire mal.
5
Tout le monde trouve à redire en autrui ce qu’on trouve à redire en lui.
6
L’orgueil, comme
lassé de ses artifices et de ses différentes métamorphoses, après avoir
joué tout seul tous les personnages de la comédie humaine, se montre
avec un visage naturel, et se découvre par la fierté ; de sorte qu’à
proprement parler la fierté est l’éclat et la déclaration de l’orgueil.
7
La complexion qui fait le talent pour les petites choses est contraire à celle qu’il faut pour le talent des grandes.
8
C’est une espèce de bonheur, de connaître jusques à quel point on doit être malheureux.
9
On n’est jamais si malheureux qu’on croit, ni si heureux qu’on avait espéré.
10
On se console souvent d’être malheureux par un certain plaisir qu’on trouve à le paraître.
11
Il faudrait pouvoir répondre de sa fortune, pour pouvoir répondre de ce que l’on fera.
12
Comment peut-on
répondre de ce qu’on voudra à l’avenir, puisque l’on ne sait pas
précisément ce que l’on veut dans le temps présent ?
13
L’amour est à l’âme de celui qui aime ce que l’âme est au corps qu’elle anime.
14
La justice
n’est qu’une vive appréhension qu’on ne nous ôte ce qui nous
appartient ; de là vient cette considération et ce respect pour tous les
intérêts du prochain, et cette scrupuleuse application à ne lui faire
aucun préjudice ; cette crainte retient l’homme dans les bornes des
biens que la naissance, ou la fortune, lui ont donnés, et sans cette
crainte il ferait des courses continuelles sur les autres.
15
La justice, dans les juges qui sont modérés, n’est que l’amour de leur élévation.
16
On blâme l’injustice, non pas par l’aversion que l’on a pour elle, mais pour le préjudice que l’on en reçoit.
17
Le premier
mouvement de joie que nous avons du bonheur de nos amis ne vient ni de
la bonté de notre naturel, ni de l’amitié que nous avons pour eux ;
c’est un effet de l’amour-propre qui nous flatte de l’espérance d’être
heureux à notre tour, ou de retirer quelque utilité de leur bonne
fortune.
18
Dans l’adversité de nos meilleurs amis, nous trouvons toujours quelque chose qui ne nous déplaît pas.
19
L’aveuglement
des hommes est le plus dangereux effet de leur orgueil : il sert à le
nourrir et à l’augmenter, et nous ôte la connaissance des remèdes qui
pourraient soulager nos misères et nous guérir de nos défauts.
20
On n’a plus de raison, quand on n’espère plus d’en trouver aux autres.
21
Les
philosophes, et Sénèque surtout, n’ont point ôté les crimes par leurs
préceptes : ils n’ont fait que les employer au bâtiment de l’orgueil.
22
Les plus sages le sont dans les choses indifférentes, mais ils ne le sont presque jamais dans leurs plus sérieuses affaires.
23
La plus subtile folie se fait de la plus subtile sagesse.
24
La sobriété est l’amour de la santé, ou l’impuissance de manger beaucoup.
25
Chaque talent dans les hommes, de même que chaque arbre, a ses propriétés et ses effets qui lui sont tous particuliers.
26
On n’oublie jamais mieux les choses que quand on s’est lassé d’en parler.
27
La modestie, qui semble refuser les louanges, n’est en effet qu’un désir d’en avoir de plus délicates.
28
On ne blâme le vice et on ne loue la vertu que par intérêt.
29
L’amour-propre empêche bien que celui qui nous flatte ne soit jamais celui qui nous flatte le plus.
30
On ne fait
point de distinction dans les espèces de colères, bien qu’il y en ait
une légère et quasi innocente, qui vient de l’ardeur de la complexion,
et une autre très criminelle, qui est à proprement parler la fureur de
l’orgueil.
31
Les grandes
âmes ne sont pas celles qui ont moins de passions et plus de vertu que
les âmes communes, mais celles seulement qui ont de plus grands
desseins.
32
La férocité naturelle fait moins de cruels que l’amour-propre.
33
On peut dire de
toutes nos vertus ce qu’un poète italien a dit de l’honnêteté des
femmes, que ce n’est souvent autre chose qu’un art de paraître honnête.
34
Ce que le monde
nomme vertu n’est d’ordinaire qu’un fantôme formé par nos passions, à
qui on donne un nom honnête, pour faire impunément ce qu’on veut.
35
Nous n’avouons jamais nos défauts que par vanité.
36
On ne trouve point dans l’homme le bien ni le mal dans l’excès.
37
Ceux qui sont incapables de commettre de grands crimes n’en soupçonnent pas facilement les autres.
38
La pompe des enterrements regarde plus la vanité des vivants que l’honneur des morts.
39
Quelque
incertitude et quelque variété qui paraisse dans le monde, on y remarque
néanmoins un certain enchaînement secret, et un ordre réglé de tout
temps par la Providence, qui fait que chaque chose marche en son rang,
et suit le cours de sa destinée.
40
L’intrépidité
doit soutenir le cœur dans les conjurations, au lieu que la seule valeur
lui fournit toute la fermeté qui lui est nécessaire dans le périls de
la guerre.
41
Ceux qui
voudraient définir la victoire par sa naissance seraient tentés comme
les poètes de l’appeler la fille du Ciel, puisqu’on ne trouve point son
origine sur la terre. En effet elle est produite par infinité d’actions
qui, au lieu de l’avoir pour but, regardent seulement les intérêts
particuliers de ceux qui les font, puisque tous ceux qui composent une
armée, allant à leur propre gloire et à leur élévation, procurent un
bien si grand et si général.
42
On ne peut répondre de son courage quand on n’a jamais été dans le péril.
43
L’imitation est
toujours malheureuse, et tout ce qui est contrefait déplaît avec les
mêmes choses qui charment lorsqu’elles sont naturelles.
44
Il est bien malaisé de distinguer la bonté générale, et répandue sur tout le monde, de la grande habileté.
45
Pour pouvoir être toujours bon, il faut que les autres croient qu’ils ne peuvent jamais nous être impunément méchants.
46
La confiance de plaire est souvent un moyen de déplaire infailliblement.
47
La confiance que l’on a en soi fait naître la plus grande partie de celle que l’on a aux autres.
48
Il y a une révolution générale qui change le goût des esprits, aussi bien que les fortunes du monde.
49
La vérité est
le fondement et la raison de la perfection, et de la beauté ; une chose,
de quelque nature qu’elle soit, ne saurait être belle, et parfaite, si
elle n’est véritablement tout ce qu’elle doit être, et si elle n’a tout
ce qu’elle doit avoir.
50
Il y a de belles choses qui ont plus d’éclat quand elles demeurent imparfaites que quand elles sont trop achevées.
51
La magnanimité
est un noble effort de l’orgueil par lequel il rend l’homme maître de
lui-même pour le rendre maître de toutes choses.
52
Le luxe et la
trop grande politesse dans les États sont le présage assuré de leur
décadence parce que, tous les particuliers s’attachant à leurs intérêts
propres, ils se détournent du bien public.
53
Rien ne prouve
tant que les philosophes ne sont pas si persuadés qu’ils disent que la
mort n’est pas un mal, que le tourment qu’ils se donnent pour établir
l’immortalité de leur nom par la perte de la vie.
54
De toutes les
passions celle qui est la plus inconnue à nous-mêmes, c’est la paresse ;
elle est la plus ardente et la plus maligne de toutes, quoique sa
violence soit insensible, et que les dommages qu’elle cause soient très
cachés ; si nous considérons attentivement son pouvoir, nous verrons
qu’elle se rend en toutes rencontres maîtresse de nos sentiments, de nos
intérêts et de nos plaisirs ; c’est la rémore qui a la force d’arrêter
les plus grands vaisseaux, c’est une bonace plus dangereuse aux plus
importantes affaires que les écueils, et que les plus grandes tempêtes ;
le repos de la paresse est un charme secret de l’âme qui suspend
soudainement les plus ardentes poursuites et les plus opiniâtres
résolutions ; pour donner enfin la véritable idée de cette passion, il
faut dire que la paresse est comme une béatitude de l’âme, qui la
console de toutes ses pertes, et qui lui tient lieu de tous les biens.
55
Il est plus facile de prendre de l’amour quand on n’en a pas, que de s’en défaire quand on en a.
56
La plupart des
femmes se rendent plutôt par faiblesse que par passion ; de là vient que
pour l’ordinaire les hommes entreprenants réussissent mieux que les
autres, quoiqu’ils ne soient pas plus aimables.
57
N’aimer guère en amour est un moyen assuré pour être aimé.
58
La sincérité
que se demandent les amants et les maîtresses, pour savoir l’un et
l’autre quand ils cesseront de s’aimer, est bien moins pour vouloir être
avertis quand on ne les aimera plus que pour être mieux assurés qu’on
les aime lorsque l’on ne dit point le contraire.
59
La plus juste
comparaison qu’on puisse faire de l’amour, c’est celle de la fièvre ;
nous n’avons non plus de pouvoir sur l’un que sur l’autre, soit pour sa
violence ou pour sa durée.
60
La plus grande habileté des moins habiles est de se savoir soumettre à la bonne conduite d’autrui.
2° Maxime retranchée après la deuxième édition.
61
Quand on ne trouve pas son repos en soi-même, il est inutile de le chercher ailleurs.
3° Maximes retranchées après la quatrième édition.
62
Comme on n’est
jamais en liberté d’aimer, ou de cesser d’aimer, l’amant ne peut se
plaindre avec justice de l’inconstance de sa maîtresse, ni elle de la
légèreté de son amant.
63
Quand nous sommes las d’aimer, nous sommes bien aises qu’on nous devienne infidèle, pour nous dégager de notre fidélité.
64
Comment prétendons-nous qu’un autre garde notre secret si nous ne pouvons le garder nous-mêmes ?
65
Il n’y en a
point qui pressent tant les autres que les paresseux lorsqu’ils ont
satisfait à leur paresse, afin de paraître diligents.
66
C’est une preuve de peu d’amitié de ne s’apercevoir pas du refroidissement de celle de nos amis.
67
Les rois font
des hommes comme des pièces de monnaie ; ils les font valoir ce qu’ils
veulent, et l’on est forcé de les recevoir selon leur cours, et non pas
selon leur véritable prix.
68
Il y a des
crimes qui deviennent innocents et même glorieux par leur éclat, leur
nombre et leur excès. De là vient que les voleries publiques sont des
habiletés, et que prendre des provinces injustement s’appelle faire des
conquêtes.
69
On donne plus aisément des bornes à sa reconnaissance qu’à ses espérances et qu’à ses désirs.
70
Nous ne
regrettons pas toujours la perte de nos amis par la considération de
leur mérite, mais par celle de nos besoins et de la bonne opinion qu’ils
avaient de nous.
71
On aime à deviner les autres ; mais l’on n’aime pas à être deviné.
72
C’est une ennuyeuse maladie que de conserver sa santé par un trop grand régime.
73
On craint toujours de voir ce qu’on aime, quand on vient de faire des coquetteries ailleurs.
74
On doit se consoler de ses fautes, quand on a la force de les avouer.
Maximes posthumes
1° Maximes fournies par le manuscrit de Liancourt.
1
Comme la plus
heureuse personne du monde est celle à qui peu de choses suffit, les
grands et les ambitieux sont en ce point les plus misérables qu’il leur
faut l’assemblage d’une infinité de biens pour les rendre heureux.
2
La finesse n’est qu’une pauvre habileté.
3
Les philosophes
ne condamnent les richesses que par le mauvais usage que nous en
faisons ; il dépend de nous de les acquérir et de nous en servir sans
crime et, au lieu qu’elles nourrissent et accroissent les vices, comme
le bois entretient et augmente le feu, nous pouvons les consacrer à
toutes les vertus et les rendre même par là plus agréables et plus
éclatantes.
4
La ruine du prochain plaît aux amis et aux ennemis.
5
Chacun pense être plus fin que les autres.
6
On ne saurait compter toutes les espèces de vanité.
7
Ce qui nous
empêche souvent de bien juger des sentences qui prouvent la fausseté des
vertus, c’est que nous croyons trop aisément qu’elles sont véritables
en nous.
8
Nous craignons toutes choses comme mortels, nous désirons toutes choses comme si nous étions immortels.
9
Dieu a mis des
talents différents dans l’homme comme il a planté de différents arbres
dans la nature, en sorte que chaque talent de même que chaque arbre a
ses propriétés et ses effets qui lui sont tous particuliers ; de là
vient que le poirier le meilleur du monde ne saurait porter les pommes
les plus communes, et que le talent le plus excellent ne saurait
produire les mêmes effets des talents les plus communs ; de là vient
encore qu’il est aussi ridicule de vouloir faire des sentences sans en
avoir la graine en soi que de vouloir qu’un parterre produise des
tulipes quoiqu’on n’y ait point semé les oignons.
10
Une preuve
convaincante que l’homme n’a pas été créé comme il est, c’est que plus
il devient raisonnable et plus il rougit en soi-même de l’extravagance,
de la bassesse et de la corruption de ses sentiments et de ses
inclinations.
11
Il ne faut pas s’offenser que les autres nous cachent la vérité puisque nous nous la cachons si souvent nous-mêmes.
12
Rien ne prouve
davantage combien la mort est redoutable que la peine que les
philosophes se donnent pour persuader qu’on la doit mépriser.
13
Il semble que c’est le diable qui a tout exprès placé la paresse sur la frontière de plusieurs vertus.
14
La fin du bien est un mal ; la fin du mal est un bien.
15
On blâme aisément les défauts des autres, mais on s’en sert rarement à corriger les siens.
16
Les biens et les maux qui nous arrivent ne nous touchent pas selon leur grandeur, mais selon notre sensibilité.
17
Ceux qui prisent trop leur noblesse ne prisent d’ordinaire pas assez ce qui en est l’origine.
18
Le remède de la
jalousie est la certitude de ce qu’on craint, parce qu’elle cause la
fin de la vie ou la fin de l’amour ; c’est un cruel remède, mais il est
plus doux que les doutes et les soupçons.
19
Il est difficile de comprendre combien est grande la ressemblance et la différence qu’il y a entre tous les hommes.
20
Ce qui fait tant disputer contre les maximes qui découvrent le cœur de l’homme, c’est que l’on craint d’y être découvert.
21
L’homme est si
misérable que, tournant toutes ses conduites à satisfaire ses passions,
il gémit incessamment sous leur tyrannie ; il ne peut supporter ni leur
violence ni celle qu’il faut qu’il se fasse pour s’affranchir de leur
joug ; il trouve du dégoût non seulement dans ses vices, mais encore
dans leurs remèdes, et ne peut s’accommoder ni des chagrins de ses
maladies ni du travail de sa guérison.
22
Dieu a permis,
pour punir l’homme du péché originel, qu’il se fît un dieu de son
amour-propre pour en être tourmenté dans toutes les actions de sa vie.
23
L’espérance et la crainte sont inséparables, et il n’y a point de crainte sans espérance ni d’espérance sans crainte.
24
Le pouvoir que les personnes que nous aimons ont sur nous est presque toujours plus grand que celui que nous y avons nous-mêmes.
25
Ce qui nous fait croire si facilement que les autres ont des défauts, c’est la facilité que l’on a de croire ce qu’on souhaite.
26
L’intérêt est
l’âme de l’amour-propre, de sorte que, comme le corps, privé de son âme,
est sans vue, sans ouïe, sans connaissance, sans sentiment et sans
mouvement, de même l’amour-propre séparé, s’il le faut dire ainsi, de
son intérêt, ne voit, n’entend, ne sent et ne se remue plus ; de là
vient qu’un même homme qui court la terre et les mers pour son intérêt
devient soudainement paralytique pour l’intérêt des autres ; de là vient
le soudain assoupissement et cette mort que nous causons à tous ceux à
qui nous contons nos affaires ; de là vient leur prompte résurrection
lorsque dans notre narration nous y mêlons quelque chose qui les
regarde ; de sorte que nous voyons dans nos conversations et dans nos
traités que dans un même moment un homme perd connaissance et revient à
soi, selon que son propre intérêt s’approche de lui ou qu’il s’en
retire.
2° Maximes fournies par des lettres.
27
On ne donne des louanges que pour en profiter.
28
Les passions ne sont que les divers goûts de l’amour propre.
29
L’extrême ennui sert à nous désennuyer.
30
On loue et on blâme la plupart des choses parce que c’est la mode de les louer ou de les blâmer.
31
Il n’est jamais plus difficile de bien parler que lorsqu’on ne parle que de peur de se taire.
3° Maximes fournies par l’édition hollandaise de 1664.
32
Si on avait ôté à ce qu’on appelle force le désir de conserver, et la crainte de perdre, il ne lui resterait pas grand’chose.
33
La familiarité
est un relâchement presque de toutes les règles de la vie civile, que le
libertinage a introduit dans la société pour nous faire parvenir à
celle qu’on appelle commode. C’est un effet de l’amour-propre qui,
voulant tout accommoder à notre faiblesse, nous soustrait à l’honnête
sujétion que nous imposent les bonnes mœurs et, pour chercher trop les
moyens de nous les rendre commodes, le fait dégénérer en vices. Les
femmes, ayant naturellement plus de mollesse que les hommes, tombent
plutôt dans ce relâchement, et y perdent davantage : l’autorité du sexe
ne se maintient pas, le respect qu’on lui doit diminue, et l’on peut
dire que l’honnête y perd la plus grande partie de ses droits.
34
La raillerie
est une gaieté agréable de l’esprit, qui enjoue la conversation, et qui
lie la société si elle est obligeante, ou qui la trouble si elle ne
l’est pas. Elle est plus pour celui qui la fait que pour celui qui la
souffre. C’est toujours un combat de bel esprit, que produit la vanité ;
d’où vient que ceux qui en manquent pour la soutenir, et ceux qu’un
défaut reproché fait rougir, s’en offensent également, comme d’une
défaite injurieuse qu’ils ne sauraient pardonner. C’est un poison qui
tout pur éteint l’amitié et excite la haine, mais qui corrigé par
l’agrément de l’esprit, et la flatterie de la louange, l’acquiert ou la
conserve ; et il en faut user sobrement avec ses amis et avec les
faibles.
4° Maximes fournies par le supplément de l’édition de 1693.
35
Force gens veulent être dévots, mais personne ne veut être humble.
36
Le travail du corps délivre des peines de l’esprit, et c’est ce qui rend les pauvres heureux.
37
Les véritables mortifications sont celles qui ne sont point connues ; la vanité rend les autres faciles.
38
L’humilité est l’autel sur lequel Dieu veut qu’on lui offre des sacrifices.
39
Il faut peu de
choses pour rendre le sage heureux ; rien ne peut rendre un fol
content ; c’est pourquoi presque tous les hommes sont misérables.
40
Nous nous tourmentons moins pour devenir heureux que pour faire croire que nous le sommes.
41
Il est bien plus aisé d’éteindre un premier désir que de satisfaire tous ceux qui le suivent.
42
La sagesse est à l’âme ce que la santé est pour le corps.
43
Les grands de
la terre ne pouvant donner la santé du corps ni le repos d’esprit, on
achète toujours trop cher tous les biens qu’ils peuvent faire.
44
Avant que de désirer fortement une chose, il faut examiner quel est le bonheur de celui qui la possède.
45
Un véritable ami est le plus grand de tous les biens et celui de tous qu’on songe le moins à acquérir.
46
Les amants ne voient les défauts de leurs maîtresses que lorsque leur enchantement est fini.
47
La prudence et l’amour ne sont pas faits l’un pour l’autre : à mesure que l’amour croît, la prudence diminue.
48
Il est quelquefois agréable à un mari d’avoir une femme jalouse : il entend toujours parler de ce qu’il aime.
49
Qu’une femme est à plaindre, quand elle a tout ensemble de l’amour et de la vertu !
50
Le sage trouve mieux son compte à ne point s’engager qu’à vaincre.
51
Il est plus nécessaire d’étudier les hommes que les livres.
52
Le bonheur ou le malheur vont d’ordinaire à ceux qui ont le plus de l’un ou de l’autre.
53
On ne se blâme que pour être loué.
54
Il n’est rien de plus naturel ni de plus trompeur que de croire qu’on est aimé.
55
Nous aimons mieux voir ceux à qui nous faisons du bien que ceux qui nous en font.
56
Il est plus difficile de dissimuler les sentiments que l’on a que de feindre ceux que l’on n’a pas.
57
Les amitiés renouées demandent plus de soins que celles qui n’ont jamais été rompues.
58
Un homme à qui personne ne plaît est bien plus malheureux que celui qui ne plaît à personne.
5° Maximes fournies par des témoignages de contemporains
59
L’enfer des femmes, c’est la vieillesse.
60
Les soumissions
et les bassesses que les seigneurs de la Cour font auprès des ministres
qui ne sont pas de leur rang sont des lâchetés de gens de cœur.
61
L’honnêteté [n’est] d’aucun état en particulier, mais de tous les états en général.
Réflexions Diverses
I. Du vrai
Le vrai, dans quelque sujet qu’il se trouve, ne peut être effacé
par aucune comparaison d’un autre vrai, et quelque différence qui puisse
être entre deux sujets, ce qui est vrai dans l’un n’efface point ce qui
est vrai dans l’autre : ils peuvent avoir plus ou moins d’étendue et
être plus ou moins éclatants, mais ils sont toujours égaux par leur
vérité, qui n’est pas plus vérité dans le plus grand que dans le plus
petit. L’art de la guerre est plus étendu, plus noble et plus brillant
que celui de la poésie ; mais le poète et le conquérant sont comparables
l’un à l’autre ; comme aussi, en tant qu’ils sont véritablement ce
qu’ils sont, le législateur et le peintre, etc.
Deux sujets de même nature peuvent être différents, et même
opposés, comme le sont Scipion et Annibal, Fabius Maximus et Marcellus ;
cependant, parce que leurs qualités sont vraies, elles subsistent en
présence l’une de l’autre, et ne s’effacent point par la comparaison.
Alexandre et César donnent des royaumes ; la veuve donne une pite :
quelque différents que soient ces présents, la libéralité est vraie et
égale en chacun d’eux, et chacun donne à proportion de ce qu’il est.
Un sujet peut avoir plusieurs vérités, et un autre sujet peut
n’en avoir qu’une : le sujet qui a plusieurs vérités est d’un plus grand
prix, et peut briller par des endroits où l’autre ne brille pas ; mais
dans l’endroit où l’un et l’autre est vrai, ils brillent également.
Epaminondas était grand capitaine, bon citoyen, grand philosophe ; il
était plus estimable que Virgile, parce qu’il avait plus de vérités que
lui ; mais comme grand capitaine, Epaminondas n’était pas plus excellent
que Virgile comme grand poète, parce que, par cet endroit, il n’était
pas plus vrai que lui. La cruauté de cet enfant qu’un consul fit mourir
pour avoir crevé les yeux d’une corneille était moins importante que
celle de Philippe second, qui fit mourir son fils, et elle était
peut-être mêlée avec moins d’autres vices ; mais le degré de cruauté
exercée sur un simple animal ne laisse pas de tenir son rang avec la
cruauté des princes les plus cruels, parce que leurs différents degrés
de cruauté ont une vérité égale.
Quelque disproportion qu’il y ait entre deux maisons qui ont les
beautés qui leur conviennent, elles ne s’effacent point l’une l’autre :
ce qui fait que Chantilly n’efface point Liancourt, bien qu’il ait
infiniment plus de diverses beautés, et que Liancourt n’efface pas aussi
Chantilly, c’est que Chantilly a les beautés qui conviennent à la
grandeur de Monsieur le Prince, et que Liancourt a les beautés qui
conviennent à un particulier, et qu’ils ont chacun de vraies beautés. On
voit néanmoins des femmes d’une beauté éclatante, mais irrégulière, qui
en effacent souvent de plus véritablement belles ; mais comme le goût,
qui se prévient aisément, est le juge de la beauté, et que la beauté des
plus belles personnes n’est pas toujours égale, s’il arrive que les
moins belles effacent les autres, ce sera seulement durant quelques
moments ; ce sera que la différence de la lumière et du jour fera plus
ou moins discerner la vérité qui est dans les traits ou dans les
couleurs, qu’elle fera paraître ce que la moins belle aura de beau, et
empêchera de paraître ce qui est de vrai et de beau dans l’autre.
II. De la société
Mon dessein n’est pas de parler de l’amitié en parlant de la
société ; bien qu’elles aient quelque rapport, elles sont néanmoins très
différentes : la première a plus d’élévation et de dignité, et le plus
grand mérite de l’autre, c’est de lui ressembler. Je ne parlerai donc
présentement que du commerce particulier que les honnêtes gens doivent
avoir ensemble.
Il serait inutile de dire combien la société est nécessaire aux
hommes : tous la désirent et tous la cherchent, mais peu se servent des
moyens de la rendre agréable et de la faire durer. Chacun veut trouver
son plaisir et ses avantages aux dépens des autres ; on se préfère
toujours à ceux avec qui on se propose de vivre, et on leur fait presque
toujours sentir cette préférence ; c’est ce qui trouble et qui détruit
la société. Il faudrait du moins savoir cacher ce désir de préférence,
puisqu’il est trop naturel en nous pour nous en pouvoir défaire ; il
faudrait faire son plaisir et celui des autres, ménager leur
amour-propre, et ne le blesser jamais.
L’esprit a beaucoup de part à un si grand ouvrage, mais il ne
suffit pas seul pour nous conduire dans les divers chemins qu’il faut
tenir. Le rapport qui se rencontre entre les esprits ne maintiendrait
pas longtemps la société, si elle n’était réglée et soutenue par le bon
sens, par l’humeur, et par des égards qui doivent être entre les
personnes qui veulent vivre ensemble. S’il arrive quelquefois que des
gens opposés d’humeur et d’esprit paraissent unis, ils tiennent sans
doute par des liaisons étrangères, qui ne durent pas longtemps. On peut
être aussi en société avec des personnes sur qui nous avons de la
supériorité par la naissance ou par des qualités personnelles ; mais
ceux qui ont cet avantage n’en doivent pas abuser ; ils doivent rarement
le faire sentir, et ne s’en servir que pour instruire les autres ; ils
doivent les faire apercevoir qu’ils ont besoin d’être conduits, et le
mener par raison, en s’accommodant autant qu’il est possible à leurs
sentiments et à leurs intérêts.
Pour rendre la société commode, il faut que chacun conserve sa
liberté : il faut se voir, ou ne se voir point, sans sujétion, se
divertir ensemble, et même s’ennuyer ensemble ; il faut se pouvoir
séparer, sans que cette séparation apporte de changement ; il faut se
pouvoir passer les uns des autres, si on ne veut pas s’exposer à
embarrasser quelquefois, et on doit se souvenir qu’on incommode souvent,
quand on croit ne pouvoir jamais incommoder. Il faut contribuer, autant
qu’on le peut, au divertissement des personnes avec qui on veut vivre ;
mais il ne faut pas être toujours chargé du soin d’y contribuer. La
complaisance est nécessaire dans la société, mais elle doit avoir des
bornes : elle devient une servitude quand elle est excessive ; il faut
du moins qu’elle paraisse libre, et qu’en suivant le sentiment de nos
amis, ils soient persuadés que c’est le nôtre aussi que nous suivons.
Il faut être facile à excuser nos amis, quand leurs défauts sont
nés avec eux, et qu’ils sont moindres que leurs bonnes qualités ; il
faut souvent éviter de leur faire voir qu’on les ait remarqués et qu’on
en soit choqué, et on doit essayer de faire en sorte qu’ils puissent
s’en apercevoir eux-mêmes, pour leur laisser le mérite de s’en corriger.
Il y a une sorte de politesse qui est nécessaire dans le commerce
des honnêtes gens ; elle leur fait entendre raillerie, et elle les
empêche d’être choqués et de choquer les autres par de certaines façons
de parler trop sèches et trop dures, qui échappent souvent sans y
penser, quand on soutient son opinion avec chaleur.
Le commerce des honnêtes gens ne peut subsister sans une certaine
sorte de confiance ; elle doit être commune entre eux ; il faut que
chacun ait un air de sûreté et de discrétion qui ne donne jamais lieu de
craindre qu’on puisse rien dire par imprudence.
Il faut de la variété dans l’esprit : ceux qui n’ont que d’une
sorte d’esprit ne peuvent plaire longtemps. On peut prendre des routes
diverses, n’avoir pas les mêmes vues ni les mêmes talents, pourvu qu’on
aide au plaisir de la société, et qu’on y observe la même justesse que
les différentes voix et les divers instruments doivent observer dans la
musique.
Comme il est malaisé que plusieurs personnes puissent avoir les
mêmes intérêts, il est nécessaire au moins, pour la douceur de la
société, qu’ils n’en aient pas de contraires.
On doit aller au-devant de ce qui peut plaire à ses amis,
chercher les moyens de leur être utile, leur épargner des chagrins, leur
faire voir qu’on les partage avec eux quand on ne peut les détourner,
les effacer insensiblement sans prétendre de les arracher tout d’un
coup, et mettre en la place des objets agréables, ou du moins qui les
occupent. On peut leur parler des choses qui les regardent, mais ce
n’est qu’autant qu’ils le permettent, et on y doit garder beaucoup de
mesure ; il y a de la politesse, et quelquefois même de l’humanité, à ne
pas entrer trop avant dans les replis de leur cœur ; ils ont souvent de
la peine à laisser voir tout ce qu’ils en connaissent, et ils en ont
encore davantage quand on pénètre ce qu’ils ne connaissent pas. Bien que
le commerce que les honnêtes gens ont ensemble leur donne de la
familiarité, et leur fournisse un nombre infini de sujets de se parler
sincèrement, personne presque n’a assez de docilité et de bon sens pour
bien recevoir plusieurs avis qui sont nécessaires pour maintenir la
société : on veut être averti jusqu’à un certain point, mais on ne veut
pas l’être en toutes choses, et on craint de savoir toutes sortes de
vérités.
Comme on doit garder des distances pour voir les objets, il en
faut garder aussi pour la société : chacun a son point de vue, d’où il
veut être regardé ; on a raison, le plus souvent, de ne vouloir pas être
éclairé de trop près, et il n’y a presque point d’homme qui veuille, en
toutes choses, se laisser voir tel qu’il est.
III. De l’air et des manières
Il y a un air qui convient à la figure et aux talents de chaque
personne ; on perd toujours quand on le quitte pour en prendre un autre.
Il faut essayer de connaître celui qui nous est naturel, n’en point
sortir, et le perfectionner autant qu’il nous est possible.
Ce qui fait que la plupart des petits enfants plaisent, c’est
qu’ils sont encore renfermés dans cet air et dans ces manières que la
nature leur a donnés, et qu’ils n’en connaissent point d’autres. Ils les
changent et les corrompent quand ils sortent de l’enfance : ils croient
qu’il faut imiter ce qu’ils voient faire aux autres, et ils ne le
peuvent parfaitement imiter ; il y a toujours quelque chose de faux et
d’incertain dans cette imitation. Ils n’ont rien de fixe dans leurs
manières ni dans leurs sentiments ; au lieu d’être en effet ce qu’ils
veulent paraître, ils cherchent à paraître ce qu’ils ne sont pas. Chacun
veut être un autre, et n’être plus ce qu’il est : ils cherchent une
contenance hors d’eux-mêmes, et un autre esprit que le leur ; ils
prennent des tons et des manières au hasard ; ils en font l’expérience
sur eux, sans considérer que ce qui convient à quelques-uns ne convient
pas à tout le monde, qu’il n’y a point de règle générale pour les tons
et pour les manières, et qu’il n’y a point de bonnes copies. Deux hommes
néanmoins peuvent avoir du rapport en plusieurs choses sans être copie
l’un de l’autre, si chacun suit son naturel ; mais personne presque ne
le suit entièrement. On aime à imiter ; on imite souvent, même sans s’en
apercevoir, et on néglige ses propres biens pour des biens étrangers,
qui d’ordinaire ne nous conviennent pas.
Je ne prétends pas, par ce que je dis, nous renfermer tellement
en nous-mêmes que nous n’ayons pas la liberté de suivre des exemples, et
de joindre à nous des qualités utiles ou nécessaires que la nature ne
nous a pas données : les arts et les sciences conviennent à la plupart
de ceux qui s’en rendent capables, la bonne grâce et la politesse
conviennent à tout le monde ; mais ces qualités acquises doivent avoir
un certain rapport et une certaine union avec nos propres qualités, qui
les étendent et les augmentent imperceptiblement.
Nous sommes quelquefois élevés à un rang et à des dignités
au-dessus de nous, nous sommes souvent engagés dans une profession
nouvelle où la nature ne nous avait pas destinés ; tous ces états ont
chacun un air qui leur convient, mais qui ne convient pas toujours avec
notre air naturel ; ce changement de notre fortune change souvent notre
air et nos manières, et y ajoute l’air de la dignité, qui est toujours
faux quand il est trop marqué et qu’il n’est pas joint et confondu avec
l’air que la nature nous a donné : il faut les unir et les mêler
ensemble et qu’ils ne paraissent jamais séparés.
On ne parle pas de toutes choses sur un même ton et avec les
mêmes manières ; on ne marche pas à la tête d’un régiment comme on
marche en se promenant. Mais il faut qu’un même air nous fasse dire
naturellement des choses différentes, et qu’il nous fasse marcher
différemment, mais toujours naturellement, et comme il convient de
marcher à la tête d’un régiment et à une promenade.
Il y en a qui ne se contentent pas de renoncer à leur air propre
et naturel, pour suivre celui du rang et des dignités où ils sont
parvenus ; il y en a même qui prennent par avance l’air des dignités et
du rang où ils aspirent. Combien de lieutenants généraux apprennent à
paraître maréchaux de France ! Combien de gens de robe répètent
inutilement l’air de chancelier, et combien de bourgeoises se donnent
l’air de duchesses !
Ce qui fait qu’on déplaît souvent, c’est que personne ne sait
accorder son air et ses manières avec sa figure, ni ses tons et ses
paroles avec ses pensées et ses sentiments ; on trouble leur harmonie
par quelque chose de faux et d’étranger ; on s’oublie soi-même, et on
s’en éloigne insensiblement. Tout le monde presque tombe, par quelque
endroit, dans ce défaut ; personne n’a l’oreille assez juste pour
entendre parfaitement cette sorte de cadence. Mille gens déplaisent avec
des qualités aimables, mille gens plaisent avec de moindres talents :
c’est que les uns veulent paraître ce qu’ils ne sont pas, les autres
sont ce qu’ils paraissent ; et enfin, quelques avantages ou quelques
désavantages que nous ayons reçus de la nature, on plaît à proportion de
ce qu’on suit l’air, les tons, les manières et les sentiments qui
conviennent à notre état et à notre figure, et on déplaît à proportion
de ce qu’on s’en éloigne.
IV. De la conversation
Ce qui fait que si peu de personnes sont agréables dans la
conversation, c’est que chacun songe plus à ce qu’il veut dire qu’à ce
que les autres disent. Il faut écouter ceux qui parlent, si on en veut
être écouté ; il faut leur laisser la liberté de se faire entendre, et
même de dire des choses inutiles. Au lieu de les contredire ou de les
interrompre, comme on fait souvent, on doit, au contraire, entrer dans
leur esprit et dans leur goût, montrer qu’on les entend, leur parler de
ce qui les touche, louer ce qu’ils disent autant qu’il mérite d’être
loué, et faire voir que c’est plus par choix qu’on le loue que par
complaisance. Il faut éviter de contester sur des choses indifférentes,
faire rarement des questions inutiles, ne laisser jamais croire qu’on
prétend avoir plus de raison que les autres, et céder aisément
l’avantage de décider.
On doit dire des choses naturelles, faciles et plus ou moins
sérieuses, selon l’humeur et l’inclinaison des personnes que l’on
entretient, ne les presser pas d’approuver ce qu’on dit, ni même d’y
répondre. Quand on a satisfait de cette sorte aux devoirs de la
politesse, on peut dire ses sentiments, sans prévention et sans
opiniâtreté, en faisant paraître qu’on cherche à les appuyer de l’avis
de ceux qui écoutent.
Il faut éviter de parler longtemps de soi-même, et de se donner
souvent pour exemple. On ne saurait avoir trop d’application à connaître
la pente et la portée de ceux à qui on parle, pour se joindre à
l’esprit de celui qui en a le plus, et pour ajouter ses pensées aux
siennes, en lui faisant croire, autant qu’il est possible, que c’est de
lui qu’on les prend. Il y a de l’habileté à n’épuiser pas les sujets
qu’on traite, et à laisser toujours aux autres quelque chose à penser et
à dire.
On ne doit jamais parler avec des airs d’autorité, ni se servir
de paroles et de termes plus grands que les choses. On peut conserver
ses opinions, si elles sont raisonnables ; mais en les conservant, il ne
faut jamais blesser les sentiments des autres, ni paraître choqué de ce
qu’ils ont dit. Il est dangereux de vouloir être toujours le maître de
la conversation, et de parler trop souvent d’une même chose ; on doit
entrer indifféremment sur tous les sujets agréables qui se présentent,
et ne faire jamais voir qu’on veut entraîner la conversation sur ce
qu’on a envie de dire.
Il est nécessaire d’observer que toute sorte de conversation,
quelque honnête et quelque spirituelle qu’elle soit, n’est pas également
propre à toute sorte d’honnêtes gens : il faut choisir ce qui convient à
chacun, et choisir même le temps de le dire ; mais s’il y a beaucoup
d’art à parler, il n’y en a pas moins à se taire. Il y a un silence
éloquent : il sert quelquefois à approuver et à condamner ; il y a un
silence moqueur ; il y a un silence respectueux ; il y a des airs, des
tours et des manières qui font souvent ce qu’il y a d’agréable ou de
désagréable, de délicat ou de choquant dans la conversation. Le secret
de s’en bien servir est donné à peu de personnes ; ceux mêmes qui en
font des règles s’y méprennent quelquefois ; la plus sûre, à mon avis,
c’est de n’en point avoir qu’on ne puisse changer, de laisser plutôt
voir des négligences dans ce qu’on dit que de l’affectation, d’écouter,
de ne parler guère, et de ne se forcer jamais à parler.
V. De la confiance
Bien que la sincérité et la confiance aient du rapport, elles
sont néanmoins différentes en plusieurs choses : la sincérité est une
ouverture de cœur, qui nous montre tels que nous sommes ; c’est un amour
de la vérité, une répugnance à se déguiser, un désir de se dédommager
de ses défauts, et de les diminuer même par le mérite de les avouer. La
confiance ne nous laisse pas tant de liberté, ses règles sont plus
étroites, elle demande plus de prudence et de retenue, et nous ne sommes
pas toujours libres d’en disposer : il ne s’agit pas de nous
uniquement, et nos intérêts sont mêlés d’ordinaire avec les intérêts des
autres. Elle a besoin d’une grande justesse pour ne livrer pas nos amis
en nous livrant nous-mêmes, et pour ne faire pas des présents de leur
bien dans la vue d’augmenter le prix de ce que nous donnons.
La confiance plaît toujours à celui qui la reçoit : c’est un
tribut que nous payons à son mérite ; c’est un dépôt que l’on commet à
sa foi ; ce sont des gages qui lui donnent un droit sur nous, et une
sorte de dépendance où nous nous assujettissons volontairement. Je ne
prétends pas détruire par ce que je dis la confiance, si nécessaire
entre les hommes puisqu’elle est le lien de la société et de l’amitié ;
je prétends seulement y mettre des bornes, et la rendre honnête et
fidèle. Je veux qu’elle soit toujours vraie et toujours prudente, et
qu’elle n’ait ni faiblesse ni intérêt ; je sais bien qu’il est malaisé
de donner de justes limites à la manière de recevoir toute sorte de
confiance de nos amis, et de leur faire part de la nôtre.
On se confie le plus souvent par vanité, par envie de parler, par
le désir de s’attirer la confiance des autres, et pour faire un échange
de secrets. Il y a des personnes qui peuvent avoir raison de se fier en
nous, vers qui nous n’aurions pas raison d’avoir la même conduite, et
on s’acquitte envers ceux-ci en leur gardant le secret, et en les payant
de légères confidences. Il y en a d’autres dont la fidélité nous est
connue, qui ne ménagent rien avec nous, et à qui on peut se confier par
choix et par estime. On doit ne leur rien cacher de ce qui ne regarde
que nous, se montrer à eux toujours vrais dans nos bonnes qualités et
dans nos défauts même, sans exagérer les unes et sans diminuer les
autres, se faire une loi de ne leur faire jamais de demi-confidences ;
elles embarrassent toujours ceux qui les font, et ne contentent presque
jamais ceux qui les reçoivent : on leur donne des lumières confuses de
ce qu’on veut cacher, on augmente leur curiosité, on les met en droit
d’en vouloir savoir davantage, et ils se croient en liberté de disposer
de ce qu’ils ont pénétré. Il est plus sûr et plus honnête de ne leur
rien dire que de se taire quand on a commencé de parler.
Il y a d’autres règles à suivre pour les choses qui nous ont été
confiées. Plus elles sont importantes, et plus la prudence et la
fidélité y sont nécessaires. Tout le monde convient que le secret doit
être inviolable, mais on ne convient pas toujours de la nature et de
l’importance du secret ; nous ne consultons le plus souvent que
nous-mêmes sur ce que nous devons dire et sur ce que nous devons taire ;
il y a peu de secrets de tous les temps, et le scrupule de les révéler
ne dure pas toujours.
On a des liaisons étroites avec des amis dont on connaît la
fidélité ; ils nous ont toujours parlé sans réserve, et nous avons
toujours gardé les mêmes mesures avec eux ; ils savent nos habitudes et
nos commerces, et il nous voient de trop près pour ne s’apercevoir pas
du moindre changement ; ils peuvent savoir par ailleurs ce que nous
sommes engagés de ne dire jamais à personne ; il n’a pas été en notre
pouvoir de les faire entrer dans ce qu’on nous a confié ; ils ont
peut-être même quelque intérêt de le savoir ; on est assuré d’eux comme
de soi, et on se voit réduit à la cruelle nécessité de prendre leur
amitié, qui nous est précieuse, ou de manquer à la foi du secret. Cet
état est sans doute la plus rude épreuve de la fidélité ; mais il ne
doit pas ébranler un honnête homme : c’est alors qu’il lui est permis de
se préférer aux autres ; son premier devoir est de conserver
indispensablement ce dépôt en son entier, sans en peser les suites ; il
doit non seulement ménager ses paroles et ses tons, il doit encore
ménager ses conjectures, et ne laisser jamais rien voir, dans ses
discours ni dans son air, qui puisse tourner l’esprit des autres vers ce
qu’il ne veut pas dire.
On a souvent besoin de force et de prudence pour opposer à la
tyrannie de la plupart de nos amis, qui se font un droit sur notre
confiance, et qui veulent tout savoir de nous. On ne doit jamais leur
laisser établir ce droit sans exception : il y a des rencontres et des
circonstances qui ne sont pas de leur juridiction ; s’ils s’en
plaignent, on doit souffrir leur plaintes, et s’en justifier avec
douceur ; mais s’ils demeurent injustes, on doit sacrifier leur amitié à
son devoir, et choisir entre deux maux inévitables, dont l’un se peut
réparer, et l’autre est sans remède.
VI. De l’amour et de la mer
Ceux qui ont voulu nous représenter l’amour et ses caprices l’ont
comparé en tant de sortes à la mer qu’il est malaisé de rien ajouter à
ce qu’ils en ont dit. Ils nous ont fait voir que l’un et l’autre ont une
inconstance et une infidélité égales, que leurs biens et leurs maux
sont sans nombre, que les navigations les plus heureuses sont exposées à
mille dangers, que les tempêtes et les écueils sont toujours à
craindre, et que souvent même on fait naufrage dans le port. Mais en
nous exprimant tant d’espérances et tant de craintes, ils ne nous pas
assez montré, ce me semble, le rapport qu’il y a d’un amour usé,
languissant et sur sa fin, à ces longues bonaces, à ces calmes ennuyeux,
que l’on rencontre sous la ligne : on est fatigué d’un grand voyage, on
souhaite de l’achever ; on voit la terre, mais on manque de vent pour y
arriver ; on se voit exposé aux injures des saisons ; les maladies et
les langueurs empêchent d’agir ; l’eau et les vivres manquent ou
changent de goût ; on a recours inutilement aux secours étrangers ; on
essaye de pêcher, et on prend quelques poissons, sans en tirer de
soulagement ni de nourriture ; on est las de tout ce qu’on voit, on est
toujours avec ses mêmes pensées, et on est toujours ennuyé ; on vit
encore, et on a regret à vivre ; on attend des désirs pour sortir d’un
état pénible et languissant, mais on n’en forme que de faibles et
d’inutiles.
VII. Des exemples
Quelque différence qu’il y ait entre les bons et les mauvais
exemples, on trouvera que les uns et les autres ont presque également
produit de méchants effets. Je ne sais même si les crimes de Tibère et
de Néron ne nous éloignent pas plus du vice que les exemples estimables
des plus grands hommes ne nous approchent de la vertu. Combien la valeur
d’Alexandre a-t-elle fait de fanfarons ! Combien la gloire de César
a-t-elle autorisé d’entreprises contre la patrie ! Combien Rome et
Sparte ont-elles loué de vertus farouches ! Combien Diogène a-t-il fait
de philosophes importuns, Cicéron de babillards, Pomponius Atticus de
gens neutres et paresseux, Marius et Sylla de vindicatifs, Lucullus de
voluptueux, Alcibiade et Antoine de débauchés, Capon d’opiniâtres ! Tous
ces grands originaux ont produit un nombre infini de mauvaises copies.
Le vertus sont frontières des vices ; les exemples sont des guides qui
nous égarent souvent, et nous sommes si remplis de fausseté que nous ne
nous en servons pas moins pour nous éloigner du chemin de la vertu que
pour le suivre.
VIII. De l’incertitude de la jalousie
Plus on parle de sa jalousie, et plus les endroits qui ont déplu
paraissent de différents côtés ; les moindres circonstances les
changent, et font toujours découvrir quelque chose de nouveau. Ces
nouveautés font revoir sous d’autres apparences ce qu’on croyait avoir
assez vu et assez pesé ; on cherche à s’attacher à une opinion, et on ne
s’attache à rien ; tout ce qui est de plus opposé et de plus effacé se
présente en même temps ; on veut haïr et on veut aimer, mais on aime
encore quand on hait, et on hait encore quand on aime ; on croit tout,
et on doute de tout ; on a de la honte et du dépit d’avoir cru et
d’avoir douté ; on se travaille incessamment pour arrêter son opinion,
et on ne la conduit jamais à un lieu fixe.
Les poètes devraient comparer cette opinion à la peine de
Sisyphe, puisqu’on roule aussi inutilement que lui un rocher, par un
chemin pénible et périlleux : on voit le sommet de la montagne et on
s’efforce d’y arriver, on l’espère quelquefois, mais on n’y arrive
jamais. On n’est pas assez heureux pour oser croire ce qu’on souhaite,
ni même assez heureux aussi pour être assuré de ce qu’on craint le plus.
On est assujetti à une incertitude éternelle, qui nous présente
successivement des biens et des maux qui nous échappent toujours.
IX. De l’amour et de la vie
L’amour est une image de notre vie : l’un et l’autre sont sujets
aux mêmes révolutions et aux mêmes changements. Leur jeunesse est pleine
de joie et d’espérance : on se trouve heureux d’être jeune, comme on se
trouve heureux d’aimer. Cet état si agréable nous conduit à désirer
d’autres biens, et on en veut de plus solides ; on ne se contente pas de
subsister, on veut faire des progrès, on est occupé des moyens de
s’avancer et d’assurer sa fortune ; on cherche la protection des
ministres, on se rend utile à leurs intérêts ; on ne peut souffrir que
quelqu’un prétende ce que nous prétendons. Cette émulation est traversée
de mille soins et de mille peines, qui s’effacent par le plaisir de se
voir établi : toutes les passions sont alors satisfaites, et on ne
prévoit pas qu’on puisse cesser d’être heureux.
Cette félicité néanmoins est rarement de longue durée, et elle ne
peut conserver longtemps la grâce de la nouveauté. Pour avoir ce que
nous avons souhaité, nous ne laissons pas de souhaiter encore. Nous nous
accoutumons à tout ce qui est à nous ; les mêmes biens ne conservent
pas leur même prix, et ils ne touchent pas toujours également notre
goût ; nous changeons imperceptiblement, sans remarquer notre
changement ; ce que nous avons obtenu devient une partie de nous-même :
nous serions cruellement touchés de le perdre, mais nous ne sommes plus
sensibles au plaisir de le conserver ; la joie n’est plus vive, on en
cherche ailleurs que dans ce qu’on a tant désiré. Cette inconstance
involontaire est un effet du temps, qui prend malgré nous sur l’amour
comme sur notre vie ; il en efface insensiblement chaque jour un certain
air de jeunesse et de gaieté, et en détruit les plus véritables
charmes ; on prend des manières plus sérieuses, on joint des affaires à
la passion ; l’amour ne subsiste plus par lui-même, et il emprunte des
secours étrangers. Cet état de l’amour représente le penchant de l’âge,
où on commence à voir par où on doit finir ; mais on n’a pas la force de
finir volontairement, et dans le déclin de l’amour comme dans le déclin
de la vie personne ne se peut résoudre de prévenir les dégoûts qui
restent à éprouver ; on vit encore pour les maux, mais on ne vit plus
pour les plaisirs. La jalousie, la méfiance, la crainte de lasser, la
crainte d’être quitté, sont des peines attachées à la vieillesse de
l’amour, comme les maladies sont attachées à la trop longue durée de la
vie : on ne sent plus qu’on est vivant que parce qu’on sent qu’on est
malade, et on ne sent aussi qu’on est amoureux que par sentir toutes les
peines de l’amour. On ne sort de l’assoupissement des trop longs
attachements que par le dépit et le chagrin de se voir toujours
attaché ; enfin, de toutes les décrépitudes, celle de l’amour est la
plus insupportable.
X. Des goûts
Il y a des personnes qui ont plus d’esprit que de goût, et
d’autres qui ont plus de goût que d’esprit ; il y a plus de variété et
de caprice dans le goût que dans l’esprit.
Ce terme de goût a diverses significations, et il est aisé de s’y
méprendre. Il y a différence entre le goût qui nous porte vers les
choses, et le goût qui nous en fait connaître et discerner les qualités,
en s’attachant aux règles : on peut aimer la comédie sans avoir le goût
assez fin et assez délicat pour en bien juger, et on peut avoir le goût
assez bon pour bien juger de la comédie sans l’aimer. Il y a des goûts
qui nous approchent imperceptiblement de ce qui se montre à nous ;
d’autres nous entraînent par leur force ou par leur durée.
Il y a des gens qui ont le goût faux en tout ; d’autres ne l’ont
faux qu’en de certaines choses, et ils l’ont droit et juste dans ce qui
est de leur portée. D’autres ont des goûts particuliers, qu’ils
connaissent mauvais, et ne laissent pas de les suivre. Il y en a qui ont
le goût incertain ; le hasard en décide ; ils changent par légèreté, et
sont touchés de plaisir ou d’ennui sur la parole de leurs amis.
D’autres sont toujours prévenus ; ils sont esclaves de tous leurs goûts,
et les respectent en toutes choses. Il y en a qui sont sensibles à ce
qui est bon, et choqués de ce qui ne l’est pas ; leurs vues sont nettes
et justes, et il trouvent la raison de leur goût dans leur esprit et
dans leur discernement.
Il y en a qui, par une sorte d’instinct dont ils ignorent la
cause, décident de ce qui se présente à eux, et prennent toujours le bon
parti. Ceux-ci font paraître plus de goût que d’esprit, parce que leur
amour-propre et leur humeur ne prévalent point sur leurs lumières
naturelles ; tout agit de concert en eux, tout y est sur un même ton.
Cet accord les fait juger sainement des objets, et leur en forme une
idée véritable ; mais, à parler généralement, il y a peu de gens qui
aient le goût fixe et indépendant de celui des autres ; ils suivent
l’exemple et la coutume, et ils en empruntent presque tout ce qu’ils ont
de goût.
Dans toutes ces différences de goûts que l’on vient de marquer,
il est très rare, et presque impossible, de rencontrer cette sorte de
bon goût qui sait donner le prix à chaque chose, qui en connaît toute la
valeur, et qui se porte généralement sur tout : nos connaissances sont
trop bornées, et cette juste disposition des qualités qui font bien
juger ne se maintient d’ordinaire que sur ce qui ne nous regarde pas
directement. Quand il s’agit de nous, notre goût n’a plus cette justesse
si nécessaire, la préoccupation la trouble, tout ce qui a du rapport à
nous nous paraît sous une autre figure. Personne ne voit des mêmes yeux
ce qui le touche et ce qui ne le touche pas ; notre goût est conduit
alors par la pente de l’amour-propre et de l’humeur, qui nous
fournissent des vues nouvelles, et nous assujettissent à un nombre
infini de changements et d’incertitudes ; notre goût n’est plus à nous,
nous n’en disposons plus, il change sans notre consentement, et les
mêmes objets nous paraissent par tant de côtés différents que nous
méconnaissons enfin ce que nous avons vu et ce que nous avons senti.
XI. Du rapport des hommes avec les animaux
Il y a autant de diverses espèces d’hommes qu’il y a de diverses
espèces d’animaux, et les hommes sont, à l’égard des autres hommes, ce
que les différentes espèces d’animaux sont entre elles et à l’égard les
unes des autres.
Combien y a-t-il d’hommes qui vivent du sang et de la vie des
innocents, les uns comme des tigres, toujours farouches et toujours
cruels, d’autres comme des lions, en gardant quelque apparence de
générosité, d’autres comme des ours, grossiers et avides, d’autres comme
des loups, ravissants et impitoyables, d’autres comme des renards, qui
vivent d’industrie, et dont le métier est de tromper !
Combien y a-t-il d’hommes qui ont du rapport aux chiens ! Ils
détruisent leur espèce ; ils chassent pour le plaisir de celui qui les
nourrit ; les uns suivent toujours leur maître, les autres gardent sa
maison. Il y a des lévriers d’attache, qui vivent de leur valeur, qui se
destinent à la guerre, et qui ont de la noblesse dans leur courage ; il
y a des dogues acharnés, qui n’ont de qualités que la fureur ; il y a
des chiens, plus ou moins inutiles, qui aboient souvent, et qui mordent
quelquefois, et il y a même des chiens de jardinier. Il y a des singes
et des guenons qui plaisent par leurs manières, qui ont de l’esprit, et
qui font toujours du mal. Il y a des paons qui n’ont que de la beauté,
qui déplaisent par leur chant, et qui détruisent les lieux qu’ils
habitent.
Il y a des oiseaux qui ne sont recommandables que par leur ramage
ou par leurs couleurs. Combien de perroquets, qui parlent sans cesse,
et qui n’entendent jamais ce qu’ils disent ; combien de pies et de
corneilles, qui ne s’apprivoisent que pour dérober ; combien d’oiseaux
de proie, qui ne vivent que de rapine ; combien d’espèces d’animaux
paisibles et tranquilles, qui ne servent qu’à nourrir d’autres animaux !
Il y a des chats, toujours au guet, malicieux et infidèles, et
qui font patte de velours ; il y a des vipères dont la langue est
venimeuse, et dont le reste est utile ; il y a des araignées, des
mouches, des punaises et des puces, qui sont toujours incommodes et
insupportables ; il y a des crapauds, qui font horreur, et qui n’ont que
du venin ; il y a des hiboux, qui craignent la lumière. Combien
d’animaux qui vivent sous terre pour se conserver ! Combien de chevaux,
qu’on emploie à tant d’usages, et qu’on abandonne quand ils ne servent
plus ; combien de bœufs, qui travaillent toute leur vie pour enrichir
celui qui leur impose le joug ; de cigales, qui passent leur vie à
chanter ; de lièvres, qui ont peur de tout ; de lapins, qui
s’épouvantent et rassurent en un moment ; de pourceaux, qui vivent dans
la crapule et dans l’ordure ; de canards privés, qui trahissent leurs
semblables, et les attirent dans les filets, de corbeaux et de vautours,
qui ne vivent que de pourriture et de corps morts ! Combien d’oiseaux
passagers, qui vont si souvent d’un bout du monde à l’autre, et qui
s’exposent à tant de périls, pour chercher à vivre ! combien
d’hirondelles, qui suivent toujours le beau temps ; de hannetons,
inconsidérés et sans dessein ; de papillons, qui cherchent le feu qui
les brûle ! Combien d’abeilles, qui respectent leur chef, et qui se
maintiennent avec tant de règle et d’industrie ! combien de frelons,
vagabonds et fainéants, qui cherchent à s’établir aux dépens des
abeilles ! Combien de fourmis, dont la prévoyance et l’économie
soulagent tous leurs besoins ! combien de crocodiles, qui feignent de se
plaindre pour dévorer ceux qui sont touchés de leur plainte ! Et
combien d’animaux qui sont assujettis parce qu’ils ignorent leur force !
Toutes ces qualités se trouvent dans l’homme, et il exerce, à
l’égard des autres hommes, tout ce que les animaux dont on vient de
parler exercent entre eux.
XII. De l’origine des maladies
Si on examine la nature des maladies, on trouvera qu’elles tirent
leur origine des passions et des peines de l’esprit. L’âge d’or, qui en
était exempt, était exempt de maladies. L’âge d’argent, qui le suivit,
conserva encore sa pureté. L’âge d’airain donna la naissance aux
passions et aux peines de l’esprit ; elles commencèrent à se former, et
elles avaient encore la faiblesse de l’enfance et sa légèreté. Mais
elles parurent avec toute leur force et toute leur malignité dans l’âge
de fer, et répandirent dans le monde, par la suite de leur corruption,
les diverses maladies qui ont affligé les hommes depuis tant de siècles.
L’ambition a produit les fièvres aiguës et frénétiques : l’envie a
produit la jaunisse et l’insomnie ; c’est de la paresse que viennent les
léthargies, les paralysies et les langueurs : la colère a fait les
étouffements, les ébullitions de sang, et les inflammations de
poitrine : la peur a fait les battements de cœur et les syncopes ; la
vanité a fait les folies ; l’avarice, la teigne et la gale ; la
tristesse a fait le scorbut ; la cruauté, la pierre ; la calomnie et les
faux rapports ont répandu la rougeole, la petite vérole, et le pourpre,
et on doit à la jalousie la gangrène, la peste et la rage. Les
disgrâces imprévues ont fait l’apoplexie ; les procès ont fait la
migraine et le transport au cerveau ; les dettes ont fait les fièvres
étiques ; l’ennui du mariage a produit la fièvre quarte, et la lassitude
des amants qui n’osent se quitter a causé les vapeurs. L’amour, lui
seul, a fait plus de maux que tout le reste ensemble, et personne ne
doit entreprendre de les exprimer ; mais comme il fait aussi les plus
grands biens de la vie, au lieu de médire de lui, on doit se taire ; on
doit le craindre et le respecter toujours.
XIII. Du faux
On est faux en différentes manières. Il y a des hommes faux qui
veulent toujours paraître ce qu’ils ne sont pas. Il y en a d’autres, de
meilleure foi, qui sont nés faux, qui se trompent eux-mêmes, et qui ne
voient jamais les choses comme elles sont. Il y en a dont l’esprit est
droit, et le goût faux. D’autres ont l’esprit faux, et ont quelque
droiture dans le goût. Et il y en a qui n’ont rien de faux dans le goût,
ni dans l’esprit. Ceux-ci sont très rares, puisque, à parler
généralement, il n’y a presque personne qui n’ait de la fausseté dans
quelque endroit de l’esprit ou du goût.
Ce qui fait cette fausseté si universelle, c’est que nos qualités
sont incertaines et confuses, et que nos vues le sont aussi ; on ne
voit point les choses précisément comme elles sont, on les estime plus
ou moins qu’elles ne valent, et on ne les fait point rapporter à nous en
la manière qui leur convient, et qui convient à notre état et à nos
qualités. Ce mécompte met un nombre infini de faussetés dans le goût et
dans l’esprit : notre amour-propre est flatté de tout ce qui se présente
à nous sous les apparences du bien ; mais comme il y a plusieurs sortes
de biens qui touchent notre vanité ou notre tempérament, on les suit
souvent par coutume, ou par commodité ; on les suit parce que les autres
les suivent, sans considérer qu’un même sentiment ne doit pas être
également embrassé par toute sorte de personnes, et qu’on s’y doit
attacher plus ou moins fortement selon qu’il convient plus ou moins à
ceux qui le suivent.
On craint encore plus de se montrer faux par le goût que par
l’esprit. Les honnêtes gens doivent approuver sans prévention ce qui
mérite d’être approuvé, suivre ce qui mérite d’être suivi, et ne se
piquer de rien. Mais il y faut une grande proportion et une grande
justesse ; il faut savoir discerner ce qui est bon en général, et ce qui
nous est propre, et suivre alors avec raison la pente naturelle qui
nous porte vers les choses qui nous plaisent. Si les hommes ne voulaient
exceller que par leurs propres talents et en suivant leurs devoirs, il
n’y aurait rien de faux dans leur goût et dans leur conduite ; ils se
montreraient tels qu’ils sont ; ils jugeraient des choses par leurs
lumières, et s’y attacheraient par raison ; il y aurait de la proportion
dans leurs vues et dans leurs sentiments ; leur goût serait vrai, il
viendrait d’eux et non pas des autres, et ils le suivraient par choix,
et non pas par coutume ou par hasard.
Si on est faux en approuvant ce qui ne doit pas être approuvé, on
ne l’est pas moins, le plus souvent, par l’envie de se faire valoir par
des qualités qui sont bonnes de soi, mais qui ne nous conviennent pas :
un magistrat est faux quand il se pique d’être brave, bien qu’il puisse
être hardi dans de certaines rencontres ; il doit paraître ferme et
assuré dans une sédition qu’il a droit d’apaiser, sans craindre d’être
faux, et il serait faux et ridicule de se battre en duel. Une femme peut
aimer les sciences, mais toutes les sciences ne lui conviennent pas
toujours, et l’entêtement de certaines sciences ne lui convient jamais,
et est toujours faux.
Il faut que la raison et le bon sens mettent le prix aux choses,
et qu’elles déterminent notre goût à leur donner le rang qu’elles
méritent et qu’il nous convient de leur donner ; mais presque tous les
hommes se trompent dans ce prix et dans ce rang, et il y a toujours de
la fausseté dans ce mécompte.
Les plus grands rois sont ceux qui s’y méprennent le plus
souvent : ils veulent surpasser les autres hommes en valeur, en savoir,
en galanterie, et dans mille autres qualités où tout le monde a droit de
prétendre ; mais ce goût d’y surpasser les autres peut être faux en
eux, quand il va trop loin. Leur émulation doit avoir un autre objet :
ils doivent imiter Alexandre, qui ne voulut disputer du prix de la
course que contre des rois, et se souvenir que ce n’est que des qualités
particulières à la royauté qu’ils doivent disputer. Quelque vaillant
que puisse être un roi, quelque savant et agréable qu’il puisse être, il
trouvera un nombre infini de gens qui auront ces mêmes qualités aussi
avantageusement que lui, et le désir de les surpasser paraîtra toujours
faux, et souvent même il lui sera impossible d’y réussir ; mais s’il
s’attache à ses devoirs véritables, s’il est magnanime, s’il est grand
capitaine et grand politique, s’il est juste, clément et libéral, s’il
soulage ses sujets, s’il aime la gloire et le repos de son État, il ne
trouvera que des rois à vaincre dans une si noble carrière ; il n’y aura
rien que de vrai et de grand dans un si juste dessein, le désir d’y
surpasser les autres n’aura rien de faux. Cette émulation est digne d’un
roi, et c’est la véritable gloire où il doit prétendre.
XIV. Des modèles de la nature et de la fortune
Il semble que la fortune, toute changeante et capricieuse qu’elle
est, renonce à ses changements et à ses caprices pour agir de concert
avec la nature, et que l’une et l’autre concourent de temps en temps à
faire des hommes extraordinaires et singuliers, pour servir de modèles à
la postérité. Le soin de la nature est de fournir les qualités ; celui
de la fortune est de les mettre en œuvre, et de les faire voir dans le
jour et avec les proportions qui conviennent à leur dessein ; on dirait
alors qu’elles imitent les règles des grands peintres, pour nous donner
des tableaux parfaits de ce qu’elles veulent représenter. Elles
choisissent un sujet, et s’attachent au plan qu’elles se sont proposé ;
elles disposent de la naissance, de l’éducation, des qualités naturelles
et acquises, des temps, des conjonctures, des amis, des ennemis ; elles
font remarquer des vertus et des vices, des actions heureuses et
malheureuses ; elles joignent même de petites circonstances aux plus
grandes, et les savent placer avec tant d’art que les actions des hommes
et leurs motifs nous paraissent toujours sous la figure et avec les
couleurs qu’il plaît à la nature et à la fortune d’y donner.
Quel concours de qualités éclatantes n’ont-elles pas assemblé
dans la personne d’Alexandre, pour le montrer au monde comme un modèle
d’élévation d’âme et de grandeur de courage ! Si on examine sa naissance
illustre, son éducation, sa jeunesse, sa beauté, sa complexion
heureuse, l’étendue et la capacité de son esprit pour la guerre et pour
les sciences, ses vertus, ses défauts même, le petit nombre de ses
troupes, la puissance formidable de ses ennemis, la courte durée d’une
si belle vie, sa mort et ses successeurs, ne verra-t-on pas l’industrie
et l’application de la fortune et de la nature à renfermer dans un même
sujet ce nombre infini de diverses circonstances ? Ne verra-t-on pas le
soin particulier qu’elles ont pris d’arranger tant d’événements
extraordinaires, et de les mettre chacun dans son jour, pour composer un
modèle d’un jeune conquérant, plus grand encore par ses qualités
personnelles que par l’étendue de ses conquêtes ?
Si on considère de quelle sorte la nature et la fortune nous
montrent César, ne verra-t-on pas qu’elles ont suivi un autre plan,
qu’elles n’ont renfermé dans sa personne tant de valeur, de clémence, de
libéralité, tant de qualités militaires, tant de pénétration, tant de
facilité d’esprit et de mœurs, tant d’éloquence, tant de grâces du
corps, tant de supériorité de génie pour la paix et pour la guerre, ne
verra-t-on pas, dis-je, qu’elles ne se sont assujetties si longtemps à
arranger et à mettre en œuvre tant de talents extraordinaires, et
qu’elles n’ont contraint César de s’en servir contre sa patrie, que pour
nous laisser un modèle du plus grand homme du monde, et du plus célèbre
usurpateur ? Elle le fait naître particulier dans une république
maîtresse de l’univers, affermie et soutenue par les plus grands hommes
qu’elle eût jamais produits ; la fortune choisit parmi eux ce qu’il y
avait de plus illustre, de plus puissant et de plus redoutable pour les
rendre ses ennemis ; elle le réconcilie pour un temps avec les plus
considérables pour les faire servir à son élévation ; elle les éblouit
et les aveugle ensuite, pour lui faire une guerre qui le conduit à la
souveraine puissance. Combien d’obstacles ne lui a-t-elle pas fait
surmonter ! De combien de périls sur terre et sur mer ne l’a-t-elle pas
garanti, sans jamais avoir été blessé ! Avec quelle persévérance la
fortune n’a-t-elle pas soutenu les desseins de César et détruit ceux de
Pompée ! Par quelle industrie n’a-t-elle pas disposé ce peuple romain,
si puissant, si fier et si jaloux de sa liberté à la soumettre à la
puissance d’un seul homme ! Ne s’est-elle pas même servie des
circonstances de la mort de César pour la rendre convenable à sa vie ?
Tant d’avertissements des devins, tant de prodiges, tant d’avis de sa
femme et de ses amis ne peuvent le garantir, et la fortune choisit le
propre jour qu’il doit être couronné dans le Sénat pour le faire
assassiner par ceux mêmes qu’il a sauvés, et par un homme qui lui doit
la naissance.
Cet accord de la nature et de la fortune n’a jamais été plus
marqué que dans la personne de Caton, et il semble qu’elles se soient
efforcées l’une et l’autre de renfermer dans un seul homme non seulement
les vertus de l’ancienne Rome, mais encore de l’opposer directement aux
vertus de César, pour montrer qu’avec une pareille étendue d’esprit et
de courage, le désir de gloire conduit l’un à être usurpateur et l’autre
à servir de modèle d’un parfait citoyen ? Mon dessein n’est pas de
faire ici le parallèle de ces deux grands hommes, après tout ce qui en
est écrit ; je dirai seulement que, quelque grands et illustres qu’ils
nous paraissent, la nature et la fortune n’auraient pu mettre toutes
leurs qualités dans le jour qui convenait pour les faire éclater, si
elles n’eussent opposé Caton à César. Il fallait les faire naître en
même temps dans une même république, différents par leurs mœurs et par
leurs talents, ennemis par les intérêts de la patrie et par des intérêts
domestiques, l’un vaste dans ses desseins et sans bornes dans son
ambition, l’autre austère, renfermé dans les lois de Rome et idolâtre de
la liberté, tous deux célèbres par des vertus qui les montraient par de
si différents côtés, et plus célèbres encore, si on l’ose dire, par
l’opposition que la fortune et la nature ont pris soin de mettre entre
eux. Quel arrangement, quelle suite, quelle économie de circonstances
dans la vie de Caton, et dans sa mort ! La destinée même de la
république a servi au tableau que la fortune nous a voulu donner de ce
grand homme, et elle finit sa vie avec la liberté de son pays.
Si nous laissons les exemples des siècles passés pour venir aux
exemples du siècle présent, on trouvera que la nature et la fortune ont
conservé cette même union dont j’ai parlé, pour nous montrer de
différents modèles en deux hommes consommés en l’art de commander. Nous
verrons Monsieur le Prince et M. de Turenne disputer de la gloire des
armes, et mériter par un nombre infini d’actions éclatantes la
réputation qu’ils ont acquise. Ils paraîtront avec une valeur et une
expérience égales ; infatigables de corps et d’esprit, on les verra agir
ensemble, agir séparément, et quelquefois opposés l’un à l’autre ; nous
les verrons, heureux et malheureux dans diverses occasions de la
guerre, devoir les bons succès à leur conduite et à leur courage, et se
montrer même toujours plus grands par leurs disgrâces ; tous deux sauver
l’État ; tous deux contribuer à le détruire, et se servir des mêmes
talents par des voies différentes, M. de Turenne suivant ses desseins
avec plus de règle et moins de vivacité, d’une valeur plus retenue et
toujours proportionnée au besoin de la faire paraître, Monsieur le
Prince inimitable en la manière de voir et d’exécuter les plus grandes
choses, entraîné par la supériorité de son génie qui semble lui
soumettre les événements et les faire servir à sa gloire. La faiblesse
des armées qu’ils ont commandées dans les dernières campagnes, et la
puissance des ennemis qui leur étaient opposés, ont donné de nouveaux
sujets à l’un et à l’autre de montrer toute leur vertu et de réparer par
leur mérite tout ce qui leur manquait pour soutenir la guerre. La mort
même de M. de Turenne, si convenable à une si belle vie, accompagnée de
tant de circonstances singulières et arrivée dans un moment si
important, ne nous paraît-elle pas comme un effet de la crainte et de
l’incertitude de la fortune, qui n’a osé décider de la destinée de la
France et de l’Empire ? Cette même fortune, qui retire Monsieur le
Prince du commandement des armées sous le prétexte de sa santé et dans
un temps où il devait achever de si grandes choses, ne se joint-elle pas
à la nature pour nous montrer présentement ce grand homme dans une vie
privée, exerçant des vertus paisibles soutenu de sa propre gloire ? Et
brille-t-il moins dans sa retraite qu’au milieu de ses victoires ?
XV. Des coquettes et des vieillards
S’il est malaisé de rendre raison des goûts en général, il le
doit être encore davantage de rendre raison du goût des femmes
coquettes. On peut dire néanmoins que l’envie de plaire se répand
généralement sur tout ce qui peut flatter leur vanité, et qu’elles ne
trouvent rien d’indigne de leurs conquêtes. Mais le plus
incompréhensible de tous leurs goûts est, à mon sens, celui qu’elles ont
pour les vieillards qui ont été galants. Ce goût paraît trop bizarre,
et il y en a trop d’exemples, pour ne chercher pas la cause d’un
sentiment tout à la fois si commun et si contraire à l’opinion que l’on a
des femmes. je laisse aux philosophes à décider si c’est un soin
charitable de la nature, qui veut consoler les vieillards dans leur
misère, et qui leur fournit le secours des coquettes par la même
prévoyance qui lui fait donner des ailes aux chenilles, dans le déclin
de leur vie, pour les rendre papillons ; mais, sans pénétrer dans les
secrets de la physique, on peut, ce me semble, chercher des causes plus
sensibles de ce goût dépravé des coquettes pour les vieilles gens. Ce
qui est plus apparent, c’est qu’elles aiment les prodiges, et qu’il n’y
en a point qui doive plus toucher leur vanité que de ressusciter un
mort. Elles ont le plaisir de l’attacher à leur char, et d’en parer leur
triomphe, sans que leur réputation en soit blessée ; au contraire, un
vieillard est un ornement à la suite d’une coquette, et il est aussi
nécessaire dans son train que les nains l’étaient autrefois dans Amadis.
Elles n’ont point d’esclaves si commodes et si utiles. Elles paraissent
bonnes et solides en conservant un ami sans conséquence. Il publie
leurs louanges, il gagne croyance vers les maris et leur répond de la
conduite de leurs femmes. S’il a du crédit, elles en retirent mille
secours ; il entre dans tous les intérêts et dans tous les besoins de la
maison. S’il sait les bruits qui courent des véritables galanteries, il
n’a garde de les croire ; il les étouffe, et assure que le monde est
médisant ; il juge par sa propre expérience des difficultés qu’il y a de
toucher le cœur d’une si bonne femme ; plus on lui fait acheter des
grâces et des faveurs et plus il est discret et fidèle ; son propre
intérêt l’engage assez au silence ; il craint toujours d’être quitté, et
il se trouve trop heureux d’être souffert. Il se persuade aisément
qu’il est aimé, puisqu’on le choisit contre tant d’apparences ; il croit
que c’est un privilège de son vieux mérite, et remercie l’amour de se
souvenir de lui dans tous les temps.
Elle, de son côté, ne voudrait pas manquer à ce qu’elle lui a
promis ; elle lui fait remarquer qu’il a toujours touché son
inclination, et qu’elle n’aurait jamais aimé si elle ne l’avait jamais
connu ; elle le prie surtout de n’être pas jaloux et de se fier en
elle ; elle lui avoue qu’elle aime un peu le monde et le commerce des
honnêtes gens, qu’elle a même intérêt d’en ménager plusieurs à la fois,
pour ne laisser pas voir qu’elle le traite différemment des autres ; que
si elle fait quelques railleries de lui avec ceux dont on s’est avisé
de parler, c’est seulement pour avoir le plaisir de le nommer souvent,
ou pour mieux cacher ses sentiments ; qu’après tout il est le maître de
sa conduite, et que, pourvu qu’il en soit content et qu’il l’aime
toujours, elle se met aisément en repos du reste. Quel vieillard ne se
rassure pas par des raisons si convaincantes, qui l’ont souvent trompé
quand il était jeune et aimable ? Mais, pour son malheur, il oublie trop
aisément qu’il n’est plus ni l’un ni l’autre, et cette faiblesse est,
de toutes, la plus ordinaire aux vieilles gens qui ont été aimés. Je ne
sais même si cette tromperie ne leur vaut pas mieux encore que de
connaître la vérité : on les souffre du moins, on les amuse, ils sont
détournés de la vue de leurs propres misères, et le ridicule où ils
tombent est souvent un moindre mal pour eux que les ennuis et
l’anéantissement d’une vie pénible et languissante.
XVI. De la différence des esprits
Bien que toutes les qualités de l’esprit se puissent rencontrer
dans un grand esprit, il y en a néanmoins qui lui sont propres et
particulières : ses lumières n’ont point de bornes, il agit toujours
également et avec la même activité, il discerne les objets éloignés
comme s’ils étaient présents, il comprend, il imagine les plus grandes
choses, il voit et connaît les plus petites ; ses pensées sont relevées,
étendues, justes et intelligibles ; rien n’échappe à sa pénétration, et
elle lui fait toujours découvrir la vérité au travers des obscurités
qui la cachent aux autres. Mais toutes ces grandes qualités ne peuvent
souvent empêcher que l’esprit ne paraisse petit et faible, quand
l’humeur s’en est rendue la maîtresse.
Un bel esprit pense toujours noblement ; il produit avec facilité
des choses claires, agréables et naturelles ; il les fait voir dans
leur plus beau jour, et il les pare de tous les ornements qui leur
conviennent ; il entre dans le goût des autres, et retranche de ses
pensées ce qui est inutile ou ce qui peut déplaire. Un esprit adroit,
facile, insinuant, sait éviter et surmonter les difficultés ; il se plie
aisément à ce qu’il veut ; il sait connaître et suivre l’esprit et
l’humeur de ceux avec qui il traite ; et en ménageant leurs intérêts il
avance et établit les siens. Un bon esprit voit toutes choses comme
elles doivent être vues ; il leur donne le prix qu’elles méritent, il
les sait tourner du côté qui lui est le plus avantageux, et il s’attache
avec fermeté à ses pensées parce qu’il en connaît toute la force et
toute la raison.
Il y a de la différence entre un esprit utile et un esprit
d’affaires : on peut entendre les affaires sans s’appliquer à son
intérêt particulier ; il y a des gens habiles dans tout ce qui ne les
regarde pas et très malhabiles dans ce qui les regarde, et il y en a
d’autres, au contraire, qui ont une habileté bornée à ce qui les touche
et qui savent trouver leur avantage en toutes choses.
On peut avoir tout ensemble un air sérieux dans l’esprit et dire
souvent des choses agréables et enjouées ; cette sorte d’esprit convient
à toutes personnes, et à tous les âges de la vie. Les jeunes gens ont
d’ordinaire l’esprit enjoué et moqueur, sans l’avoir sérieux, et c’est
ce qui les rend souvent incommodes. Rien n’est plus malaisé à soutenir
que le dessein d’être toujours plaisant, et les applaudissements qu’on
reçoit quelquefois en divertissant les autres ne valent pas que l’on
s’expose à la honte de les ennuyer souvent, quand ils sont de méchante
humeur. La moquerie est une des plus agréables et des plus dangereuses
qualités de l’esprit : elle plaît toujours, quand elle est délicate ;
mais on craint toujours aussi ceux qui s’en servent trop souvent. La
moquerie peut néanmoins être permise, quand elle n’est mêlée d’aucune
malignité et quand on y fait entrer les personnes mêmes dont on parle.
Il est malaisé d’avoir un esprit de raillerie sans affecter
d’être plaisant, ou sans aimer à se moquer ; il faut une grande justesse
pour railler longtemps sans tomber dans l’une ou l’autre de ces
extrémités. La raillerie est un air de gaieté qui remplit l’imagination,
et qui lui fait voir en ridicule les objets qui se présentent ;
l’humeur y mêle plus ou moins de douceur ou d’âpreté ; il y a une
manière de railler délicate et flatteuse qui touche seulement les
défauts que les personnes dont on parle veulent bien avouer, qui sait
déguiser les louanges qu’on leur donne sous des apparences de blâme, et
qui découvre ce qu’elles ont d’aimable en feignant de le vouloir cacher.
Un esprit fin et un esprit de finesse sont très différents. Le
premier plaît toujours ; il est délié, il pense des choses délicates et
voit les plus imperceptibles. Un esprit de finesse ne va jamais droit,
il cherche des biais et des détours pour faire réussir ses desseins ;
cette conduite est bientôt découverte, elle se fait toujours craindre et
ne mène presque jamais aux grandes choses.
Il y a quelque différence entre un esprit de feu et un esprit
brillant. Un esprit de feu va plus loin et avec plus de rapidité ; un
esprit brillant a de la vivacité, de l’agrément et de la justesse.
La douceur de l’esprit, c’est un air facile et accommodant, qui plaît toujours quand il n’est point fade.
Un esprit de détail s’applique avec de l’ordre et de la règle à
toutes les particularités des sujets qu’on lui présente. Cette
application le renferme d’ordinaire à de petites choses ; elle n’est pas
néanmoins toujours incompatible avec de grandes vues, et quand ces deux
qualités se trouvent ensemble dans un même esprit, elles l’élèvent
infiniment au-dessus des autres.
On a abusé du terme de bel esprit, et bien que tout ce qu’on
vient de dire des différentes qualités de l’esprit puisse convenir à un
bel esprit, néanmoins, comme ce titre a été donné à un nombre infini de
mauvais poètes et d’auteurs ennuyeux, on s’en sert plus souvent pour
tourner les gens en ridicule que pour les louer.
Bien qu’il y ait plusieurs épithètes pour l’esprit qui paraissent
une même chose, le ton et la manière de les prononcer y mettent de la
différence ; mais comme les tons et les manières ne se peuvent écrire,
je n’entrerai point dans un détail qu’il serait impossible de bien
expliquer. L’usage ordinaire le fait assez entendre, et en disant qu’un
homme a de l’esprit, qu’il a bien de l’esprit, qu’il a beaucoup
d’esprit, et qu’il a bon esprit, il n’y a que les tons et les manières
qui puissent mettre de la différence entre ces expressions qui
paraissent semblables sur le papier, et qui expriment néanmoins de très
différentes sortes d’esprit.
On dit encore qu’un homme n’a que d’une sorte d’esprit, qu’il a
de plusieurs sortes d’esprit, et qu’il a de toutes sortes d’esprit. On
peut être sot avec beaucoup d’esprit, et on peut n’être pas sot avec peu
d’esprit.
Avoir beaucoup d’esprit et un terme équivoque : il peut
comprendre toutes les sortes d’esprit dont on vient de parler, mais il
peut aussi n’en marquer aucune distinctement. On peut quelquefois faire
paraître de l’esprit dans ce qu’on dit sans en avoir dans sa conduite,
on peut avoir de l’esprit et l’avoir borné ; un esprit peut être propre à
de certaines choses et ne l’être pas à d’autres ; on peut avoir
beaucoup d’esprit et n’être propre à rien, et avec beaucoup d’esprit on
est souvent fort incommode. Il semble néanmoins que le plus grand mérite
de cette sorte d’esprit est de plaire quelquefois dans la conversation.
Bien que les productions d’esprit soient infinies, on peut, ce me
semble, les distinguer de cette sorte : il y a des choses si belles que
tout le monde est capable d’en voir et d’en sentir la beauté, il y en a
qui ont de la beauté et qui ennuient, il y en a qui sont belles, que
tout le monde sent et admire bien que tous n’en sachent pas la raison,
il y en a qui sont si fines et si délicates que peu de gens sont
capables d’en remarquer toutes les beautés, il y en a d’autres qui ne
sont pas parfaites, mais qui sont dites avec tant d’art et qui sont
soutenues et conduites avec tant de raison et tant de grâce qu’elles
méritent d’être admirées.
XVII. De l’inconstance
Je ne prétends pas justifier ici l’inconstance en général, et
moins encore celle qui vient de la seule légèreté ; mais il n’est pas
juste aussi de lui imputer tous les autres changements de l’amour. Il y a
une première fleur d’agrément et de vivacité dans l’amour qui passe
insensiblement, comme celle des fruits ; ce n’est la faute de personne,
c’est seulement la faute du temps. Dans les commencements, la figure est
aimable, les sentiments ont du rapport, on cherche de la douceur et du
plaisir, on veut plaire parce qu’on nous plaît, et on cherche à faire
voir qu’on sait donner un prix infini à ce qu’on aime ; mais dans la
suite on ne sent plus ce qu’on croyait sentir toujours, le feu n’y est
plus, le mérite de la nouveauté s’efface, la beauté, qui a tant de part à
l’amour, ou diminue ou ne fait plus la même impression ; le nom d’amour
se conserve, mais on ne se retrouve plus les mêmes personnes, ni les
mêmes sentiments ; on suit encore ses engagements par honneur, par
accoutumance et pour n’être pas assez assuré de son propre changement.
Quelles personnes auraient commencé de s’aimer, si elles
s’étaient vues d’abord comme on se voit dans la suite des années ? Mais
quelles personnes aussi se pourraient séparer, si elles se revoyaient
comme on s’est vu la première fois ? L’orgueil, qui est presque toujours
le maître de nos goûts, et qui ne se rassasie jamais, serait flatté
sans cesse par quelque nouveau plaisir ; la constance perdrait son
mérite : elle n’aurait plus de part à une si agréable liaison, les
faveurs présentes auraient la même grâce que les premières faveurs et le
souvenir n’y mettrait point de différence ; l’inconstance serait même
inconnue, et on s’aimerait toujours avec le même plaisir parce qu’on
aurait toujours les mêmes sujets de s’aimer. Les changements qui
arrivent dans l’amitié ont à peu près des causes pareilles à ceux qui
arrivent dans l’amour : leurs règles ont beaucoup de rapport. Si l’un a
plus d’enjouement et de plaisir, l’autre doit être plus égale et plus
sévère, elle ne pardonne rien ; mais le temps, qui change l’humeur et
les intérêts, les détruit presque également tous deux. Les hommes sont
trop faibles et trop changeants pour soutenir longtemps le poids de
l’amitié. L’antiquité en a fourni des exemples ; mais dans le temps où
nous vivons, on peut dire qu’il est encore moins impossible de trouver
un véritable amour qu’une véritable amitié.
XVIII. De la retraite
Je m’engagerais à un trop long discours si je rapportais ici en
particulier toutes les raisons naturelles qui portent les vieilles gens à
se retirer du commerce du monde : le changement de leur humeur, de leur
figure et l’affaiblissement des organes les conduisent insensiblement,
comme la plupart des autres animaux, à s’éloigner de la fréquentation de
leurs semblables. L’orgueil, qui est inséparable de l’amour-propre,
leur tient alors lieu de raison : il ne peut plus être flatté de
plusieurs choses qui flattent les autres, l’expérience leur a fait
connaître le prix de ce que tous les hommes désirent dans la jeunesse et
l’impossibilité d’en jouir plus longtemps ; les diverses voies qui
paraissent ouvertes aux jeunes gens pour parvenir aux grandeurs, aux
plaisirs, à la réputation et à tout ce qui élève les hommes leur sont
fermées, ou par la fortune, ou par leur conduite, ou par l’envie et
l’injustice des autres ; le chemin pour y rentrer est trop long et trop
pénible quand on s’est une fois égaré ; les difficultés leur en
paraissent insurmontables, et l’âge ne leur permet plus d’y prétendre.
Ils deviennent insensibles à l’amitié, non seulement parce qu’ils n’en
ont peut-être jamais trouvé de véritable, mais parce qu’ils ont vu
mourir un grand nombre de leurs amis qui n’avaient pas encore eu le
temps ni les occasions de manquer à l’amitié et ils se persuadent
aisément qu’ils auraient été plus fidèles que ceux qui leur restent. Ils
n’ont plus de part aux premiers biens qui ont d’abord rempli leur
imagination ; ils n’ont même presque plus de part à la gloire : celle
qu’ils ont acquise est déjà flétrie par le temps, et souvent les hommes
en perdent plus en vieillissant qu’ils n’en acquièrent. Chaque jour leur
ôte une portion d’eux-mêmes ; ils n’ont plus assez de vie pour jouir de
ce qu’ils ont, et bien moins encore pour arriver à ce qu’ils désirent ;
il ne voient plus devant eux que des chagrins, des maladies et de
l’abaissement ; tous est vu, et rien ne peut avoir pour eux la grâce de
la nouveauté ; le temps les éloigne imperceptiblement du point de vue
d’où il leur convient de voir les objets, et d’où ils doivent être vus.
Les plus heureux sont encore soufferts, les autres sont méprisés ; le
seul bon parti qu’il leur reste, c’est de cacher au monde ce qu’ils ne
lui ont peut-être que trop montré. Leur goût, détrompé des désirs
inutiles, se tourne alors vers des objets muets et insensibles ; les
bâtiments, l’agriculture, l’économie, l’étude, toutes ces choses sont
soumises à leurs volontés ; ils s’en approchent ou s’en éloignent comme
il leur plaît ; ils sont maîtres de leurs desseins et de leurs
occupations ; tout ce qu’ils désirent est en leur pouvoir, et, s’étant
affranchis de la dépendance du monde, ils font tout dépendre d’eux. Les
plus sages savent employer à leur salut le temps qu’il leur reste et,
n’ayant qu’une si petite part à cette vie, ils se rendent dignes d’une
meilleure. Les autres n’ont au moins qu’eux-mêmes pour témoins de leur
misère ; leurs propres infirmités les amusent ; le moindre relâche leur
tient lieu de bonheur ; la nature, défaillante et plus sage qu’eux, leur
ôte souvent la peine de désirer ; enfin ils oublient le monde, qui est
si disposé à les oublier ; leur vanité même est consolée par leur
retraite, et avec beaucoup d’ennuis, d’incertitudes et de faiblesses,
tantôt par piété, tantôt par raison, et le plus souvent par
accoutumance, ils soutiennent le poids d’une vie insipide et
languissante.
XIX. Des événements de ce siècle
L’histoire, qui nous apprend ce qui arrive dans le monde, nous
montre également les grands événements et les médiocres ; cette
confusion d’objets nous empêche souvent de discerner avec assez
d’attention les choses extraordinaires qui sont renfermées dans les
cours de chaque siècle. Celui où nous vivons en a produit, à mon sens,
de plus singuliers que les précédents. J’ai voulu en écrire
quelques-uns, pour les rendre plus remarquables aux personnes qui
voudront y faire réflexion.
Marie de Médicis, reine de France, femme de Henri le Grand, fut
mère du roi Louis XIII, de Gaston, fils de France, de la reine
d’Espagne, de la duchesse de Savoie, et de la reine d’Angleterre ; elle
fut régente en France, et gouverna le roi son fils, et son royaume,
plusieurs années. Elle éleva Armand de Richelieu à la dignité de
cardinal ; elle le fit premier ministre, maître de l’État et de l’esprit
du Roi. Elle avait peu de vertus et peu de défauts qui la dussent faire
craindre, et néanmoins, après tant d’éclat et de grandeurs, cette
princesse, veuve de Henri IVe et mère de tant de rois, a été arrêtée
prisonnière par le Roi son fils, et par la haine du cardinal de
Richelieu qui lui devait sa fortune. Elle a été délaissée des autres
rois ses enfants, qui n’ont osé même la recevoir dans leurs États, et
elle est morte de misère, et presque de faim, à Cologne, après une
persécution de dix années.
Ange de Joyeuse, duc et pair, maréchal de France et amiral,
jeune, riche, galant et heureux, abandonna tant d’avantages pour se
faire capucin. Après quelques années les besoins de l’État le
rappelèrent au monde ; le Pape le dispensa de ses vœux, et lui ordonna
d’accepter le commandement des armées du Roi contre les huguenots ; il
demeura quatre ans dans cet emploi, et se laissa entraîner pendant ce
temps aux mêmes passions qui l’avaient agité pendant sa jeunesse. La
guerre étant finie, il renonça une seconde fois au monde, et reprit
l’habit de capucin. Il vécut longtemps dans une vie sainte et
religieuse ; mais la vanité, dont il avait triomphé dans le milieu des
grandeurs, triompha de lui dans le cloître ; il fut élu gardien du
couvent de Paris, et son élection étant contestée par quelques
religieux, il s’exposa non seulement à aller à Rome dans un âge avancé, à
pied et malgré les autres incommodités d’un si pénible voyage, mais la
même opposition des religieux s’étant renouvelée à son retour, il partit
une seconde fois pour retourner à Rome soutenir un intérêt si peu digne
de lui, et il mourut en chemin de fatigue, de chagrin, et de
vieillesse.
Trois hommes de qualité, Portugais, suivis de dix-sept de leurs
amis, entreprirent la révolte de Portugal et des Indes qui en dépendent,
sans concert avec les peuples ni avec les étrangers, et sans
intelligence dans les places. Ce petit nombre de conjurés se rendit
maître du palais de Lisbonne, en chassa la douairière de Mantoue,
régente pour le roi d’Espagne, et fit soulever tout le royaume ; il ne
périt dans ce désordre que Vasconcellos, ministre d’Espagne, et deux de
ses domestiques. Un si grand changement se fit en faveur du duc de
Bragance, et sans participation : il fut déclaré roi contre sa propre
volonté, et se trouva le seul homme de Portugal qui résistât à son
élection ; il a possédé ensuite cette couronne pendant quatorze années,
n’ayant ni élévation, ni mérite ; il est mort dans son lit, et a laissé
son royaume paisible à ses enfants.
Le cardinal de Richelieu a été maître absolu du royaume de France
pendant le règne d’un roi qui lui laissait le gouvernement de son État,
lorsqu’il n’osait lui confier sa propre personne ; le Cardinal avait
aussi les mêmes défiances du Roi, et il évitait d’aller chez lui,
craignant d’exposer sa vie ou sa liberté ; le Roi néanmoins sacrifie
Cinq-Mars, son favori, à la vengeance du Cardinal, et consent qu’il
périsse sur un échafaud. Ensuite le Cardinal meurt dans son lit ; il
dispose par son testament des charges et des dignités de l’État, et
oblige le Roi, dans le plus fort de ses soupçons et de sa haine, à
suivre aussi aveuglement ses volontés après sa mort qu’il avait fait
pendant sa vie.
On doit sans doute trouver extraordinaire que Anne-Marie-Louise
d’Orléans, petite-fille de France, la plus riche sujette de l’Europe,
destinée pour les plus grands rois, avare, rude et orgueilleuse, ait pu
former le dessein, à quarante-cinq ans, d’épouser Puyguilhem, cadet de
la maison de Lauzun, assez mal fait de sa personne, d’un esprit
médiocre, et qui n’a, pour toute bonne qualité, que d’être hardi et
insinuant. Mais on doit être encore plus surpris que Mademoiselle ait
pris cette chimérique résolution par un esprit de servitude et parce que
Puyguilhem était bien auprès du Roi ; l’envie d’être femme d’un favori
lui tint lieu de passion, elle oublia son âge et sa naissance, et, sans
avoir d’amour, elle fit des avances à Puyguilhem qu’un amour véritable
ferait à peine excuser dans une jeune personne et d’une moindre
condition. Elle lui dit un jour qu’il n’y avait qu’un seul homme qu’elle
pût choisir pour épouser. Il la pressa de lui apprendre son choix ;
mais n’ayant pas la force de prononcer son nom, elle voulut l’écrire
avec un diamant sur les vitres d’une fenêtre. Puyguilhem jugea sans
doute ce qu’elle allait faire, et espérant peut-être qu’elle lui
donnerait cette déclaration par écrit, dont il pourrait faire quelque
usage, il feignit une délicatesse de passion qui pût plaire à
Mademoiselle, et il lui fit un scrupule d’écrire sur du verre un
sentiment qui devait durer éternellement. Son dessein réussit comme il
désirait, et Mademoiselle écrivit le soir dans du papier :
« C’est vous. » Elle le cachera elle-même ; mais, comme cette
aventure se passait un jeudi et que minuit sonna avant que Mademoiselle
pût donner son billet à Puyguilhem, elle ne voulut pas paraître moins
scrupuleuse que lui, et craignant que le vendredi ne fût un jour
malheureux, elle lui fit promettre d’attendre au samedi à ouvrir le
billet qui lui devait apprendre cette _grande nouvelle. L’excessive
fortune que cette déclaration faisait envisager à Puyguilhem ne lui
parut point au-dessus de son ambition. Il songea à profiter du caprice
de Mademoiselle, et il eut la hardiesse d’en rendre compte au Roi.
Personne n’ignore qu’avec si grandes et éclatantes qualités nul prince
au monde n’a jamais eu plus de hauteur, ni plus de fierté. Cependant, au
lieu de perdre Puyguilhem d’avoir osé lui découvrir ses espérances, il
lui permit non seulement de les conserver, mais il consentit que quatre
officiers de la couronne lui vinssent demander son approbation pour un
mariage si surprenant, et sans que Monsieur ni Monsieur le Prince en
eussent entendu parler. Cette nouvelle se répandit dans le monde, et le
remplit d’étonnement et d’indignation. Le Roi ne sentit pas alors ce
qu’il venait de faire contre sa gloire et contre sa dignité. Il trouva
seulement qu’il était de sa grandeur d’élever en un jour Puyguilhem
au-dessus des plus grands du royaume et, malgré tant de disproportion,
il le jugea digne d’être son cousin germain, le premier pair de France
et maître de cinq cent mille livres de rente ; mais ce qui le flatta le
plus encore, dans un si extraordinaire dessein, ce fut le plaisir secret
de surprendre le monde, et de faire pour un homme qu’il aimait ce que
personne n’avait encore imaginé. Il fut au pouvoir de Puyguilhem de
profiter durant trois jours de tant de prodiges que la fortune avait
faits en sa faveur, et d’épouser Mademoiselle ; mais, par un prodige
plus grand encore, sa vanité ne put être satisfaite s’il ne l’épousait
avec les mêmes cérémonies que s’il eût été de sa qualité : il voulut que
le Roi et la Reine fussent témoins de ses noces, et qu’elles eussent
tout l’éclat que leur présence y pouvait donner. Cette présomption sans
exemple lui fit employer à de vains préparatifs, et à passer son
contrat, tout le temps qui pouvait assurer son bonheur. Mme de
Montespan, qui le haïssait, avait suivi néanmoins le penchant du Roi et
ne s’était point opposée à ce mariage. Mais le bruit du monde la
réveilla ; elle fit voir au Roi ce que lui seul ne voyait pas encore ;
elle lui fit écouter la voix publique ; il connut l’étonnement des
ambassadeurs, il reçut les plaintes et les remontrances respectueuses de
Madame douairière et de toute la maison royale. Tant de raisons firent
longtemps balancer le Roi, et ce fut avec un[e] extrême peine qu’il
déclara à Puyguilhem qu’il ne pouvait consentir ouvertement à son
mariage. Il l’assura néanmoins que ce changement en apparence ne
changerait rien en effet ; qu’il était forcé, malgré lui, de céder à
l’opinion générale, et de lui défendre d’épouser Mademoiselle, mais
qu’il ne prétendait pas que cette défense empêchât son bonheur. Il le
pressa de se marier en secret, et il lui promit que la disgrâce qui
devait suivre une telle faute ne durerait que huit jours. Quelque
sentiment que ce discours pût donner à Puyguilhem, il dit au Roi qu’il
renonçait avec joie à tout ce qui lui avait permis d’espérer, puisque sa
gloire en pouvait être blessée, et qu’il n’y avait point de fortune qui
le pût consoler d’être huit jours séparé de lui. Le Roi fut
véritablement touché de cette soumission ; il n’oublia rien pour obliger
Puyguilhem à profiter de la faiblesse de Mademoiselle, et Puyguilhem
n’oublia rien aussi, de son côté, pour faire voir au Roi qu’il lui
sacrifiait toutes choses. Le désintéressement seul ne fit pas prendre
néanmoins cette conduite à Puyguilhem : il crut qu’elle l’assurait pour
toujours de l’esprit du Roi, et que rien ne pourrait à l’avenir diminuer
sa faveur. Son caprice et sa vanité le portèrent même si loin que ce
mariage si grand et si disproportionné lui parut insupportable parce
qu’il ne lui était plus permis de le faire avec tout le faste et tout
l’éclat qu’il s’était proposé. Mais ce qui le détermina le plus
puissamment à le rompre, ce fut l’aversion insurmontable qu’il avait
pour la personne de Mademoiselle, et le dégoût d’être son mari. Il
espéra même de tirer des avantages solides de l’emportement de
Mademoiselle, et que, sans l’épouser, elle lui donnerait la souveraineté
de Dombes et le duché de Montpensier. Ce fut dans cette vue qu’il
refusa d’abord toutes les grâces dont le Roi voulut le combler ; mais
l’humeur avare et inégale de Mademoiselle, et les difficultés qui se
rencontrèrent à assurer de si grands biens à Puyguilhem, rendirent ce
dessein inutile, et l’obligèrent à recevoir les bienfaits du Roi. Il lui
donna le gouvernement de Berry et cinq cent mille livres. Des avantages
si considérables ne répondirent pas toutefois aux espérances que
Puyguilhem avait formées. Son chagrin fournit bientôt à ses ennemis, et
particulièrement à Mme de Montespan, tous les prétextes qu’ils
souhaitaient pour le ruiner. Il connut son état et sa décadence et, au
lieu de se ménager auprès du Roi avec de la douceur, de la patience et
de l’habileté, rien ne fut plus capable de retenir son esprit âpre et
fier. Il fit enfin des reproches au Roi ; il lui dit même des choses
rudes et piquantes, jusqu’à casser son épée en sa présence en disant
qu’il ne la tirerait plus pour son service ; il lui parla avec mépris de
Mme de Montespan, et s’emporta contre elle avec tant de violence
qu’elle douta de sa sûreté et n’en trouva plus qu’à le perdre. Il fut
arrêté bientôt après, et on le mena à Pignerol, où il éprouva par une
longue et dure prison la douleur d’avoir perdu les bonnes grâces du Roi,
et d’avoir laissé échapper par une fausse vanité tant de grandeurs et
tant d’avantages que la condescendance de son maître et la bassesse de
Mademoiselle lui avaient présentés.
Alphonse, roi de Portugal, fils du duc de Bragance dont je viens
de parler, s’est marié en France à la fille du duc de Nemours, jeune,
sans biens et sans protection. Peu de temps après, cette princesse a
formé le dessein de quitter le Roi son mari ; elle l’a fait arrêter dans
Lisbonne, et les mêmes troupes, qui un jour auparavant le gardaient
comme leur roi, l’ont gardé le lendemain comme prisonnier ; il a été
confiné dans une île de ses propres États, et on lui a laissé la vie et
le titre de roi. Le prince de Portugal, son frère, a épousé la Reine ;
elle conserve sa dignité, et elle a revêtu le prince son mari de toute
l’autorité du gouvernement, sans lui donner le nom de roi ; elle jouit
tranquillement du succès d’une entreprise si extraordinaire, en paix
avec les Espagnols, et sans guerre civile dans le royaume.
Un vendeur d’herbes, nommé Masaniel, fit soulever le menu peuple
de Naples, et malgré la puissance des Espagnols il usurpa l’autorité
royale ; il disposa souverainement de la vie, de la liberté et des biens
de tout ce qui lui fut suspect ; il se rendit maître des douanes ; il
dépouilla les partisans de tout leur argent et de leurs meubles, et fit
brûler publiquement toutes ces richesses immenses dans le milieu de la
ville, sans qu’un seul de cette foule confuse de révoltés voulût
profiter d’un bien qu’on croyait mal acquis. Ce prodige ne dura que
quinze jours, et finit par un autre prodige : ce même Masaniel, qui
achevait de si grandes choses avec tant de bonheur, de gloire, et de
conduite, perdit subitement l’esprit, et mourut frénétique en
vingt-quatre heures.
La reine de Suède, en paix dans ses États et avec ses voisins,
aimée de ses sujets, respectée des étrangers, jeune et sans dévotion, a
quitté volontairement son royaume, et s’est réduite à une vie privée. Le
roi de Pologne, de la même maison que la reine de Suède, s’est démis
aussi de la royauté, par la seule lassitude d’être roi.
Un lieutenant d’infanterie sans nom et sans crédit, a commencé, à
l’âge de quarante-cinq ans, de se faire connaître dans les désordres
d’Angleterre. Il a dépossédé son roi légitime, bon, juste, doux,
vaillant et libéral ; il lui a fait trancher la tête, par un arrêt de
son parlement ; il a changé la royauté en république ; il a été dix ans
maître de l’Angleterre, plus craint de ses voisins et plus absolu dans
son pays que tous les rois qui y ont régné. Il est mort paisible, et en
pleine possession de toute la puissance du royaume.
Les Hollandais ont secoué le joug de la domination d’Espagne ;
ils ont formé une puissante république, et ils ont soutenu cent ans la
guerre contre leurs rois légitimes pour conserver leur liberté. Ils
doivent tant de grandes choses à la conduite et à la valeur des princes
d’Orange, dont ils ont néanmoins toujours redouté l’ambition et limité
le pouvoir. Présentement cette république, si jalouse de sa puissance,
accorde au prince d’Orange d’aujourd’hui, malgré son peu d’expérience et
ses malheureux succès dans la guerre, ce qu’elle a refusé à ses pères :
elle ne se contente pas de relever sa fortune abattue, elle le met en
état de se faire souverain de Hollande, et elle a souffert qu’il ait
fait déchirer par le peuple un homme qui maintenait seul la liberté
publique.
Cette puissance d’Espagne, si étendue et si formidable à tous les
rois du monde, trouve aujourd’hui son principal appui dans ses sujets
rebelles, et se soutient par la protection des Hollandais.
Un empereur, jeune, faible, simple, gouverné par des ministres
incapables, et pendant le plus grand abaissement de la maison
d’Autriche, se trouve en un moment chef de tous les princes d’Allemagne,
qui craignent son autorité et méprisent sa personne, et il est plus
absolu que n’a jamais été Charles-Quint.
Le roi d’Angleterre, faible, paresseux, et plongé dans les
plaisirs, oubliant les intérêts de son royaume et ses exemples
domestiques, s’est exposé avec fermeté depuis six ans à la fureur de ses
peuples et à la haine de son parlement pour conserver une liaison
étroite avec le roi de France ; au lieu d’arrêter les conquêtes de ce
prince dans les Pays-Bas, il y a même contribué en lui fournissant des
troupes. Cet attachement l’a empêché d’être maître absolu d’Angleterre
et d’en étendre les frontières en Flandre et en Hollande par des places
et par des ports, qu’il a toujours refusés ; mais dans le temps qu’il
reçoit des sommes considérables du Roi, et qu’il a le plus de besoin
d’en être soutenu contre ses propres sujets il renonce, sans prétexte, à
tant d’engagements, et il se déclare contre la France, précisément
quand il lui est utile et honnête d’y être attaché ; par une mauvaise
politique précipitée, il perd, en un moment, le seul avantage qu’il
pouvait retirer d’une mauvaise politique de six années, et ayant pu
donner la paix comme médiateur, il est réduit à la demander comme
suppliant, quand le Roi l’accorde à l’Espagne, à l’Allemagne et à la
Hollande.
Les propositions qui avaient été faites au roi d’Angleterre de
marier sa nièce, la princesse d’York, au prince d’Orange, ne lui étaient
pas agréables ; le duc d’York en paraissait aussi éloigné que le Roi
son frère, et le prince d’Orange même, rebuté par les difficultés de ce
dessein, ne pensait plus à le faire réussir. Le roi d’Angleterre,
étroitement lié au roi de France, consentait à ses conquêtes, lorsque
les intérêts du grand trésorier d’Angleterre et la crainte d’être
attaqué par le Parlement lui ont fait chercher sa sûreté particulière,
en disposant le Roi son maître à s’unir avec le prince d’Orange par le
mariage de la princesse d’York, et à faire déclarer l’Angleterre contre
la France pour la protection des Pays-Bas. Ce changement du roi
d’Angleterre a été si prompt et si secret que le duc d’York l’ignorait
encore deux jours devant le mariage de sa fille, et personne ne se
pouvait persuader que le roi d’Angleterre, qui avait hasardé dix ans sa
vie et sa couronne pour demeurer attaché à la France, pût renoncer en un
moment à tout ce qu’il en espérait pour suivre le sentiment de son
ministre. Le prince d’Orange, de son côté, qui avait tant d’intérêt de
se faire un chemin pour être un jour roi d’Angleterre, négligeait ce
mariage qui le rendait héritier présomptif du royaume ; il bornait ses
desseins à affermir son autorité en Hollande, malgré les mauvais succès
de ses dernières campagnes, et il s’appliquait à se rendre aussi absolu
dans les autres provinces de cet État qu’il le croyait être dans la
Zélande ; mais il s’aperçut bientôt qu’il devait prendre d’autres
mesures, et une aventure ridicule lui fit mieux connaître l’état où il
était dans son pays qu’il ne le voyait par ses propres lumières. Un
crieur public vendait des meubles à un encan où beaucoup de monde
s’assembla ; il mit en vente un atlas, et voyant que personne ne
l’enchérissait, il dit au peuple que ce livre était néanmoins plus rare
qu’on ne pensait, et que les cartes en étaient si exactes que la rivière
dont M. le prince d’Orange n’avait eu aucune connaissance lorsqu’il
perdit la bataille de Cassel y était fidèlement marquée. Cette
raillerie, qui fut reçue avec un applaudissement universel, a été un des
plus puissants motifs qui ont obligé le prince d’Orange à rechercher de
nouveau l’alliance d’Angleterre, pour contenir la Hollande, et pour
joindre tant de puissances contre nous. Il semble néanmoins que ceux qui
ont désiré ce mariage, et ceux qui y ont été contraires, n’ont pas
connu leurs intérêts : le grand trésorier d’Angleterre a voulu adoucir
le Parlement et se garantir d’en être attaqué, en portant le Roi son
maître à donner sa nièce au prince d’Orange, et à se déclarer contre la
France ; le roi d’Angleterre a cru affermir son autorité dans son
royaume par l’appui du prince d’Orange, et il a prétendu engager ses
peuples à lui fournir de l’argent pour ses plaisirs, sous prétexte de
faire la guerre au roi de France et de le contraindre à recevoir la
paix ; le prince d’Orange a eu dessein de soumettre la Hollande par la
protection d’Angleterre ; à la France a appréhendé qu’un mariage si
opposé à ses intérêts n’emportât la balance en joignant l’Angleterre à
tous nos ennemis. L’événement a fait voir, en six semaines, la fausseté
de tant de raisonnements : ce mariage met une défiance éternelle entre
l’Angleterre et la Hollande, et toutes deux le regardent comme un
dessein d’opprimer leur liberté ; le parlement d’Angleterre attaque les
ministres du Roi, pour attaquer ensuite sa propre personne ; les États
de Hollande, lassés de la guerre et jaloux de leur liberté, se repentent
d’avoir mis leur autorité entre les mains d’un jeune homme ambitieux,
et héritier présomptif de la couronne d’Angleterre ; le roi de France,
qui a d’abord regardé ce mariage comme une nouvelle ligue qui se formait
contre lui, a su s’en servir pour diviser ses ennemis, et pour se
mettre en état de prendre la Flandre, s’il n’avait préféré la gloire de
faire la paix à la gloire de faire de nouvelles conquêtes.
Si le siècle présent n’a pas moins produit d’événements
extraordinaires que les siècles passés, on conviendra sans doute qu’il a
le malheureux avantage de les surpasser dans l’excès des crimes. La
France même, qui les a toujours détestés, qui y est opposée par l’humeur
de la nation, par la religion, et qui est soutenue par les exemples du
prince qui règne, se trouve néanmoins aujourd’hui le théâtre où l’on
voit paraître tout ce que l’histoire et la fable nous ont dit des crimes
de l’antiquité Les vices sont de tous les temps, les hommes sont nés
avec de l’intérêt, de la cruauté et de la débauche ; mais si des
personnes que tout le monde connaît avaient paru dans les premiers
siècles, parlerait-on présentement des prostitutions d’Héliogabale, de
la foi des Grecs et des poisons et des parricides de Médée ?
Appendice aux événements de ce siècle
1. Portrait de Mme de Montespan
Diane de Rochechouart est fille du duc de Mortemart et femme du
marquis de Montespan. Sa beauté est surprenante ; son esprit et sa
conversation ont encore plus de charme que sa beauté. Elle fit dessein
de plaire au Roi et de l’ôter à La Vallière dont il était amoureux. Il
négligea longtemps cette conquête, et il en fit même des railleries.
Deux ou trois années se passèrent sans qu’elle fît d’autres progrès que
d’être dame du palais attachée particulièrement à la Reine, et dans une
étroite familiarité avec le Roi et La Vallière. Elle ne se rebuta pas
néanmoins, et se confiant à sa beauté, à son esprit, et aux offices de
Mme de Montausier, dame d’honneur de la Reine, elle suivit son projet
sans douter de l’événement. Elle ne s’y est pas trompée : ses charmes et
le temps détachèrent le Roi de La Vallière, et elle se vit maîtresse
déclarée. Le marquis de Montespan sentit son malheur avec toute la
violence d’un homme jaloux. Il s’emporta contre sa femme ; il reprocha
publiquement à Mme de Montausier qu’elle l’avait entraînée dans la honte
où elle était plongée. Sa douleur et son désespoir firent tant d’éclat
qu’il fut contraint de sortir du royaume pour conserver sa liberté. Mme
de Montespan eut alors toute la facilité qu’elle désirait, et son crédit
n’eut plus de bornes. Elle eut un logement particulier dans toutes les
maisons du Roi ; les conseils secrets se tenaient chez elle. La Reine
céda à sa faveur comme tout le reste de la cour, et non seulement il ne
lui fut plus permis d’ignorer un amour si public, mais elle fut obligée
d’en voir toutes les suites sans oser se plaindre, et elle dut à Mme de
Montespan les marques d’amitié et de douceur qu’elle recevait du Roi.
Mme de Montespan voulut encore que La Vallière fût témoin de son
triomphe, qu’elle fût présente et auprès d’elle à tous les
divertissements publics et particuliers ; elle la fit entrer dans le
secret de la naissance de ses enfants dans les temps où elle cachait son
état à ses propres domestiques. Elle se lassa enfin de la présence de
La Vallière malgré ses soumissions et ses souffrances, et cette fille
simple et crédule fut réduite à prendre l’habit de carmélite, moins par
dévotion que par faiblesse, et on peut dire qu’elle ne quitta le monde
que pour faire sa cour.
2. Portrait du cardinal de Retz
Paul de Gondi, cardinal de Retz, a beaucoup d’élévation,
d’étendue d’esprit, et plus d’ostentation que de vraie grandeur de
courage. Il a une mémoire extraordinaire, plus de force que de politesse
dans ses paroles, l’humeur facile, de la docilité et de la faiblesse à
souffrir les plaintes et les reproches de ses amis, peu de piété,
quelques apparences de religion. Il paraît ambitieux sans l’être ; la
vanité, et ceux qui l’ont conduit, lui ont fait entreprendre de grandes
choses presque toutes opposées à sa profession ; il a suscité les plus
grands désordres de l’État sans avoir un dessein formé de s’en
prévaloir, et bien loin de se déclarer ennemi du cardinal Mazarin pour
occuper sa place, il n’a pensé qu’à lui paraître redoutable, et à se
flatter de la fausse vanité de lui être opposé. Il a su profiter
néanmoins avec habileté des malheurs publics pour se faire cardinal ; il
a souffert la prison avec fermeté, et n’a dû sa liberté qu’à sa
hardiesse. La paresse l’a soutenu avec gloire, durant plusieurs années,
dans l’obscurité d’une vie errante et cachée. Il a conservé l’archevêché
de Paris contre la puissance du cardinal Mazarin ; mais après la mort
de ce ministre il s’en est démis sans connaître ce qu’il faisait, et
sans prendre cette conjoncture pour ménager les intérêts de ses amis et
les siens propres. Il est entré dans divers conclaves, et sa conduite a
toujours augmenté sa réputation. Sa pente naturelle est l’oisiveté ; il
travaille néanmoins avec activité dans les affaires qui le pressent, et
il se repose avec nonchalance quand elles sont finies. Il a une présence
d’esprit, et il sait tellement tourner à son avantage les occasions que
la fortune lui offre qu’il semble qu’il les ait prévues et désirées. Il
aime à raconter ; il veut éblouir indifféremment tous ceux qui
l’écoutent par des aventures extraordinaires, et souvent son imagination
lui fournit plus que sa mémoire. Il est faux dans la plupart de ses
qualités, et ce qui a le plus contribué à sa réputation c’est de savoir
donner un beau jour à ses défauts. Il est insensible à la haine et à
l’amitié, quelque soin qu’il ait pris de paraître occupé de l’une ou de
l’autre ; il est incapable d’envie ni d’avarice, soit par vertu ou par
inapplication. Il a plus emprunté de ses amis qu’un particulier ne
devait espérer de leur pouvoir rendre ; il a senti de la vanité à
trouver tant de crédit, et à entreprendre de s’acquitter. Il n’a point
de goût ni de délicatesse ; il s’amuse à tout et ne se plaît à rien ; il
évite avec adresse de laisser pénétrer qu’il n’a qu’une légère
connaissance de toutes choses. La retraite qu’il vient de faire est la
plus éclatante et la plus fausse action de sa vie ; c’est un sacrifice
qu’il fait à son orgueil, sous prétexte de dévotion : il quitte la cour,
où il ne peut s’attacher, et il s’éloigne du monde, qui s’éloigne de
lui.
3. Remarques sur les commencements de la vie du cardinal de Richelieu
Monsieur de Luçon, qui depuis a été cardinal de Richelieu,
s’étant attaché entièrement aux intérêts du maréchal d’Ancre, lui
conseilla de faire la guerre ; mais après lui avoir donné cette pensée
et que la proposition en fut faite au Conseil, Monsieur de Luçon
témoigna de la désapprouver et s’y opposa pour ce que M. de Nevers, qui
croyait que la paix fût avantageuse pour ses desseins, lui avait fait
offrir le prieuré de La Charité par le P. Joseph, pourvu qu’il la fît
résoudre au Conseil. Ce changement d’opinion de Monsieur de Luçon
surprit le maréchal d’Ancre, et l’obligea de lui dire avec quelque
aigreur qu’il s’étonnait de le voir passer si promptement d’un sentiment
à un autre tout contraire ; à quoi Monsieur de Luçon répondit ces
propres paroles, que les nouvelles rencontres demandent de nouveaux
conseils. Mais jugeant bien par là qu’il avait déplu au maréchal, il
résolut de chercher les moyens de le perdre ; et un jour que Déageant
l’était allé trouver pour lui faire signer quelques expéditions, il lui
dit qu’il avait une affaire importante à communiquer à M. de Luynes, et
qu’il souhaitait de l’entretenir. Le lendemain, M. de Luynes et lui se
virent, où Monsieur de Luçon lui dit que le maréchal d’Ancre était
résolu de le perdre, et que le seul moyen de se garantir d’être opprimé
par un si puissant ennemi était de le prévenir. Ce discours surprit
beaucoup M. de Luynes, qui avait déjà pris cette résolution, ne sachant
si ce conseil, qui lui était donné par une créature du maréchal, n’était
point un piège pour le surprendre et pour lui faire découvrir ses
sentiments. Néanmoins Monsieur de Luçon lui fit paraître tant de zèle
pour le service du Roi et un si grand attachement à la ruine du
maréchal, qu’il disait être le plus grand ennemi de l’État, que M. de
Luynes, persuadé de sa sincérité, fut sur le point de lui découvrir son
dessein, et de lui communiquer le projet qu’il avait fait de tuer le
maréchal ; mais s’étant retenu alors de lui en parler, il dit à Déageant
la conversation qu’ils avaient eue ensemble et l’envie qu’il avait de
lui faire part de son secret ; ce que Déageant désapprouva entièrement,
et lui fit voir que ce serait donner un moyen infaillible à Monsieur de
Luçon de se réconcilier à ses dépens avec le maréchal, et de se joindre
plus étroitement que jamais avec lui, en lui découvrant une affaire de
cette conséquence : de sorte que la chose s’exécuta, et le maréchal
d’Ancre fut tué sans que Monsieur de Luçon en eût connaissance. Mais les
conseils qu’il avait donnés à M. de Luynes, et l’animosité qu’il lui
avait témoigné d’avoir contre le maréchal le conservèrent, et firent que
le Roi lui commanda de continuer d’assister au Conseil, et d’exercer sa
charge de secrétaire d’État comme il avait accoutumé : si bien qu’il
demeura encore quelque temps à la cour, sans que la chute du maréchal
qui l’avait avancé nuisît à sa fortune. Mais, comme il n’avait pas pris
les mêmes précautions envers les vieux ministres qu’il avait fait auprès
de M. de Luynes, M. de Villeroy et M. le président Jeannin, qui virent
par quel biais il entrait dans les affaires, firent connaître à M. de
Luynes qu’il ne devait pas attendre plus de fidélité de lui qu’il en
avait témoigné pour le maréchal d’Ancre, et qu’il était nécessaire de
l’éloigner comme une personne dangereuse et qui voulait s’établir par
quelques voies que ce pût être : ce qui fit résoudre M. de Luynes à lui
commander de se retirer à Avignon.
Cependant la Reine mère du Roi alla à Blois, et Monsieur de
Luçon, qui ne pouvait souffrir de se voir privé de toutes ses
espérances, essaya de renouer avec M. de Luynes et lui fit offrir que,
s’il lui permettait de retourner auprès de la Reine, qu’il se servirait
du pouvoir qu’il avait sur son esprit pour lui faire chasser tous ceux
qui lui étaient désagréables et pour lui faire faire toutes les choses
que M. de Luynes lui prescrirait. Cette proposition fut reçue, et
Monsieur de Luçon, retournant, produisit l’affaire du Pont-de-Cé, en
suite de quoi il fut fait cardinal, et commença d’établir les fondements
de la grandeur où il est parvenu.
4. Le comte d’Harcourt
Le soin que la fortune a pris d’élever et d’abattre le mérite des
hommes est connu dans tous les temps, et il y a mille exemples du droit
qu’elle s’est donné de mettre le prix à leurs qualités, comme les
souverains mettent le prix à la monnaie, pour faire voir que sa marque
leur donne le cours qu’il lui plaît. Si elle s’est servie des talents
extraordinaires de Monsieur le Prince et de M. de Turenne pour les faire
admirer, il paraît qu’elle a respecté leur vertu et que, tout injuste
qu’elle est, elle n’a pu se dispenser de leur faire justice. Mais on
peut dire qu’elle veut montrer toute l’étendue de son pouvoir
lorsqu’elle choisit des sujets médiocres pour les égaler aux plus grands
hommes. Ceux qui ont connu le comte d’Harcourt conviendront de ce que
je dis, et ils le regarderont comme un chef-d’œuvre de la fortune, qui a
voulu que la postérité le jugeât digne d’être comparé dans la gloire
des armes aux plus célèbres capitaines. Ils lui verront exécuter
heureusement les plus difficiles et les plus glorieuses entreprises. Les
succès des îles Sainte-Marguerite, de Casal, le combat de la Route, le
siège de Turin, les batailles gagnées en Catalogne, une si longue suite
de victoires étonneront les siècles à venir. La gloire du comte
d’Harcourt sera en balance avec celle de Monsieur le Prince et de M. de
Turenne, malgré les distances que la nature a mises entre eux ; elle
aura un même rang dans l’histoire, et on n’osera refuser à son mérite ce
que l’on sait présentement qui n’est dû qu’à sa seule fortune.
Portrait de La Rochefoucauld par lui-même
Je
suis d’une taille médiocre, libre et bien proportionnée. J’ai le teint
brun mais assez uni, le front élevé et d’une raisonnable grandeur, les
yeux noirs, petits et enfoncés, et les sourcils noirs et épais, mais
bien tournés. Je serais fort empêché à dire de quelle sorte j’ai le nez
fait, car il n’est ni camus ni aquilin, ni gros ni pointu, au moins à ce
que je crois. Tout ce que je sais, c’est qu’il est plutôt grand que
petit, et qu’il descend un peu trop en bas. J’ai la bouche grande, et
les lèvres assez rouges d’ordinaire, et ni bien ni mal taillées. J’ai
les dents blanches, et passablement bien rangées. On m’a dit autrefois
que j’avais un peu trop de menton : je viens de me tâter et de me
regarder dans le miroir pour savoir ce qui en est, et je ne sais pas
trop bien qu’en juger. Pour le tour du visage, je l’ai ou carré ou en
ovale ; lequel des deux, il me serait fort difficile de le dire. J’ai
les cheveux noirs, naturellement frisés, et avec cela assez épais et
assez longs pour pouvoir prétendre en belle tête. J’ai quelque chose de
chagrin et de fier dans la mine ; cela fait croire à la plupart des gens
que je suis méprisant, quoique je ne le sois point du tout. J’ai
l’action fort aisée, et même un peu trop, et jusques à faire beaucoup de
gestes en parlant. Voilà naïvement comme je pense que je suis fait au
dehors, et l’on trouvera, je crois, que ce que je pense de moi là-dessus
n’est pas fort éloigné de ce qui en est. J’en userai avec la même
fidélité dans ce qui me reste à faire de mon portrait ; car je me suis
assez étudié pour me bien connaître, et je ne manque ni d’assurance pour
dire librement ce que je puis avoir de bonnes qualités, ni de sincérité
pour avouer franchement ce que j’ai de défauts. Premièrement, pour
parler de mon humeur, je suis mélancolique, et je le suis à un point que
depuis trois ou quatre ans à peine m’a-t-on vu rire trois ou quatre
fois. J’aurais pourtant, ce me semble, une mélancolie assez supportable
et assez douce, si je n’en avais point d’autre que celle qui me vient de
mon tempérament ; mais il m’en vient tant d’ailleurs, et ce qui m’en
vient me remplir de telle sorte l’imagination, et m’occupe si fort
l’esprit, que la plupart du temps ou je rêve sans dire mot ou je n’ai
presque point d’attache à ce que je dis. Je suis fort resserré avec ceux
que je ne connais pas, et je ne suis pas même extrêmement ouvert avec
la plupart de ceux que je connais. C’est un défaut, je le sais bien, et
je ne négligerai rien pour m’en corriger ; mais comme un certain air
sombre que j’ai dans le visage contribue à me faire paraître encore plus
réservé que je ne le suis, et qu’il n’est pas en notre pouvoir de nous
défaire d’un méchant air qui nous vient de la disposition naturelle des
traits, je pense qu’après m’être corrigé au dedans, il ne laissera pas
de me demeurer toujours de mauvaises marques au dehors. J’ai de l’esprit
et je ne fais point difficulté de le dire ; car à quoi bon façonner
là-dessus ? Tant biaiser et tant apporter d’adoucissement pour dire les
avantages que l’on a, c’est, ce me semble, cacher un peu de vanité sous
une modestie apparente et se servir d’une manière bien adroite pour
faire croire de soi beaucoup plus de bien que l’on n’en dit. Pour moi,
je suis content qu’on ne me croie ni plus beau que je me fais, ni de
meilleure humeur que je me dépeins, ni plus spirituel et plus
raisonnable que je dirai que je le suis. J’ai donc de l’esprit, encore
une fois, mais un esprit que la mélancolie gâte ; car, encore que je
possède assez bien ma langue, que j’aie la mémoire heureuse, et que je
ne pense pas les choses fort confusément, j’ai pourtant une si forte
application à mon chagrin que souvent j’exprime assez mal ce que je veux
dire. La conversation des honnêtes gens est un des plaisirs qui me
touchent le plus. J’aime qu’elle soit sérieuse et que la morale en fasse
la plus grande partie ; cependant je sais la goûter aussi quand elle
est enjouée, et si je n’y dis pas beaucoup de petites choses pour rire,
ce n’est pas du moins que je ne connaisse bien ce que valent les
bagatelles bien dites, et que je ne trouve fort divertissante cette
manière de badiner où il y a certains esprits prompts et aisés qui
réussissent si bien. J’écris bien en prose, je fais bien en vers, et si
j’étais sensible à la gloire qui vient de ce côté-là, je pense qu’avec
peu de travail je pourrais m’acquérir assez de réputation. J’aime la
lecture en général ; celle où il se trouve quelque chose qui peut
façonner l’esprit et fortifier l’âme est celle que j’aime le plus.
Surtout, j’ai une extrême satisfaction à lire avec une personne
d’esprit ; car de cette sorte on réfléchit à tous moments sur ce qu’on
lit, et des réflexions que l’on fait il se forme une conversation la
plus agréable du monde, et la plus utile. Je juge assez bien des
ouvrages de vers et de prose que l’on me montre ; mais j’en dis
peut-être mon sentiment avec un peu trop de liberté. Ce qu’il y a encore
de mal en moi, c’est que j’ai quelquefois une délicatesse trop
scrupuleuse, et une critique trop sévère. Je ne hais pas à entendre
disputer, et souvent aussi je me mêle assez volontiers dans la dispute :
mais je soutiens d’ordinaire mon opinion avec trop de chaleur et
lorsqu’on défend un parti injuste contre moi, quelquefois, à force de me
passionner pour celui de la raison, je deviens moi-même fort peu
raisonnable. J’ai les sentiments vertueux, les inclinations belles, et
une si forte envie d’être tout à fait honnête homme que mes amis ne me
sauraient faire un plus grand plaisir que de m’avertir sincèrement de
mes défauts. Ceux qui me connaissent un peu particulièrement et qui ont
eu la bonté de me donner quelquefois des avis là-dessus savent que je
les ai toujours reçus avec toute la joie imaginable, et toute la
soumission d’esprit que l’on saurait désirer. J’ai toutes les passions
assez douces et assez réglées : on ne m’a presque jamais vu en colère et
je n’ai jamais eu de haine pour personne. Je ne suis pas pourtant
incapable de me venger, si l’on m’avait offensé, et qu’il y allât de mon
honneur à me ressentir de l’injure qu’on m’aurait faite. Au contraire
je suis assuré que le devoir ferait si bien en moi l’office de la haine
que je poursuivrais ma vengeance avec encore plus de vigueur qu’un
autre. L’ambition ne me travaille point. Je ne crains guère de choses,
et ne crains aucunement la mort. Je suis peu sensible à la pitié, et je
voudrais ne l’y être point du tout. Cependant il n’est rien que je ne
fisse pour le soulagement d’une personne affligée, et je crois
effectivement que l’on doit tout faire, jusques à lui témoigner même
beaucoup de compassion de son mal, car les misérables sont si sots que
cela leur fait le plus grand bien du monde ; mais je tiens aussi qu’il
faut se contenter d’en témoigner, et se garder soigneusement d’en avoir.
C’est une passion qui n’est bonne à rien au-dedans d’une âme bien
faite, qui ne sert qu’à affaiblir le cœur et qu’on doit laisser au
peuple qui, n’exécutant jamais rien par raison, a besoin de passions
pour le porter à faire les choses. J’aime mes amis, et je les aime d’une
façon que je ne balancerais pas un moment à sacrifier mes intérêts aux
leurs ; j’ai de la condescendance pour eux, je souffre patiemment leurs
mauvaises humeurs et j’en excuse facilement toutes choses ; seulement je
ne leur fais pas beaucoup de caresses, et je n’ai pas non plus de
grandes inquiétudes en leur absence. J’ai naturellement fort peu de
curiosité pour la plus grande partie de tout ce qui en donne aux autres
gens. Je suis fort secret, et j’ai moins de difficulté que personne à
taire ce qu’on m’a dit en confidence. Je suis extrêmement régulier à ma
parole ; je n’y manque jamais, de quelque conséquence que puisse être ce
que j’ai promis et je m’en suis fait toute ma vie une loi
indispensable. J’ai une civilité fort exacte parmi les femmes, et je ne
crois pas avoir jamais rien dit devant elles qui leur ait pu faire de la
peine. Quand elles ont l’esprit bien fait, j’aime mieux leur
conversation que celle des hommes : on y trouve une certaine douceur qui
ne se rencontre point parmi nous, et il me semble outre cela qu’elles
s’expliquent avec plus de netteté et qu’elles donnent un tour plus
agréable aux choses qu’elles disent. Pour galant, je l’ai été un peu
autrefois ; présentement je ne le suis plus, quelque jeune que je sois.
J’ai renoncé aux fleurettes et je m’étonne seulement de ce qu’il y a
encore tant d’honnêtes gens qui s’occupent à en débiter. J’approuve
extrêmement les belles passions : elles marquent la grandeur de l’âme,
et quoique dans les inquiétudes qu’elles donnent il y ait quelque chose
de contraire à la sévère sagesse, elles s’accommodent si bien d’ailleurs
avec la plus austère vertu que je crois qu’on ne les saurait condamner
avec justice. Moi qui connais tout ce qu’il y a de délicat et de fort
dans les grands sentiments de l’amour, si jamais je viens à aimer, ce
sera assurément de cette sorte ; mais, de la façon dont je suis, je ne
crois pas que cette connaissance que j’ai me passe jamais de l’esprit au
cœur.
Documents relatifs à la genèse des maximes
Avis au lecteur
Voici un portrait du cœur de l’homme que je donne au public, sous
le nom de Réflexions ou Maximes morales. Il court fortune de ne plaire
pas à tout le monde, parce qu’on trouvera peut-être qu’il ressemble
trop, et qu’il ne flatte pas assez. Il y a apparence que l’intention du
peintre n’a jamais été de faire paraître cet ouvrage, et qu’il serait
encore renfermé dans son cabinet si une méchante copie qui en a couru,
et qui a passé même depuis quelque temps en Hollande, n’avait obligé un
de ses amis de m’en donner une autre, qu’il dit être tout à fait
conforme à l’original ; mais toute correcte qu’elle est, possible
n’évitera-t-elle pas la censure de certaines personnes qui ne peuvent
souffrir que l’on se mêle de pénétrer dans le fond de leur cœur, et qui
croient être en droit d’empêcher que les autres les connaissent, parce
qu’elles ne veulent pas se connaître elles-mêmes. Il est vrai que, comme
ces Maximes sont remplies de ces sortes de vérités dont l’orgueil
humain ne se peut accommoder, il est presque impossible qu’il ne se
soulève contre elles, et qu’elles ne s’attirent des censeurs. Aussi
est-ce pour eux que je mets ici une Lettre que l’on m’a donné, qui a été
faite depuis que le manuscrit a paru, et dans le temps que chacun se
mêlait d’en dire son avis. Elle m’a semblé assez propre pour répondre
aux principales difficultés que l’on peut opposer aux Réflexions, et
pour expliquer les sentiments de leur auteur. Elle suffit pour faire
voir que ce qu’elles contiennent n’est autre chose que l’abrégé d’une
morale conforme aux pensées de plusieurs Pères de l’Église, et que celui
qui les a écrites a eu beaucoup de raison de croire qu’il ne pouvait
s’égarer en suivant de si bons guides, et qu’il lui était permis de
parler de l’homme comme les Pères en ont parlé. Mais si le respect qui
leur est dû n’est pas capable de retenir le chagrin des critiques, s’ils
ne font point de scrupule de condamner l’opinion de ces grands hommes
en condamnant ce livre, je prie le lecteur de ne les pas imiter, de ne
laisser point entraîner son esprit au premier mouvement de son cœur, et
de donner ordre, s’il est possible, que l’amour-propre ne se mêle point
dans le jugement qu’il en fera ; car il le consulte, il ne faut pas
s’attendre qu’il puisse être favorable à ces Maximes : comme elles
traitent l’amour-propre de corrupteur de la raison, il ne manquera pas
de prévenir l’esprit contre elles. Il faut donc prendre garde que cette
prévention ne les justifie, et se persuader qu’il n’y a rien de plus
propre à établir la vérité de ces Réflexions que la chaleur et la
subtilité que l’on témoignera pour les combattre. En effet il sera
difficile de faire croire à tout homme de bon sens que l’on les condamne
par d’autre motif que par celui de l’intérêt caché, de l’orgueil et de
l’amour-propre. En un mot, le meilleur parti que le lecteur ait à
prendre est de se mettre d’abord dans l’esprit qu’il n’y a aucune de ces
maximes qui le regarde en particulier, et qu’il en est seul excepté,
bien qu’elles paraissent générales ; après cela, je lui réponds qu’il
sera le premier à y souscrire, et qu’il croira qu’elles font encore
grâce au cœur humain. Voilà ce que j’avais à dire sur cet écrit en
général. Pour ce qui est de la méthode que l’on y eût pu observer, je
crois qu’il eût été à désirer que chaque maxime eût eu un titre du sujet
qu’elle traite, et qu’elles eussent été mises dans un plus grand
ordre ; mais je ne l’ai pu faire sans renverser entièrement celui de la
copie qu’on m’a donnée ; et comme il y a plusieurs maximes sur une même
matière, ceux à qui j’en ai demandé avis ont jugé qu’il était plus
expédient de faire une table à laquelle on aura recours pour trouver
celles qui traitent d’une même chose.
Discours sur les réflexions ou sentences et maximes morales
Monsieur,
Je ne saurais vous dire au vrai si les Réflexions morales sont de
M.***, quoiqu’elles soient écrites d’une manière qui semble approcher
de la sienne ; mais en ces occasions-là je me défie presque toujours de
l’opinion publique, et c’est assez qu’elle lui en ait fait un présent
pour me donner une juste raison de n’en rien croire. Voilà de bonne foi
tout ce que je vous puis répondre sur la première chose que vous me
demandez. Et pour l’autre, si vous n’aviez bien du pouvoir sur moi, vous
n’en auriez guère plus de contentement ; car un homme prévenu, au point
que je le suis, d’estime pour cet ouvrage n’a pas toute la liberté
qu’il faut pour en bien juger. Néanmoins, puisque vous me l’ordonnez, je
vous en dirai mon avis, sans vouloir m’ériger autrement en faiseur de
dissertations, et sans y mêler en aucune façon l’intérêt de celui que
l’on croit avoir fait cet écrit. Il est aisé de voir d’abord qu’il
n’était pas destiné pour paraître au jour, mais seulement pour la
satisfaction d’une personne qui, à mon avis, n’aspire pas à la gloire
d’être auteur ; et si par hasard c’était M.***, je puis vous dire que sa
réputation est établie dans le monde par tant de meilleurs titres qu’il
n’aurait pas moins de chagrin de savoir que ces Réflexions sont
devenues publiques qu’il en eut lorsque les Mémoires qu’on lui attribue
furent imprimés. Mais vous savez, Monsieur, l’empressement qu’il y a
dans le siècle pour publier toutes les nouveautés, et s’il y a moyen de
l’empêcher quand on le voudrait, surtout celles qui courent sous des
noms qui les rendent recommandables. Il n’y a rien de plus vrai,
Monsieur : les noms font valoir les choses auprès de ceux qui n’en
sauraient connaître le véritable prix ; celui des Réflexions est connu
de peu de gens, quoique plusieurs se soient mêlés d’en dire leur avis.
Pour moi, je ne me pique pas d’être assez délicat et assez habile pour
en bien juger ; je dis habile et délicat, parce que je tiens qu’il faut
être pour cela l’un et l’autre ; et quand je me pourrais flatter de
l’être, je m’imagine que j’y trouverais peu de choses à changer. J’y
rencontre partout de la force et de la pénétration, des pensées élevées
et hardies, le tour de l’expression noble, et accompagné d’un certain
air de qualité qui n’appartient pas à tous ceux qui se mêlent d’écrire.
Je demeure d’accord qu’on n’y trouvera pas tout l’ordre ni tout l’art
que l’on y pourrait souhaiter, et qu’un savant qui aurait un plus grand
loisir y aurait pu mettre plus d’arrangement ; mais un homme qui n’écrit
que pour soi, et pour délasser son esprit, qui écrit les choses à
mesure qu’elles lui viennent dans la pensée, n’affecte pas tant de
suivre les règles que celui qui écrit de profession, qui s’en fait une
affaire, et qui songe à s’en faire honneur. Ce désordre néanmoins a ses
grâces, et des grâces que l’art ne peut imiter. Je ne sais pas si vous
êtes de mon goût, mais quand les savants m’en devraient vouloir du mal,
je ne puis m’empêcher de dire que je préférerai toute ma vie la manière
d’écrire négligée d’un courtisan qui a de l’esprit à la régularité gênée
d’un docteur qui n’a jamais rien vu que ses livres. Plus ce qu’il dit
et ce qu’il écrit paraît aisé, et dans un certain air d’un homme qui se
néglige, plus cette négligence, qui cache l’art sous une expression
simple et naturelle, lui donne d’agrément. C’est de Tacite que je tiens
ceci, je vous mets à la marge le passage latin, que vous lirez si vous
en avez envie ; et j’en userai de même de tous ceux dont je me
souviendrai, n’étant pas assuré si vous aimez cette langue qui n’entre
guère dans le commerce du grand monde, quoique je sache que vous
l’entendez parfaitement. N’est-il pas vrai, Monsieur, que cette justesse
recherchée avec trop d’étude a toujours un je ne sais quoi de contraint
qui donne du dégoût, et qu’on ne trouve jamais dans les ouvrages de ces
gens esclaves des règles ces beautés où l’art se déguise sous les
apparences du naturel, ce don d’écrire facilement et noblement, enfin ce
que le Tasse a dit du palais d’Armide :
Stimi (si misto il culto è col negletto),
Sol naturali gli ornamenti e i siti.
Di natura arte par, che per diletto
L’imitatrice sua scherzando imiti.
Voilà comme un poète français l’a pensé après lui.
L’artifice n’a point de part
Dans cette admirable structure ;
La nature, en formant tous les traits au hasard,
Sait si bien imiter la justesse de l’art
Que l’œil, trompé d’une douce imposture,
Croit que c’est l’art qui suit l’ordre de la nature.
Voilà ce que je pense de l’ouvrage en général ; mais je vois bien
que ce n’est pas assez pour vous satisfaire, et que vous voulez que je
réponde plus précisément aux difficultés que vous me dites que l’on vous
a faites. Il me semble que la première est celle-ci : que les
Réflexions détruisent toutes les vertus. On peut dire à cela que
l’intention de celui qui les a écrites paraît fort éloignée de les
vouloir détruire ; il prétend seulement faire voir qu’il n’y en a
presque point de pures dans le monde, et que dans la plupart de nos
actions il y a un mélange d’erreur et de vérité, de perfection et
d’imperfection, de vice et de vertu ; il regarde le cœur de l’homme
corrompu, attaqué de l’orgueil et de l’amour-propre, et environné de
mauvais exemples comme le commandant d’une ville assiégée à qui l’argent
a manqué : il fait de la monnaie de cuir, et de carton ; cette monnaie a
la figure de la bonne, on la débite pour le même prix, mais ce n’est
que la misère et le besoin qui lui donnent cours parmi les assiégés. De
même la plupart des actions des hommes que le monde prend pour des
vertus n’en ont bien souvent que l’image et la ressemblance. Elles ne
laissent pas néanmoins d’avoir leur mérite et d’être dignes en quelque
sorte de notre estime, étant très difficile d’en avoir humainement de
meilleures. Mais quand il serait vrai qu’il croirait qu’il n’y en aurait
aucune de véritable dans l’homme, en le considérant dans un état
purement naturel, il ne serait pas le premier qui aurait eu cette
opinion. Si je ne craignais pas de m’ériger trop en docteur, je vous
citerais bien des auteurs, et même des Pères de l’Église, et de grands
saints, qui ont pensé que l’amour-propre et l’orgueil étaient l’âme des
plus belles actions des païens. Je vous ferais voir que quelques-uns
d’entre eux n’ont pas même pardonné à la chasteté de Lucrèce, que tout
le monde avait crue vertueuse jusqu’à ce qu’ils eussent découvert la
fausseté de cette vertu, qui avait produit la liberté de Rome, et qui
s’était attiré l’admiration de tant de siècles. Pensez-vous, Monsieur,
que Sénèque, qui faisait aller son sage de pair avec les dieux, fût
véritablement sage lui-même, et qu’il fût bien persuadé de ce qu’il
voulait persuader aux autres ? Son orgueil n’a pu l’empêcher de dire
quelquefois qu’on n’avait point vu dans le monde d’exemple de l’idée
qu’il proposait, qu’il était impossible de trouver une vertu si achevée
parmi les hommes, et que le plus parfait d’entre eux était celui qui
avait le moins de défauts. Il demeure d’accord que l’on peut reprocher à
Socrate d’avoir eu quelques amitiés suspectes ; à Platon et Aristote,
d’avoir été avares ; à Epicure, prodigue et voluptueux ; mais il s’écrie
en même temps que nous serions trop heureux d’être parvenus à savoir
imiter leurs vices. Ce philosophe aurait eu raison d’en dire autant des
siens, car on ne serait pas trop malheureux de pouvoir jouir comme il a
fait de toute sorte de biens, d’honneurs et de plaisirs, en affectant de
les mépriser ; de se voir le maître de l’empire, et de l’empereur, et
l’amant de l’impératrice en même temps ; d’avoir de superbes palais, des
jardins délicieux, et de prêcher, aussi à son aise qu’il faisait, la
modération, et la pauvreté, au milieu de l’abondance, et des richesses.
Pensez-vous, Monsieur, que ce stoïcien qui contrefaisait si bien le
maître de ses passions eut d’autres vertus que celle de bien cacher ses
vices, et qu’en se faisant couper les veines il ne se repentit pas plus
d’une fois d’avoir laissé à son disciple le pouvoir de le faire mourir ?
Regardez un peu de près ce faux brave : vous verrez qu’en faisant de
beaux raisonnements sur l’immortalité de l’âme, il cherche à s’étourdir
sur la crainte de la mort ; il ramasse toutes ses forces pour faire
bonne mine ; il se mord la langue de peur de dire que la douleur est un
mal ; il prétend que la raison peut rendre l’homme impassible, et au
lieu d’abaisser son orgueil il le relève au-dessus de la divinité. Il
nous aurait bien plus obligés de nous avouer franchement les faiblesses
et la corruption du cœur humain, que de prendre tant de peine à nous
tromper. L’auteur des Réflexions n’en fait pas de même : il expose au
jour toutes les misères de l’homme. Mais c’est de l’homme abandonné à sa
conduite qu’il parle, et non pas du chrétien. Il fait voir que, malgré
tous les efforts de sa raison, l’orgueil et l’amour-propre ne laissent
pas de se cacher dans les replis de son cœur, d’y vivre et d’y conserver
assez de forces pour répandre leur venin sans qu’il s’en aperçoive dans
la plupart de ses mouvements.
La seconde difficulté que l’on vous a faite, et qui a beaucoup de
rapport à la première, est que les Réflexions passent dans le monde
pour des subtilités d’un censeur qui prend en mauvaise part les actions
les plus indifférentes, plutôt que pour des vérités solides. Vous me
dites que quelques-uns de vos amis vous ont assuré de bonne foi qu’ils
savaient, par leur propre expérience, que l’on fait quelquefois le bien
sans avoir d’autre vue que celle du bien, et souvent même sans en avoir
aucune, ni pour le bien, ni pour le mal, mais par une droiture naturelle
du cœur, qui le porte sans y penser vers ce qui est bon. Je voudrais
qu’il me fût permis de croire ces gens-là sur leur parole, et qu’il fût
vrai que la nature humaine n’eût que des mouvements raisonnables, et que
toutes nos actions fussent naturellement vertueuses ; mais, Monsieur,
comment accorderons-nous le témoignage de vos amis avec les sentiments
des mêmes Pères de l’Église, qui ont assuré que toutes nos vertus, sans
le secours de la foi, n’étaient que des imperfections ; que notre
volonté était née aveugle ; que ses désirs étaient aveugles, sa conduite
encore plus aveugle, et qu’il ne fallait pas s’étonner si, parmi tant
d’aveuglement, l’homme était dans un égarement continuel ? Il en ont
parlé encore plus fortement, car ils ont dit qu’en cet état la prudence
de l’homme ne pénétrait dans l’avenir et n’ordonnait rien que par
rapport à l’orgueil ; que sa tempérance ne modérait aucun excès que
celui que l’orgueil avait condamné ; que sa constance ne se soutenait
dans les malheurs qu’autant qu’elle était soutenue par l’orgueil ; et
enfin que toutes ses vertus, avec cet éclat extérieur de mérite qui les
faisait admirer, n’avaient pour but que cette admiration, l’amour d’une
vaine gloire, et l’intérêt de l’orgueil. On trouverait un nombre presque
infini d’autorités sur cette opinion ; mais si je m’engageais à vous
les citer régulièrement, j’en aurais un peu plus de peine, et vous n’en
auriez pas plus de plaisir. Je pense donc que le meilleur, pour vous et
pour moi, sera de vous en faire voir l’abrégé dans six vers d’un
excellent poète de notre temps :
Si le jour de la foi n’éclaire la raison,
Notre goût dépravé tourne tout en poison ;
Toujours de notre orgueil la subtile imposture
Au bien qu’il semble aimer fait changer de nature ;
Et dans le propre amour dont l’homme est revêtu,
Il se rend criminel même par sa vertu.
S’il faut néanmoins demeurer d’accord que vos amis ont le don de
cette foi vive qui redresse toutes les mauvaises inclinations de
l’amour-propre, si Dieu leur fait des grâces extraordinaires, s’il les
sanctifie dès ce monde, je souscris de bon cœur à leur canonisation, et
je leur déclare que les Réflexions morales ne les regardent point. Il
n’y a pas d’apparence que celui qui les a écrites en veuille à la vertu
des saints ; il ne s’adresse, comme je vous ai dit, qu’à l’homme
corrompu, il soutient qu’il fait presque toujours du mal quand son
amour-propre le flatte qu’il fait le bien, et qu’il se trompe souvent
lorsqu’il veut juger de lui-même, parce que la nature ne se déclare pas
en lui sincèrement des motifs qui le font agir. Dans cet état malheureux
où l’orgueil est l’âme de tous ses mouvements, les saints mêmes sont
les premiers à lui déclarer la guerre, et le traitent plus mal sans
comparaison que ne fait l’auteur des Réflexions. S’il vous prend quelque
jour envie de voir les passages que j’ai trouvés dans leurs écrits sur
ce sujet, vous serez aussi persuadé que je le suis de cette vérité ;
mais je vous supplie de vous contenter à présent de ces vers, qui vous
expliqueront une partie de ce qu’ils ont pensé :
Le désir des honneurs, des biens, et des délices,
Produit seul ses vertus, comme il produit ses vices,
Et l’aveugle intérêt qui règne dans son cœur,
Va d’objet en objet, et d’erreur en erreur ;
Le nombre de ses maux s’accroît par leur remède ;
Au mal qui se guérit un autre mal succède ;
Au gré de ce tyran dont l’empire est caché,
Un péché se détruit par un autre péché.
Montaigne, que j’ai quelque scrupule de vous citer après des
Pères de l’Église, dit assez heureusement sur ce même sujet que son âme a
deux visages différents, qu’elle a beau se replier sur elle-même, elle
n’aperçoit jamais que celui que l’amour-propre a déguisé, pendant que
l’autre se découvre par ceux qui n’ont point de part à ce déguisement.
Si j’osais enchérir sur une métaphore si hardie, je dirais que l’homme
corrompu est fait comme ces médailles qui représentent la figure d’un
saint et celle d’un démon dans une seule face et par les mêmes traits.
Il n’y a que la diverse situation de ceux qui la regardent qui change
l’objet ; l’un voit le saint, et l’autre voit le démon. Ces comparaisons
nous font assez comprendre que, quand l’amour-propre a séduit le cœur,
l’orgueil aveugle tellement la raison, et répand tant d’obscurité dans
toutes ses connaissances, qu’elle ne peut juger du moindre de nos
mouvements, ni former d’elle-même aucun discours assuré pour notre
conduite. Les hommes, dit Horace, sont sur la terre comme une troupe de
voyageurs, que la nuit a surpris en passant dans une forêt : ils
marchent sur la foi d’un guide qui les égare aussitôt, ou par malice, ou
par ignorance, chacun d’eux se met en peine de retrouver le chemin ;
ils prennent tous diverses routes, et chacun croit suivre la bonne ;
plus il le croit, et plus il s’en écarte. Mais quoique leurs égarements
soient différents, ils n’ont pourtant qu’une même cause : c’est le guide
qui les a trompés, et l’obscurité de la nuit qui les empêche de se
redresser. Peut-on mieux dépeindre l’aveuglement et les inquiétudes de
l’homme abandonné à sa propre conduite, qui n’écoute que les conseils de
son orgueil, qui croit aller naturellement droit au bien, et qui
s’imagine toujours que le dernier qu’il recherche est le meilleur ?
N’est-il pas vrai que, dans le temps qu’il se flatte de faire des
actions vertueuses, c’est alors que l’égarement de son cœur est plus
dangereux ? Il y a un si grand nombre de roues qui composent le
mouvement de cet horloge, et le principe en est si caché, qu’encore que
nous voyions ce que marque la montre, nous ne savons pas quel est le
ressort qui conduit l’aiguille sur toutes les heures du cadran.
La troisième difficulté que j’ai à résoudre est que beaucoup de
personnes trouvent de l’obscurité dans le sens et dans l’expression de
ces réflexions. L’obscurité, comme vous savez, Monsieur, ne vient pas
toujours de la faute de celui qui écrit. Les Réflexions, ou si vous
voulez les Maximes et les Sentences, comme le monde a nommé celles-ci,
doivent être écrites dans un style serré, qui ne permet pas de donner
aux choses toute la clarté qui serait à désirer. Ce sont les premiers
traits du tableau : les yeux habiles y remarquent bien toute la finesse
de l’art et la beauté de la pensée du peintre ; mais cette beauté n’est
pas faite pour tout le monde, et quoique ces traits ne soient point
remplis de couleurs, ils n’en sont pas moins des coups de maître. Il
faut donc se donner le loisir de pénétrer le sens et la force des
paroles, il faut que l’esprit parcoure toute l’étendue de leur
signification avant que de se reposer pour en former le jugement.
La quatrième difficulté est, ce me semble, que les Maximes sont
presque partout trop générales. On vous a dit qu’il est injuste
d’étendre sur tout le genre humain des défauts qui ne se trouvent qu’en
quelques hommes. Je sais, outre ce que vous me mandez des différents
sentiments que vous en avez entendus, ce que l’on oppose d’ordinaire à
ceux qui découvrent et qui condamnent les vices : on appelle leur
censure le portrait du peintre ; on dit qu’ils sont comme les malades de
la jaunisse, qu’ils voient tout jaune parce qu’ils le sont eux-mêmes.
Mais s’il était vrai que, pour censurer la corruption du cœur en
général, il fallût la ressentir en particulier plus qu’un autre, il
faudrait aussi demeurer d’accord que ces philosophes, dont Diogène de
Laërce nous rapporte les sentences, étaient les hommes les plus
corrompus de leur siècle, il faudrait faire le procès à la mémoire de
Caton, et croire que c’était le plus méchant homme de la république,
parce qu’il censurait les vices de Rome. Si cela est, Monsieur, je ne
pense pas que l’auteur des Réflexions, quel qu’il puisse être, trouve
rien à redire au chagrin de ceux qui le condamneront, quand, à la
religion près, on ne le croira pas plus homme de bien, ni plus sage que
Caton. Je dirai encore, pour ce qui regarde les termes que l’on trouve
trop généraux, qu’il est difficile de les restreindre dans les sentences
sans leur ôter tout le sel et toute la force ; il me semble, outre
cela, que l’usage nous fait voir que sous des expressions générales
l’esprit ne laisse pas de sous-entendre de lui-même des restrictions.
Par exemple, quand on dit : Tout Paris fut au-devant du Roi, toute la
cour est dans la joie, ces façons de parler ne signifient néanmoins que
la plus grande partie. Si vous croyez que ces raisons ne suffisent pas
pour fermer la bouche aux critiques, ajoutons-y que quand on se
scandalise si aisément des termes d’une censure générale, c’est à cause
qu’elle nous pique trop vivement dans l’endroit le plus sensible du
cœur.
Néanmoins il est certain que nous connaissons, vous et moi, bien
des gens qui ne se scandalisent pas de celle des Réflexions, j’entends
de ceux qui ont l’hypocrisie en aversion, et qui avouent de bonne foi ce
qu’ils sentent en eux-mêmes et ce qu’ils remarquent dans les autres.
Mais peu de gens sont capables d’y penser, ou s’en veulent donner la
peine, et si par hasard ils y pensent, ce n’est jamais sans se flatter.
Souvenez-vous, s’il vous plaît, de la manière dont notre ami Guarini
traite ces gens-là :
Huomo sono, e mi preggio d’esser humano :
E teco, che sei huomo.
E ch’altro esser non puoi,
Come huomo parlo di cosa humana.
E se di cotal nome forse ti sdegni,
Guarda, garzon superbo,
Che, nel dishumanarti,
Non divenghi una fiera, anzi ch’un dio.
Voilà, Monsieur, comme il faut parler de l’orgueil de la nature
humaine ; et au lieu de se fâcher contre le miroir qui nous fait voir
nos défauts, au lieu de savoir mauvais gré à ceux qui nous les
découvrent, ne vaudrait-il pas mieux nous servir des lumières qu’ils
nous donnent pour connaître l’amour-propre et l’orgueil, et pour nous
garantir des surprises continuelles qu’ils font à notre raison ? Peut-on
jamais donner assez d’aversion pour ces deux vices, qui furent les
causes funestes de la révolte de notre premier père, ni trop décrier ces
sources malheureuses de toutes nos misères ?
Que les autres prennent donc comme ils voudront les Réflexions
morales. Pour moi je les considère comme peinture ingénieuse de toutes
les singerie du faux sage ; il me semble que, dans chaque trait, l’amour
de la vérité lui ôte le masque, et le montre tel qu’il est. Je les
regarde comme des leçons d’un maître qui entend parfaitement l’art de
connaître les hommes, qui démêle admirablement bien tous les rôles
qu’ils jouent dans le monde, et qui non seulement nous fait prendre
garde aux différents caractères des personnages du théâtre, mais encore
qui nous fait voir, en levant un coin du rideau, que cet amant et ce roi
de la comédie sont les mêmes acteurs qui font le docteur et le bouffon
dans la farce. Je vous avoue que je n’ai rien lu de notre temps qui
m’ait donné plus de mépris pour l’homme, et plus de honte à ma propre
vanité. Je pense toujours trouver à l’ouverture du livre quelque
ressemblance aux mouvements secrets de mon cœur ; je me tâte moi-même
pour examiner s’il dit vrai, et je trouve qu’il le dit presque toujours,
et de moi et des autres, plus qu’on ne voudrait. D’abord j’en ai
quelque dépit, je rougis quelquefois de voir qu’il ait deviné, mais je
sens bien, à force de le lire, que si je n’apprends à devenir plus sage,
j’apprends au moins à connaître que je ne le suis pas ; j’apprends
enfin, par l’opinion qu’il me donne de moi-même, à ne me répandre pas
sottement dans l’admiration de toutes ces vertus dont l’éclat nous saute
aux yeux. Les hypocrites passent mal leur temps à la lecture d’un livre
comme celui-là. Défiez-vous donc, Monsieur, de ceux qui vous en diront
du mal, et soyez assuré qu’ils n’en disent que parce qu’ils sont au
désespoir de voir révéler des mystères qu’ils voudraient pouvoir cacher
toute leur vie aux autres et à eux-mêmes.
En ne voulant vous faire qu’une lettre, je me suis engagé
insensiblement à vous écrire un grand discours ; appelez-le comme vous
voudrez, ou discours ou lettre, il ne m’importe, pourvu que vous en
soyez content, et que vous me fassiez l’honneur de me croire,
MONSIEUR,
Votre, etc.