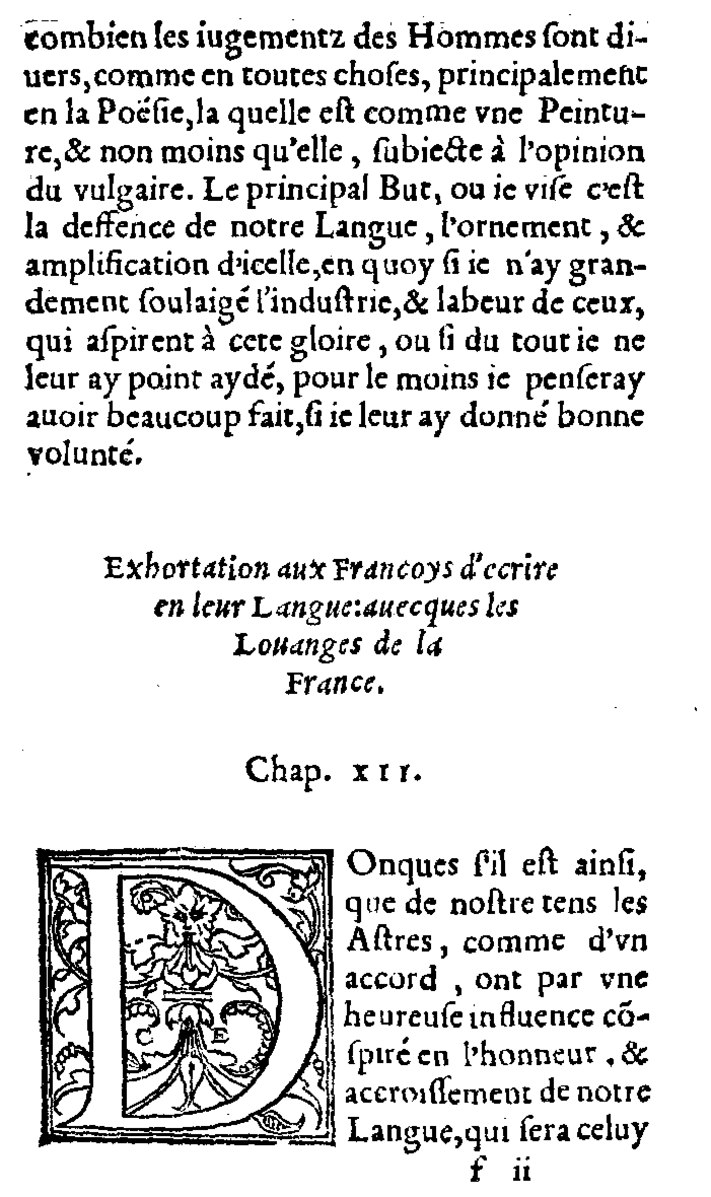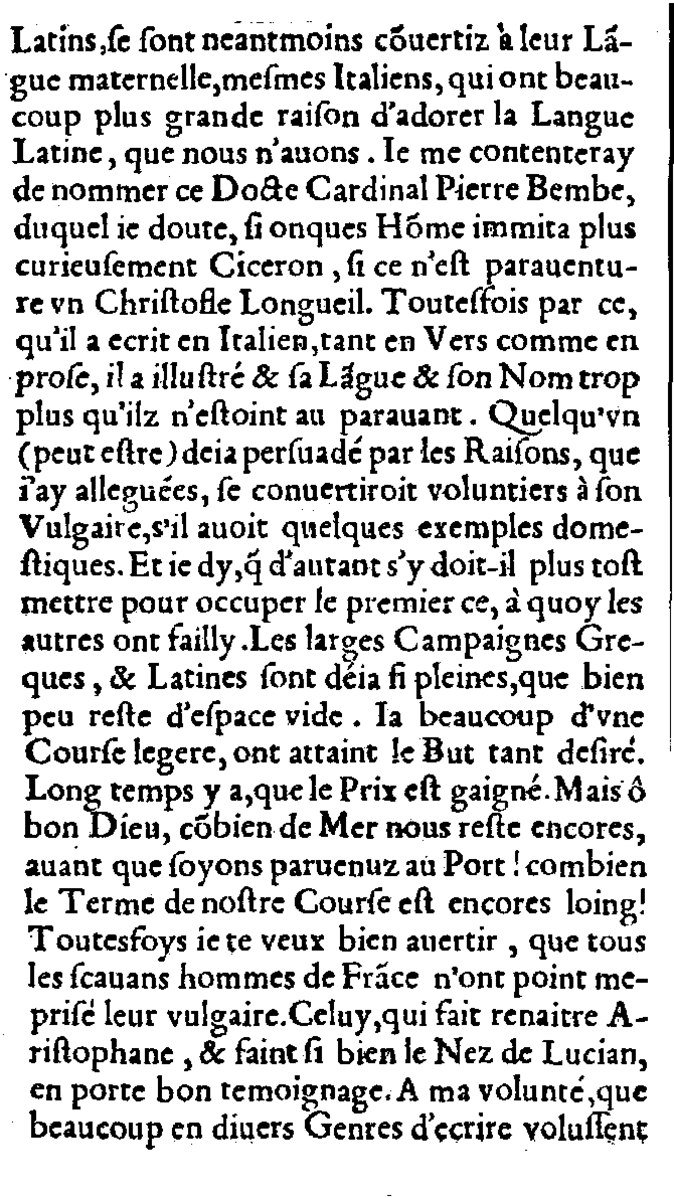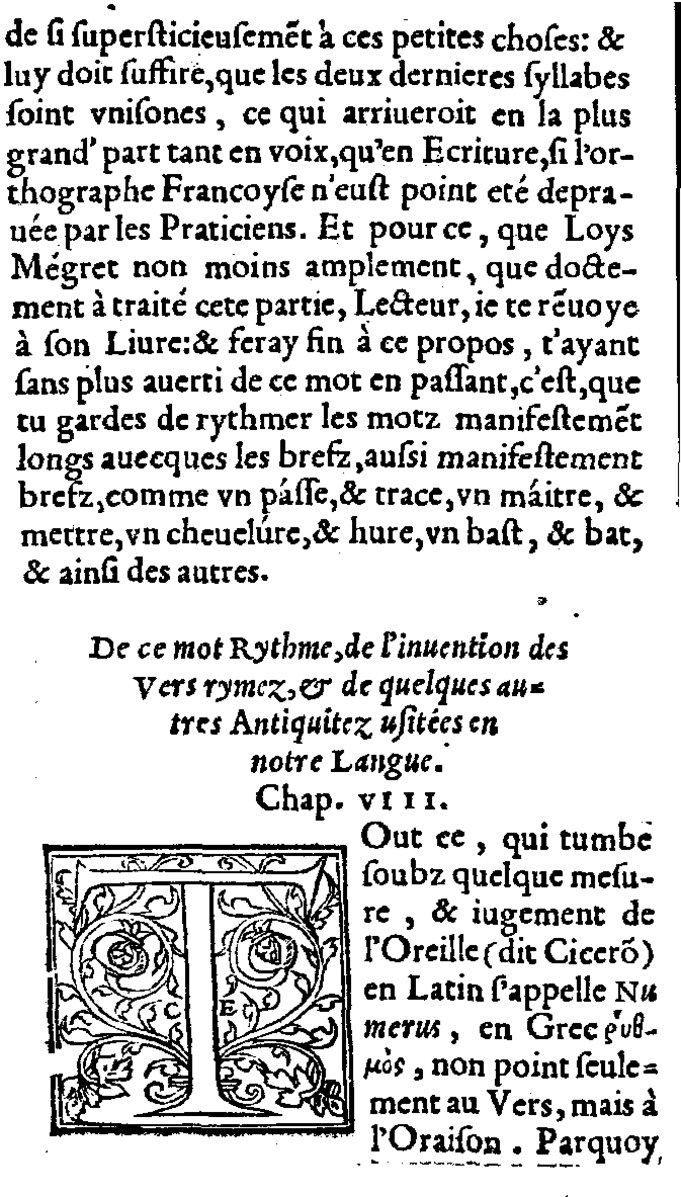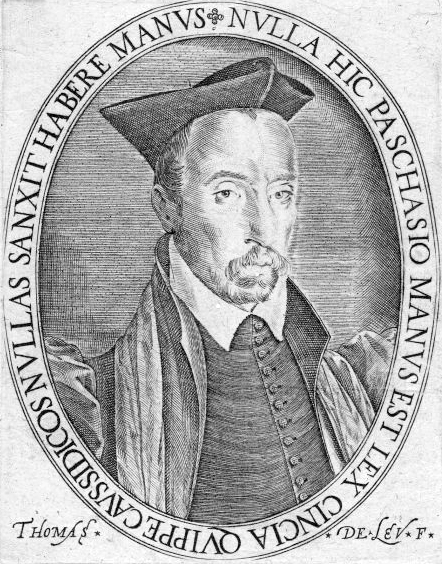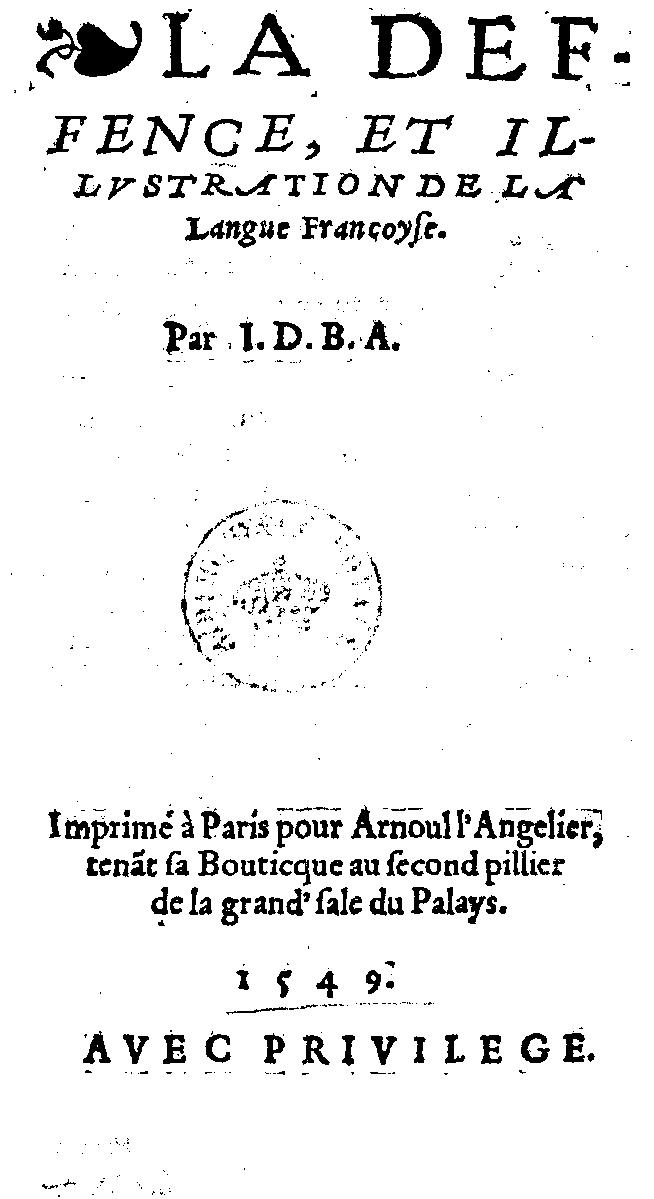La revue pdf Le salut public par la démocratie populaire vise quelque chose de très simple. Il s’agit de valoriser les rapports humains tout en faisant en sorte que, dans leur caractère multiple, ils permettent l’épanouissement des uns et des autres. Autrement dit, il s’agit de contribuer à l’établissement d’un droit qui soit à la fois celui des uns et celui des autres, et qui dans tous les cas permet à chacun de développer sa personnalité.
Le problème qui existe ici à l’arrière-plan, et qui justifie l’expression démocratie populaire, est qu’il existe des avantages et des désavantages dans l’existence de monopoles, ou si l’on veut de très grandes entreprises. Ces avantages tiennent à la mise en branle de très nombreuses forces, à grande échelle. Cela permet d’atteindre un niveau d’exigence, de qualité, de rendement, qu’on ne peut pas trouver si les activités étaient dispersées.
Inversement, on perd pratiquement tout sur le plan des rapports humains, on bascule dans un anonymat désespérant et les gens font face à des machines efficaces mais dénuées de compréhension de ce qu’est la chaleur humaine.
Si l’on veut ainsi chercher à exprimer cela sous la forme d’une question, on pourrait dire : comment le droit peut-il profiter du potentiel humain des artisans-commerçants et de l’exigence des monopoles ?
C’est que dans une société marquée par la domination des monopoles, les mentalités qui prédominent sont celles du pragmatisme. Il ne s’agit pas simplement d’un esprit bassement mercantile, propre au capitalisme. Le petit commerçant est par exemple tout à fait heureux d’avoir des rapports humains avec ses clients, et inversement. L’artisan est fier que son travail bien fait satisfasse la personne qui lui a demandé un travail. Le monopole est lui dans un rapport purement cynique ; son service à la clientèle est froid et anonyme.
Or, cela dérange les gens. Commander quelque chose sur Amazon n’a pas la même chaleur qu’un achat dans une boutique et il y a tout un romantisme des échoppes, des petites rues commerçantes, des marchands pittoresques et des produits originaux, sélectionnés par un regard intelligent et cultivé.
La question est alors de savoir comment le droit peut faire en sorte, non pas d’humaniser les monopoles, mais de généraliser les rapports humains, c’est-à-dire d’imposer, si l’on veut, le monopole du rapport humain authentique. La question se présente sous des traits philosophiques, elle a cependant une réponse tout à fait concrète.
Un client a un avantage dans sa relation avec le monopole : il a la certitude d’un rapport formel, bien établi, pouvant être en sa défaveur mais relevant de normes. Il y a côté routinier, mécanique dans l’action du monopole. Il n’y a pas de surprises lorsqu’on établit un lien avec la FNAC, Darty, Orange, la SNCF, Ebay, Apple, etc.
Un client ne peut pas avoir le même rapport avec le cafetier, le garagiste ou le plombier et cela semble ici en sa défaveur. Chaque rapport est différent et le cafetier, le garagiste ou le plombier peuvent tour à tour être honnête ou malhonnête, sincère ou hypocrite, compréhensif ou bourru, rendant à chaque fois le service plus ou moins différent.
Il est évident que le droit doit ici intervenir, afin d’apporter à la fois de la cohérence et de la satisfaction. La cohérence, c’est de maintenir le niveau des monopoles établis, mais de les faire passer au service du peuple et, ce faisant, d’humaniser les rapports qui existent. Les artisans et commerçant ont ici un rôle à jouer. Ils peuvent contribuer à rétablir des relations meilleures de la part des monopoles, mais pour cela ils doivent cesser leur prétention à former des royaumes indépendants dans l’économie.
Pour dire les choses concrètement en prenant un exemple, les cafetiers doivent être soutenus dans leur activité indépendante où c’est leur dimension personnelle qui est au premier plan. Cependant, la majeure part de leurs revenus doit être fixe et déterminés par l’État les intégrant dans un monopole des cafetiers et rémunérant ceux-ci, avec des exigences universelles de qualité.
Cela signifie que le droit accorde aux cafetiers des assurances dans leur existence : ils ne relèvent plus des aléas du marché. Et en même temps le droit leur reconnaît des spécificités dans leur existence personnelle. Il faut alors une grille d’analyses, évidemment public, pour évaluer à leur juste mesure ces spécificités.