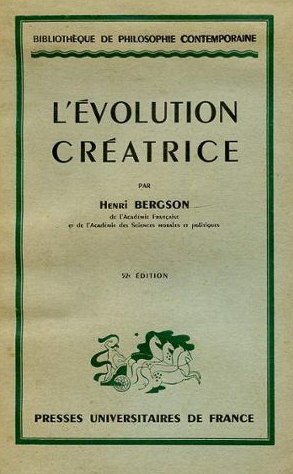21 Décembre 1939
[Norman Béthune fut membre du Parti communiste du Canada et célèbre chirurgien. En 1936, lorsque les hordes fascistes allemandes et italiennes attaquèrent l’Espagne, il se rendit sur le front et se mit au service du peuple espagnol qui luttait contre le fascisme.
Au début de 1938, après qu’eut éclaté la Guerre de Résistance, il arriva en Chine à la tête d’une équipe médicale. Il atteignit Yenan vers mars-avril et alla peu après dans la région frontière du Chansi-Tchahar-Hopei.
Animé d’un fervent esprit internationaliste et faisant preuve du plus grand dévouement et d’une totale abnégation, le camarade Béthune soigna, pendant près de deux ans, les malades et les blessés de la VIII Armée de Route. Il contracta une septicémie en faisant une opération d’urgence et mourut à Tanghsien, dans le Hopei, le 12 novembre 1939, malgré tous les soins qui lui furent prodigués. ]
Au début de 1938, après qu’eut éclaté la Guerre de Résistance, il arriva en Chine à la tête d’une équipe médicale. Il atteignit Yenan vers mars-avril et alla peu après dans la région frontière du Chansi-Tchahar-Hopei.
Animé d’un fervent esprit internationaliste et faisant preuve du plus grand dévouement et d’une totale abnégation, le camarade Béthune soigna, pendant près de deux ans, les malades et les blessés de la VIII Armée de Route. Il contracta une septicémie en faisant une opération d’urgence et mourut à Tanghsien, dans le Hopei, le 12 novembre 1939, malgré tous les soins qui lui furent prodigués. était membre du Parti communiste du Canada. Il avait une cinquantaine d’années lorsqu’il fut envoyé en Chine par le Parti communiste du Canada et le Parti communiste des Etats-Unis ; il n’hésita pas à faire des milliers de kilomètres pour venir nous aider dans la Guerre de Résistance contre le Japon.
Il arriva à Yenan au printemps de l’année dernière, puis alla travailler dans le Woutaichan où, à notre plus grand regret, il est mort à son poste. Voilà donc un étranger qui, sans être poussé par aucun intérêt personnel, a fait sienne la cause de la libération du peuple chinois: Quel est l’esprit qui l’a inspiré? C’est l’esprit de l’internationalisme, du communisme, celui que tout communiste chinois doit s’assimiler.
Le léninisme enseigne que la révolution mondiale ne peut triompher que si le prolétariat des pays capitalistes soutient la lutte libératrice des peuples coloniaux et semi-coloniaux et si le prolétariat des colonies et semi-colonies soutient la lutte libératrice du prolétariat des pays capitalistes.
Le camarade Béthune a mis en pratique cette ligne léniniste. Nous, membres du Parti communiste chinois, devons faire de même. Il nous faut nous unir au prolétariat de tous les pays capitalistes, au prolétariat du Japon, de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de l’Allemagne, de l’Italie et de tout autre pays capitaliste, pour qu’il soit possible d’abattre l’impérialisme, de parvenir à la libération de notre nation et de notre peuple, des nations et des peuples du monde entier. Tel est notre internationalisme, celui que nous opposons au nationalisme et au patriotisme étroits.
L’esprit du camarade Béthune, oubli total de soi et entier dévouement aux autres, apparaissait dans son profond sens des responsabilités à l’égard du travail et dans son affection sans bornes pour les camarades, pour le peuple.
Tout communiste doit le prendre pour exemple. Ils ne sont pas rares ceux à qui manque le sens des responsabilités dans leur travail, qui choisissent les tâches faciles et se dérobent aux besognes pénibles, laissant aux autres le fardeau le plus lourd et prenant la charge la plus légère. En toute chose, ils pensent d’abord à eux-mêmes, aux autres après.
A peine ont-ils accompli quelque effort, craignant qu’on ne s’en soit pas aperçu, ils s’en vantent et s’enflent d’orgueil. Ils n’éprouvent point de sentiments chaleureux pour les camarades et pour le peuple, ils n’ont à leur endroit que froideur, indifférence, insensibilité.
En vérité, ces gens-là ne sont pas des communistes ou, du moins, ne peuvent être considérés comme de vrais communistes. Parmi ceux qui revenaient du front, il n’y avait personne qui, parlant de Béthune, ne manifestât son admiration pour lui, et qui fût resté insensible à l’esprit qui l’animait. Il n’est pas un soldat, pas un civil de la région frontière du Chansi-Tchahar-Hopei qui, ayant reçu les soins du docteur Béthune ou l’ayant vu à l’œuvre, ne garde de lui un souvenir ému.
Tout membre de notre Parti doit apprendre du camarade Béthune cet esprit authentiquement communiste.
Le camarade Béthune était médecin. L’art de guérir était sa profession, il s’y perfectionnait sans cesse et se distinguait par son habileté dans tout le service médical de la VIIIe Armée de Route. Son cas exemplaire devrait faire réfléchir tous ceux qui ne pensent qu’à changer de métier sitôt qu’ils en entrevoient un autre, ou qui dédaignent le travail technique, le considérant comme insignifiant, sans avenir.
Je n’ai rencontré qu’une seule fois le camarade Béthune. Il m’a souvent écrit depuis. Mais, pris par mes occupations, je ne lui ai répondu qu’une fois, et je ne sais même pas s’il a reçu ma lettre. Sa mort m’a beaucoup affligé.
Maintenant, nous honorons tous sa mémoire, c’est dire la profondeur des sentiments que son exemple nous inspire. Nous devons apprendre de lui ce parfait esprit d’abnégation. Ainsi, chacun pourra devenir très utile au peuple.
Qu’on soit plus ou moins capable, il suffit de posséder cet esprit pour être un homme aux sentiments nobles, intègres, un homme d’une haute moralité, détaché des intérêts mesquins, un homme utile au peuple.