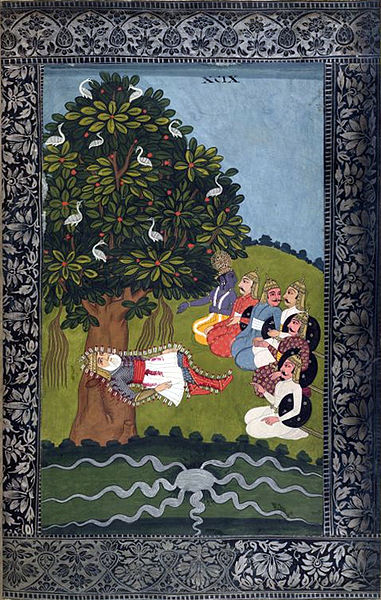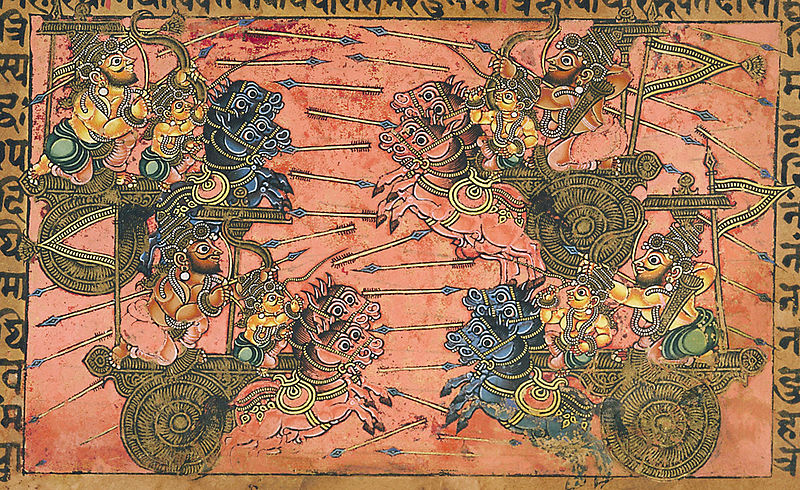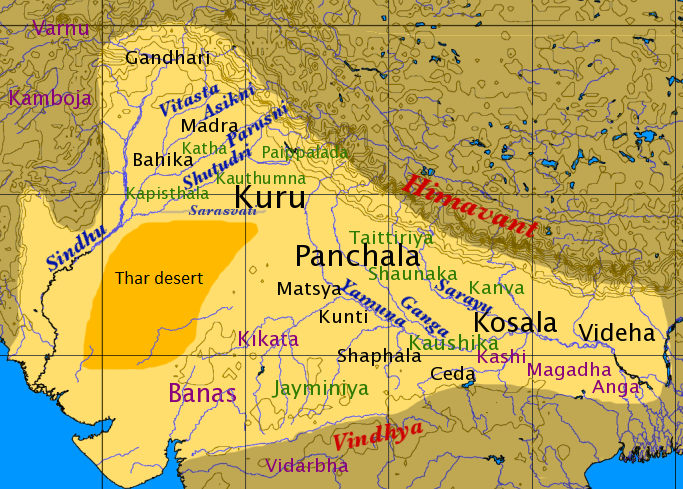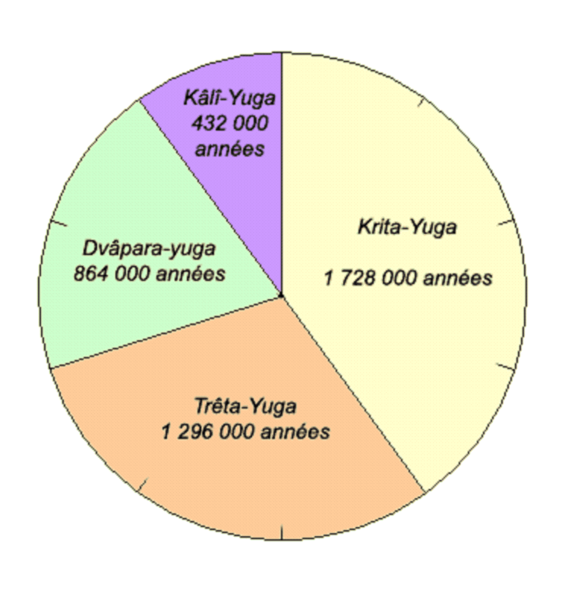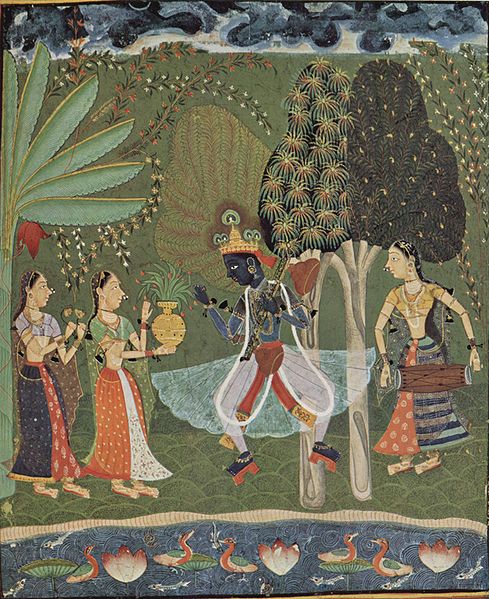Chapitre 1 : L’angoisse d’Arjuna
DHṚITARÂSHṬRA dit :
1. Rassemblés dans le champ sacré, le Kurukshetra, par leur impatience de combattre, qu’ont fait, ô Sañjaya les guerriers, les miens et ceux des Pâṇḍavas ?
SAÑJAYA dit :
2. Voyant l’armée des Pâṇḍavas en ordre de bataille, Duryodhana, le roi, s’approcha de son maître Droṇa et lui tint ce discours :
3. « Regarde, ô maître, cette immense armée des fils de Pâṇḍu, rangée par le fils de Drupada, ton habile élève.
4. Que de héros, de grands archers, émules au combat d’Anjuna et de Bhîma : Yuyudhâna et Kirâṭa et Drupada le grand guerrier ;
5. Dhṛitarâshṭra, Čekitâna et le puissant roi de Kâçi, Purujit, et Kuntibhoja et le mâle chef des Çibis ;
6. Et le vaillant Yudhâmanyu et le puissant Uttamaujas, le fils de Subhadrâ et la lignée de Draupadî, tous grands guerriers !
7. Ceux aussi qui se distinguent parmi les nôtres, connais-les, illustre brâhmane ; ces chefs de mon armée, je vais te dire leurs noms :
8. Toi-même et Bhîshma et Karṇa, et Kṛipa, vainqueurs dans la bataille, Açvatthâman et Vikarṇa et aussi les fils de Somadatta.
9. Bien d’autres héros encore ont engagé leur vie pour ma cause, divers par l’équipement, par les armes, tous habiles au combat.
10. Limitée en nombre, c’est en Bhîshma que notre armée a sa sauvegarde ; leur armée à eux, sous la sauvegarde de Bhîma, est immense.
11. Quelque place que vous occupiez dans les lignes de bataille, ne songez tous qu’à sauver Bhîshma. »
12. Ainsi parla Duryodhana. Pour réveiller en lui la joie, l’ancien des Kurus, l’aïeul vénérable, poussant son formidable cri de guerre, souffla dans sa conque.
13. Aussitôt, conques, gongs, tambours et trompettes retentirent puissamment. Ce fut un fracas énorme.
14. Alors, debout sur leur grand char attelé de chevaux blancs, Mâdhava et le Pâṇḍava[1] soufflaient dans leurs conques divines.
15. Hṛishîkeça soufflait dans la conque Pâñcajanya, Dhanañjaya dans Devadatta et Vṛikodara[2] aux exploits terribles dans la grande conque Pauṇḍra ;
16. Le roi fils de Kuntî, Yudhishṭhira, dans la conque Anantavijaya, Nakula et Sahadeva dans Sughosha et Maṇipushpaka ;
17. Le roi de Kâçi, le meilleur des archers, et Çikhaṇḍin le grand guerrier, Dhṛishṭadyumna et Kirâṭa et l’invincible Sâtyaki ;
18. Drupada et ses fils, ô roi, le fils de Subhadrâ aux grands bras, de tous côtés faisaient résonner chacun sa conque.
19. Ébranlant la terre et le ciel, ce bruit formidable déchira le cœur des amis de Dhṛitarâshṭra.
20. Ils étaient à leur poste de combat ; déjà volaient les traits ; le Pâṇḍava dont l’étendard porte un singe[3], élevant son arc,
21. Adressa, ô roi, ces paroles à Hṛishîkeça : Arrête, ô Ačyuta, mon char entre les deux armées ;
22. Il faut que je considère ces guerriers alignés, impatients de combattre, que je voie avec qui il me faudra lutter dans cette bataille qui se déchaîne.
23. Je veux voir ces combattants qui, réunis là, prétendent soutenir par la force la cause du coupable fils de Dhṛitarâshṭra.
24. À ces mots de Guḍâkeça, Hṛishîkeça arrêta entre les deux armées le char sans pareil.
25. Puis, face à Bhîshma, à Droṇa, à tous les rois : « Vois, dit-il, ô fils de Pṛithâ, les Kurus rassemblés. »
26. Le fils de Pṛithâ aperçut alors, dispersés dans les deux armées, des pères, des petits-fils et des compagnons et des beaux-pères et des amis.
27. Voyant tous ces parents ainsi affrontés pour la lutte, le fils de Kuntî se sentit envahi d’une pitié immense, et, tout troublé, il prononça :
ARJUNA dit :
28. Voici, ô Kṛishṇa, que tous les hommes de ma parenté s’avancent avides d’une lutte fratricide ; à ce spectacle, mes membres défaillent et ma bouche se sèche.
29. Mon corps frissonne et tous mes poils se dressent ; Gâṇḍîva[4] tombe de ma main et ma chair devient brûlante.
30. Je ne puis demeurer en place ; mon esprit se trouble, je n’envisage que présages funestes.
31. Quel bien me promettrais-je à frapper les miens dans la bataille ? À pareil prix, je n’aspire, ô Kṛishṇa, ni à la victoire, ni à la royauté, ni au plaisir.
32. Que nous sont, ô Govinda, la royauté, la richesse, la vie même ?
33. Ceux en vue de qui nous souhaitions la royauté, la richesse et les plaisirs, ils sont là, rangés en bataille, renonçant à la vie et à leurs biens,
34. Maîtres, pères et fils et aïeuls, oncles, beaux-pères, petits-fils, gendres et parents.
35. Je ne saurais, même, sous la menace de leurs coups, me résigner à les frapper, fût-ce pour la royauté des trois mondes ; que dire de la souveraineté de la terre ?
36. Quelle joie resterait-il pour nous, ô Janârdana, quand nous aurions détruit la famille de Dhṛitarâshṭra ? Nous serions la proie du péché si nous frappions de tels adversaires.
37. Nous ne pouvons consentir à frapper les fils de Dhṛitarâshṭra, nos parents. Comment, ayant tué les nôtres, pourrions-nous jamais être heureux, ô Mâdhava ?
38. Même si, aveuglés par la cupidité, ils ne voient pas combien il est coupable de détruire sa propre famille, quel crime c’est de trahir des amis,
39. Comment nous, qui comprenons combien il est coupable de détruire sa famille, ô Janârdana, pourrions-nous ne pas reculer devant pareil péché ?
40. La famille détruite, c’est la fin des devoirs familiaux imprescriptibles ; ruiné le devoir, le désordre envahit la famille tout entière.
41. Sous l’empire du désordre, ô Kṛishṇa, les femmes se corrompent ; la corruption des femmes, ô rejeton de Vṛishṇi, compromet la pureté de la race.
42. Cette confusion, c’est l’enfer, non seulement pour les destructeurs de la famille, mais pour la famille même. Les ancêtres, privés des libations et des sacrifices, tombent aux lieux de tourment.
43. Ainsi, par la faute de ceux qui, attentant à la famille, troublent la pureté de la race, sont renversées les lois éternelles de la caste, de la famille.
44. Les hommes, ô Janârdana, qui n’ont plus de lois de famille, sont irrémédiablement voués à l’enfer ; telle est la loi qui nous a été transmise.
45. En vérité, c’est un grand crime que nous allions commettre quand, par passion de la royauté et dés plaisirs, nous nous apprêtions à frapper les nôtres ;
46. Combien ne vaudrait-il pas mieux pour moi être frappé sans défense, sans armes, par le glaive des amis de Dhṛitarâshṭra !
SAÑJAYA dit :
47. Ainsi parla Arjuna en pleine bataille ; et, laissant échapper arc et flèches, il retomba assis dans le char, l’âme étreinte d’angoisse.
[1] Je prends occasion de ce premier passage où paraissent des synonymes de Kṛishṇa et d’Arjuna, pour rassembler la plupart des équivalents par lesquels on les trouvera dans la suite plus ou moins fréquemment désignés. Je note pour Kṛishṇa : Mâdhava, Hṛishîkeça, Ačyuta, Govinda, Janârdana, Madhusûdana (destructeur de Madhu), Keçava, Vârshṇeya, Hari ; pour Arjuna : fils de Kuntî, fils de Pṛithâ, Bhârata, Pâṇḍava, Dhanaṃjaya, Guḍâkeça, sans parler de plusieurs périphrases descriptives.
[2] Autre dénomination de Bhîma.
[3] Arjuna.
[4] Le nom de son arc.
La Bhagavad Gîtâ – chapitre 2 : La
spéculation
SAÑJAYA dit :
1. Le voyant ainsi envahi par la pitié, aveuglé
par un flot de larmes, tout hors de lui, Madhusûdana lui tint ce
langage :
BHAGAVAT dit :
2. D’où te viennent, ô Arjuna, à l’heure du
danger, ces pensées troubles, indignes d’un ârya, ces pensées
qui ne mènent ni au ciel, ni à l’honneur ?
3. Pas de lâcheté, ô fils de Pṛithâ ; cela
te sied mal ; chasse une défaillance misérable et lève-toi,
redoutable guerrier !
ARJUNA dit :
4. Comment lutter, ô vainqueur de Madhu ? Comment
diriger mes flèches contre Bhîshma, contre Droṇa, ces hommes, ô
héros vainqueur, à qui je dois tous les respects ?
5. Plutôt qu’attenter à la vie de maîtres
vénérables, mieux vaudrait vivre ici-bas d’aumônes. À frapper
des maîtres, même coupables de désirs cupides, ma nourriture, dès
cette terre, serait souillée de sang.
6. Et nous ne savons ce qu’il nous faut plus
redouter de les vaincre ou d’être vaincus par eux. Ces fils de
Dhṛitarâshṭra alignés devant nous, en les frappant, nous
perdrions tout motif de désirer vivre.
7. Pitié et scrupule paralysent mes instincts de
guerrier ; mon esprit troublé discerne mal le devoir ; je m’adresse
à toi ; dis-moi nettement ce qui est bien ; je suis ton disciple ;
instruis-moi ; je me réfugie en toi !
8. Car je ne vois rien qui puisse dissiper
l’angoisse qui anéantit mes forces, dussé-je obtenir la
souveraineté prospère, incontestée de la terre, voire le rang de
maître des dieux.
SAÑJAYA dit :
9. Quand il eut ainsi parlé à Hṛishîkeça,
quand il eut déclaré à Govinda qu’il ne combattrait pas,
Guḍâkeça, le héros terrible, garda le silence.
10. Hṛishîkeça, ô Bhârata, répondit avec un
sourire au héros qui se désolait ainsi entre les deux armées.
BHAGAVAT dit :
11. Tu t’apitoies là où la pitié n’a que
faire, et tu prétends parler raison ! Mais les sages ne s’apitoient
ni sur qui meurt ni sur qui vit.
12. Jamais temps où nous n’ayons existé, moi
comme toi, comme tous ces princes ; jamais, dans l’avenir ne
viendra le jour où les uns et les autres nous n’existions pas.
13. L’âme, dans son corps présent, traverse
l’enfance, la jeunesse, la vieillesse : après celui-ci elle
revêtira de même d’autres corps. Le sage ne s’y trompe pas.
14. Les impressions des sens, ô fils de Kuntî,
chaud et froid, plaisir et peine, vont et viennent, elles sont
fugitives ; il n’est, ô Bhârata, que de les supporter.
15. Car l’homme qu’elles ne troublent pas, ô
Taureau des hommes, l’homme ferme, indifférent au plaisir et à la
peine, celui-là est mûr pour l’immortalité.
16. Pas d’existence pour le néant, pas de
destruction pour l’être. De l’un à l’autre, le philosophe
sait que la barrière est infranchissable.
17. Indestructible, sache-le, est la trame de cet
univers ; c’est l’Impérissable ; la détruire n’est au pouvoir
de personne.
18. Les corps finissent ; l’âme qui s’y
enveloppe est éternelle, indestructible, infinie. Combats donc, ô
Bhârata !
19. Croire que l’un tue, penser que l’autre est tué, c’est
également se tromper ; ni l’un ne tue, ni l’autre n’est tué.
20. Jamais de naissance, jamais de mort ; personne
n’a commencé, ni ne cessera d’être ; sans commencement et sans
fin, éternel, l’Ancien[1] n’est pas frappé quand le corps
est frappé.
21. Celui qui le connaît pour indestructible,
éternel, sans commencement et impérissable, comment cet homme, ô
fils de Pṛithâ, peut-il imaginer qu’il fait tuer, qu’il tue ?
22. Comme un homme dépouille des vêtements usés
pour en prendre de neufs, ainsi l’âme, dépouillant ses corps
usés, s’unit à d’autres, nouveaux.
23. Le fer ne la blesse pas plus que le feu ne la
brûle, ni l’eau ne la mouille, ni le vent ne la dessèche.
24. Elle ne peut être ni blessée, ni brûlée,
ni mouillée, ni desséchée ; permanente, pénétrant tout, stable,
inébranlable, elle est éternelle.
25. Insaisissable aux sens, elle ne peut être
imaginée et n’est sujette à aucun changement. La connaissant
telle, tu ne saurais concevoir aucune pitié.
26. Que si, même, tu pensais qu’elle naît ou
meurt indéfiniment, même alors tu ne devrais concevoir aucune pitié
pour elle.
27. Car ce qui est né est assuré de mourir et ce
qui est mort, sûr de naître ; en face de l’inéluctable, il n’y
a pas de place pour la pitié.
28. Les êtres, ô Bhârâta, nous échappent dans leur origine ;
perceptibles au cours de leur carrière, ils nous échappent de
nouveau dans leur fin. Qu’y peuvent les lamentations ?
29. C’est merveille que personne la[2] découvre
; merveille aussi que quelqu’un l’enseigne, merveille qu’un
autre en entende la révélation ; et, même après avoir entendu,
personne ne la connaît.
30. Dans tout corps, cette âme, ô Bhârata,
demeure, éternellement intangible ; renonce donc à t’apitoyer sur
l’universelle destinée.
31. Considère aussi ton devoir personnel et tu ne
reculeras pas ; car rien pour le Kshatriya ne passe avant un combat
légitime.
32. D’où qu’il lui soit offert, il ouvre pour
lui là porte du ciel ; trop heureux sont les Kshatriyas, ô fils de
Pṛithâ, d’accepter un pareil combat.
33. Te refuser à cette lutte légitime, ce serait
forfaire à ton devoir, à l’honneur et tomber dans le péché.
34. L’univers racontera ton irréparable honte ;
la honte est pour l’homme d’honneur pire que la mort.
35. Les guerriers penseront que c’est par peur
que tu as esquivé la bataille ; et de ceux dont tu avais l’estime,
tu encourras le mépris.
36. Tes ennemis tiendront sur ton compte mille
propos insultants ; ils contesteront ta vaillance. Quel malheur plus
cruel ?
37. Mort, tu iras au ciel ; ou vainqueur, tu
gouverneras la terre. Relève-toi, ô fils de Kuntî, résolu à
combattre.
38. Considère que plaisir ou souffrance, richesse ou misère,
victoire ou défaite se valent. Apprête-toi donc au combat ; de la
sorte, tu éviteras le péché.
39. Je t’ai exposé la doctrine dans l’ordre
du sâṃkhya : écoute-la maintenant dans l’ordre du yoga[3], et à
quelle doctrine il te faut t’attacher, ô fils de Pṛithâ, pour
t’afïranchir des chaînes du Karman.
40. Dans cette voie, aucune peine n’est perdue ;
point de retour en arrière ; un peu, si peu que ce soit, de cette
pratique protège de beaucoup de souffrance.
41. Ici, ô fils de Kuru, une doctrine unique sûre
d’elle-même ; diverses à l’infini sont les doctrines des hommes
que ne soutient pas la certitude.
42. Il est une parole fleurie, ô fils de Pṛithâ, que proclament
ceux qui n’ont pas la sagesse, ces hommes qui, attachés à la
lettre du veda, professent qu’il ne faut s’embarrasser de rien
d’autre.
43. Esclaves du désir, qui ne voient que les
joies paradisiaques[4] ! Elle ne produit que la renaissance
comme résultat du Karman, se perd dans les complications de la
liturgie, ne vise que les jouissances sensibles et les pouvoirs
magiques.
44. Fascinés par les
jouissances sensibles et les pouvoirs magiques, les hommes dont
l’esprit est égaré par elle, ne sauraient réaliser dans la
contemplation la vérité sûre d’elle-même.
45. C’est le domaine sensible des trois
guṇas[5] qui est l’objet des vedas ; affranchis-toi, ô
Arjuna, du domaine des trois guṇas ; demeure supérieur à toutes
les sensations, de volonté inébranlable, indifférent à la
richesse, maître de toi.
46. Un réservoir est abondant où l’eau afflue
de tous les côtés ; de même un brâhmane éclairé fait son profit
de tous les vedas.
47. Ne te préoccupe que de l’acte, jamais de
ses fruits. N’agis pas en vue des fruits de l’acte ; ne te laisse
pas non plus séduire par l’inaction.
48. N’agis qu’en disciple fidèle du yoga, en
dépouillant tout attachement, ô Dhanañjaya, en restant indifférent
au succès ou à l’insuccès : le yoga est indifférence.
49. Car l’acte, ô Dhanañjaya, est inférieur
infiniment au détachement intérieur ; c’est dans la pensée qu’il
faut chercher le refuge. Ils sont à plaindre ceux qui ont le fruit
pour mobile.
50. Pour qui réalise le détachement intérieur,
il n’est plus, ici-bas, ni bien ni mai. Efforce-toi donc au yoga ;
le yoga est, dans les actes, la perfection.
51. Car les sages, qui
ont réalisé le détachement intérieur, esquivant le fruit qui naît
des actes, libérés des liens de la renaissance, vont au séjour
bienheureux.
52. Quand ta pensée aura traversé les ténèbres
de l’erreur, tu n’éprouveras que dégoût pour tout ce que
t’aura enseigné, tout ce que pourrait t’enseigner la
révélation[6].
53. Quand, détachée de la révélation, ta
pensée sera fixée, stable, inébranlable dans la contemplation,
alors, tu seras en possession du yoga.
ARJUNA dit :
54. Quand dit-on, ô Keçava, qu’un homme est en
possession de la sagesse, qu’il a atteint la contemplation ? Celui
qui est en possession de la lumière, comment parle-t-il ? Comment
s’asseoit-il ? Comment marche-t-il ?
BHAGAVAT dit :
55. Quand l’homme s’affranchit, fils de
Pṛithâ, de tous les désirs qui hantent l’esprit, qu’il trouve
sa satisfaction en soi et par soi, on dit qu’il est en possession
de la sagesse.
56. Sans trouble dans la souffrance, sans attrait
pour le plaisir, libre d’attachement, de colère et de crainte,
l’ascète est en possession de la lumière.
57. Celui qui ne ressent aucune inclination, qui,
d’aucun bien ni d’aucun mal, ne conçoit ni joie ni révolte,
celui-là est en possession de la sagesse.
58. Et lorsque, telle la tortue rentrant
complètement ses membres, il isole ses sens des objets sensibles, la
sagesse en lui est vraiment solide.
59. Les objets des sens disparaissent pour l’âme
qui n’en fait pas son aliment ; la sensibilité reste. À son tour,
elle disparaît pour qui a reconnu l’absolu.
60. Malgré ses efforts, ô fils de Kuntî, même
chez le sage, les sens toujours tyranniques agissent violemment sur
l’esprit.
61. Il faut, les contenant tous, se concentrer, se
fixer uniquement sur son moi. Car qui tient ses sens sous son
pouvoir, chez celui-là la sagesse est vraiment solide.
62. Si l’homme s’attarde à considérer les
objets des sens, l’attrait s’éveille en lui ; de l’attrait
sort le désir ; du désir naît la colère.
63. La colère produit l’égarement ;
l’égarement, la défaillance de la raison ; la défaillance de la
raison, le naufrage de la pensée. C’est la perte de l’homme.
64. Mais qui traverse le monde extérieur avec des
sens affranchis d’attachement et de haine, dociles à sa volonté,
celui-là, l’âme disciplinée, aborde à la paix.
65. Dans la paix, il trouve la fin de toutes les
souffrances, car, dans l’esprit pacifié, bien vite la vérité
s’établit.
66. Pas de vérité sans yoga ; sans yoga pas de
méditation ; mais pour qui ne médite pas, point de repos ; à qui
n’a point le repos d’où viendrait le bonheur ?
67. De l’esprit qui leur obéit, le tumulte des
sens emporte la sagesse comme la tempête un vaisseau sur l’océan.
68. Celui, ô guerrier aux grands bras, de qui les
sens sont parfaitement dégagés des objets sensibles, chez celui-là,
au contraire, la sagesse est solide.
69. Ce qui est la nuit pour tous les êtres est,
pour l’homme maître de ses sens, le temps de l’éveil ; ce qui
aux autres êtres est la veille, est la nuit pour l’ascète qui
voit.
70. Comme l’océan où affluent les eaux, tout
en s’en remplissant, garde un équilibre immuable, de même celui
en qui affluent tous les désirs peut conserver le repos, non pas
celui qui cède à l’attrait du désir.
71. L’homme qui, chassant tout désir, vit sans
passion, sans poursuites personnelles, sans égoïsme, celui-là
entre dans le repos.
72.
C’est là, ô fils de Pṛithâ, s’établir en Brahman ; à ce
point, plus d’incertitude ; qui y est parvenu, fût-ce à la
dernière heure, atteint la délivrance en Brahman.
[1] L’Âme. Ce n’est pas le lieu d’entrer dans le détail des motifs qui ont favorisé cette dénomination.
[2] « L’âme. » On sent ici combien est souvent faible et gauche la liaison entre les vers.
[3] Si j’ai maintenu dans la traduction les termes sâṃkhya et yoga, je tiens à prévenir tout malentendu. Ils ne visent pas, au sens étroit, les deux systèmes dont ils sont la dénomination technique. Comme plus bas, III, 3, c’est, d’une façon plus générale, le point de vue théorique et le point de vue pratique qui sont ici opposés : sâṃkhya vise la spéculation, et yoga ne se restreint pas au code de discipline physique et morale qui prétend régler les méthodes du détachement, de l’extase, de l’ascension aux pouvoirs magiques. Yoga signifie d’abord effort, effort moral, et la Gîtâ l’emploie avec une large liberté et beaucoup de nuances.
[4] Le svarga, c’est-à-dire le séjour temporaire des dieux subalternes.
[5] Les trois « gunas », c’est-à-dire tout l’ensemble du monde sensible et vivant qu’embrasse la prakṛiti (l’universalité des choses sensibles), laquelle est représentée comme constituée par trois éléments sattva, rajas et lamas, auxquels la suite va nous ramener.
[6] « Révélation » est une traduction commode, mais qui, pour être exactement entendue, réclamerait quelque commentaire. Il s’agit de la « çruti » (ce qui a été entendu…). Le mot embrasse dans l’Inde les textes anciens et sacrés (tels les hymnes du veda qui passent pour avoir été « entendus » par les sages antiques favorisés d’une inspiration surhumaine) et s’oppose à la « smṛiti » ( « ce dont on se souvient » ), la « tradition ».
La Bhagavad Gîtâ – chapitre 3 : L’action
ARJUNA dit :
1. Si, ô Janârdana, tu juges la pensée
supérieure à l’action, pourquoi, alors, ô Keçava, me poussestu
à des actes terribles ?
2. Ton discours, comme mêlé de vues contraires,
jette mon esprit dans la perplexité ; énonce enfin une affirmation
précise qui me montre la voie meilleure.
BHAGAVAT dit :
3. Il y a en ce monde, héros sans tache, je te
l’ai dit déjà, deux attitudes : celle des penseurs qui repose sur
l’effort de l’esprit, celle des ascètes sur l’effort pratique.
4. Il ne suffit pas de s’abstenir d’action pour se libérer de
l’acte ; l’inaction seule ne mène pas à la perfection.
5. Jamais personne ne saurait un seul instant
demeurer entièrement inactif ; malgré qu’il en ait, du fait des
guṇas issus de la prakṛiti[1], chacun est condamné à l’action.
6. Il a beau brider l’activité de ses sens,
demeurer coi, celui dont l’âme est troublée par l’évocation
des objets sensibles, cet homme est dans la voie de l’erreur.
7. Celui-là l’emporte qui, dominant ses sens
par l’esprit, pleinement détaché, leur impose un effort
discipliné.
8. Accomplis les actes prescrits ; l’activité
est supérieure à l’inaction ; faute d’agir, la vie physique
elle-même s’arrêterait en toi.
9. Hors ceux qui ont pour objet le sacrifice, les actes sont le lien
qui enchaîne le monde ; n’agis donc, ô fils de Kuntî, qu’en
dépouillant tout attachement.
10. Jadis, après avoir, avec les créatures,
produit le sacrifice, Prajâpati[2] prononça : C’est par
celui-ci que vous vous propagerez ; qu’il vous donne tout ce que
vous désirerez[3].
11. Par lui, satisfaites aux dieux et que les
dieux vous satisfassent ; grâce à cette réciprocité, vous
atteindrez le bien suprême.
12. Satisfaits par le sacrifice, les dieux vous
donneront les jouissances que vous souhaiterez. Qui jouit de leurs
dons sans leur rien donner, celui-là n’est qu’un voleur.
13. Les gens de bien qui se nourrissent des
reliefs du sacrifice sont libres de toute souillure ; mais ceux-là
sont des pécheurs et se nourrissent de péché qui cuisent des
aliments à leur usage.
14. C’est dans la nourriture que les êtres ont leur origine ; la
nourriture dans la pluie, la pluie dans le sacrifice ; il n’est pas
de sacrifice sans actes rituels.
15. Quant à l’acte rituel, sache qu’il est
issu de Brahman, Brahman de l’Impérissable. Le Brahman qui pénètre
tout a donc dans le sacrifice son fondement éternel[4].
16. Ainsi évolue le cercle ; celui qui, ici-bas,
n’en suit pas le rythme, celui-là, ô fils de Pṛithâ, impie,
esclave de ses sens, perd sa vie.
17. Mais le mortel qui ne cherche sa joie qu’en
l’âme, qui se satisfait en l’âme et qui, en l’âme et en
l’âme seule se rassasie pleinement, celui-là n’a rien à
accomplir.
18. Nul intérêt pour lui à rien faire ; à rien
éviter ; de tous les êtres, aucun ne saurait être pour lui un
objet d’intérêt.
19. Exécute donc toujours dans un esprit de
détachement les actes qu’il faut accomplir ; car l’homme qui
agit en complet détachement atteint le but suprême.
20. C’est par les actes du sacrifice que Janaka
et tant d’autres se sont efforcés vers la perfection. Agis, toi
aussi, uniquement pour le bien du monde.
21. Tout ce que fait le chef, les autres hommes
l’imitent ; la règle qu’il observe, le monde la suit.
22. Il n’est, ô fils dé Pṛithâ, dans les
trois mondes, rien que je sois tenu de faire, rien qui me manque,
rien que j’aie à acquérir, et, cependant, je demeure en action.
23. Si je n’étais pas toujours infatigablement
en action, de toutes parts, les hommes, ô fils de Pṛithâ,
suivraient mon exemple.
24. Les mondes cesseraient d’exister si je
n’accomplissais pas mon œuvre ; je serais la cause de
l’universelle confusion et de la fin des créatures.
25. Les ignorants agissent par attachement à
l’acte ; que le sage agisse, lui aussi, mais en dehors de tout
attachement et seulement pour le bien du monde.
26. Que le sage évite de jeter le trouble dans
l’âme des ignorants que mène l’attrait des actes ; qu’il
encourage toute activité en se comportant, lui qui sait, en adepte
du yoga.
27. Les actes procèdent uniquement des guṇas du monde sensible. Si
l’homme imagine en être l’agent, c’est qu’il est égaré par
la conscience personnelle.
28. Mais celui, ô guerrier aux longs bras, qui
connaît la vérité sur la double série des gunas et des actes,
sait que ce sont toujours les gunas opérant sur les gunas, et il
demeure détaché[5].
29. C’est parce qu’ils sont égarés par les
gunas du monde sensible que les hommes s’attachent aux actes,
ouvrage des gunas. Il ne faut pas que celui qui sait toute la vérité
jette dans le trouble les esprits lents, aux lumières imparfaites.
30. Rapportant à moi toute action, l’esprit
replié sur soi, affranchi d’espérance et de vues intéressées,
combats sans t’enfiévrer de scrupules.
31. Voilà mon enseignement : les mortels qui s’y
conforment toujours avec foi et sans murmure sont, eux aussi,
affranchis des actes.
32. Quant à ceux qui murmurent contre ma
doctrine, qui ne s’y conforment pas, sache que ce sont des insensés
à qui toute connaissance échappe ; ils sont perdus.
33. Mais chacun, fût-ce le plus instruit, se
comporte conformément à sa nature ; tous les êtres suivent leur
nature. Qu’y pourraient les remontrances ?
34. Toute impression d’un sens, quel qu’il
soit, réagit en désir ou en aversion ; il faut échapper à
l’empire de l’un et de l’autre ; ce sont nos ennemis.
35. Mieux vaut accomplir, fût-ce imparfaitement,
son devoir propre que remplir, même parfaitement, le devoir d’une
autre condition ; plutôt périr en persévérant dans son devoir ;
assumer le devoir d’une autre condition n’apporte que malheur.
ARJUNA dit :
36. Sous quelle impulsion l’homme s’engage-t-il,
malgré qu’il en ait, dans le péché, ô Vârshneya, comme
entraîné de force ?
BHAGAVAT dit :
37. C’est cet attrait, c’est cette aversion,
nés, l’un et l’autre, du guna rajas, qui est le grand Vorace, le
grand Méchant[6] ; sache que là est, ici-bas, l’ennemi.
38. Comme le feu est masqué par la fumée, le
miroir par des taches, le fœtus par des membranes, ainsi tout cet
univers est enveloppé par lui.
39. La vérité est masquée par cet éternel
ennemi du sage qui, sous la forme du désir, ô fils de Kuntî, est
un feu insatiable.
40. Il a son siège dans les sens, la perception,
la pensée ; c’est par eux que, masquant la vérité, il égare
l’esprit.
41. Commence donc, ô
héros des Bhâratas, par brider tes sens, pour frapper ce Méchant,
destructeur de la vérité et de l’intelligence.
42. On place haut les sens ; au-dessus des sens
est le manas, le centre psychique ; au-dessus du manas, la pensée
(buddhi), au-dessus de la pensée, Lui[7].
43.
Connaissant Celui qui est au-dessus de la pensée, affermis-toi dans
ta force intérieure et frappe, ô guerrier aux longs bras, cet
ennemi redoutable qu’est le désir.
[1] La « prakṛiti », on l’a vu, embrasse tout le monde sensible et vivant, le monde de l’activité, tout, en dehors du « purusha », de l’âme, conçue comme essentiellement passive.
[2] Le démiurge.
[3] Littéralement : « qu’il soit pour vous la vache des désirs », la vache du conte qui donnait à son maître tout ce qu’il pouvait souhaiter.
[4] J’ai signalé dans l’introduction, ce rapprochement, sous le même nom de « brahman », du sacrifice et de l’âme universelle.
[5] D’après la théorie, l’activité humaine relève de la prakriti, non moins que les choses sensibles ; par leur origine comme par leur objet, les actes sont donc entièrement du domaine de la prakriti.
[6] Notion semi-mythologique semi-symbolique de « Pâpman », le mal ou le péché personnifié, celui qui, dans la légende bouddhique, paraît dans le rôle « de Mâra Pâpman, « Mâra le Méchant ».
[7] L’Esprit suprême.
La Bhagavad Gîtâ – chapitre 4 : La
connaissance et l’action
BHAGAVAT dit :
1. Ce yoga impérissable, je l’ai, moi, enseigné
à Vivasvat[1] ; Vivasvat le communiqua à Manu et Manu le
transmit à Ikṣhvâku.
2. C’est par cette tradition que l’ont connu
les rois-ṛishîs ; mais, avec le temps, ce yoga, ô héros
terrible, disparut ici-bas.
3. C’est ce même antique yoga que je t’ai
aujourd’hui enseigné ; je t’ai traité en fidèle et en ami ;
car c’est le mystère suprême.
ARJUNA dit :
4. Ta naissance est récente ; la naissance de
Vivasvat se place par delà le temps. Comment comprendre que tu aies
pu enseigner à l’origine ?
BHAGAVAT dit :
5. Nombreuses sont les existences que j’ai
traversées, ô Arjuna, et nombreuses aussi les tiennes ; moi, je les
connais toutes, ô héros, mais non pas toi.
6. Encore que je sois l’Âme sans commencement,
impérissable, encore que je sois le Seigneur des êtres, je nais par
mon pouvoir, en vertu de ma nature propre,
7. Toutes les fois que l’ordre chancelle, que le
désordre se dresse, je me produis moi-même.
8. D’âge en âge, je nais pour la protection
des bons et la perte dés méchants, pour le triomphe de l’ordre.
9. Ma naissance, comme mon œuvre, est divine. Qui
sait cela en vérité, quand il dépouille son corps mortel, ne va
pas à une nouvelle naissance, c’est à moi qu’il vient, ô
Arjuna.
10. Affranchis de la passion, de la crainte et de
la colère, identifiés à, moi, purifiés au feu de la connaissance,
beaucoup se sont fondus en mon être.
11. À chacun je fais sa part, dans la mesure où
il tend vers moi ; mais de toutes façons, ô fils de Prithâ, c’est
dans ma voie que cheminent les hommes.
12. Ceux qui recherchent le succès dans l’action
sacrifient ici-bas aux dieux ; car le succès que procurent les rites
se produit immédiatement dans le monde des hommes.
13. J’ai créé la division en quatre classes
que distinguent le guna et les devoirs qui lui sont propres. J’en
suis l’auteur ; sache pourtant que je suis inagissant, immuable.
14. Les actes ne m’atteignent pas ; en moi nul
désir du fruit des actes ; qui me connaît tel échappe aux chaînes
de l’action.
15. Ils savaient cela, les anciens, avides de
délivrance, et ils ont agi ; agis donc, toi aussi, comme ont fait
jadis les anciens.
16. Qu’est l’action ? Qu’est l’inaction ?
Les plus sages, là-dessus, s’égarent. Je t’enseignerai donc ce
qu’est l’action pour que, le sachant, tu sois libéré du mal.
17. Car il faut être au fait de l’action, au
fait de l’action dévoyée, au fait de l’inaction. Les sentiers
de l’action sont mystérieux.
18. Celui qui sait voir l’inaction dans l’action
et l’action dans l’inaction, celui-là est sage entre les hommes
; tout en agissant sans restriction, il reste fidèle au yoga.
19. Celui qui, quoi qu’il fasse, n’obéit
jamais au désir ni à un calcul d’espérance, les gens sensés le
considèrent comme un sage dont les actions sont brûlées au feu de
là connaissance.
20. Indifférent au fruit de l’action, toujours
satisfait, libre de toute attache, si affairé qu’il puisse être,
en réalité il n’agit pas.
21. Sans désir, l’esprit dompté, ayant renoncé
à rien posséder, n’accomplissant que matériellement les actes,
il ne contracte aucune souillure.
22. Satisfait de ce que le hasard lui apporte,
également supérieur à toutes les perceptions, libre de tout
égoïsme, indifférent au succès ou à l’insuccès, même en
agissant il n’est point lié.
23. Pour qui, affranchi de tout attachement,
délivré, la pensée solidement assise dans la vérité, s’emploie
aux œuvres du sacrifice, toute activité se dissout en néant.
24. L’instrument du sacrifice est Brahman ;
l’offrande est Brahman ; c’est par Brahman qu’est faite
l’oblation dans le feu qui, lui-même, est Brahman. Il ne peut
aller qu’en Brahman, celui qui voit ainsi Brahman dans l’acte
liturgique.
25. Des yogins, plusieurs n’envisagent comme
objet du sacrifice que les dieux ; d’aucuns, par le sacrifice même,
sacrifient à Brahman, identique au feu.
26. D’autres sacrifient l’ouïe et tous les
sens dans le feu du renoncement ; d’autres les objets sensibles,
son, etc., dans les feux des sens.
27. D’autres sacrifient toutes les opérations
des sens et toutes les opérations du souffle vital dans le feu du
yoga, du renoncement intérieur, allumé par la connaissance.
28. Des ascètes aux observances rigoureuses, les
uns pratiquent le sacrifice de la pauvreté ou le sacrifice de
l’austérité, d’autres le sacrifice du yoga, d’autres encore
le sacrifice de l’étude et de la science.
29. D’aucuns sacrifient le souffle expiré dans
le souffle inspiré, d’autres le souffle inspiré dans le souffle
expiré, interrompant le cours de l’un et de l’autre et appliqués
uniquement à l’exercice des souffles.
30. D’autres, restreignant leur nourriture,
sacrifient les souffles dans les souffles. Et tous ils ont la notion
vraie du sacrifice et, par le sacrifice, effacent leurs souillures.
31. Ceux qui se nourrissent de cette ambroisie que
sont les restes du sacrifice vont au Brahman éternel. À qui ne
sacrifie pas, ce monde ne saurait appartenir ; combien moins encore
l’autre monde, ô le meilleur des Kurus ?
32. Ainsi sont de bien des sortes les sacrifices
destinés à la bouche de Brahman. Mais tous impliquent action. Si tu
entends cela, tu atteindras la délivrance.
33. Supérieur à tout sacrifice matériel est le sacrifice en
esprit, ô héros terrible. En la connaissance se résolvent, ô fils
de Pṛithâ, tous les actes du sacrifice.
34. Acquiers-la à force de soumission[2],
d’application studieuse, de services respectueux ; tu la recevras
des maîtres de la connaissance qui savent la vérité.
35. Quand tu la posséderas, ô Pâṇḍava, tu
ne tomberas plus, comme tu as fait, dans l’erreur ; par elle, tu
verras tous les êtres sans exception en toi-même, puis en moi.
36. Et aussi, fusses-tu de tous les pécheurs le
plus grand, porté par la connaissance comme par un vaisseau, tu
traverseras tout l’océan du mal.
37. Un feu flambant réduit le bois en cendres, ô
Arjuna ; ainsi le feu de la connaissance réduit en cendres tous les
actes.
38. Rien, ici-bas, ne purifie comme la
connaissance ; de lui-même, avec le temps, l’adepte parfait du
yoga la découvre en soi.
39. Le croyant acquiert la connaissance, qui,
uniquement tendu vers elle, a dompté ses sens ; maître de la
connaissance, il atteint bientôt le repos suprême.
40. Il est perdu celui qui, n’ayant ni la
connaissance ni la foi, est livré au doute ; ni ce monde ni l’autre,
ni le bonheur n’est le lot de l’homme livré au doute.
41. Celui qui par le yoga s’est libéré de
l’action, qui par la connaissance a tranché le doute, cet homme,
maître de soi, ô Dhanañjaya, les actes ne sauraient l’enchaîner.
42.
Tranche donc, armé de la vérité, ce doute né de l’ignorance que
tu portes au cœur ; élève-toi au yoga ; ô Bhârata, redresse-toi
!
[1] Le Soleil ou un héros dérivé de lui.
[2] À l’égard du maître, du « guru ».
La Bhagavad Gîtâ – chapitre 5 : Le
renoncement
ARJUNA dit :
1. Tu loues, ô Kṛishṇa, le renoncement qui
supprime l’action et, en même temps, tu loues le yoga qui est
effort ; des deux lequel enfin est le meilleur ? Dis-le moi
nettement.
BHAGAVAT dit :
2. Renoncement et yoga, l’un et l’autre mènent
au salut ; entre les deux, cependant, la pratique du yoga vaut mieux
que le renoncement à l’action.
3. Il faut reconnaître pour parfaitement détaché celui qui ne hait
ni ne désire ; insensible aux perceptions de toute nature, ô
guerrier aux grands bras, il s’affranchit aisément de tout lien.
4. Seuls les esprits bornés opposent sâṃkhya
et yoga, mais non les sages[1]. Qui est vraiment maître de l’un
est assuré du fruit des deux.
5. Le but que touchent les adeptes du sâṃkhya
est également atteint par ceux du yoga. Sâṃkhya et yoga ne sont
qu’un ; qui reconnaît cela, voit juste.
6. Mais, en dehors du yoga, le détachement, ô
guerrier aux grands bras, est malaisé à obtenir ; voué au yoga,
l’ascète rapidement atteint Brahman.
7. Celui qui, voué au yoga, est pur, maître de
soi, tient ses sens soumis, pour qui son âme se confond avec l’âme
de tous les êtres, même s’il agit, n’est pas souillé.
8. L’adepte du yoga est fondé, en vérité, à
estimer qu’il n’agit pas. Qu’il voie, qu’il entende, qu’il
touche, qu’il sente, qu’il mange, qu’il marche, qu’il dorme,
qu’il respire,
9. Qu’il parle, qu’il lâche ou qu’il appréhende, qu’il
ouvre ou ferme les yeux : tout cela, ce sont pour lui les sens
réagissant au contact des objets sensibles.
10. Celui qui, fondant en Brahman[2] tous les actes, agit en
plein détachement, le péché ne s’attache pas à lui plus que
l’eau à la feuille du lotus.
11. Le corps, le sens interne[3], l’esprit, les
sens mêmes ainsi parfaitement dégagés, les yogins, agissant en
dehors de tout attachement, travaillent à leur purification
intérieure.
12. Celui qui pratique le yoga s’affranchit du fruit des actes et
atteint la paix stable ; celui qui ne le pratique pas, attaché au
fruit sous la poussée du désir, demeure lié.
13. Libérée en esprit de tous actes, l’âme est heureuse,
maîtresse dans sa forteresse aux neuf portes[4], n’agissant ni ne
provoquant l’action.
14. Ni l’activité, ni les actes ne procèdent
du Seigneur du monde, ni le lien qui attache le fruit aux actes ;
cela, c’est le domaine de la nature individuelle[5].
15. Ni péché, ni bonne œuvre n’atteint le Seigneur ; mais
l’ignorance voile la vérité ; d’où l’erreur des créatures.
16. Pour ceux en qui cette ignorance est détruite
par la connaissance de l’âtman[6], la science révèle, claire
comme le soleil, cette Entité suprême.
17. L’esprit plein d’elle, identifiés à
elle, appuyés sur elle, réfugiés en elle, ceux qui, par la
connaissance, ont effacé leurs fautes, s’affranchissent de
nouveaux retours.
18. Le brâhmane le plus savant et le plus
vertueux, un bœuf ou un éléphant, un chien ou un, mangeur de
chien, c’est tout un aux yeux du sage.
19. C’en est fait de tout retour en ce monde
pour ceux dont l’esprit est fixé dans l’impassibilité parfaite
; Brahman est sans tache, impassible ; ils sont donc fixés en
Brahman.
20. Le plaisir ne le réjouit pas plus que la
souffrance ne l’afflige ; il a l’âme toujours égalé, jamais
troublée, celui qui connaît Brahman, qui est fixé en Brahman.
21. Insensible aux impressions du dehors, c’est
en soi qu’il trouve le bonheur ; intimement uni à Brahman, il
goûte un bonheur indestructible.
22. C’est que les jouissances que donnent les
sensations ne sont qu’une source de souffrance, elles sont
fugitives, ô fils de Kuntî. Le sage n’y cherche pas de joie.
23. Celui qui, ici-bas, n’étant pas encore
libéré du corps, est capable de résister aux mouvements que
provoque le désir ou la colère, celui-là est un homme intérieur,
c’est un homme heureux.
24. Celui qui ne trouve de bonheur, de joie, de
lumière qu’au dedans, le yôgin identifié avec Brahman atteint la
paix en Brahman.
25. Ils conquièrent la paix en Brahman les rishis
purifiés de toute souillure, qui, ayant terrassé le doute, se sont
domptés eux-mêmes et ne se passionnent que pour le bien de tous les
êtres.
26. Les ascètes qui, l’esprit dompté, libres
de désir et d’aversion, se connaissent eux-mêmes, ont devant eux
la paix en Brahman.
27. Celui qui se ferme aux sensations du dehors,
qui ramène tout son pouvoir visuel entre ses sourcils, qui maintient
en équilibre les deux souffles, respiration et inspiration, auxquels
le nez livre passage,
28. Le sage qui, dompté dans ses sens, dans sa
conscience et dans sa pensée, uniquement tendu vers la délivrance,
est toujours libre de désir, de crainte ou de colère, celui-là
vraiment est affranchi.
29. Me
reconnaissant pour l’objet du sacrifice et de l’ascèse, pour le
Seigneur souverain de l’univers, l’ami de tous les êtres, il
atteint le repos.
[1] Sans
entrer ici dans des détails qui seraient hors de place je ne puis me
défendre de souligner combien ce vers condamne l’interprétation
par laquelle on a, de divers passages analogues, prétendu conclure
que « sâṃkhya » et « yoga » seraient ici deux systèmes
fondus dans une même orientation spéculative. Rien de pareil ; ce
sont deux voies, l’une intellectuelle, l’autre pratique, donc
parfaitement distinctes, mais qui sont données comme convergeant
vers un but commun, la délivrance ou le salut.
[2] C’est-à-dire
pour qui les actes n’ont rien de personnel, mais, du fait de son
détachement parfait, retombent dans l’indétermination de
l’universel Brahman.
[3] Le
manas est conçu comme un organe central de perception qui se
superpose aux cinq sens.
[4] Le
corps avec ses neuf ouvertures, les yeux, etc.
[5] Donc
de la « prakṛiti », n’étant pas du « purusha ».
[6] L’âme, soit individuelle soit universelle.
La Bhagavad Gîtâ – chapitre 6 : La
contemplation
BHAGAVAT dit :
1. Celui qui, sans se soucier du fruit des actes,
accomplit les actes prescrits, c’est celui-là, non celui qui
néglige le feu sacré et les rites, qui est vraiment un détaché,
un yogin.
2. Ce qu’on appelle renoncement n’est,
sache-le bien, ô Pândava, rien autre que le yoga ; car on ne peut
être un yogin sans avoir renoncé au désir.
3. Pour s’élever au yoga, l’action est l’arme
du sage ; c’est l’inaction quand il s’est élevé au yoga.
4. Car c’est lorsqu’il n’a plus
d’attachement ni aux objets des sens, ni aux actes, que, affranchi
de tout désir, il s’est élevé au yoga.
5. C’est par soi-même que l’on se sauve, que
l’on échappe à la perdition ; l’homme est à lui-même son ami,
à lui-même son ennemi.
6. Il est à lui-même son ami celui qui s’est
vaincu lui-même ; quant à celui qui n’est pas maître de soi, il
est à lui-même comme un ennemi.
7. Celui qui s’est vaincu, qui est dans le
calme, celui-là demeure parfaitement recueilli, dans le chaud comme
dans le froid, dans le plaisir comme dans la douleur, voire dans
l’honneur comme dans le mépris.
8. Celui qui fait sa joie de la vérité et de la
science, qui est concentré, maître de ses sens, de ce yogin qui ne
fait de l’or plus de cas que d’une pierre ou d’une motte de
terre, on dit qu’il est parvenu au yoga.
9. Honneur à celui qui considère du même œil
compagnons et amis, ennemis ou indifférents, inconnus, gens
haïssables ou parents, hommes vertueux ou pécheurs.
10. Que le yogin toujours se gouverne lui-même, retiré, solitaire,
l’esprit dompté, sans désir, sans bien.
11. Dans un endroit pur qu’il se dresse un siège
solide, ni trop haut ni trop bas, couvert d’étoffe, d’une peau
et de kuça[1].
12. Assis sur ce siège, l’esprit concentré,
ayant enrayé toute activité delà pensée et des sens, qu’il
exerce le yoga pour se purifier.
13. Impassible, tenant le corps, la tête et le
cou droits et immobiles, qu’il fixe son regard sur l’extrémité
de son nez sans le laisser errer ailleurs.
14. Parfaitement calme, libre de crainte, fidèle
à la chasteté, la pensée maîtrisée, l’esprit plein de moi,
qu’il demeure concentré, tendu vers moi.
15. Le yogin à l’intelligence domptée, qui
toujours s’exerce de la sorte, atteint le repos, la paix suprême
qui a son siège en moi.
16. Pas de yoga, ô Arjuna, pour qui abuse de la
nourriture, non plus que pour celui qui s’en prive complètement,
pour qui veut trop dormir non plus que pour qui prétend ne dormir
jamais.
17. L’effort qui mesure les aliments et
l’exercice, qui, dans l’action, mesure le mouvement, qui mesure
le sommeil et la veille, voilà ce qui constitue le yoga destructeur
de la souffrance.
18. Quand l’esprit discipliné se replie
uniquement sur lui-même, alors, on dit que l’homme, libéré de
tous les désirs, a atteint le yoga.
19. Une lampe à l’abri du vent dresse sa flamme
immobile ; c’est l’image consacrée du yogin qui, l’esprit
maîtrisé, parvient à se concentrer en soi.
20. Quand la pensée s’arrête suspendue par la
pratique du yoga, quand, découvrant par soi-même l’âtman
(l’âme), l’homme trouve sa satisfaction en soi ;
21. Quand il connaît ce bonheur infini qui,
n’étant accessible qu’à l’esprit, dépasse les sens, et au
sein duquel il ne peut plus s’écarter de la vérité,
22. Dont la possession fait apparaître
insignifiant tout autre bien, que ne peut atteindre aucune disgrâce,
si cruelle qu’elle soit ;
23. C’est cette libération de la souffrance
qu’on appelle yoga. Ce yoga, il le faut résolument poursuivre
d’une volonté que rien ne décourage.
24. Il faut s’affranchir pleinement de toutes
les passions, filles du désir ; il faut dominer complètement par
l’esprit la troupe des sens ;
25. Puis, peu à peu, l’esprit soutenu par une
volonté ferme, glisser dans le calme et, s’enfermant en soi, ne
plus penser.
26. Toutes les fois que l’esprit, remuant,
mobile, prétend s’extérioriser, chaque fois il faut le réfréner
et le ramener en soi à la soumission.
27. Un bonheur parfait pénètre le yogin qui a
l’esprit pacifié, qui, la passion calmée, sans tache, s’identifie
à Brahman.
28. Le yogin, affranchi de souillure, qui toujours
se gouverne ainsi, atteint aisément le bonheur infini qu’est
l’union en Brahman.
29. Il découvre l’âtman (l’âme) dans tous
les êtres et tous les êtres en l’âtman, l’homme gouverné par
le yoga qui reconnaît l’identité de tout.
30. Celui qui me voit en tout et qui voit tout en
moi ne se sépare jamais de moi, et jamais je ne me sépare de lui.
31. Celui qui, réalisant l’unité, m’adore
dans tous les êtres, ce yogin, où qu’il se meuve, demeure en moi.
32. Celui, ô Arjuna, qui, à l’image de l’unité
en l’âtman, voit que tout est identique, plaisir ou souffrance,
celui-là est réputé yogin parfait.
ARJUNA dit :
33. Ce yoga, ô vainqueur de Madhu, que tu définis
par l’impassibilité parfaite[2], j’ai peine à comprendre, étant
donné notre mobilité, comment il se peut asseoir fermement ;
34. Car l’esprit, ô Krishna, est mobile,
impérieux, violent, tenace ; autant que le vent, il est difficile à
enchaîner.
BHAGAVAT dit :
35. Assurément, ô guerrier aux grands bras,
l’esprit est mobile et malaisé à enchaîner ; cependant, ô fils
de Kuntî, on le peut réduire à force d’application et de
détachement.
36. Le yoga, je l’avoue, est d’accès
difficile pour qui n’a pas l’âme domptée ; mais celui dont
l’âme est maîtrisée et qui se donne de la peine, y peut parvenir
par des efforts bien conduits.
ARJUNA dit :
37. Celui qui ne parvient pas à l’ascèse, qui,
encore que possédant la foi, ne s’élève pas jusqu’au yoga, à
défaut de la perfection du yoga, quel but atteint-il, ô Krishna ?
38. Est-ce que, manquant également tous ses
objets, il ne se perd pas, ô guerrier aux grands bras — tel un
nuage qui se déchire — égaré sans point d’appui à la
recherche de Brahman ?
39. Dissipe clairement pour moi cette incertitude,
ô Kṛishṇa ; seul tu le peux.
BHAGAVAT dit :
40. Ô fils de Pṛithâ, celui que tu dis ne se
perd ni dans ce monde, ni dans l’autre ; qui fait le bien, ô mon
frère, ne saurait aller à sa perte.
41. Cet homme qui a manqué le yoga, élevé au
séjour des gens de bien, y demeure des années infinies, puis il
renaît de parents purs et fortunés ;
42. Ou, mieux encore, il revit dans une famille de
sages yogins ; car une pareille naissance est la plus rare à obtenir
en ce monde.
43. Là, ô rejeton de Kuntî, il retrouve l’état
d’esprit où il s’était élevé dans cette existence antérieure,
et avec un zèle redoublé il s’efforce vers la perfection.
44. Même à son insu, la vertu de son application
d’autrefois le soutient ; il conçoit le désir de s’initier au
yoga et dépasse la sagesse scripturaire.
45. Or le yogin, purifié de ses fautes, qui
s’efforce avec zèle, se perfectionnant à travers de nombreuses
naissances, finit par atteindre le but suprême.
46. Le yoga est supérieur à l’ascèse,
supérieur même à la science ; le yoga est supérieur aux œuvres
du sacrifice ; deviens donc un yogin, ô Arjuna.
47.
Mais, de tous les yogins, celui qui, l’âme unie à moi, m’aime
dans une foi profonde, c’est lui qui est, à mes yeux, le yogin
parfait.
[1] Une
herbe spécialement affectée à différents usages liturgiques.
[2] Pour bien comprendre la liaison avec ce qui précède, il faut se souvenir que, dans ce passage, « l’identité » qu’exprime le mot sama enferme un double aspect : il s’agit à la fois de l’identité métaphysique de tout dans l’être universel et de l’identité de toutes choses, plaisir, souffrance, etc., au regard de l’homme également détaché de tout. Sâmya que je traduis par impassibilité embrasse ainsi à la fois et la notion théorique du monisme et l’indifférence absolue du sage que rien ne peut toucher.
La Bhagavad Gîtâ – chapitre 7 : Les
précisions de la connaissance
BHAGAVAT dit :
1. Écoute maintenant, ô fils de Pṛithâ,
comment, t’appliquant au yoga, la pensée attachée à moi, réfugié
en moi, tu me connaîtras entièrement et sans nuage.
2. Sans réserve, je te communiquerai et te
rendrai claire cette vérité qui, connue, ne laisse plus rien à
apprendre ici-bas.
3. Entre des milliers d’hommes, c’est à peine si l’un ou
l’autre s’efforce vers la perfection et parmi ces parfaits, à
peine si l’un ou l’autre me connaît en vérité.
4. Terre, eau, feu, vent, éther, sens interne,
esprit, individualité, telles sont les huit manifestations diverses
de ma nature sensible[1].
5. Cela c’est ma nature inférieure ; mais sache que j’en ai une
autre, transcendante, qui est âme vivante, ô guerrier aux grands
bras, et qui est le support de cet univers.
6. La première est la matrice de tous les êtres,
je suis, moi[2], l’origine et la fin de l’univers tout entier.
7. Il n’est rien au-dessus de moi, ô héros ;
je suis la trame sur laquelle le tout est tissé, tels les rangs de
perles sur un fil.
8. Dans l’eau je suis le goût, ô fils de
Kuntî, la lumière dans la lune et dans le soleil, la syllabe oṃ
dans tous les vedas, le son dans l’espace, la virilité dans les
hommes.
9. Je suis dans la terre le parfum, la splendeur
dans l’astre du jour, la vie dans tous les êtres, l’ascèse dans
les ascètes.
10. Sache, ô fils de Pṛithâ, que je suis le
germé éternel de tous les êtres ; je suis la pensée des êtres
pensants, la grandeur des grands.
11. Je suis la force, affranchie de désir et de passion, des forts ;
dans les êtres vivants je suis, ô héros des Bhâratas, l’amour
permis.
12. Tous les dérivés du sattva, comme du rajas
ou du tamas[3], sache bien qu’ils procèdent de moi seul ; non que
je sois en eux ; ce sont eux qui sont en moi.
13. Aveuglé par ces triples produits des gunas,
tout cet univers est impuissant à me reconnaître au-dessus d’eux,
impérissable.
14. C’est que ce monde illusoire des gunas, manifestation de ma
puissance divine, est difficile à traverser ; ceux-là seuls le
franchissent qui viennent à moi.
15. Ils ne viennent pas à moi, ces pécheurs, ces
insensés, les derniers des hommes, qui, se laissant égarer par
l’illusion, tombent au niveau des esprits méchants[4].
16. De quatre sortes, ô Arjuna, sont les gens de
bien qui m’adorent : l’homme qui souffre, l’homme passionné de
savoir, l’homme qui poursuit la richesse et celui qui possède la
connaissance, ô taureau des Bhâratas.
17. De tous, le premier est celui qui, possédant
la connaissance, s’applique infatigablement et se voue à moi
uniquement ; car je suis infiniment cher à celui qui possède la
connaissance, et lui à moi.
18. Tous sont des êtres d’élite ; mais celui
qui possède la connaissance est pour moi comme moi-même. Car,
appliqué au yoga, il tend vers moi seul comme but suprême.
19. Ce n’est qu’au terme de bien des vies que
m’atteint celui qui possède la connaissance ; il est rare l’être
magnanime qui sait que Vâsudeva est tout.
20. Ceux qu’égarent des désirs divers
s’adressent à d’autres divinités ; ils obéissent chacun à sa
nature, en assumant des pratiques diverses.
21. Mais, quelque forme divine qu’un fidèle,
dans sa foi, souhaite honorer, c’est moi qui inspire en lui cette
foi inébranlable.
22. Plein de cette foi, il se rend telle divinité
propice ; il reçoit ensuite, en réalité dispensé par moi, l’objet
de ses désirs.
23. Mais éphémère est le fruit que cueillent les esprits à la
courte sagesse ; ceux qui sacrifient aux dieux vont aux dieux ; ce
sont ceux qui se vouent à moi qui viennent à moi.
24. Pour les ignorants, je ne surs qu’un dieu
invisible qui s’est manifesté[5] ; ils ne connaissent pas mon
essence transcendante, impérissable, suprême.
25. Voilé par l’illusion que produit ma
puissance, je n’apparais pas clairement à tous ; le monde égaré
ne me reconnaît pas, moi, l’éternel, l’impérissable.
26. Je connais, ô Arjuna, les êtres passés,
présents et à venir ; mais, moi, personne ne me connaît.
27. Troublés par les mouvements contraires
qu’engendrent le désir et la répulsion, ô Bhârata, tous les
êtres, en naissant, deviennent la proie de l’erreur.
28. Mais les hommes vertueux, une fois leur péché
épuisé, libérés du trouble que suscite la sensibilité en ses
mouvements contraires, se vouent à moi par un culte immuable.
29. Ceux qui s’appliquent, en se réfugiant en
moi, à s’affranchir de la vieillesse et de la mort, ceux-là
connaissent ce Brahman universel et individuel ; ils connaissent le
tout des actes liturgiques.
30.
Ceux qui reconnaissent en moi l’essence des êtres, l’essence du
divin, l’essence du sacrifice, ceux-là, l’esprit concentré, me
connaissent encore à leur dernier moment.
[1] La
« prakṛiti » présentée ici comme l’aspect sensible de l’âme
universelle avec laquelle le dieu est identifié.
[2] «
Moi » c’est-à-dire « mon essence transcendante ».
[3] Le
sativa, le rajas et le tamas qu’on transcrit en « bonté », «
passion », « ténèbres », sont les trois gunas dont il a été
souvent question. « Guna » signifie dans la langue courante qualité
: mais c’est, je pense, sur un sens très différent que s’est
échafaudée cette théorie singulière. En somme elle se résume à
imaginer que la prakṛiti se compose de ces trois éléments qui,
mélangés en proportions diverses, constituent, aux différents
stages de la nature et de la vie, tous les êtres transitoires de
tout ordre.
[4] Cf.
ci-dessous IX, 12 et plus loin, XVI, 6 sq.
[5] Dans la personne de Vâsudeva-Kṛishṇa.
La Bhagavad Gîtâ – chapitre 8 : Le salut en
Brahman
ARJUNA dit :
1. Qu’est-ce que ce Brahman ? et l’âme
individuelle ? Qu’est-ce que l’acte, ô suprême Seigneur ?
Qu’entends-tu s par l’essence des êtres ? par l’essence du
divin ?
2. Qui — et comment ? — ô vainqueur de Madhu,
peut, ici-bas, dans un corps mortel, contenir l’essence du
sacrifice ? Comment, à l’heure suprême, peux-tu être connu des
hommes qui ont su se discipliner ?
BHAGAVAT dit :
3. L’Impérissable est le Brahman suprême ; on
appelle âme individuelle la nature propre de chacun ; le devenir des
êtres résulte de cette offrande créatrice qui s’appelle l’acte
rituel.
4. Existence transitoire dans l’ordre des êtres,
esprit (purusha) dans l’ordre des dieux, j’incarne en ce corps, ô
le meilleur des hommes, l’essence du sacrifice.
5. Celui qui, à l’heure, de sa fin, rejette sa
guenille mortelle en pensant uniquement à moi rejoint mon être ;
là-dessus aucun doute.
6. Quelque existence que conçoive celui qui, au
terme de sa vie, se sépare du corps, c’est à cette condition
qu’il passe, ô fils de Kuntî ; toujours c’est dans cette
condition qu’il revit.
7. Pense donc à moi en tout temps et combats ;
l’esprit et la pensée fixés sur moi, c’est à moi que tu
viendras ; rien de plus certain.
8. Celui, ô fils de Pṛithâ, qui, l’esprit
concentré dans la pratique du yoga, et incapable de s’en laisser
distraire, pense le divin Purusha suprême, va à lui.
9. Celui qui se souvient du Sage primordial, du
Maître, plus ténu que l’atome ; auteur de l’univers, pour qui
aucune forme n’est imaginable, qui a l’éclat du soleil, qui
demeure par delà la ténèbre ;
10. Celui qui, au moment du grand départ, la
pensée inébranlable, concentrée dans la dévotion et dans l’effort
du yoga, sait ramener entre ses sourcils toute sa puissance vitale,
celui-là va au divin Purusha suprême.
11. Cette demeure, que les connaisseurs du veda
déclarent impérissable, où pénètrent les ascètes libérés de
la passion, en vue de laquelle on pratique la chasteté, je te la
vais décrire en raccourci.
12. Quand, fermant toutes les issues sur le
dehors, emprisonnant en soi la faculté de percevoir, retenant dans
la tête son souffle vital, on réalise la concentration du yoga ;
13. Que l’on dépouille le corps en prononçant
« om » — Brahman même en une syllabe — et en pensant à moi,
on s’élève à l’asile suprême.
14. Celui qui, sans aucune défaillance, pense
toujours à moi, pour ce yogin incessamment concentré, je suis, ô
fils de Pṛithâ, facile à obtenir.
15. Quand ils m’ont atteint, les sages, s’étant élevés à la
suprême perfection, ne sont plus soumis à la renaissance, au séjour
de souffrance et d’instabilité.
16. Tous les mondes jusqu’au ciel de Brahmâ[1], ô Arjuna,
reviennent à des existences nouvelles ; mais pour qui m’a atteint,
ô fils de Kuntî, plus de renaissance.
17. Ceux qui savent qu’un jour de Brahmâ dure
mille yugas[2] et mille une nuit, ces hommes connaissent
vraiment le jour et la nuit.
18. De l’indétermination sortent, au lever du
jour, toutes les réalités sensibles ; elles s’y fondent de
nouveau à la tombée de la nuit.
19. Ainsi mécaniquement, ô fils de Pṛithâ, toute la foule des
êtres, indéfiniment ramenée à I’existence, se dissout à la
tombée de la nuit, renaît au lever du jour.
20. Mais, par delà cette indétermination[3], est
une autre essence, entité indéterminée, éternelle, qui, tous, les
êtres disparaissant, elle, ne disparaît pas.
21. C’est l’« Indestructible ». C’est lui
qui est marqué comme le but suprême, celui d’où l’on ne
revient pas ; c’est là mon siège suprême.
22. C’est, ô fils de Pṛithâ, ce suprême
Purusha qu’on ne peut atteindre que par un attachement exclusif, le
Purusha qui embrasse tous les êtres, par qui a été déployé
l’univers.
23. Et maintenant, à quels moments les yogins
quittent la vie, soit sans retour, soit pour y revenir, je vais te
l’enseigner, ô Bhârata.
24. Feu, lumière, jour, quinzaine claire,
semestre ascendant du soleil vers le nord, c’est sous ces signes
lumineux que vont à Brahman les hommes qui connaissent Brahman.
25. Fumée, nuit, quinzaine sombre, semestre
descendant du soleil au sud, — sous ces signes d’ombre, le yogin
atteint la lumière de la lune pour revenir ensuite à de nouvelles
existences.
26. Ce sont les deux voies éternelles, l’une
claire, l’autre obscure, de l’univers ; par l’une il n’est
pas de retour, par l’autre on revient en arrière.
27. Les yogins les connaissent ces deux sentiers,
et aucun d’eux ne s’égare, ô fils de Pṛithâ ; sois donc, ô
Arjuna, en tout temps appliqué au yoga.
28. Le
mérite qui est assigné à l’étude du veda, au sacrifice, à
l’ascèse, à l’aumône, le yogin qui sait tout cela, le dépasse
; il s’élève au lieu suprême, au lieu des origines.
[1] Brahmâ,
masculin, le dieu Brahmâ, ordinairement rapproché de Vishṇu et de
Çiva ; non pas Brahman, au neutre, l’être un.
[2] Nom
d’une vaste période cosmique.
[3] Avyakta, littéralement « l’indistinct, l’indiscriminé » ; c’est un des noms que l’on donne à la prakriti dans son état primitif et, en quelque sorte, chaotique. On voit ici avec évidence que ces notions réputées spéculatives sur l’origine des choses reposent, au moins pour une part, sur l’arrière-plan des conceptions mythiques et construisent la genèse première à l’image de l’origine quotidienne du cosmos sortant au matin de la nuit et y retombant le soir.
La Bhagavad Gîtâ – chapitre 9 : Le mystère
royal
BHAGAVAT dit :
1. Je te veux, à toi qui es plein de zèle, faire
entendre clairement la science la plus secrète, celle dont la
connaissance t’affranchira de tout mal.
2. C’est la science royale, le secret royal, le
moyen de sanctification le plus puissant ; elle s’impose par
l’évidence ; elle est sainte, facile à pratiquer, impérissable.
3. Les hommes qui n’ont pas foi en cette
doctrine, ô héros terrible, impuissants à m’atteindre, retombent
dans les sentiers de la transmigration et de la mort.
4. C’est moi, dénué de toute forme sensible,
qui ai déployé cet univers. Tous les êtres sont en moi et moi je
ne suis pas en eux.
5. Et, à vrai dire, les êtres ne sont pas en
moi. Admire ici ma puissance souveraine : mon être porte les
créatures, il n’est pas dans les créatures, et c’est par lui
qu’existent les créatures.
6. Comme un grand vent toujours en mouvement dans l’espace,
s’insinue partout, ainsi faut-il entendre que toutes les créatures
sont en moi.
7. Tous les êtres, ô fils de Kuntî, à la fin
du kalpa[1], rentrent dans ma prakṛiti[2] ; au commencement du
kalpa, je les rends à l’existence.
8. C’est au moyen de ma prakṛiti que je
produis et reproduis toute cette foule des êtres, mécaniquement,
par la seule poussée de la prakṛiti.
9. Et cette activité, ô Dhanañjaya, ne
m’enchaîne pas, car j’y demeure comme étranger, étant sans
aucune attache à ces œuvres.
10. C’est grâce à moi que la prakṛiti
produit toutes les créatures vivantes ou inertes ; mais je ne suis
là que spectateur ; et c’est ainsi, ô fils de Kuntî, que le
monde évolue.
11. Incorporé dans une figure humaine, les égarés
me méconnaissent ; ils ignorent mon essence suprême de souverain
Seigneur des êtres.
12. Insensés, dont les espérances, les œuvres
et la science sont également vaines et qui s’abandonnent aux
égarements propres par nature aux démons et aux esprits mauvais !
13. Mais les sages, ô fils de Pṛithâ, qui
relèvent de la nature divine, s’attachent à moi uniquement ; ils
me connaissent pour l’origine impérissable des êtres.
14. Les uns me glorifient sans cesse, et, adonnés
aux pratiques rigides, m’adorant pieusement, me servent avec une
application constante.
15. D’autres me servent en me rendant un culte
de connaissance, soit qu’ils me considèrent dans l’unité ou
dans la multiplicité infinie de mes manifestations distinctes.
16. Je suis le rite, jé suis le sacrifice, je suis l’offrande et
l’herbe rituelle ; c’est moi qui suis la prière, le beurre
clarifié ; je suis le feu ; je suis la libation.
17. De ce monde, je suis le père, la mère,
l’ordonnateur, l’ancêtre ; je suis l’objet de la science, le
purificateur, la syllabe om, le rie, le sâman, le yajus[3] ;
18. Je suis le but, le soutien, le maître, le
témoin, la demeure, le refuge, l’ami, l’origine et la fin, le
support, le réceptacle, le germe, l’impérissable.
19. Je donne la chaleur, je retiens la pluie et je la répands ; je
suis l’immortalité et la mort ; je suis, ô Ârjuna, l’être et
le non-être.
20. Les maîtres de la triple science[4] qui
en buvant le soma se purifient de leurs péchés, cherchent, en
m’honorant par des sacrifices, à gagner le ciel ; introduits dans
le monde pur du roi des dieux, ils goûtent, là-haut, les
jouissances divines des hôtes célestes.
21. Quand ils ont joui de ce monde immense du ciel
et que leurs mérites sont épuisés, ils rentrent dans le monde des
mortels ; ainsi vont et viennent ceux qui, livrés au désir, vivent
sous la loi de la triple science.
22. Quant aux hommes qui me servent, en n’ayant
de pensée que pour moi, qui s’appliquent à une concentration
constante, je leur dispense la félicité.
23. Ceux-là même qui, attachés à d’autres
divinités, sacrifient avec foi, en réalité, ô fils de Kuntî,
c’est à moi qu’implicitement ils sacrifient.
24. Car c’est moi qui suis réellement l’objet
et le maître de tous les sacrifices, mais ils ne me connaissent pas
tel que je suis ; et c’est pourquoi ils retombent dans la vie.
25. Ceux qui servent les dieux vont aux dieux, aux
mânes ceux qui servent les mânes, aux démons ceux qui servent les
démons ; ainsi viennent à moi ceux qui m’offrent leurs
sacrifices.
26. Que l’on me présente avec dévotion fût-ce
une feuille, une fleur, un fruit, un peu d’eau, je jouis de
l’offrande pieuse du serviteur au cœur zélé.
27. Actions et repas, libations, aumônes,
pénitences, offre-moi tout, ô fils de Kuntî.
28. Par là tu te libéreras des chaînes de
l’action et de ses fruits bons ou mauvais ; voué au détachement
et au yoga, affranchi, tu viendras à moi.
29. Entre toutes les créatures, je ne fais nulle
différence, aucune ne m’est en haine, aucune ne m’est chère ;
mais ceux qui s’attachent à moi avec dévotion, ceux-là sont en
moi et moi en eux.
30. Même un grand criminel, s’il m’adore sans
partage, doit être considéré comme un juste ; car sa croyance est
vraie.
31. Vite il devient irréprochable et atteint la
paix éternelle. Entends-le bien, ô fils de Kuntî, jamais mon
serviteur ne se perd.
32. Ceux, ô fils de Pṛithâ, qui prennent en
moi leur refuge, fussent-ils de la pire origine, femmes, vaiçyas ou
çûdras, ceux-là même atteignent le but suprême ;
33. Combien plus les brâhmanes purs et les
rois-ṛishis qui se donnent à moi. Tombé dans ce monde éphémère
et misérable, sois mon serviteur.
34.
Tourne vers moi ta pensée, donne-toi à moi, offre-moi tes
sacrifices, adore-moi ; en te gouvernant ainsi, uniquement occupé de
moi, tu viendras à moi.
[1] Période cosmique.
[2] La prakṛiti, on l’a vu, c’est le monde sensible et vivant ; elle est conçue, dans le syncrétisme qui prévaut ici, comme une sorte d’extériorisation de l’âme universelle avec laquelle est identifié le Dieu.
[3] C’est-à-dire le verbe même de chacun des Vedas, Ṛigveda, Sâmaveda et Yajurveda.
[4] Des trois vedas. — Le soma est la plante sacrée que l’on pressure dans les sacrifices.
La Bhagavad Gîtâ – chapitre 10 : Les
manifestations
BHAGAVAT dit :
1. Écoute encore, ô guerrier aux grands bras, ma
parole suprême, et réjouis-toi d’un enseignement que je te
communique pour ton bien.
2. Ni les dieux, ni les grands ṛishis ne
connaissent ma naissance ; car je suis moi-même l’origine unique
des dieux et des grands ṛishis.
3. Celui qui me connaît pour souverain du monde,
éternel, sans commencement, celui-là, maître entre les mortels de
la vérité, est affranchi de tout péché.
4. Intelligence, connaissance, fermeté d’esprit,
patience, sincérité, maîtrise de soi, paix, plaisir et souffrance,
naissance et destruction, crainte et courage,
5. Douceur, égalité d’âme, contentement, pénitence, aumône,
honneur et déshonneur, tous les modes divers de l’existence
procèdent de moi seul.
6. Les sept grands ṛishis du commencement et les
quatre manus[1] procèdent de moi ; ils sont mes fils spirituels
de qui sont issues dans le monde toutes les créatures.
7. Celui qui connaît en vérité, mon expansion
et ma puissance, celui-là est, de toute certitude, en possession du
yoga inébranlable.
8. Je suis l’origine de tout ; de moi tout
procède ; c’est dans cette conviction que s’attachent à moi les
sages à la pensée profonde.
9. L’esprit en moi, toute leur vie suspendue à
moi, s’éclairant les uns les autres et proclamant sans cesse mes
louanges, ils sont comblés, ils débordent de joie.
10. À ces hommes constamment recueillis, qui
s’attachent à moi avec délices, je communique la force d’esprit
par laquelle ils s’élèvent à moi.
11. Pour eux, par grâce, me manifestant dans ma
vraie nature, je dissipe les ténèbres de l’ignorance à
l’éclatante lumière de la vérité.
ARJUNA dit :
12. Tu es le Brahman suprême, le refuge suprême,
le suprême purificateur. Le divin Esprit (purusha) éternel, le
premier des dieux, l’être sans commencement, omniprésent :
13. Ainsi te nomment tous les ṛishis et Nârada,
le ṛishi divin, Asita Dévala, Vyâsa ; ainsi toi-même tu te
révèles à moi.
14. C’est sur ta parole, ô Keçava, que je
tiens tout cela pour vrai, car les dieux ni les démons ne savent, ô
Bhagavat, comment tu te manifestes.
15. Toi seul tu te connais toi-même, ô suprême
Purusha, auteur des êtres, souverain des êtres, dieu des dieux,
seigneur du monde !
16. Daigne exposer sans réserve tes
manifestations divines, ces manifestations par lesquelles tu pénètres
incessamment tous les mondes.
17. Comment, ô maître du yoga, même à méditer
sur toi sans trêve, saurais-je dans quelles formes de l’être je
dois te reconnaître, ô Bhagavat ?
18. Parle encore ; expose-moi en détail, ô
Janârdana, ta puissance et ta manifestation ; je ne puis me
rassasier de l’ambroisie de ta parole.
BHAGAVAT dit :
19. Je t’énumérerai donc, ô le meilleur des
Kurus, mes manifestations divines, mais en raccourci, car le détail
en serait sans fin.
20. Je suis, ô Guḍâkeça, l’âme qui a son
siège dans tous les êtres : de tous les êtres, je suis le
commencement, le milieu et la fin.
21. Entre les Adityas, je suis Vishṇu, entre les
astres, le soleil radieux ; je suis Marîci entre les Maruts, la lune
entre les constellations.
22. Des vedas je suis le sâman et Vâsava parmi les dieux, parmi les
sens, je suis le sens interne et entre les êtres l’esprit ;
23. Des Rudras[2] je suis Çaṃkara, entre
les Yakshas et les Rakshas le dieu des richesses ; des Vasus je suis
le feu, et des sommets le Meru ;
24. Sache, ô fils de Pṛithâ, que je suis le
chef des prêtres domestiques, Bṛihaspati, entre, les chefs d’armée
Skanda, entre les eaux l’Océan ;
25. Des grands ṛishis, je suis Bhṛigu et,
entre les sons, la syllabe unique oṃ, dans le sacrifice la prière,
entre les montagnes l’Himâlaya ;
26. L’açvattha entre tous les arbres et Nârada entre les rishis
divins ; Čitraratha entre les Gandharvas et, entre les saints,
l’ascète Kapila.
27. Sache que, entre les chevaux, je suis
Uččaiḥçravas né avec l’ambroisie, Airâvata[3] entre les
éléphants et, parmi les hommes, le roi.
28. Des armes je suis la foudre, des vaches la vache qui comble tous
les vœux. Je suis l’Amour, le dieu de la génération. Entre les
serpents, je suis Vâsuki.
29. Je suis Ananta parmi les Nâgas, Varuṇa parmi les habitants des
eaux. Parmi les Mânes, je suis Aryaman et Yama[4] parmi les
potentats.
30. Je suis Prahlâda entre les démons et Kâla
(le Temps) entre tout ce qui se compte[5], le lion parmi les animaux
et, parmi les oiseaux, le fils de Vinatâ.
31. Je suis le vent entre tout ce qui purifie,
Râma entre les guerriers, entre les poissons le Makara, entre les
fleuves le Gange.
32. Des créations, ô Arjuna, je suis le
commencement et la fin, le milieu aussi ; des sciences la
connaissance de l’âtman ; entre les thèses contraires la vérité.
33. Des lettres, je suis l’a, je suis le premier
parmi les composés ; c’est moi qui suis le temps infini, moi le
créateur au visage innombrable.
34. Je suis la mort qui
emporte tout et la naissance de ceux qui doivent venir à la vie ;
parmi les génies féminins, je suis la Gloire, la Fortune et la
Parole, la Mémoire, la Sagesse, la Fermeté, la Patience.
35. Entre les sâmans[6] je suis le
Bṛihatsâman et entre les ričs la Gâyatrî ; entre les mois
Mârgaçîrsha, entre les saisons le printemps.
36. Entre tout ce qui trompe, je suis le jeu, je
suis la splendeur de ce qui brille, je suis la victoire, la
certitude, je suis la vertu des gens vertueux.
37. Entre les Vṛishṇis je suis Vâsudeva et
entre les Pâṇḍavas Arjuna ; des ascètes je suis Vyâsa, des
sages le sage Uçanas.
38. Je suis la force des dominateurs, la politique
des conquérants, je suis le silence des mystères et la science des
savants.
39. Le germe de tous les êtres, ô Arjuna, c’est
moi ; il n’est pas un être animé ou inanimé qui puisse être
sans moi.
40. Innombrables, ô héros, sont mes
manifestations divines ; cette énumération n’est qu’une manière
d’exemple.
41. Entends que toute manifestation, toute vie,
toute beauté et toute énergie a pour origine une parcelle de ma
puissance.
42.
Mais à quoi bon, ô Arjuna, tout ce détail ? Un mot suffit : d’une
seule parcelle de moi je porte éternellement tout cet univers.
[1] Personnages
de la cosmogonie légendaire.
[2] Rudras,
Yakshas, Rakshas, Vasus, catégories diverses de génies, dieux ou
démons. De même plus bas les Gandharvas, les Nâgas, etc.
[3] Uččaiḥçravas
est un cheval mythique qui sort du barattement de l’océan ;
Airâvata, l’éléphant qui sert de monture au dieu Indra.
[4] Le
dieu des morts, avec un jeu étymologique sur saṃ-yam.
[5] Par
jeu de mots sur le thème kal, origine de Kâla, « le temps ».
[6] Formules du Sâmaveda.
La Bhagavad Gîtâ – chapitre 11 : La vision de
l’Être innombrable
ARJUNA dit :
1. Le suprême mystère que pour mon bien tu m’as
communiqué, la doctrine de l’âtman, a banni de moi toute erreur.
2. De ta bouche, ô héros aux yeux de lotus, j’ai
appris en détail l’origine et la fin des êtres et ta grandeur
impérissable.
3. Il en est comme tu l’as dit en t’affirmant
toi-même le dieu souverain. Je désire, ô suprême Purusha, te voir
dans ta forme divine.
4. Situ estimes, ô maître, que je la puisse
contempler, ô dieu du yoga, montre-toi à moi comme l’Impérissable.
BHAGAVAT dit :
5. Vois, ô fils de Pṛithâ, par centaines, par
milliers, mes formes divines, infiniment diverses, infiniment variées
de couleur et d’aspect.
6. Vois les Âdityas, les Vasus, les Rudras et les
Açvins et les Maruts ; vois, ô Bhârata, d’innombrables
merveilles que jamais jusqu’ici nul n’a aperçues.
7. Vois ici dans mon seul corps, ô Guḍâkeça,
tout l’univers, tous les êtres vivants ou inanimés et quelque
objet enfin que tu souhaites contempler.
8. Mais tu ne peux me voir avec tes seuls yeux
d’homme ; je te confère la vue divine ; contemple ma puissance
souveraine.
SAÑJAYA dit :
9. À ces mots, Hari, le grand maître du yoga,
découvrit, ô roi, au fils de Pṛithâ sa forme de souverain
Seigneur,
10. Pourvu de bouches et d’yeux sans nombre,
vision de merveilles sans fin, orné de joyaux divins innombrables,
brandissant mille armes divines,
11. Paré de guirlandes et de vêtements divins,
oint de parfums célestes, c’est, fait de tous les prodiges, le
dieu infini se manifestant en toutes choses.
12. Si l’éclat de mille soleils surgissait tout
d’un coup dans le ciel, ce serait quelque chose comme l’éclat
que répand le grand Être.
13. Tout cet univers fait de tant de parties, le
Pâṇḍava le vit ramassé là dans le corps du dieu des dieux.
14. Alors Dhanañjaya pénétré de stupeur, tous
les poils hérissés, s’inclinant devant le dieu et les mains
réunies pour l’hommage, prononça :
ARJUNA dit :
15. Ô dieu, je vois dans ton corps tous les dieux
et toutes les sortes d’êtres, Brahmâ, Çiva, le dieu au siège de
lotus et les ṛishis et tous les serpents divins.
16. Je te vois avec un nombre infini de bras, de
poitrines, de bouches et d’yeux, illimité en tous sens ; de toi, ô
maître de l’univers aux aspects infinis, je ne vois ni la fin, ni
le milieu, ni le commencement.
17. Avec le diadème, la massue et le, disque —
telle une masse de feu qui projette de tous côtés des flammes —
je te vois, toi si difficile à apercevoir, immense, répandant en
tous sens l’éclat d’un brasier ardent, du soleil.
18. En toi il faut reconnaître l’Être
indestructible, suprême ; tu es le suprême support de l’univers ;
tu es, je le sais, l’impérissable gardien de l’ordre permanent,
l’éternel Purusha.
19. Je te vois sans commencement, sans milieu et
sans fin, de force infinie, armé de bras sans nombre, pour yeux le
soleil et la lune, pour bouche le feu flambant, réchauffant
l’univers de ta splendeur.
20. Car, entre terre et ciel, seul tu remplis
tout. À la vue de ta forme merveilleuse et terrible, ô grand Être,
les trois mondes sont frappés d’épouvante. »
21. Car voici que les troupes des dieux entrent en
toi ; quelques-uns, effrayés, chantent en t’adorant ; les troupes
des ṛishis et des Siddhas te bénissent et te comblent de louanges
infinies.
22. Rudras et Âdityas, Vasus et Sâdhyas,
Viçvedevas et Açvins, les Maruts, les Mânes, la troupe des
Gandharvas, des Yakshas, des Asuras et des Siddhas, tous te
contemplent émerveillés.
23. À la vue de cette apparition immense, aux
bouches, aux yeux innombrables, aux bras, aux jambes, aux pieds sans
nombre, ô héros aux grands bras, avec tes innombrables poitrines,
tes crocs formidables, les mondes tremblent et je tremble, moi aussi.
24. En te voyant toucher le ciel de la tête,
éblouissant de mille couleurs, les bouches ouvertes, les yeux
immenses et flamboyants, je me sens épouvanté, je ne puis me
ressaisir ni reprendre contenance, ô Vishṇu.
25. À la vue de tes bouches aux crocs
formidables, pareilles au feu cosmique qui met fin à toutes choses,
je suis éperdu, je ne sais où chercher un refuge. Grâce ! ô
maître des dieux qui pénètres l’univers.
26. En toi se précipitent tous ces fils de
Dhṛitarâshṭra, avec la foule des rois, Bhîshma, Droṇa et
aussi Karṇa, avec, encore, les chefs de nos guerriers.
27. Ils se précipitent en hâte dans tes bouches
terrifiantes aux crocs formidables ; plusieurs apparaissent
suspendus, , la tête écrasée, entre tes dents.
28. Comme les flots pressés des fleuves roulent
rapides vers l’océan, tels ces héros se précipitent dans tes
mâchoires flamboyantes.
29. Comme des papillons se hâtent à leur perte
dans la flamme brillante, ainsi les hommes courent à leur perte en
se précipitant dans tes bouches.
30. De tes langues de flamme tu enveloppes, tu
dévores avidement tous les hommes ; tes feux redoutables, ô Vishṇu,
brûlent l’univers qu’ils remplissent tout entier de leur
splendeur.
31. Révèle-moi qui tu es sous cet aspect
terrible. Adoration à toi ! Grâce ! ô maître des dieux. Je
souhaite te connaître ; tu es origine ; je ne comprends pas ce rôle
de destructeur où je te vois.
BHAGAVAT dit :
32. Je suis le Temps qui, en progressant, détruit
le monde ; mon rôle est de supprimer ici-bas les hommes ; quoi que
tu fasses, ils cesseront tous quelque jour de vivre, ces guerriers
rangés en ligne de bataille.
33. Donc, lève-toi, conquiers la gloire ;
triomphe de tes ennemis et jouis d’un royaume prospère. C’est
moi qui, d’abord, frappe tous ces guerriers ; sois seulement, ô
toi l’habile archer, l’instrument dans ma main.
34. Droṇa, Bhîshma, Jayadratha, Karṇa et tous
ces autres héros, c’est moi-même qui les frapperai ; frappe-les,
toi aussi ; n’hésite pas. Combats ! Tu vaincras dans la lutte tous
tes rivaux.
SAÑJAYA dit :
35. À ce discours de Keçava, le héros au
diadème, tremblant, les mains jointes pour l’hommage, adorant
Krishna avec épouvante, répondit d’une voix coupée par
l’émotion.
ARJUNA dit :
36. C’est justice, ô Hṛishîkeça, que, à
t’entendre célébrer, le monde soit transporté de joie et
d’amour, que les mauvais esprits épouvantés s’enfuient et que
toutes les troupes des Siddhas tombent en adoration.
37. Comment ne t’adoreraient-ils pas, ô grand
Être, toi premier agent plus vénérable que Brahmâ même ! Ô
maître infini des dieux, appui de l’univers, tu es l’Impérissable,
tu es l’être et le non-être et ce qui est par-delà.
38. Tu es le premier des dieux, l’Esprit,
l’Ancien, tu es le support suprême de tout cet univers ; tu es le
sujet et l’objet de toute science et le bien suprême ; par toi, ô
dieu aux aspects infinis, le tout a été déployé.
39. Tu es Vâyu, Yama, Agni, Varuṇa ; tu es la
Lune ; tu es Prajâpati ; tu es l’Ancêtre. Adoration, mille fois
adoration à toi, et puis, encore et encore, adoration, adoration à
toi !
40. De l’est et de l’ouest, adoration à toi,
adoration de tous les points de l’horizon, ô toi qui es tout.
Immense et sans limite est ta puissance. Tu pénètres tout et ainsi
tu es tout.
41. Ne voyant en toi que l’ami, si je me suis
laissé aller à m’écrier : « Ô Kṛishṇa, ô Yâdava, ô ami
! » méconnaissant ta grandeur par légèreté ou par entraînement
de tendresse,
42. Si, par plaisanterie, je t’ai manqué de
respect, dans l’agitation ou le repos, dans des réunions ou des
repas, soit seul, ô Àčyuta, soit devant témoins, je t’en
demande pardon, à toi, l’Immense.
43. Tu es le père de ce monde animé et inanimé,
tu es son maître vénérable, adorable. Tu n’as pas d’égal,
combien moins de supérieur ! Dans les trois mondes ta puissance est
incomparable.
44. C’est pourquoi, la tête inclinée, tout
entier prosterné, je t’implore, toi, le maître digne de toute
louange. Comme le père au fils, comme l’ami à l’ami, comme
l’amant à l’aimée, daigne, ô dieu, m’être indulgent.
45. Devant ce spectacle inouï, je frissonne et
mon esprit est ébranlé par la crainte. Montre-moi seulement ta
forme de dieu ; fais-moi cette grâce, ô maître des dieux, support
de l’univers !
46. Je désire te revoir simplement ainsi avec le
diadème, la massue et le disque. Reprends cette figure à quatre
bras, ô dieu aux mille bras, aux formes infinies.
BHAGAVAT dit :
47. C’est pour te témoigner ma faveur que, par
un effet de ma puissance, je t’ai révélé, ô Arjuna, ma forme
suprême, toute resplendissante, totale, infinie, primitive, cette
forme qu’aucun autre que toi n’a jamais vue.
48. Au prix d’aucune étude, veda ni sacrifice,
d’aucune aumône, d’aucun rite, fût-ce de la plus terrible
pénitence, je ne saurais, ô chef des Kurus, être, dans le monde
des hommes, vu sous cet aspect par personne autre que toi.
49. Ne t’effraie ni ne te trouble pour m’avoir
vu sous cette forme redoutable. Cependant, bannissant toute crainte
et le cœur satisfait, contemple maintenant de nouveau ma forme
coutumière.
SAÑJAYA dit :
50. Parlant ainsi, Vâsudeva se manifesta de
nouveau à Arjuna sous ses traits ordinaires ; et le grand Être
rendit le calme au guerrier terrifié, en apparaissant derechef avec
son air de bienveillance.
ARJUNA dit :
51. En voyant, ô Janârdana, ta forme humaine à
l’expression bienveillante, voici que j’ai repris mes sens ; je
suis redevenu maître de moi.
BHAGAVAT dit :
52. Elle est bien malaisée à voir cette forme de
moi que tu as vue ; en vain les dieux eux-mêmes y aspirent sans
cesse.
53. Ni par les vedas ou la pénitence, ni à force
d’aumônes ou de sacrifices, on n’obtient de me voir tel que tu
m’as vu.
54. C’est seulement au prix d’une dévotion
sans partage que l’on peut, ô Arjuna, me connaître sous ces
traits et me contempler au vrai et entrer en moi, ô héros
redoutable.
55. Celui qui n’agit qu’en vue de moi, dont je suis le tout, qui se dévoue à moi, libre de toute attache, qui ne connaît de Haine pour aucun être, celui-là, ô Pâṇḍava, parvient à moi.
La Bhagavad Gîtâ – chapitre 12 : La Bhakti
ARJUNA dit :
1. De ceux qui te servent ainsi, s’attachant à
toi avec une application constante, ou de ceux qui ne connaissent que
l’Indestructible inaccessible aux sens, lesquels sont les meilleurs
disciples du yoga ?
BHAGAVAT dit :
2. Ceux qui, pleins d’une foi inébranlable,
fixant en moi leur pensée, me servent avec une application
incessante, ce sont ceux-là que je tiens pour les yogins les plus
parfaits.
3. Cependant, ceux dont le zèle religieux a pour
objet l’Indestructible, inexprimable, inaccessible aux sens,
omniprésent et impensable, inébranlable, immuable, fixe ;
4. Qui, dominant leurs sens, n’éprouvent, au
regard de toutes les sensations, qu’une indifférence complète,
ces hommes passionnés pour le bien de tous les êtres, c’est
moi-même qu’ils atteignent.
5. Mais l’effort est bien plus pénible pour les
esprits qui s’attachent à l’inaccessible ; un objet abstrait
est, pour les hommes, malaisé à atteindre.
6. Ceux, au contraire, qui, s’allégeant en moi
de tous actes, ne voient que moi, qui me servent en concentrant dans
ma contemplation tout leur effort,
7. Ces hommes dont l’esprit se réfugie en moi,
rapidement, ô fils de Pṛithâ, je les arrache à l’océan de la
transmigration et de la mort.
8. Porte ta pensée vers moi seul, fixe en moi ton
intelligence, tu seras sûr alors de demeurer dorénavant en moi.
9. Si tu ne peux fixer fermement en moi ton
esprit, tâche, ô Dhanañjaya, de m’atteindre par l’effort
d’exercices soutenus.
10. Si tu ne peux davantage réussir par ces
pratiques, consacre-moi toutes tes actions ; en agissant en vue de
moi seul, tu pourras encore atteindre la perfection.
11. Si tu es, enfin, incapable d’agir de la
sorte en t’efforçant à t’unir à moi, renonce, l’âme
maîtrisée, à tout fruit des actes.
12. Car la connaissance vaut mieux que les
pratiques ascétiques ; la contemplation l’emporte sur la
connaissance, et sur la contemplation, le renoncement au fruit des
actes ; le renoncement conduit immédiatement à la paix du salut.
13. Sans haine pour aucun être, tendre et
pitoyable, détaché, dénué d’égoïsme, patient jusqu’à
l’indifférence au regard de la souffrance et du plaisir,
14. Toujours satisfait, le yogin, maître de lui,
ferme eh ses résolutions, qui, tendrement attaché à moi, repose en
moi son esprit et sa pensée, celui-là m’est cher.
15. Celui de qui les hommes n’ont rien à
redouter et qui ne redoute rien des hommes, celui qui est affranchi
de tous mouvements de joie, de colère, de crainte, celui-là m’est
cher.
16. Détaché, pur, fort, parfaitement
indifférent, supérieur à toute agitation, celui qui, renonçant à
toute activité intéressée, m’est tendrement attaché, celui-là
m’est cher.
17. Celui qui, plein de tendre dévotion, ne se
réjouit ni ne hait, ne s’attriste ni ne désire, renonce également
à ce qui est agréable ou pénible, celui-là m’est cher.
18. Celui qui ne fait nulle différence entre
ennemi et ami, entre l’honneur et le mépris, le froid et le chaud,
le plaisir et la peine, libéré de tout attachement,
19. L’homme plein de dévotion tendre, qui
accueille le blâme et l’éloge du même silence dédaigneux, qui
est également satisfait de tout, qui, sans asile, garde le cœur
ferme, cet homme m’est cher.
20. Mais ceux qui, s’attachant à moi comme à leur objet suprême, croient fermement au pieux enseignement, précieuse ambroisie, que je viens de te dispenser, par-dessus tout ceux-là me sont chers.
La Bhagavad Gîtâ – chapitre 13 : Le Monde
sensible et l’Esprit
BHAGAVAT dit :
1. Le corps, ô fils de Kuntî, est appelé le
kshetra [1] ; celui qui le connaît est dit kshetrajña par ceux
qui savent.
2. Mais apprends aussi, ô Bhârata, que dans tous
les kshetras je suis le kshetrajña. La science du kshetra et du
kshetrajña, voilà qui est vraiment la science.
3. Ce qu’est le kshetra, ce qui le caractérise,
comment il se diversifie et quelle est son origine, et ce ksetrajña,
quel il est et quelle est sa puissance, je vais te l’expliquer
brièvement ; écoute-moi.
4. Les ṛishis ont proclamé cet enseignement au hasard de leurs
chants, dans nombre de vers, et aussi dans l’exposé précis et
solidement déduit des sûtras relatifs au Brahman.
5. Les éléments, l’individualité,
l’intelligence et l’indéterminé, les dix sens avec le sens
central et les cinq domaines des sens [2],
6. Le désir et la haine, le plaisir et la
souffrance, le corps, la pensée, la volonté : voilà, en abrégé,
ce qu’on appelle le kshetra dans ses aspects divers.
7. L’humilité, la loyauté, la douceur, la
patience, la probité, le respect du maître, la pureté, la fermeté,
la maîtrise de soi,
8. L’indifférence aux objets des sens,
l’affranchissement de tout égoïsme, la claire vision des maux
qu’apportent la naissance et la mort, la maladie et la vieillesse,
9. Le renoncement, le détachement de tout, fils,
femme, maison, et la constante égalité d’âme devant tous les
événements agréables ou pénibles,
10. L’union avec moi exclusive et incessante, la
pratique de la solitude, le dégoût de la société des hommes,
11. La recherche assidue de la science de l’âtman,
et le vif sentiment du prix de la vérité, — voilà ce qu’on
appelle la connaissance ; l’ignorance en est le contraire.
12. Quant à l’objet de la connaissance, je vais
te le révéler, cet objet dont la connaissance procure l’immortalité
: c’est le Brahman suprême qui n’a pas de commencement, dont on
dit qu’il n’est ni l’être ni le non-être.
13. Il est partout pieds et mains, yeux, têtes et
bouches, partout oreilles ; il embrasse toutes choses.
14. Il se manifeste par tous les sens et il est
dépourvu de tout sens ; détaché de tout, il porte tout ; étranger
aux guṇas, il perçoit les guṇas.
15. Il est à l’extérieur et à l’intérieur
des êtres, immobile et mobile ; si subtil qu’il ne peut être
perçu ; il est loin et il est près.
16. Indivisible il réside dans les êtres comme
s’il était divisé ; c’est lui qui conserve les êtres, lui
aussi qui les dévore, lui qui les produit.
17. On l’appelle la lumière des lumières,
celle qui est par delà les ténèbres. Connaissance et objet de la
connaissance, accessible par la connaissance, il réside au cœur de
chacun.
18. Ainsi je t’ai dit eh bref ce qu’est le
kshetra et aussi la connaissance et l’objet de la connaissance.
Celui qui, uniquement attaché à moi, comprend cela, accède à mon
être.
19. Sache que Prakṛiti et Purusha sont tous deux
sans commencement et ; que de la Prakṛiti sont issus les modalités
(vikâras) et les guṇas.
20. De la Prakṛiti procède toute activité —
effets et causes, du Purusha toute perception — plaisir et
souffrance.
21. Résidant dans la Prakṛiti, le Purusha
perçoit les guṇas issus d’elle ; son attachement aux guṇas est
la cause des naissances heureuses ou malheureuses.
22. Même dans le corps où son seul rôle est
d’être spectateur passif, de conserver, de percevoir, c’est le
Purusha transcendant, celui qu’on appelle le Maître souverain et
l’Esprit suprême.
23. Celui qui connaît ainsi le Purusha et la
Prakṛiti avec les guṇas, en quelque condition qu’il se trouve,
ne renaît pas.
24. Quelques-uns découvrent eux-mêmes en soi
l’âtman (l’âme universelle) par la contemplation, d’autres
par l’effort de la pensée, d’autres par l’effort dans
l’action.
25. Plusieurs, s’ils ne s’élèvent pas
d’eux-mêmes à la vérité, y croient, instruits par d’autres ;
eux aussi, uniquement dirigés par la révélation, triomphent de la
mort.
26. Dans tous les cas où naît un être, animé
ou inanimé, sache, ô taureau des Bharatas, que c’est par l’union
du kshetra et du kshetrajña.
27. Celui qui connaît que c’est le souverain
Seigneur qui réside, le même, dans tous les êtres sans jamais
périr avec ceux qui périssent, celui-là sait.
28. Celui qui voit le Seigneur résidant partout,
toujours identique, celui-là ne risque pas de se perdre lui-même ;
il atteint le but suprême.
29. Celui qui voit que toujours et partout
l’action est œuvre de la seule Prakṛiti, et que l’âme n’est
point agent, celui-là voit.
30. Quand il reconnaît que c’est sur le même
être unique que repose la foule des existences particulières et que
de lui tout rayonne, alors il atteint Brahman.
31. Cet âtman suprême, impérissable parce qu’il
est sans commencement et sans guṇas, bien qu’il demeure dans le
corps, n’agit pas, ô fils de Kuntî ; il ne contamine pas.
32. Comme l’éther répandu partout échappe par
sa subtilité à toute souillure, de même l’âtman partout répandu
dans le corps, ne se contamine jamais.
33. Comme le soleil à lui seul illumine tout cet
univers, de même, ô Bhârata, le maître du kshetra illumine le
kshetra entier.
34.
Ceux qui, à la lumière de la science, ont ainsi reconnu la
distinction du kshetra et du kshetrajña et comment on s’affranchit
du monde sensible des créatures, ceux-là atteignent l’absolu.
[1] Kshetra
signifie « le champ » ; kshetrajña « qui connaît le champ » ;
c’est le corps et l’âme.
[2] Les vingt-quatre premiers tattvas du Sâṃkhya figurent ici dans une énumération qui ne paraît pas encore définitivement systématisée, puisqu’ils y sont associés à des termes de tout autre caractère. Je veux seulement remarquer que ce que je traduis « l’indéterminé » est l’avyakta, autrement dit la prakṛiti considérée en quelque sorte à l’état abstrait, avant que, par la différenciation des êtres, le cosmos ait pris une réalité concrète accessible aux sens. « Éléments » traduit mahâbhûta, « individualité » ahaṇkâra, « intelligence » buddhi, le « sens interne » manas.
La Bhagavad Gîtâ – chapitre 14 :
La
répartition des trois Gunas
BHAGAVAT dit :
1. Je t’enseignerai maintenant la science
suprême, la plus haute des connaissances, par laquelle tous les
ascètes se sont d’ici-bas élevés à la suprême perfection.
2. Ceux qui s’identifient à moi, grâce à
cette connaissance, ne renaissent pas, même au renouvellement du
kalpa, et demeurent sans trouble à l’heure de sa destruction.
3. Le grand Brahman est pour moi la matrice ; j’y
dépose le germe ; de là, ô Bhârata, tous les êtres tirent leur
origine.
4. Les formes qui sortent d’une matrice quelle
qu’elle soit, ô fils de Kuntî, de toutes lé grand Brahman est la
matrice ; j’en suis, moi, le père, celui qui donne la semence.
5. Les trois guṇas dits sattva, rajas et tamas,
ont pour origine la prakṛiti ; ce sont eux, guerrier aux grands
bras, qui tiennent prisonnière dans le corps l’âme impérissable.
6. Le sattva, étant sans tache, est lumière et
Joie ; il enchaîne, ô héros irréprochable, par l’attrait du
plaisir et par l’attrait de la connaissance.
7. Le rajas, sache-le, est passion ; il a pour
origine l’attrait du désir ; c’est par l’attrait de l’action,
ô fils de Kuntî, qu’il enchaîne l’âme.
8. Quant au tamas, né de l’ignorance, il égare
toutes les âmes ; c’est par la négligence, la paresse et le
sommeil qu’il enchaîne, ô Bhârata.
9. Le sattva conduit à la joie, le rajas à
l’action, ô Bhârata ; quant au tamas, il obscurcit la pensée et
jette dans la négligence du devoir.
10. C’est en dominant rajas et tamas que
s’établit le sattva, ô Bhârata, le tamas en dominant rajas et
sattva, et le rajas en dominant sattva et tamas.
11. Quand la lumière, la connaissance pénètre
dans le corps par toutes ses portes, alors on peut être assuré que
le sattva domine.
12. Lorsque grandit le rajas, ô Bhârata, alors
naissent la cupidité, l’activité, l’esprit d’entreprise,
l’inquiétude, le désir.
13. Quand le tamas se développe, ô fils de Kuru,
alors naissent l’obscurité, la paresse, la négligence et
l’erreur.
14. Si la mort survient quand le sattva domine,
l’âme atteint les mondes purs des êtres qui possèdent la science
la plus haute.
15. Si c’est le rajas, elle renaît parmi les
êtres épris d’activité ; si c’est le tamas, parmi les êtres
dénués de raison.
16. D’un acte vertueux le fruit sans tache est
de la nature du sattva ; du rajas le fruit est là souffrance, et
l’ignorance le fruit du tamas.
17. Du sattva naît la connaissance et du rajas la
cupidité ; la négligence et l’erreur, l’ignorance aussi,
viennent du tamas.
18. Ceux qui sont en puissance du sattva tendent à
monter, ceux qui participent de la nature du rajas restent dans les
régions moyennes, les êtres qui sont dans la sphère du dernier des
guṇas, les êtres pénétrés de tamas, vont aux abîmes.
19. Quand ce témoin (qu’est l’esprit) sait
qu’il n’y a pas d’agent en dehors des guṇas et connaît celui
qui est par delà les guṇas, il s’élève jusqu’à mon être.
20. Dans ce corps même, il dépasse les trois
guṇas qui sont l’origine du corps ; affranchi de la naissance et
de la mort, de la vieillesse et de la souffrance, il atteint
l’immortalité.
ARJUNA dit :
21. À quels signes, ô Maître, se reconnaît
celui qui a dépassé les trois guṇas ? Comment se comporte-t-il et
en quelle façon domine-t-il les trois guṇas ?
BHAGAVAT dit :
22. Ni la lumière, ni l’activité, ni l’erreur
ne lui inspirent, présents, de répugnance ni, absents, de désir.
23. Celui qui, parfaitement indifférent, n’est
nullement troublé par les guṇas, qui, se disant : « Ce sont les
guṇas qui seuls sont en cause », se tient tranquille et ne s’agite
pas,
24. Qui, maître de lui, également inaccessible
au plaisir et à la souffrance, ne fait pas de différence entre une
motte de terre, une pierre ou un lingot d’or, qui considère du
même œil le plaisant et le déplaisant, qui est ferme, indifférent
au blâme et à l’éloge,
25. Pour qui estime et mépris sont tout un, qui
est le même pour amis et ennemis, qui a renoncé à toute
entreprise, celui-là a dépassé les guṇas.
26. Et celui qui me sert avec une dévotion sans
défaillance, celui-là, dépassant les guṇas, est mûr pour se
fondre en Brahman.
27. Car c’est moi qui suis le support de Brahman, de l’Immortalité et de l’Impérissable et de l’ordre éternel et du bonheur parfait.
La Bhagavad Gîtâ – chapitre 15 : L’Esprit
suprême
BHAGAVAT dit :
1. On raconte qu’il est un açvattha
impérissable, les racines en haut, les branches en bas, dont les
hymnes du veda sont les feuilles ; celui qui le connaît, celui-là
connaît le veda.
2. Ses branches se développent en hauteur et en
profondeur, poussant sur les guṇas ; ses bourgeons sont les objets
des sens ; par en bas, ses racines se ramifient, liées aux actes,
dans le monde des hommes.
3. On n’en perçoit pas en ce monde la forme, ni
la fin, ni le commencement, ni l’envergure. Il faut, avec l’arme
solide du renoncement, trancher d’abord cet açvattha aux
puissantes racines ;
4. Puis rechercher le lieu d’où l’on ne
revient pas et se réfugier dans le Purusha primitif de qui émane
l’impulsion originelle.
5. Ce lieu impérissable est le lot assuré des
sages libres d’orgueil et d’erreur qui ont triomphé de la
concupiscence et, toujours ramassés sur eux-mêmes, ont fait taire
tous les désirs, qui se sont affranchis également de toutes les
impressions contraires, plaisir ou souffrance.
6. Ce lieu, ni le soleil, ni la lune, ni le feu ne
l’éclairé ; ce lieu d’où il n’est pas de retour, c’est ma
demeure suprême.
7. Une parcelle de moi éternelle, devenue âme vivante dans le monde
des vivants, groupe les six sens — dont le sens interne — qui
procèdent de la prakṛiti.
8. Qu’il prenne possession d’un corps où
qu’il l’abandonne, Îçvara[1] les entraîne avec soi comme
le vent les odeurs d’un brûle-parfums.
9. C’est par l’ouïe, la vue et le toucher, le
goût et l’odorat et grâce au sens interne qu’il perçoit les
objets.
10. Qu’il sorte du corps, ou qu’il y réside,
ou qu’il perçoive dans son enveloppe de guṇas, les esprits
égarés ne le découvrent pas ; il ne se découvre qu’aux yeux de
la connaissance.
1 1. En faisant effort, les yogins aussi le voient
résidant en eux ; mais les hommes dénués de réflexion et de vie
intérieure ne le voient au prix d’aucun effort.
12. La splendeur qui, ramassée dans le soleil,
illumine tout l’univers, celle qui est dans la lune et celle qui
est dans le feu, sache que toute cette splendeur est de moi.
13. C’est moi qui, pénétrant la terre, soutiens par ma force tous
les êtres, moi qui nourris toutes les plantes, étant le soma, la
sève par excellence.
14. Moi qui, étant la chaleur au corps des
vivants, associé au souffle vital[2], assimile les quatre sortes
d’aliments.
15. Je demeure au cœur de tout être ; de moi
procèdent la mémoire, la connaissance, le raisonnement ; c’est
moi seul que tous les vedas ont pour but de faire connaître ; je
suis l’auteur du vedânta et le maître du veda.
16. Il y a deux Purushas en ce monde, le
destructible et l’indestructible : le premier embrasse tous les
êtres ; le second est l’immuable.
17. Mais il est un autre Purusha, le plus haut, qu’on appelle le
suprême âtman, qui, Seigneur impérissable, pénètre et soutient
les trois mondes.
18. Comme je dépasse le destructible et que je
suis supérieur même à l’indestructible, je suis dans le monde et
dans le veda célébré sous le nom de Très-Haut (purushottama)[3].
19. Celui qui, inaccessible à l’erreur, me
connaît ainsi comme Purushottama, celui-là sait tout, ô Bhârata ;
il se voue à moi de tout son être.
20. Ce
que je te révèle là, ô héros sans tache, c’est la doctrine la
plus secrète. Qui la connaît possède vraiment l’intelligence ;
il ne lui reste rien à accomplir.
[1] «
Dieu », c’est-à-dire l’âme universelle intégrée, comme
ordinairement ici, dans un Dieu personnel.
[2] Littéralement
« associé au souffle inspiré et au souffle expiré ».
[3] « Esprit suprême ».
La Bhagavad Gîtâ – chapitre 16 :
Destinées
divines et destinées démoniaques
BHAGAVAT dit :
1. L’intrépidité, la pureté intérieure, la
fermeté à acquérir la science, la libéralité, la maîtrise de
soi, la piété, l’étude, l’austérité, la droiture,
2. La bonté, la véracité, la patience, le
renoncement, le calme, la sincérité, la pitié, le
désintéressement, la tendresse, la pudeur, la tranquillité,
3. La force, l’endurance, la volonté, la
pureté, l’indulgence, la modestie, tels sont, ô fils de Pâṇdu,
les traits de qui est qualifié pour une destinée divine.
4. La fausseté, l’orgueil et l’infatuation,
la colère et la dureté et, aussi, l’ignorance, ô fils de Pṛithâ,
les traits de qui est voué à une destinée démoniaque.
5. La qualification divine mène à la délivrance,
la démoniaque à l’asservissement de la transmigration.
Réjouis-toi, ô fils de Pându, tu es marqué pour une destinée
divine.
6. Il y a dans ce monde deux ordres d’êtres,
les uns divins, les autres démoniaques. Je viens de te décrire le
premier ; écoute, ô fils de Pṛithâ, ce qui caractérise le
second.
7. Les hommes de complexion démoniaque ne savent
ni agir ni s’abstenir de l’action ; en eux ni pureté, ni
conscience, ni véracité.
8. Pour eux, cet univers est sans loi, sans
fondement, sans dieu ; il n’est pas produit par une série de
causes enchaînées mais résulte uniquement du désir.
9. Partant de cette erreur, ces êtres à l’esprit
faible, funestes à eux-mêmes, naissent, malfaisants et pernicieux,
pour le malheur de l’univers.
10. Dominés par l’insatiable désir, pleins de
fausseté, d’orgueil et de folie, se forgeant, dans leur égarement,
des idées mauvaises, ils vivent adonnés à des pratiques impures.
11. Absorbés par une inquiétude incessante qui
ne finit qu’avec leur vie, uniquement tendus vers les jouissances
du plaisir, ils se tiennent assurés qu’il n’est rien au delà.
12. Enchaînés par les mille liens de
l’espérance, livrés au désir et à la colère, pour satisfaire
leurs appétits, ils cherchent à s’enrichir, fût-ce par des
moyens coupables.
13. J’ai acquis ceci aujourd’hui ; je pourrai
satisfaire, tel désir ; ceci est à moi ; tel autre bien encore va
m’échoir ;
14. J’ai frappé tel de mes ennemis ; à leur
tour, je vais frapper les autres ; je suis le maître, je jouis, je
réussis, je suis fort, je suis heureux ;
15. Je suis riche, je suis bien né ; quel autre
est mon égal ? Je sacrifierai, je ferai des largesses, je vivrai
dans la joie… Ainsi pensent les hommes égarés par l’ignorance.
16. Trompés par leurs illusions, pris au filet de
l’erreur, attachés aux jouissances du plaisir, ils tombent dans
l’enfer impur.
17. Pleins de soi, arrogants, animés de l’orgueil
et de la folie de la richesse, ils offrent des sacrifices qui ne sont
que formules vaines, œuvres d’ostentation que ne règle pas une
exacte piété.
18. Voués à l’égoïsme, à la violence, à la
vanité, au désir et à la colère, envieux et me poursuivant de
leur haine en eux et dans les autres,
19. Ces êtres haineux, cruels, partout les
derniers des hommes, ces êtres impurs, je les rejette indéfiniment
dans des naissances démoniaques.
20. Condamnés de naissance en naissance à une
destinée démoniaque, ces insensés, ô fils de Kuntî, loin de
m’atteindre, tombent au dernier échelon de la vie.
21. Triple est cette porte de l’enfer si funeste
à l’âme : désir, colère, cupidité ; que l’homme donc évite
ces trois périls.
22. Libéré, ô fils de Kuntî, de ces trois
portes de ténèbres, l’homme marche dans les voies du salut ; il
atteint le but suprême.
23. Celui qui, rejetant les prescriptions de
l’enseignement, ne connaît de règle que le désir, celui-là
n’atteint pas la perfection ni le bonheur ni le séjour suprême.
24. Que l’enseignement soit donc ta règle pour établir ce qu’il faut faire, ce qu’il faut éviter ; connais et ne manque pas de pratiquer ici-bas ce que prescrit l’enseignement.
La Bhagavad Gîtâ – chapitre 17 :
La triple Foi
ARJUNA dit :
1. Ceux qui, tout en se dérobant aux préceptes
de l’enseignement, sacrifient avec foi, sur quel terrain sont-ils,
sattva, rajas ou tamas ?
BHAGAVAT dit :
2. La foi est, dans les âmes, de trois sortes ;
expression en chacune de sa nature propre, elle se colore de sattva,
de rajas et de tamas. Écoute !
3. La foi de chacun est, ô Bhârata, conforme à
son être intime ; c’est sa foi qui fait l’homme ; telle sa foi,
tel il est lui-même.
4. Les êtres de sattva sacrifient aux dieux, les
êtres de rajas aux Yakshas et aux Rakshas ; les autres, les hommes
de tamas, sacrifient aux morts et aux spectres.
5. Les hommes qui se soumettent à des austérités,
excessives que l’enseignement ne prescrit pas, hypocrites et
égoïstes, pleins de violence, de passion et de désir,
6. Molestant sans mesure les éléments groupés
dans leur corps et moi-même qui y fais ma demeure, ceux-là,
sache-le, obéissent à une inspiration démoniaque.
7. La nourriture préférée de chacun est
également de trois sortes, et aussi le sacrifice, l’ascèse et
l’aumône ; écoute les différences.
8. Aux êtres de sattva, les aliments qui
développent la vie, la solidité, la force, la santé, le bien-être,
la joie, aliments savoureux, onctueux, fortifiants, agréables.
9. Les aliments amers, acides, salés, trop
chauds, piquants, grossiers et brûlants sont ceux que préfèrent
les êtres de rajas ; ils causent déplaisir, souffrance et maladie.
10. Ce qui est passé, qui a perdu toute saveur,
qui est pourri, corrompu, voire des restes impurs, telle est la
nourriture qui plaît aux êtres de tamas.
11. Le sacrifice procède du sattva, qui est
pratiqué conformément aux rites par des hommes qui ne poursuivent
aucun fruit, qu’inspire uniquement la pensée que sacrifier est un
devoir.
12. Au contraire, c’est du rajas, ô le meilleur
des Bhâratas, que procède le sacrifice offert en vue du fruit qu’on
s’en promet ou bien encore par ostentation.
13. Du tamas procède le sacrifice qui s’écarte
des rites, où manquent les offrandes ou les prières, que
n’accompagne pas le don du aux prêtres, que n’inspire pas une
foi sincère.
14. Culte des dieux, des brâhmanes, des maîtres
et des sages, pureté, droiture, chasteté et respect de la vie,
voilà ce qu’on appelle l’ascèse d’action ;
15. Un langage qui ne blesse jamais, vrai,
agréable et utile et la récitation du veda, c’est l’ascèse de
parole ;
16. Le calme de l’esprit, la bonté, le silence,
la maîtrise de soi, la pureté intérieure, constituent l’ascèse
de pensée.
17. Pratiquée avec une foi parfaite par des
hommes appliqués au yoga et insensibles à tout calcul de
récompense, cette triple ascèse procède du sattva.
18. Quant à l’ascèse qui recherche
hypocritement l’admiration, les respects et la vénération de la
foule, fragile et instable, elle participe du rajas.
19. L’ascèse, inspirée de folles illusions,
que l’on pratique en se torturant soi-même ou en vue de procurer
la perte d’autrui, celle-là procède du tamas.
20. L’aumône uniquement dictée par le précepte
de charité, qui s’adresse à qui ne l’a pas prévenue par des
bienfaits antérieurs, et qui, faite en lieu et en temps convenables,
va à qui en est digne, cette aumône est de la nature du sattva.
21. Mais celle qu’inspire l’espoir de la
récompense ou d’une contre-partie de bienfaits, cette aumône,
souillée dans sa source, est de la nature du rajas.
22. L’aumône qui n’est faite ni en lieu ni en
temps convenables, ni à des gens qui en soient dignes ; qui s’exerce
d’une façon blessante et méprisante, de celle-là, on dit qu’elle
procède du tamas.
23. On enseigne que la formule oṃ, tat, sat sert
à désigner Brahman ; c’est par ces trois mots qu’ont, au
commencement, été institués les brâhmanes, les vedas et les
sacrifices.
24. C’est pourquoi tous les exercices prescrits, sacrifices,
aumônes, pénitences » sont toujours, chez les maîtres du Brahman,
précédés de la syllabe oṃ.
25. C’est en pensant à tat, que les hommes qui
cherchent la délivrance accomplissent, sans se préoccuper de leurs
fruits, toutes les pratiques du sacrifice, de l’ascèse ou de la
charité[1].
26. On emploie sat pour dire ce qui est et ce qui
est bien ; ainsi, le mot sat, ô fils de Pṛithâ, s’applique à
toute action louable.
27. La pratique fidèle du sacrifice, de la
pénitence et de l’aumône est sat, et l’on proclame sat tout
acte qui s’y rapporte.
28.
Toute offrande, toute aumône, toute pénitence, tout acte accompli
sans la foi, ô fils de Pṛithâ, est dit asat, et n’est, en
effet, réellement pas, ni ici-bas ni dans l’au-delà.
[1] Tat, « cela » sert dans la spéculation védantique à désigner l’être universel, la seule réalité objective.
La Bhagavad Gîtâ – chapitre 18 : Renoncement
et Délivrance
ARJUNA dit :
1. Je voudrais, ô héros aux grands bras,
connaître la nature du détachement et du renoncement, ô
Hṛishîkeça, ô vainqueur de Keçin, et ce qui les distingue.
BHAGAVAT dit :
2. S’abstenir des actes qu’inspire le désir,
voilà ce que les maîtres entendent par détachement ; renoncer à
tout fruit des actes, c’est ce que les hommes éclairés appellent
renoncement.
3. Suivant certains sages, tout acte implique
faute, et il faut renoncer à tous ; d’autres estiment qu’il ne
faut pas renoncer aux pratiques du sacrifice, de l’aumône, ni de
la pénitence.
4. Écoute donc ce que j’enseigne sur le
renoncement, ô le meilleur des Bhâratas. Du renoncement, ô Tigre
des hommes, on distingue trois sortes.
5. Il ne faut pas renoncer aux pratiques du
sacrifice, de l’aumône et de la pénitence ; il faut les
accomplir. Le sacrifice, l’aumône et la pénitence sont pour les
sages des moyens de sanctification.
6. Mais ces pratiques mêmes, il faut les
accomplir sans s’y attacher, ni à leurs fruits ; voilà, ô fils
de Pṛithâ, quelle est ma formelle et suprême doctrine.
7. Il ne convient pas de s’affranchir d’un
acte prescrit ; y renoncer, c’est s’égarer, c’est être sous
l’empire du tamas.
8. Si quelqu’un, par crainte de la souffrance
physique, se dérobe à quelque acte, le jugeant pénible, il agit
sous l’empire du rajas ; il ne saurait cueillir le fruit du
renoncement.
9. Accomplis l’acte prescrit, ô Arjuna, par la
seule raison qu’il doit être accompli, sans attachement, sans
égard pour ses fruits ; c’est là le renoncement qui relève du
sattva.
10. L’homme qui pratique vraiment le
renoncement, l’homme pénétré de sattva, affranchi du doute,
n’éprouvé pas plus de répulsion pour un acte pénible que
d’attrait pour un acte agréable.
11. Quant à renoncer complètement à tous les
actes, l’âme, liée au corps, ne le peut pas ; c’est celui qui
renonce aux fruits des actes qui vraiment pratique le renoncement.
12. Le fruit des actes est de trois sortes :
désagréable, agréable, mélangé ; il est le partage, après cette
vie, de ceux qui n’ont pas pratiqué le renoncement ; jamais de
ceux qui ont vécu détachés.
13. Apprends de moi, ô guerrier aux grands bras,
les cinq facteurs que la réflexion révèle dans l’accomplissement
de tous les actes,
14. Le sujet, l’agent et les organes divers, les
différents modes d’activité et enfin, en cinquième, le destin.
15. Quoi que, en acte, en parole ou en pensée,
l’homme entreprenne de bien ou de mal, toujours apparaissent les
cinq facteurs.
16. Les choses étant ainsi, celui qui est assez
irréfléchi pour penser que l’âme en est l’agent indépendant,
celui-là voit mal, il se trompe.
17. Celui que n’égare pas l’égoïsme, dont
l’intelligence n’est pas troublée, tuât-il toutes les
créatures, ne tue pas, il ne se charge d’aucune chaîne.
18. La connaissance, l’objet à connaître et le
sujet qui connaît sont les trois éléments qui préparent l’action
; l’organe, l’acte, l’agent, les trois éléments qui
embrassent l’acte lui-même.
19. La connaissance, l’acte et l’agent sont de
trois sortes selon le guṇa qui y domine. C’est ce qu’enseigne
la théorie des guṇas ; écoutes-en le détail fidèle.
20. La doctrine qui reconnaît dans tous les êtres
une essence unique, impérissable, indivisible, quoique répandue
dans des objets séparés, sache que cette doctrine procède du
sattva.
21. Mais la doctrine qui, égarée par la
multiplicité des objets, admet dans tous les êtres des entités
diverses et distinctes, dérive, celle-là, du rajas.
22. Quant à cette doctrine superficielle et
bornée qui, sans remonter aux causes, s’attache à un objet
particulier comme s’il était tout, celle-là procède du tamas.
23. L’acte prescrit que ne suggère aucun
attrait, qui s’accomplit en dehors de toute passion, de toute
haine, et sans préoccupation de ses fruits, cet acte procède du
sattva.
24. Mais l’acte qu’on accomplit avec effort,
sous l’empire du désir ou d’une pensée égoïste, cet acte est
de la nature du rajas.
25. L’acte est dit procéder du tamas que l’on
entreprend à l’aveuglette, sans mesurer sa force, sans se
préoccuper des suites, des pertes qu’il entraînera en biens ou en
vies.
26. L’agent procède du sattva qui est affranchi
de tout attachement, ne se préoccupe pas de soi, est capable de
volonté et d’énergie, ne se soucie ni du succès ni de
l’insuccès.
27. Celui qui est passionné, préoccupé du fruit
de l’acte, cupide, violent, impur, impressionnable à la joie et à
la souffrance, un pareil agent relève du rajas.
28. L’agent léger, d’instincts bas, arrogant,
fourbe, malhonnête, paresseux, découragé et lent, celui-là
procède du tamas.
29. Écoute, ô Dhanañjaya, complète et
détaillée, la triple distinction, d’après les guṇas, de
l’intelligence et de la volonté.
30. L’intelligence qui connaît quand il faut
agir ou non, ce qu’il faut faire et éviter, ce qu’il faut
craindre ou ne pas craindre, ce qui lie et ce qui délivre, cette
intelligence, ô fils de Pṛithâ, participe du sattva.
31. L’intelligence qui ne discerne pas avec
exactitude ce qui est permis ou interdit, ce qu’il faut faire ou
éviter, cette intelligence, ô fils de Pṛithâ, procède du rajas.
32. L’intelligence enveloppée de ténèbres qui
prend le mal pour le bien, et partout le vrai pour le faux, cette
intelligence, ô fils de Pṛithâ, est de la nature du tamas.
33. La volonté qui, d’un effort sans
défaillance, soutient l’activité de l’esprit, de la vie et des
sens, cette volonté, ô fils de Pṛithâ, est de la nature du
sattva.
34. La volonté, ô Arjuna, qui obéissant, faute
de renoncement, au désir des fruits, poursuit le bien, l’agréable
et l’utile, est, elle, ô fils de Pṛithâ, de la nature du rajas.
35. Celle de l’insensé qui ne se libère pas du
sommeil, de la crainte, de la tristesse, de l’indolence, de
l’enivrement, cette volonté, ô fils de Pṛithâ, relève du
tamas.
36. Et maintenant, apprends de moi, ô le meilleur
des Bhâratas, comment le bonheur est de trois sortes : celui qui
grandit en durant et qui met définitivement un terme à la
souffrance,
37. Qui, au commencement, semble amer comme un
poison et, finalement, a la douceur de l’ambroisie, ce bonheur né
de la paix que procure la connaissance de soi est lié au sattva.
38. Le bonheur que procure la satisfaction des
sens, qui, d’abord, a la douceur de l’ambroisie, et, finalement,
l’amertume du poison, ce bonheur procède du rajas.
39. Le bonheur qui, du commencement à la fin,
n’est qu’égarement de l’âme, que l’on cherche dans le
sommeil, la paresse, l’indolence, ce bonheur-là est de la nature
du tamas.
40. Il n’est, ni sur terre ni au ciel, parmi les
dieux, rien qui soit affranchi de ces trois guṇas qui naissent de
la Prakṛiti.
41. Entre Brâhmanes, Kshatriyas, Vaiçyas et
Çûdras, les devoirs, ô héros terrible, sont répartis d’après
les guṇas qui déterminent leur nature aux uns et aux autres.
42. Le calme, la maîtrise de soi, l’ascèse, la
pureté, la patience et la droiture, la connaissance, l’intelligence
et la foi sont affaire au brâhmane et fondés dans sa nature.
43. La vaillance, la force, la constance,
l’adresse et dans le combat le courage qui ne connaît pas la
fuite, la libéralité, l’exercice du pouvoir sont le devoir du
kshatriya conforme à sa nature.
44. Le labourage, le soin des troupeaux et le
négoce sont la tâche que sa nature assigne au vaiçya ; quant au
çûdra, sa destination naturelle est de servir.
45. C’est en s’attachant chacun à sa tâche
propre que les hommes atteignent la perfection. Écoute comment.
46. C’est en honorant par l’activité qui lui
est dévolue l’être d’où vient l’impulsion de la vie et par
lequel tout cet univers a été déployé, que l’homme trouve la
perfection.
47. Mieux vaut accomplir, fût-ce médiocrement,
son devoir propre qu’assumer, même pour l’accomplir en
perfection, la tâche qui appartient à un autre. On ne contracte
aucune tache à remplir le devoir que sa nature assigne à chacun.
48. Il ne faut pas, ô fils de Kuntî, se dérober
à l’acte, même s’il apparaît coupable, qu’impose à chacun
sa naissance ; car, comme le feu se mêle de fumée, toute activité
se mêle d’imperfection.
49. L’esprit libre de tout attrait, maître de
soi, affranchi de tout désir, s’élève par le détachement à la
perfection suprême qu’est la suppression de l’acte.
50. Apprends de moi, ô fils de Kuntî, comment,
atteignant la perfection, on atteint du même coup Brahman, ce qui
est le sommet suprême de la connaissance.
51. Celui dont l’intelligence est éclairée,
qui se maîtrise par une volonté ferme, qui est détaché des sons
et des autres objets des sens, qui déracine en soi la passion et la
haine,
52. Qui pratique la solitude, mange légèrement,
qui en tout, pensées, paroles et actions, se domine, qui, uniquement
appliqué à la contemplation, se recueille dans une invariable
impassibilité,
53. Qui, s’affranchissant de l’égoïsme, de
la violence, de l’orgueil, du désir, de la colère, de la
richesse, supérieur à tout calcul personnel, atteint au calme,
celui-là est mûr pour se fondre en Brahman.
54. Identifié à Brahman, l’âme sereine, il ne
connaît ni la tristesse, ni le désir ; voyant tous les êtres du
même œil, il se voue à moi d’une dévotion suprême.
55. Grâce à cette dévotion, il méconnaît ; il
sait quel et combien grand je suis en vérité ; dès qu’il me
connaît tel que je suis, aussitôt il entre en moi.
56. Quelques actions encore qu’il accomplisse
jamais, après qu’il a pris en moi son refuge, il atteint, par ma
faveur, la demeure éternelle ; impérissable.
57. Ne voyant que moi, rapportant à moi en pensée
toutes tes actions, tendant l’effort de ton intelligence, demeure
toujours l’esprit plein de moi.
58. L’esprit plein de moi, par ma faveur, tu
franchiras tous les obstacles ; mais si, par infatuation égoïste,
tu ne m’écoutes pas, tu es perdu.
59. Quand, esclave de ta pensée propre, tu
refuses de combattre, ta résolution est vaine ; ta nature intime
l’emportera.
60. Lié, ô fils de Kuntî, par ta tâche innée,
ce que, dans ton erreur, tu te refuses à faire, tu le feras, fût-ce
contre ton gré.
61. Dieu, ô Arjuna, réside au cœur de tous les
êtres, les mettant en mouvement par sa puissance, comme s’ils
étaient des ressorts en sa main.
62. Prends en lui ton refuge, ô Bhârata, de tout
ton être ; par sa faveur, tu atteindras la paix suprême, la demeure
éternelle.
63. Je t’ai fait connaître la vérité, le
mystère des mystères ; médite à fond mes enseignements, puis,
agis comme il te plaira.
64. Encore une fois, écoute ma suprême parole,
de toutes la plus mystérieuse… Tu m’es profonddément cher ;
c’est pourquoi je veux te parler pour ton bien.
65. Que ton esprit s’attache à moi, que ta
dévotion soit pour moi, pour moi tes sacrifices, à moi tes
adorations, et c’est à moi que tu viendras ; je te le promets en
vérité ; car tu m’es cher.
66. Laisse-là toutes les règles et accours à
moi comme à ton seul refuge ; je t’affranchirai de tous les maux,
ne t’inquiète pas.
67. Cette parole tu ne la dois jamais communiquer
à qui ne pratique pas l’ascèse ni la dévotion, à qui n’est
pas disposé à obéir, à qui me dénigre.
68. Mais celui qui répandra ce mystère suprême
parmi mes fidèles, ayant pratiqué envers moi la dévotion parfaite,
entrera assurément en moi.
69. Nul parmi les hommes ne fera œuvre qui me
soit plus agréable, nul ici-bas ne me sera plus cher.
70. Et celui qui se pénétrera de cette
conversation sainte échangée entre nous, je considérerai qu’il
m’a offert le sacrifice en esprit.
71. Et l’homme qui l’aura seulement écoutée
avec foi et componction, affranchi, lui aussi, atteindra les mondes
heureux réservés aux hommes de bien.
72. As-tu, ô fils de Pṛithâ, recueilli mes
paroles d’un esprit tout à fait attentif ? En est-ce fait, ô
Dhanañjaya, des erreurs de ton ignorance ?
ARJUNA dit :
73. C’en est fait de mon erreur ; grâce à toi,
ô Ačyuta, j’ai retrouvé l’esprit, me voici ferme, affranchi du
doute ; j’exécuterai ton ordre.
SAÑJAYA dit :
74. Tel j’ai entendu ce dialogue de Vâsudeva et
de l’illustre fils de Pṛithâ, dialogue merveilleux qui fait
frissonner d’admiration.
75. Grâce à Vyâsa, j’ai recueilli ce mystère
suprême, le yoga, de la bouche de Kṛishṇa, le maître du yoga
enseignant directement en personne.
76. Ô roi, chaque fois que je pense à ce pur, à
ce merveilleux dialogue de Keçava et d’Arjuna, j’éprouve une
joie toujours nouvelle.
77. Et chaque fois que je repense à cette vision
merveilleuse de Hari, une stupeur m’étreint et j’éprouve une
joie toujours nouvelle.
78. Où est Kṛishṇa, le dieu du yoga, où l’archer fils de Pṛithâ, là sont fixées à, toujours la fortune, la victoire, la prospérité. Telle est ma foi.
>Sommaire du dossier