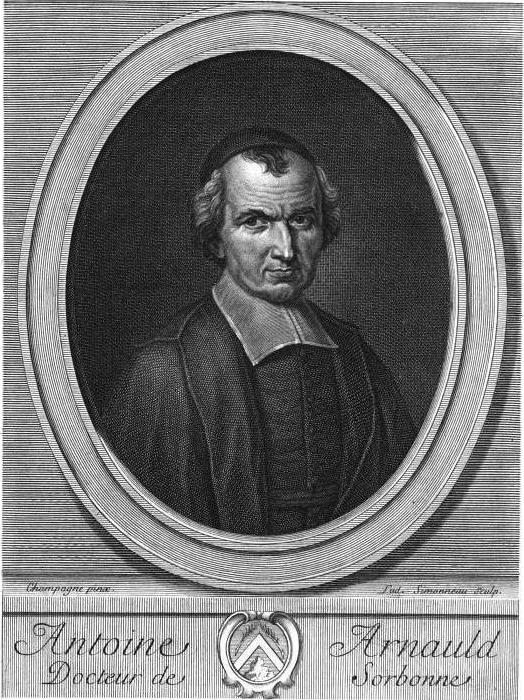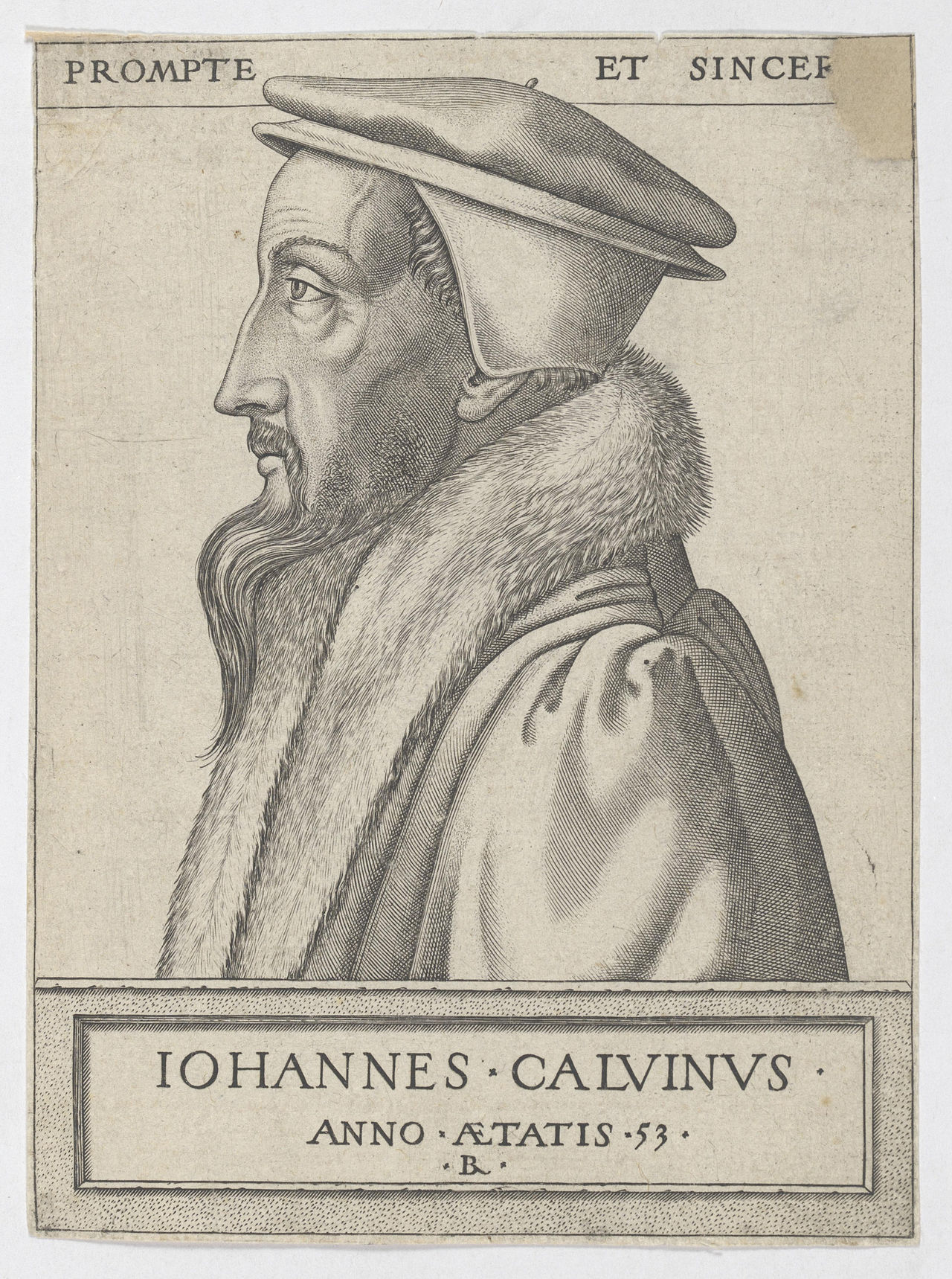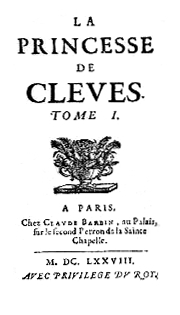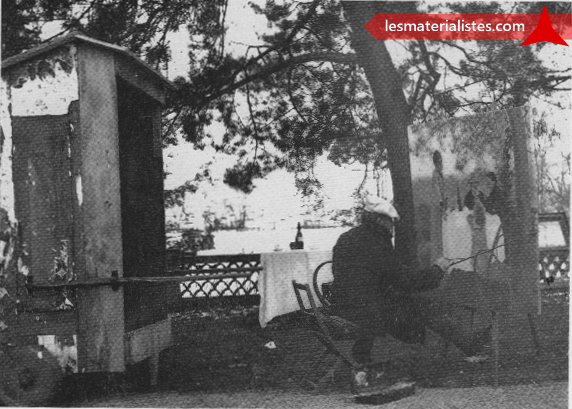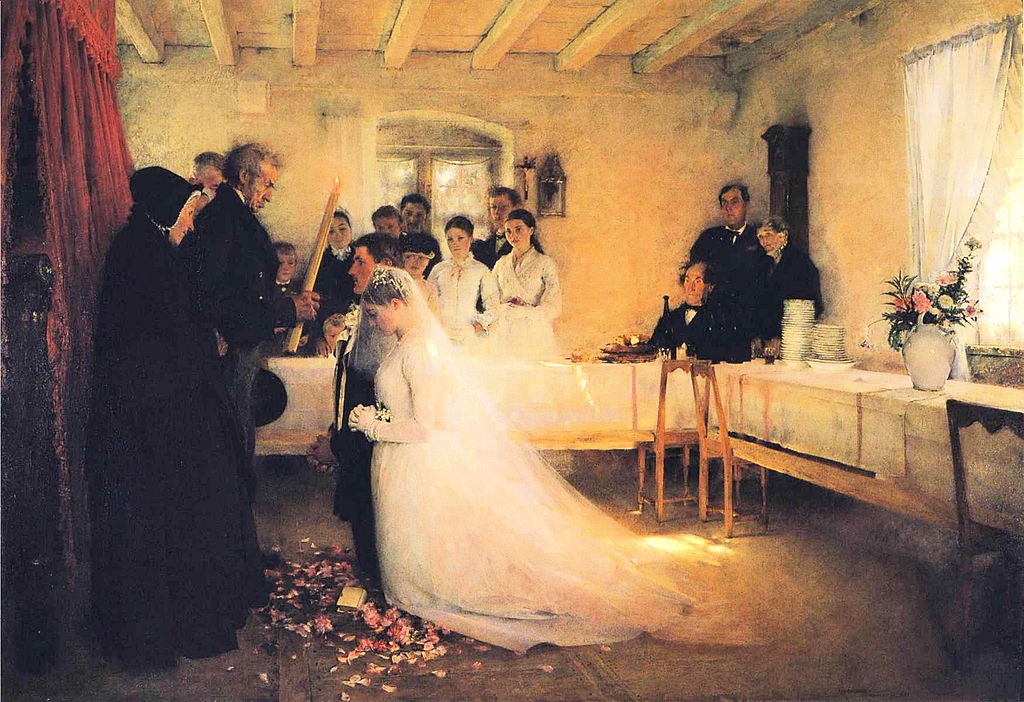Acte III
Scène I
Scène I
LEON, ROGER
LEON
Si par vostre valeur qui n’a point de pareille,
Bradamante j’acquiers, du monde la merveille,
Que j’en recevray d’aise, et que j’auray d’honneur!
O que je vous seray tenu d’un si grand heur!
ROGER
Ah! quel malheur me suit! mechante destinee!
LEON
Mon ame à la servir est si fort obstinee,
A l’aimer, l’adorer, qu’en moy plus je ne vy;
Je ne vy qu’en ses yeux, que jamais je ne vey.
Une heure m’est un siecle, un jour mille ans me dure,
Que je ne suis l’object de si belle figure.
ROGER
Hélas pauvre Roger, qu’extreme est ton malheur!
LEON
Que n’est à mon amour égale ma valeur,
Pour meriter sa grace! ô Nature fautiere,
Indigne tu m’as fait de cette âme emperiere!
Je ne me suis pas bon, je connois mon defaut;
De la main d’un plus digne accommoder me faut.
Pourquoy me connoissant me suis-je laissé prendre
Aux rets d’une beauté que je ne puis pretendre?
Amour est bien aveugle, aveugle il est vrayment,
De nous contraindre aimer si dissemblablement.
Las! frere, c’est de vous qu’elle deust estre dame.
ROGER
Hà propos douloureux qui me torturent l’ame!
Ma force s’affoiblist; frissonner je me voy;
Mon sang et sens se trouble et ne suis plus à moy.
LEON
Quoy? vous sentez-vous mal? la couleur vous abaisse.
ROGER
Vos langoureux discours me plongent en tristesse.
LEON
Ha là mon bon ami, c’est de franche amitié
Que vous avez ainsi de mes tourmens pitié.
Prenons bon coeur tous deux, car aujourdhuy j’espere
Recevoir beaucoup d’heur.
ROGER
Moy beaucoup de misere.
LEON
Je seray de ma Dame aujourdhuy le vaincueur,
Et tenu d’un chacun pour brave belliqueur
Par vostre vaillantise: or’ qu’il soit deshonneste
De se vouloir parer d’une faulse conqueste.
ROGER
Ma vie est toute vostre; elle fust aux enfers
Si, prompt, vous ne m’eussiez tiré d’entre les fers.
Quand au fond d’une tour vostre tante inhumaine
Me détint pour souffrir une cruelle peine,
Vostre âme pitoyable eslargir me voulut.
Vous me fustes alors ma vie et mon salut.
Faites-en vostre propre; elle vous est acquise.
Ne craignez le hasard d’une dure entreprise:
Pour vous je graviray sur les rochers moussus,
Et plongeray mon chef dedans les flots bossus;
J’iray nu de poitrine à travers mille picques,
A travers les Lyons et les Ourses Libyques.
Je ne vy que pour vous, et desja m’est à tard
Que je n’entre pour vous en quelque bon hasard.
J’iray quand vous plaira sous vos armes combatre
La guerriere beauté que vostre ame idolatre.
LEON
Mon frere, ô que le jour bien-heureux m’eclaira,
Quand des seps outrageux ma main vous retira.
Nulle chose m’esmeut à ce plaisir vous faire,
Sinon vostre vertu, qui nous estoit contraire.
C’est un estrange cas, le dommage que fist
Vostre extrême valeur, quand elle nous desfist,
M’engrava dedans l’ame une amitié soudaine,
Au lieu de vous porter une implacable haine.
Mais vrayment vostre coeur en est bien desgagé.
Je vous suis maintenant beaucoup plus obligé.
Par vous j’auray le bien qui d’amour me consomme.
ROGER
Et moy le plus grief mal que jamais souffrit homme.
LEON
Je vay voir l’Empereur.
ROGER
Le coeur au sein me bat.
LEON
Pour entendre le temps et le lieu du combat:
Demeurez en la tente.
ROGER
Allez à la bonne heure.
LEON
Je reviendray bien tost.
ROGER
Faites peu de demeure.
Astres qui conduisez la torche de nos jours,
Tournants sous le mouvoir de vos célestes cours
Abregez ma detresse, accourcissant ma vie,
Trop long temps jusqu’ici des malheurs poursuivie.
L’espoir ne flate plus ma douteuse raison.
Je n’ay plus qu’esperer, je suis sans guarison.
Quel estrange destin! ô ciel, je vous appelle,
Soyez tesmoing, ô ciel, de ma peine cruelle:
Il me fault despouiller moymesme de mon bien,
Delivrer à un autre un amour qui est mien,
En douer mon contraire, et l’emplir de liesse,
M’enfiellant l’estomach d’une amere tristesse.
O des pauvres mortels avantureux desseins!
O attente trompeuse! ô longs voyages vains!
O nuisible entreprise! helas! pour me desfaire
Des brigues de Leon, mon rival adversaire
Que j’avois en horreur, je fus n’aguère expres
Jusqu’aux murs de Belgrade ou campageoyent les Grecs,
Pour rompre son armee, en combatant l’occire
Avec son père Auguste, et conquester l’Empire.
Mais quoy? de ce haineur l’amitié me sauva.
Celuy que j’offensois à mon bien se trouva.
Je le cherchois à mort, il me donna la vie.
J’estois jaloux de luy, je luy livre m’amie.
L’eussé-je refusé, d’un tel bien-faict ingrat,
Me priant d’esprouver Bradamante au combat?
M’en fussé-je excusé? luy fussé-je allé dire
Que j’avois nom Roger, que j’allois pour l’occire?
Hélas! non. Mais quoy donc? Las! je ne sçay; je suis
En une mer de maux, en un gouffre d’ennuis.
Scène II
BRADAMANTE
Et quoy? Roger, tousjours languiray-je de peine?
Sera tousjours, Roger, mon esperance vaine?
Où estes-vous, mon coeur? quelle terre vous tient,
Quelle mer, quel rivage ha ce qui m’appartient?
Entendez mes soupirs, Roger, oyez mes plaintes;
Voyez mes yeux lavez en tant de larmes saintes,
O Roger, mon Roger, vous me cachez le jour,
Quand vostre oeil, mon soleil, ne luist en ceste Cour.
Comme un rosier privé de ses roses vermeilles,
Un pré de sa verdure, un taillis de ses fueilles,
Un ruisseau de son onde, un champ de ses épis,
Telle je suis sans vous, telle et encore pis.
Quelque nouvelle amour (ce que Dieu ne permette)
Vous eschauferoit point d’une flamme secrette?
Quelque face angelique auroit point engravé
Ses traits dans vostre coeur de ses yeux esclavé?
Hé, Dieu! que sçay-je? hélas! si d’Aymon la rudesse
Vous a desesperé de m’avoir pour maistresse,
Que pour vous arracher cet amour ennuyeux
Vous soyez pour jamais esloigné de mes yeux!
Vous ne l’avez pas fait, vostre ame est trop constante;
Vous ne sçauriez aimer autre que Bradamante.
Retournez donc, mon coeur, las! revenez à moy,
Je ne sçaurois durer si vos yeux je ne voy.
Je ressemble à celuy qui, de son or avare,
Ne l’esloigne de peur qu’un larron s’en empare,
Toujours le voudroit voir, l’avoir à son costé,
Craignant incessamment qu’il ne luy soit osté.
Retournez donc, mon coeur, ostez-moy cette crainte:
Las vostre seule absence est cause de ma plainte!
Comme, quand le Soleil cache au soir sa clairté,
Vient la palle frayeur avec l’obscurité,
Mais si tost qu’apparoist sa rayonnante face,
La nuit sombre nous laisse, et la crainte se passe;
Ainsi sans mon Roger je suis tousjours en peur,
Mais quand il est présent, elle sort de mon coeur.
Comme durant l’Hyver, quand le Soleil s’absente,
Que nos jours sont plus courts, sa torche moins ardente,
Viennent les Aquilons dans le ciel tempester,
On voit sur les rochers les neiges s’afester,
Les glaces et frimas rendre la terre dure,
Le bois rester sans feuille, et le pré sans verdure:
Ainsi quand vous, Roger, vous absentez de moy,
Je suis en un hyver de tristesse et d’esmoy.
Retournez donc, Roger, revenez ma lumiere,
Las! et me ramenez la saison printaniere.
Tout me desplaist sans vous, le jour m’est une nuit;
Tout plaisir m’abandonne, et tout chagrin me suit:
Je vis impatiente, et si guere demeure
Vostre oeil à me revoir, il faudra que je meure,
Que je meure d’angoisse, et qu’au lieu du flambeau
De nostre heureux Hymen, vous trouvez mon tombeau.
Scène III
LEON, CHARLEMAGNE
LEON
Sire, ce m’est grand heur qu’au theatre du monde,
Ici, dans vostre France, en Chevaliers feconde
Et feconde en vertus, vos yeux j’aye ce jour
Tesmoins de ma prouesse, et de ma ferme amour,
Et que vostre bonté pour fruit de ma victoire
Me face recevoir du bien et de la gloire.
Bradamante est mon ame, et ne crains de mourir,
Si mourir me convient en voulant l’acquerir.
Mais j’espere (et le ciel ceste faveur me face)
Qu’avecques de l’honneur je conquerray sa grace.
Quoy que soit, je luy veux ma vie avanturer,
Et l’avoir pour maistresse ou la mort endurer.
Je pry’ vostre bonté que promesse on me tienne,
Et qu’ayant la victoire elle demeure mienne.
Vous n’auriez point d’honneur qu’on me vint décevoir
Et qu’on m’ostast, vainqueur, ce que je deusse avoir.
CHARLEMAGNE
N’ayez doute, mon fils; n’ayez point cette crainte.
Ma parole est toujours inviolable et sainte.
Si Bradamante en force au combat vous passez,
Vos pas ne seront point ingratement tracez.
Vous l’aurez pour espouse avec la gloire acquise
D’avoir fait preuve icy de vostre vaillantise.
Allez à la bonne heure et ne vous espargnez.
Montrez-vous digne d’elle et son amour gaignez.
La lice est toute preste, allez en vostre tente
Endosser le harnois, j’apperçoy Bradamante.
Scène IV
BRADAMANTE, HIPPALQUE, CHARLEMAGNE
BRADAMANTE
Hippalque, mon amour, que feray-je? tu vois
Que j’aime un arrogant qui est sourd à ma vois,
Qui se rit des langueurs dont sa beauté me lime,
Qui n’a que sa valeur et sa force en estime.
Las pauvrette!
CHARLEMAGNE
Ma fille, il vous faut apprester.
Leon veut par le fer vostre amour conquester.
Il s’offre à la bataille avecques la cuirace,
Le brassart, le bouclier, l’armet, la coutelace.
Il ne tardera guère; allez, dépeschez-vous:
Je désire beaucoup que l’ayez pour espoux.
BRADAMANTE
Sire, par vostre loy je ne seray tenue
De prendre aucun mary qui ne m’aura vaincue.
CHARLEMAGNE
Je ne l’entens qu’ainsi, telle est ma volonté.
BRADAMANTE
J’espere qu’il sera de ma main surmonté.
HIPPALQUE
Il n’est venu si loin de la mer Thracienne
Sans avoir balancé vostre force à la sienne.
BRADAMANTE
Ce debile Gregeois, ce jeune effeminé?
HIPPALQUE
Voyez combien il est à combatre obstiné.
BRADAMANTE
Il se pense assez fort pour vaincre une pucelle.
HIPPALQUE
Pucelle qui a peu d’hommes pareils à elle.
BRADAMANTE
Il a sous cest espoir son voyage entrepris.
HIPPALQUE
S’il n’a point d’autre attente, il n’aura pas le prix.
BRADAMANTE
Plutost palle à ses pieds je resteray sans ame,
Qu’autre que mon Roger m’ait jamais pour sa femme.
Est l’empire Gregeois de beautez despourveu?
Pourquoy me poursuit-il? je ne l’ay jamais veu.
Veut-il avoir de force en son lict une amie?
Ne sçait-il pas assez que Roger est ma vie,
Que je n’aime que luy? Pourquoy vient-il tenter
Le desir de mon père, et ses sceptres vanter?
Ce n’est rien de grandeurs, de royaumes, d’empires,
De havres et de ports, de flottes, de navires,
Si l’amour nous bourrelle. Et vaudroit mieux cent fois
Mener paistre, bergere, un troupeau par les bois,
Contente en son amour, qu’Emperière du monde
Regir sans son amy toute la terre ronde.
HIPPALQUE
Mais pensons à combatre. Il est temps d’aviser
De vestir le harnois et l’espee aiguiser,
Puis que Leon est prest, que la lice est ouverte,
Et la place de peuple autour du champ couverte.
BRADAMANTE
Je seray tost armee, et preste de ranger
Avec le fer luisant ce fascheux estranger.
Scène V
ROGER, sous les armes de Leon
O Dieu! jusques à quand ardra sur moy ton ire?
Jusqu’à quand languiray-je en ce cruel martyre?
Jusqu’à quand ma pauvre ame habitera ce corps?
Quand seray-je insensible en la plaine des morts?
Qui suis-je? où suis-je? où vay-je? O dure destinee
O fatale misere à me nuire obstinee!
Quel harnois est-ce cy? contre qui l’ay-je pris?
Quel combat ay-je à faire? Hé Dieu qu’ay-je entrepris!
Veillé-je ou si je dors! sont ce point des allarmes
De l’enchanteur Atlant, ou d’Alcine les charmes?
Me voici desguisé, mais c’est pour me tromper.
Je porte un coutelas, mais c’est pour m’en frapper.
J’entre dans le combat pour me vaincre moymesme.
Le prix de ma victoire est ma despouille mesme.
Qui veit onc tel malheur? Leon triomphera
De Roger, et Roger sa victoire acquerra:
Je suis ore Leon et Roger tout ensemble.
Chose estrange! un contraire au contraire s’assemble.
Qu’il m’eust bien mieux valu souffrir l’affliction
D’où Leon me tira, que cette passion!
Helas je suis entré d’un mal en un martyre!
De tous aspres tourmens mon tourment est le pire.
A mon sort les Enfers de semblables n’ont rien:
Ils ont divers tourmens, mais moy je suis le mien,
Moymesme me punis, moymesme me bourrelle;
Je suis mon punisseur et ma peine cruelle;
Je me suis ma Mégère et mes noirs coulevreaux,
Mes cordes et mes fers, mes fouets et mes flambeaux.
O piteux infortune! Ay-je esté si mal sage,
Si privé de bon sens que jurer mon dommage?
Que promettre à Leon de luy livrer mon coeur,
Et d’estre de moymesme à son profit vaincueur?
Encor si à moy seul je faisois cet outrage.
Mais Bradamante, hélas! le souffre davantage.
Il faut n’en faire rien. Mais quoy? tu l’as promis.
C’est tout un; ne m’en chaut, il n’estoit pas permis.
Si ma promesse estoit de faire à Dieu la guerre,
A mon pere, à ma race, à ma natale terre,
La devroy-je tenir? non, non, seroit mal fait.
De promesse mechante est tres mechant l’effet.
Voire, mais tu luy es attenu de ta vie.
Las! de ma vie, ouy bien, mais non pas de m’amie.
Il est venu de Grece en France sous ta foy.
S’est offert au combat se faisant fort de toy;
Tout son honneur y pend, il n’est pas raisonnable
De luy faulser promesse estant son redevable.
Allons donc, de par Dieu, puis que j’y suis tenu.
Combatons l’estomach, le col ou le flanc nu,
Pour mourir de la main de celle que j’offense.
Je recevray la peine en commettant l’offense.
Je ne puis mieux mourir, puis qu’il faut que ce jour
M’arrache par ma faute et: la vie et l’amour.
Mais d’ailleurs je faudrois car de ma foy promise
Je ne m’acquitte point combattant par feintise:
Puis l’ennuy de la vierge en deviendroit plus grand
Et se tueroit possible avec le mesme brand.
Quoy donc? l’offenseray-je? hélas! je n’ay pas garde!
Je me mettroy l’espee au coeur jusqu’à la garde
Si je voyoy rougir sur son estomac blanc
Ou dessur son armeure une goute de sang.
Je ne veux que parer aux coups de son espee,
Sans qu’elle soit au vif de la mienne frapee.
Scène VI
BRADAMANTE
Si je le puis atteindre avec le coutelas,
Je l’envoiray chercher une femme là-bas.
Ce mignon, ce beau-fils, qui n’a bougé de Grece,
Et qui ne feit jamais preuve de sa prouesse,
N’a couru la fortune et ne s’est hasardé:
Mais s’est tousjours le corps sans mal contregardé,
Contant de son beau nom, et ores vient en France
Faire monstre à nos yeux de sa magnificence.
Aux François ne se voit un teint si delicat,
Mais une main robuste endurcie au combat.
La sueur du harnois est nostre commun baume.
Les combats, les assauts sont l’esbat du royaume.
Les cuiraces d’acier, les armets bien fourbis,
Les brassarts, les cuissots sont nos riches habits.
Nos licts sont une tante, et souvent la vouture
De ce grand Ciel courbé nous sert de couverture.
Nostre ame est courageuse, et ne craint nul effort.
Nous ne prisons rien tant qu’une honorable mort,
Et nous, Filles, n’avons nos poitrines eprises
Des yeux de nos amants, mais de leurs vaillantises.
Or vienne ce musqué, qui ne feit jamais rien
Et qui n’est renommé que pour l’Empire sien:
A son dam apprendra qu’il n’est point de vaillance
Qu’on doive comparer à la valeur de France,
Et qu’acquerir ne faut par importunité,
D’une fille l’amour qu’on n’a point merité.
Acte IIII
Scène I
Scène I
LA MONTAGNE, AYMON, BEATRIX
LA MONTAGNE
Qui eust jamais pensé que ce prince de Grece
Eust en luy tant de coeur, tant de force et d’adresse,
Veu qu’il n’estoit cogneu des Paladins François,
Et qu’on prise assez peu les armes des Gregeois?
Toutefois il est brave et vaillant au possible.
Son ame est genereuse et sa force invincible.
AYMON
Que dit ce gentilhomme?
LA MONTAGNE
Il est César de nom,
Mais il l’est maintenant de faict et de renom.
AYMON
C’est de Leon qu’il parle, escoutons-le un peu dire.
LA MONTAGNE
Chacun luy fait honneur, tout le monde l’admire.
AYMON
Il a doncques vaincu; nous voylà hors d’ennuy.
LA MONTAGNE
Certe il est digne d’elle autant qu’elle de luy.
Beatrix.
Arraisonnons-le un peu.
AYMON
J’en ay fort grand’envie.
Et quoy? nostre bataille est-elle ja finie?
LA MONTAGNE
C’en est fait.
AYMON
Et qui gaigne?
LA MONTAGNE
Ils ont egal honneur.
AYMON
Egal? comment cela?
LA MONTAGNE
Mais Leon est vaincueur.
AYMON
Hà que j’en ay de joye!
BEATRIX
Et moy, que j’en suis aise!
AYMON
Je ne sçaurois ouir chose qui tant me plaise!
Mais de grace contez comme tout s’est passé.
LA MONTAGNE
Autour du camp estoit tout le peuple amassé,
Et Charles devisoit avec les preux de France,
Quand les deux champions après la reverence
Se plantent opposez l’un à l’autre, aux deux bouts,
L’un attisé d’amour, et l’autre de courroux.
Un pennache ondoyoit sur leurs brillantes armes.
Chacun prisoit le port de ce pair de gensdarmes,
Leur demarche et leur grace: ils sembloyent deux soleils,
Ils paroissoyent en force et prouesse pareils.
Ils firent quelque pause aux portes des barrieres,
S’entroeilladant l’un l’autre au travers des visieres:
Et ressembloit la vierge, au mouvoir de son corps,
Un genereux cheval qu’on retient par le mors
Trop ardent de la course, et qui, l’oreille droite,
La narine tendue et la bouche mouete,
Frappe du pié la terre, et marchant çà et là,
Monstre l’impatience et la fureur qu’il a.
La voix ne fut si tost de la trompette ouye,
Que l’espee en la main elle court resjouye
Contre son adversaire, et semble à l’approcher
D’une tourmente esmeue encontre un grand rocher.
L’autre marche à grand pas, et plus grave, ne montre
Avoir tant de fureur qu’elle, à ce dur rencontre:
Il saque au poing l’espee, et destourne et soustient
Les grands coups qu’elle rue, et ferme se maintient.
Comme une forte tour sur le rivage assise,
Par les vagues battue, et par la froide bise,
Ne s’en esbranle point, dure contre l’effort
De l’orage qui bruit et tempeste si fort,
Ainsi luy sans ployer sous l’ardente furie
Et les aspres assauts de sa douce ennemie
Qui chamaille sans cesse, ores haut, ores bas,
Par le chef, par le col, par les flancs, par les bras,
Ne s’esmeut de la charge, ains s’avance, ou se tourne,
Ou recule en arrière, et le malheur destourne.
Il s’arreste par fois, et par fois s’avançant,
De la main et du pié se va comme elançant,
Puis soudain se retire, et jette la rudache
Au devant de l’espee et rend le coup plus lasche.
Il tire peu souvent, et encores ses coups,
Comme en feinte tirez, sont debiles et mous.
Il prend garde à frapper où sa dextre ne nuise,
Et là par grande addresse à tous les coups il vise:
Mais elle s’en courrouce, et ce courtois devoir
Fait redoubler sa haine, ainsi qu’il semble à voir.
Tantost fiert du trenchant, et tantost de la pointe;
Elle cherche où l’armure est à l’armure jointe;
Elle voltige, et tourne incessamment la main,
Le sonde en tous endroits, mais son labeur est vain.
Comme un qui pour forcer une ville travaille,
Ceinte de grands fossez et d’espaisse muraille
De toutes parts flanquee, ore fait son effort
Contre un gros boulevard ou contre un autre fort,
Ore bat une tour, ore assaut une porte,
Ore donne escalade à la muraille forte,
S’attaque à tous endroits, en vain essaye tout:
Il y perd ses soldats et n’en vient point à bout.
La vierge ainsi se peine, et tant moins elle espere
Vaincre son ennemi, d’autant plus se colere,
D’autant plus fait d’effort; le feu sort de ses coups,
Et ne sçauroit briser mailles, lames, ne clous.
En fin elle se lasse, et halette de peine;
Elle fond en sueur et se met hors d’haleine;
La main luy devient foible, et ne peut plus tenir
L’indigne coutelace, et l’escu soutenir.
La force luy défaut: mais la colere aigue,
La honte et le despit de se trouver vaincue
Luy renfle le courage: et laschant le pavois
Prend à deux mains l’espee, et bat sur le harnois
Comme sur une enclume au milieu d’une forge,
Où quelque grand Cyclope un corps d’armures forge.
Ses coups drus et pesans passent l’humain pouvoir;
La force luy redouble avec le desespoir;
D’ahan elle se courbe, et semble avoir envie
De perdre en cet effort la victoire et la vie.
Leon frais et dispos comme en ayant pitié,
Pour finir ce combat, entrepris d’amitié,
Commence à la presser la suivre, la contraindre,
Feint redoubler ses coups, sans toutefois l’atteindre,
La poursuit,la resserre; il la pousse et la poind,
Et lasse la reduit jusques au dernier point.
Charles fait le signal, et Leon se retire:
Bradamante fremist de dueil, de honte, et d’ire.
Le Conseil s’assembla, qui, de Charles requis,
Dit que Leon avoit Bradamante conquis,
Qu’il la devoit avoir pour legitime espouse.
AYMON
Et que dit l’Empereur?
LA MONTAGNE
Qu’il entend qu’il l’espouse.
AYMON
O Dieu, que de ta main les faits sont merveilleux!
Tu as ore abatu le coeur des orgueilleux:
Bradamante a trouvé maintenant qui la donte.
BEATRIX
Elle n’en faisoit cas.
AYMON
Mais elle en avoit honte.
Je vay trouver le Roy, pour ensemble adviser
De l’endroit et du jour de les faire espouser.
Scène II
ROGER
Gouffres des creux enfers, Tenariens rivages,
Ombres, Larves, Fureurs, Monstres, Démons et Rages,
Arrachez-moy d’ici pour me rouer là-bas:
Tous tous à moy venez, et me tendez les bras.
Je sens plus de douleurs, je souffre plus de peines
Qu’on n’en sçauroit souffrir sur vos dolentes plaines.
Je suis au desespoir, je suis plein de fureur;
Je ne projette en moy que désastre et qu’horreur.
Je ne veux plus du jour, j’ay sa lampe odieuse;
Je veux chercher des nuits la nuit la plus ombreuse,
Un lieu le plus sauvage et le plus escarté
Qui se trouve sur terre, un rocher deserté,
Solitaire, effroyable, où, sans destourbier d’homme,
Le dueil, l’amour, la rage, et la faim me consomme.
Où me puis-je laver de l’horrible forfaict
Que j’ay, monstre exécrable, à ma maistresse faict?
Je l’ay prise de force, et de force ravie
A moy, à son amour, et à sa propre vie,
Pour la donner en proye, et en faire seigneur
(Ingrate cruauté!) son principal haineur?
O terre, ouvre ton sein! ô ciel lasche ton foudre,
Et mon parjure chef broye soudain en poudre!
J’ay madame conquise, et un autre l’aura;
J’ay gaigné la victoire, un autre en bravera.
Ainsi pour vous, taureaux, vous n’escorchez la plaine;
Ainsi, pour vous, moutons, vous ne portez la laine;
Ainsi, mousches, pour vous aux champs vous ne ruchez,
Ainsi pour vous, oiseaux, aux bois vous ne nichez.
Hà regret éternel, crèvecoeur, jalousie,
Dont ma detestable ame est justement saisie!
Mourons tost, depeschons, ne tardons plus ici;
Allons voir les Enfers le Royaume noirci;
Je n’ay plus que du mal, et des langueurs au monde;
Ce qu’il ha de plaisir à douleur me redonde.
Adieu cuirace, armet, cuissots, greves, brassars;
Adieu, rudache, espee, outils sanglans de Mars,
Dont le Troyen Hector s’arma jadis en guerre:
Je ne vous verray plus, devalé sous la terre.
Et vous Maistresse adieu adieu Maistresse helas!
Pardonnez-moy ma coulpe, et n’y repensez pas.
J’ay failli, j’ay forfait, il faut qu’on me punisse.
Je soumets corps et ame à tout aspre supplice.
Je ne refuse rien, pourveu que mon tourment
Tire de vostre coeur tout mescontentement,
Que vous me pardonnez devant que je trespasse,
Si que mourir je puisse en vostre bonne grace.
Scène III
BRADAMANTE, HIPPALQUE
BRADAMANTE
Ha fille miserable et regorgeant de maux!
O du Sort outrageux trop outrageux assauts!
O malheureuse vie en miseres plongee!
O mon ame, ô mon ame à jamais affligee!
Que feray-je? où iray-je? et que diray-je plus?
Je suis prise à mes rets, je suis prise à ma glus.
Ah Bradamante où est ta prouesse guerriere?
Où est plus ta vigueur et ta force premiere?
Bras traistres, traistres acier, et pourquoy n’avez-vous
Poussé dans son gosier la roideur de vos coups?
Une goutte de sang n’est de son corps sortie;
Nulle escaille ne lame est de son lieu partie;
Il n’a point chancelé, ferme comme une tour
Que la mer abayante assaut tout alentour.
Et folle je pensois ne trouver rien sur terre
Que Roger seulement, qui me vainquist en guerre:
Toutefois ce Gregeois qui n’est pareil à luy,
Qui n’acquist onc honneur, m’a domtee aujourdhuy.
Las! Roger, où es-tu, où es-tu ma chere ame?
Où es-tu, mon Roger? en vain je te reclame,
Tu n’entens à mes cris. Es-tu seul des mortels
Qui n’ayes entendu publier mes cartels?
Chacun l’a sceu, Roger: les peuples Iberides,
Les Mores, les Persans, les Getes, les Colchides,
Et tu l’ignores seul; cela toy seul ne scais,
Qu’espandre pour toy seul par le monde je fais.
HIPPALQUE
Hé mon Dieu, que vous sert ceste larmeuse plainte?
Pourquoy vous gesnez-vous d’une chose contrainte?
Pourquoy plorez-vous tant? que souspirez-vous tant?
Pensez-vous le malheur rompre en vous tourmentant?
BRADAMANTE
Ma compagne, m’amie, hé que j’ay de tristesse!
Le dueil, l’amour, la haine et la crainte m’oppresse.
Je suis au desespoir, au desespoir je suis:
Je n’ay plus que la mort pour borner mes ennuis.
HIPPALQUE
Ne vous desolez point. Il n’y a maladie,
Tant soit elle incurable; où lon ne remedie:
Il fault prendre courage et tousjours esperer.
Dieu vous peut (s’il luy plaist) de ces malheurs tirer.
BRADAMANTE
Et comment? quel moyen? qu’à Leon j’obeisse
Par ses armes vaincue, et sois Imperatrice?
Hà non! plustost la mort se coule dans mon sein,
Et plustost me puissé-je enferrer de ma main
Que d’estre oncques à luy: j’en suis là resolue.
Je sçay que d’un chacun j’en seray mal-voulue:
Charles s’en faschera, et mon père sur tous
Vomira contre moy le fiel de son courroux.
Je seray justement inconstante estimee,
Des Grecs et des François impudente nommee;
Leon j’offenseray: mais tout m’est plus leger
Et de moindre peché que d’offenser Roger.
HIPPALQUE
Je voy Marphise seule, allons par devers elle:
Elle en pourra possible avoir quelque nouvelle.
Scène IV
MARPHISE, BRADAMANTE, HIPPALQUE
MARPHISE
Quelle fureur, mon frere, a vostre esprit espoind
De quitter vostre Dame et ne la revoir point?
D’abandonner la Cour, et moy vostre germaine,
Me laissant en destresse, et Bradamante en peine?
La pauvre Bradamante, ha que j’en ay pitié!
Jamais ne fut je croy, plus constante amitié.
Las! que sera-ce d’elle? Elle avoir esperance
Qu’au bruit de son cartel vous reviendriez en France;
Un chacun l’estimoit, son pere en avoit peur,
Qui a tant ce Leon et son Empire au coeur:
Et ores la pauvrette, et mocquée et trompee,
Est la femme du Grec par le droit de l’espee.
BRADAMANTE
Dieu m’en garde, ma soeur, je veux plustost mourir.
MARPHISE
Helas! que je voudrois vous pouvoir secourir.
Mais quoy? tout est perdu, que sçaurions-nous plus faire?
La peine en est à vous, et la coulpe à mon frère.
Prenez le sort en gré, c’est Dieu qui l’a permis.
Leon vous doit avoir, puis qu’on luy a promis.
BRADAMANTE
Jamais, ma soeur.
MARPHISE
Mais quoy? seroit-il raisonnable?
BRADAMANTE
Le soit ou ne le soit, mon coeur est immuable.
MARPHISE
Quelle excuse aurez-vous de ne le faire pas?
BRADAMANTE
J’auray pour mon excuse un violent trespas.
MARPHISE
Un trespas! et pourquoy? n’avances point vostre heure.
BRADAMANTE
Je mourray, je mourray: je n’ay chose meilleure.
MARPHISE
Et que diroit Roger entendant vostre mort?
BRADAMANTE
Que morte je seray pour ne luy faire tort.
MARPHISE
Mais il auroit causé vostre mort outrageuse.
BRADAMANTE
Non, ainçois la fortune à mon bien envieuse.
MARPHISE
Il mourroit à l’instant qu’il sçauroit vostre fin.
BRADAMANTE
J’ay peur qu’il soit desja de la mort le butin.
MARPHISE
Non est pas, si Dieu plaist il en seroit nouvelle.
BRADAMANTE
S’il vit, il est épris de quelque amour nouvelle.
MARPHISE
N’ayez peur qu’il soit onc d’autre amour retenu.
BRADAMANTE
Qu’au bruit de ce combat n’est-il donques venu?
MARPHISE
Hélas! je n’en sçay rien; j’ay peur qu’il soit malade.
BRADAMANTE
Leon luy auroit bien dressé quelque embuscade,
Comme il est fraudulent, et l’aurois pris, de peur
Qu’il fust à son dommage encontre moy vaincueur.
HIPPALQUE
Je sçay bien un moyen pour brouiller tout l’affaire.
MARPHISE
Et quel? ma grand amie.
BRADAMANTE
Et que faudroit-il faire?
MARPHISE
Je volle toute d’aise.
BRADAMANTE
Hippalque, mon amour.
MARPHISE
Mon coeuret je te piy, fay nous quelque bon tour.
HIPPALQUE
La fourbe est bien aisee, il faut que vous, Marphise,
Allez vers l’empereur, et que de galantise
Soustenez qu’on fait tort à vostre frere absent,
Mariant Bradamante, et la luy ravissant,
Veu qu’ils ont devant vous par paroles expresses
Fait de s’entre-espouser l’un à l’autre promesses:
Qu’un sceptre ne doit pas la faire varier,
Qu’on ne la sçauroit plus à d’autres marier:
Que si par arrogance elle veut contredire,
Les armes en la main soustiendrez vostre dire.
Bradamante y sera qui, le front abbaissant,
Ira par son maintien vos propos confessant;
Lors Charles et ses Pairs ne voulans faire outrage
A Roger, suspendront ce dernier mariage.
Il viendra ce pendant, ou quelque autre moyen
Se pourra presenter commode à nostre bien.
MARPHISE
J’approuve ce conseil: car si Leon s’y treuve,
Il faudra qu’avec moy par l’honneur il s’espreuve
Pour défendre sa cause, et j’espère qu’apres
Vous n’aurez plus de mal de luy, ny d’autres Grecs.
Scène V
LEON, CHARLES, AYMON, MARPHISE, BEATRIX
LEON
Magnanime empereur, dont le nom venerable
Est aus fiers Sarrasins et aus Turcs redoutable,
Qui le sceptre François faites craindre par tout
D’un bout de l’univers jusques à l’autre bout,
Et qui ce grand Paris, vostre cité Royale,
En majesté rendez aux deux Rommes égale,
Heureuse est vostre France, et moy plein de grand
De m’estre ici trouvé pour voir vostre grandeur,
Et d’avoir eu de vous tesmoignage honorable
Aux prix de ma valeur, qui vous est redevable.
CHARLES
Mon fils, vostre vertu s’est montree à nos yeux
Comme l’alme clairté d’un soleil radieux.
Ma voix ne la sçauroit rendre plus héroïque.
Le tesmoignage est vain en chose si publique.
Vrayment vous méritez d’un Auguste le nom,
Et méritez aussi d’estre gendre d’Aymon,
Bradamante espousant, que vostre vaillantise
Et vostre ferme amour a doublement conquise.
LEON
Sire, vous plaist-il pas la faire icy venir,
Pour de nostre nopçage ensemble convenir?
CHARLES
Je le veux. Hà voicy le bon duc de Dordonne,
Noble sang de Clairmont qui vous affectionne,
Vostre race et vaillance il honore: et voici
La duchesse sa femme, et Bradamante aussi.
Vous, Aymon, sçavez bien que le prince de Grece,
Aussi grand en vertu comme il est en noblesse,
Poursuit vostre alliance, et s’est acquis vaincueur
En publique combat vostre fille, son coeur.
Ore voulez-vous pas vos promesses conclure,
Et determiner jour pour la nopce future?
AYMON
Ouy, Sire. Je n’ay rien qui me plaise si fort
Que me voir allié d’un prince si accort.
Je me sens bien-heureux, et Bradamante heureuse
D’entrer en une race et noble et valeureuse.
LEON
Moy plus heureux encor, d’avoir une beauté
Dont mon coeur si long temps idolâtre a esté,
Et qui, vraye Amazone, est aussi belliqueuse
(Rare faveur du ciel) que belle et gracieuse.
Puis elle est d’un estoc d’hommes vaillants et forts,
Les premiers de la terre en Martiaus efforts,
De Renauts, de Rolands, les foudres de la guerre,
D’Ogers et d’Oliviers, plus craints que le tonnerre.
CHARLES
Tout l’Orient n’est point en gemmes si fécond
Qu’est en hommes guerriers la race de Clairmont.
Jadis le cheval grec n’eut les entrailles pleines
De tant de bons soldats et de bons capitaines
Que de cette famille, il en sort tous les jours,
Indomtez de courage aux belliqueux estours.
La loy de Jesus-Christ par eux est maintenue,
Et la fureur Payenne en ses bords retenue,
Comme un torrent enflé, qui par la plaine bruit
Et jà prez et jardins de ses ondes destruit,
Entraîneroit maisons, granges, moulins, estables,
S’il n’estoit arresté par rempars défensables,
Qui rompent sa fureur, et ne permettent pas
Qu’il desborde, et s’espande aux endroits les plus bas.
AYMON
C’est par vostre vertu, que cette heureuse France
Sert encor’ Jesus-Christ, vous estes sa defense.
CHARLES
La puissance Chrestienne accroistra de moitié
Par ce noeu conjugal qui joint nostre amitié,
Quand l’un et l’autre Empire, unissant ses armées,
Guerroyra les Payens aux terres Idumees,
Ou en la chaude Egypte, en l’Afrique, et aux bords
De l’Espagne indomtee, où j’ay fait tant d’efforts.
BEATRIX
Mais pensons d’ordonner du jour du mariage,
A fin qu’on se prepare et mette en equipage.
LEON
Ce ne sera si tost que j’en ay de desir.
AYMON
Sire, il depend de vous, s’il vous plaist le choisir
CHARLES
Je veux que par tout soit la feste publiee.
MARPHISE
Il n’est pas raisonnable, elle est ja mariee.
AYMON, BEATRIX
Mariee? et à qui? Elle ne le fut onc;
Jamais n’en fut parlé.
MARPHISE
Elle vous trompe donc.
BEATRIX
Ma fille mariée?
AYMON
Il n’en fut onc nouvelle.
BEATRIX
Sans le respect que j’ay.
CHARLES
Que sert ceste querelle?
Bradamante est presente, il la faut enquerir.
AYMON
Qu’elle disse à qui c’est.
Cela me fait mourir.
MARPHISE
C’est à Roger, mon frere.
AYMON, BEATRIX
O Dieu! quelle impudence!
CHARLES
Comment le sçavez-vous?
MARPHISE
Ce fut en ma presence.
BEATRIX
Ils s’entre-sont promis?
MARPHISE
Voire avecque serment.
LEON
J’ay tousjours entendu qu’il estoit son amant.
AYMON, BEATRIX
O qu’elle est effrontee!
MARPHISE
O fille desloyale!
Et faut-il sous couleur d’une Aigle imperiale,
D’un sceptre, d’un tiare ainsi vous oublier?
O! que l’ambition fait nos ames plier!
CHARLES
Mais qu’en dit Bradamante?
MARPHISE
Et que peut elle dire?
CHARLES
Levez un peu le front.
AYMON
Ne la croyez pas, Sire.
MARPHISE
Si elle contredit, je la veux desfier:
J’ay les armes au poing pour le verifier.
S’y offre qui voudra, je soustiens obstinee
Qu’elle s’est pour espouse à mon frere donnee,
Et que l’on ne sçauroit, qui ne luy fera tort,
A d’autres la donner jusqu’à tant qu’il soit mort.
CHARLES
Elle ne répond rien.
MARPHISE
Elle se sent coupable,
Et reconnoist assez mon dire veritable.
AYMON
C’est une pure fraude ourdie encontre moy.
Bradamante à Roger n’a point donné sa foy.
Aussi ne pouvoit-elle, estant en ma puissance.
Une telle promesse est de nulle importance.
Puis, où fut-ce? quand fut-ce? estoit-il ja chrestien?
Il n’y a que deux jours qu’il combatoit, payen,
Nos peuples baptisez: or, estant infidelle,
Il ne pouvoit avoir d’alliance avec elle.
C’est abus, c’est abus; jamais n’en fut rien dit:
Au contraire elle-mesme a pratique l’edit
Qui a conduit Leon, un si notable prince,
Depuis le bord Gregeois jusqu’en cette province,
Pour entrer en bataille: et ore, estant vaincueur,
Qu’on le vienne frauder par un propos mocqueur,
Une baye, un affront, et sur tout que vous, Sire,
Vueillez pour tout cela revoquer vostre dire,
Il est deraisonnable. Il faut que le combat
Faict aux yeux d’un chacun ait vuidé tout debat.
CHARLES
Je ne veux rien resoudre en affaire si grande
Que des gens de conseil advis je ne demande.
Un roy, qui tout balance au poix de l’equité,
Doit juger toute chose avecque meureté.
MARPHISE
Puisque cette pucelle à Roger s’est donnee,
Leon ne peut l’avoir sous un juste Hymenee
Tant que Roger vivra. Qu’ils se battent tous deux
A la lance et l’espee, et cil qui vaincra d’eux
Son rival, envoyé làbas chez Rhadamante,
Ait sans aucun debat l’amour de Bradamante.
AYMON
Ce n’est pas la raison, Leon a combattu,
Son droit suffisamment est par luy debatu.
MARPHISE
Que vous nuist ce combat?
AYMON
Il seroit inutile.
Car vaincueur ou vaincu Roger n’aura ma fille.
LEON
J’accepte le party. Non, non, ne craignez point;
J’ay pour luy cet estoc, qui tousjours trenche et poind.
Sire, permettez-moy d’entrer encore en lice,
Et que de s’y trouver Roger on advertisse.
CHARLES
Je desire plustost par douceur accorder
Vos differens esmeus que de vous hasarder.
Je ne veux pas vous perdre, estans de tel merite
Tous deux braves guerriers et champions d’elite.
Ce seroit grande perte à nostre chrestienté,
Que l’un de vous mourust outre nécessité,
LEON
Dieu dispose de tout; il donra la victoire
A celuy qu’il voudra, l’autre au Styx ira boire.
Marphise, c’est à vous de faire icy trouver
Vostre Roger, à fin de nous entresprouver.
Scène VI
LEON, BASILE
LEON
Quand ce seroit Renaut, quand seroit Roland mesme,
Que le ciel a doué d’une force supreme,
Je l’oserois combatre, ayant ce chevalier,
Qui est plus mille fois que nul autre guerrier,
Il n’a point de pareil: que ce beau Roger vienne,
Et l’espee à la main ses promesses soustienne,
Il luy fera bien tost son ardeur appaiser,
Et au lieu d’une amie une tombe espouser.
Mais voylà pas Basile, honneur de nostre Grece,
A qui tous mes secrets fidellement j’addresse?
Basile mon amy, je me vien d’engager,
De promesse à la Cour, de combatre Roger.
BASILE
Roger, ce grand Achille, à qui la France toute
Ne sçauroit opposer Paladin qu’il redoute!
LEON
C’est ce mesme Roger.
BASILE
Il n’est pas à la Cour.
LEON
Sa soeur Marphise y est.
BASILE
Est ce un combat d’amour?
LEON
C’est pour ma Bradamante.
BASILE
Et qui vous la querelle?
LEON
Marphise pour Roger.
BASILE
Que pretend-il en elle?
LEON
Il pretend l’espouser.
BASILE
L’espouser? et comment?
LEON
Pour luy avoir promis.
BASILE
J’estime qu’elle ment.
LEON
C’est d’où vient nostre guerre.
BASILE
Et qu’en dit Bradamante?
LEON
Elle monstre à son geste en estre consentante.
BASILE
Monsieur. Laissez-la donc et vous tirez de là.
LEON
Basile, je ne puis consentir à cela.
BASILE
Quoy? voulez-vous mourir pour une ingrate amie?
LEON
Je voudrois bien pour elle abandonner la vie.
Je n’entens toutefois combatre contre luy
D’autre sorte que j’ay combatu ce jourdhuy.
BASILE
Par la force d’un autre?
LEON
Ouy bien, de celuy mesme
Qui m’a tantost conquis ceste beauté que j’aime.
BASILE
Il n’est plus avec nous.
LEON
Et où donc? ô mon Dieu!
BASILE
Il s’en est ore allé.
LEON
Helas! et en quel lieu?
Quel chemin a-t-il pris? qui l’a meu de ce faire?
BASILE
Il estoit tout chagrin, et sembloit se desplaire.
LEON
Hé Dieu je suis perdu! malheureux, qu’ay-je fait?
Me voilà blasonné de mon deloyal fait.
On sçaura mon diffame, et la tourbe accourue
Du peuple autour de moy me hûra par la rue.
Ces chevaliers françois, du monde la terreur,
Qui ont l’honneur si cher, m’auront tous en horreur,
Et ma maistresse mesme (ah! que la terre s’ouvre)
Crèvera de despit. Charles et tout le Louvre
Se riront bien de moy, d’avoir homme peureux
Usurpé le loyer d’un homme valeureux.
Ha timide poltron, par mon dol je décrie
Moy, mon pere, ma race, et toute ma patrie!
J’ay promis de combattre en autruy me fiant,
Et du premier succez trop me glorifiant,
Et faudray de promesse, et la cour abusee
Fera de ma vergongne une longue risee.
Ha chetif!
BASILE
Mais tandis qu’ici vous souspirez,
Au lieu de vous guarir vostre mal empirez.
Ne perdons point de temps, ains suyvons-le à la trace,
Et le cherchons par tout courans de place en place.
Acte V
Scène I
LEON, ROGER
LEON
Dea mon frere, et pourquoy ne me l’avies-vous dit?
Pensiez-vous qu’en cela je vous eusse desdit?
Que j’eusse voulu perdre, après un tel merite,
Le meilleur chevalier qui sur la terre habite?
Vous m’avez fait grand tort de douter de ma foy,
Et d’avoir eu besoin de ce qui est à moy.
ROGER
Invincible Cesar, je n’eusse osé vous dire
La cause de mon dueil, et de mon long martyre.
Las! vous eussé-je dit que j’avoy nom Roger,
Que j’estoy là venu pour vous endommager?
Que j’estoy le souci de vostre belle Dame,
Brûlé du mesme feu qui consomme vostre ame?
LEON
Je fus de vostre amour si ardemment épris
Pour vos faits valeureux, que quand vous fustes pris,
Si j’eusse eu de vostre estre et dessein connoissance,
Je ne vous eusse moins porté de bien-veillance.
Mais depuis, que privant vostre coeur de son bien,
Au prix de vostre vie avez basti le mien,
Vous ne deviez douter que mon ame obligee
Ne fust de vostre mort durement affligee,
Et que plustost qu’en estre autheur, j’eusse quitté
Non l’amour, ou le bien, mais la douce clairté.
ROGER
Ne vous privez pour moy d’une telle maistresse:
Ayez-la, prenez-la.
LEON
Non, non, je vous la laisse.
ROGER
Ne me destournez point de ce constant desir.
La mort ne mettra guere à me venir saisir.
Je suis plus que demy dans la barque legere.
Mon ame veut sortir de sa geole ordinaire;
Ne la renfermez point; n’enviez son repos;
Ma mort à vos desirs viendra bien à propos.
Car tant que je vivray, celle qui vous enflame
Vous ne pouvez avoir pour légitime femme:
Il y a mariage entre nous accordé,
Dont vous avez l’effet jusqu’ici retardé.
Or ma mort dissoudra ce contract miserable,
Et ne restera rien qui vous doit dommageable.
LEON
Je ne veux pas mon aise avoir par le trespas
Du meilleur chevalier qui se trouve icy bas.
Car combien que je l’aime autant que mon coeur mesme,
Plus qu’elle toutefois vostre vaillance j’aime.
Ayez-la pour espouse, et n’y soit desormais
Fait obstacle pour moy qui ne l’auray jamais!
Je vous cede mon droit; prenez-le à la bonne heure,
Que sans plus différer vostre amour vous demeure.
ROGER
Je supply’ le bon Dieu que sans juste loyer
Longuement ne demeure un amour si entier,
Et que j’aye cet heur de quelquefois despendre
Cette vie pour vous que vous me venez rendre
Pour la seconde fois. J’en voudrois avoir deux
Pour en vostre service en estre hasardeux.
Je vy deux fois par vous; mais combient que l’on rende
Les biensfaits qu’on reçoit avec usure grande,
Je ne puis toutefois les rendre que demis,
Car de les rendre entiers il ne m’est pas permis.
Vostre amour m’a donné, par deux fois opportune,
Deux vies, et (malheur!) je n’en puis mourir qu’une.
LEON
Laissons-là ces propos; plus grands sont les biensfaits
Que j’ay receu de vous que ceux-là que j’ay faits.
Retournons au logis pour un peu vous refaire,
Puis irons au chasteau pour vos nopces parfaire.
Scène II
LES AMBASSADEURS BULGARES, CHARLEMAGNE
LES AMBASSADEURS
Que cet Empire est grand en biens et en honneurs!
Que cette Cour est grosse et pleine de seigneurs!
Que je voy de beautez! sont-ce des immortelles?
J’estime que le ciel n’a point choses si belles,
Le Soleil ne luist point si agreable aux yeux,
Et le Printemps flori n’est point si gracieux
Que leurs divins regars, que leurs beautez decloses,
Que leurs visages saints, faits de lis et de roses.
Durant la brune nuit les célestes flambeaux,
Qui brillent escartez, n’éclairent point si beaux.
Vray Dieu que ce n’est rien de nostre Bulgarie!
Ce n’est, ma foy, ce n’est que pure barbarie
Auprès de ce païs: la douceur et l’amour,
La richesse et l’honneur font à Paris sejour.
Sire, nos Palatins ont sur nostre province,
Depuis le dur trespas de Vatran nostre prince,
Un Chevalier esleu pour nous commander Roy,
Qui n’a par tout le monde homme pareil à soy.
Il nous est inconneu, fors à son brand qui tranche,
Et à son Escu peint d’une licorne blanche.
Nagueres Constantin avec Leon, son fils,
Aux plaines de Belgrade eust nos gens deconfis
Sans ce brave guerrier, qui leur donna courage,
Et des Grecs ennemis fit un sanglant carnage.
Seul il les repoussa, terraçant par milliers,
Au coeur de leurs scadrons, les soldats plus guerriers.
Il en couvrit la terre en leur sang ondoyante,
Et du Danube fut la claire eau rougissante.
L’effroy, l’horreur, le meurtre à ses costez marchoyent,
Et, quelque part qu’il fust, ennemis trebuschoyent.
Ils se mirent en route, et la nuit tenebreuse
Couvrit de son bandeau leur fuitte vergongneuse.
La noblesse, le peuple, et ceux qui à l’autel
Font devote priere au grand Dieu immortel,
Prosternez à ses pied, humbles le mercierent,
Et que le sceptre il print d’un accord le prierent.
Mais luy, les refusant, ne daigna sejourner,
Et personne depuis ne l’a veu retourner.
Les Estats toutefois l’ont tous eleu pour maistre,
Ne voulans autre roy que luy seul reconnoistre.
Ores nous le cherchons par royaumes divers.
Et pource qu’il n’est Cour en tout cet Univers
Qui soit en chevaliers tant que la vostre belle,
Nous y sommes venus pour en ouir nouvelle.
CHARLEMAGNE
De ce preux Chevalier sçavez-vous point le nom?
LES AMBASSADEURS
Nous ne l’eussions points sceu, ne le disant, sinon
Que par son Escuyer depuis nostre entreprise
Nous avons entendu que c’est Roger de Rise.
CHARLEMAGNE
Hà puisque c’est Roger, lon ne s’est pas mespris:
C’est un grand chevalier, d’inestimable prix,
Il n’est pas maintenant en ceste Cour de France.
Sa soeur Marphise y est qui a pris sa defense:
Retirez-vous vers elle, elle pourra sçavoir
Quand et en quel endroit vous le pourrez revoir.
Scène III
CHARLES, AYMON, BEATRIX
CHARLES
Que c’est de la vertu! Dieu, que sa force est grande!
Elle vainc la fortune, et grave luy commande.
Les biens et les honneurs près d’elle ne sont rien.
Quiconque est vertueux n’a point faute de bien;
Il est conneu par tout, tout le monde l’honore;
Soit qu’il soit en Scythie, ou sur la terre More,
Aux Bactres, aux Indois, il fait bruire son nom,
Et tousjours sa vertu luy acquiert du renom.
Les sceptres luy sont vils, et les richesses blesmes
Ne luy chaut de porter au front des diadêmes,
S’enfermer de soudars, et se voir au milieu
Des peuples amassez reverer comme un dieu.
Il fait de tels honneurs moindre cas que de fange.
Son coeur ne va beant qu’à la seule louange.
Tel est ce preux Roger qui n’ayant rien à soy,
Voit des peuples felons s’asservir à sa loy,
Luy offrir leur couronne, et à grande despense,
L’en faire importuner jusques au coeur de France.
Qu’en dites-vous, Aymon?
AYMON
J’en fay bien plus de cas,
Le voyant recherché, que je ne faisois pas.
CHARLES
Puisque vostre guerriere entre tous le desire,
Il seroit bon qu’il l’eust.
AYMON
Je le voudrois bien, Sire.
CHARLES
Mesme si vous sçavez qu’ils s’entre soyent promis.
AYMON
Mais nous aurons Leon et son père ennemis.
CHARLES
Nous n’aurons pas, peut-estre, ains plustost est croyable
Que Leon se voyant moins que l’autre agréable,
Luy porte moindre amour, et possible voudroit,
Content de sa victoire, entendre en autre endroit.
AYMON
J’en auroy grand desir.
BEATRIX
Je n’en serois marrie,
Puis qu’il est maintenant Roy de la Bulgarie.
CHARLES
Voicy Leon qui vient en magnifique arroy.
Il meine un chevalier tout armé quant et soy.
Sont ses armes qu’il a: mais quoy? que veut-il dire,
De faire ainsi porter les armes de l’Empire?
Scène IV
LEON, CHARLEMAGNE, MARPHISE, AYMON, BEATRIX, LES AMBASSADEURS, ROGER
LEON
Voici le Chevalier d’incroyable vertu,
Qui en champ clos naguiete a si bien combatu.
Puisqu’il a surmonté la pucelle en bataille,
Sire, c’est la raison qu’espouse on la luy baille.
Vous ne voudriez vous-mesme enfeindre vostre ban,
Le fraudant de sa Dame, honneur de Montauban.
Nul autre tant que luy merite Bradamante,
Soit en digne valeur, soit en amour ardante.
S’il se présente aucun qui le vueille nier,
Il est prest sur le champ de le verifier.
CHARLEMAGNE
Et n’estoit-ce pas vous qui combatiez naguiere,
Et qui estes vaincueur sorti de la barrière?
Nous l’avons ainsi creu. Qui est don cestuy-ci,
Qui pour vous combattant nous a trompez ainsi?
LEON
C’est un bon Chevalier de qui la dextre et preste
De defendre en tous lieux le droit de sa conqueste.
AYMON
Qui est cet abuseur? d’où nous est-il venu?
Je ne veux que ma fille ait un homme inconnu.
MARPHISE
Puisque, mon frère absent, cetuy-ci veut pretendre
Sa femme meriter, je suis pour le defendre:
Je mourray sur la place, ou luy feray sentir
Qu’on a de l’offenser un soudain repentir.
Il ne faut différer; que ce soit à ceste heure,
Que sans bouger d’icy l’un ou l’autre y demeure.
LEON
Il n’est point incogneu, voyez-le sur le front:
Pleines de son renom toutes les terres sont.
Hà mon frere, est-ce vous? est-ce vous, ma lumiere?
Je vous pensois enclos en une triste biere.
Pourquoy vous celez-vous à vostre cher soeur?
Pourquoy vous celez-vous à vostre tendre coeur,
A vostre Bradamante? hé mon frere, hé mon frere,
Luy vouliez-vous ourdir une mort volontaire?
Que je vous baise encor; je ne me puis lasser
De vous baiser sans cesse et de vous embrasser.
ROGER
Ne m’en accusez point, ma soeur, ce n’est ma faute.
Sire, puisse tousjours vostre Majesté haute
Prosperer en tout bien, et l’Empire Romain
Paisible reverer vostre indomtable main.
Vous, Princes, Chevaliers, estonnement du monde,
Dont vole dans le ciel la gloire vagabonde,
Soyez tousjours prisez, soyez tousjours heureux,
Et durent eternels vos faicts chevaleureux.
CHARLEMAGNE
Mais dites-moy, mon fils, pourquoy Roger de Rise
De combatre pour vous a-t-il la charge prise,
Contre son propre amour? où l’avez-vous trouvé?
Aviez-vous quelquefois sa valeur esprouvé?
LEON
Magnanime Empereur, et vous astres de France,
Vous connoistrez combien l’amour ha de puissance
Qui sourd de la vertu, par l’estrange accident
De Roger en Bulgare arrivé d’Occident.
CHARLEMAGNE
J’entendray volontiers cette estrange avanture,
Si de la nous conter ne vous est chose dure.
LEON
Aux champs Bulgariens mon père guerroyoit,
Et d’hommes et chevaux la campagne effroyoit,
Pour recouvrer Belgrade à l’empire ravie.
Vatran, leur Roy Vatran, se l’estoit asservie
Et la vouloit defendre, ayant de toutes pars
Pour tenir la campagne amassé des soudars.
Ils sortent dessur nous d’une ardeur animee,
Renversant, terraçant la plus part de l’armee,
Jusqu’à tant que Vatran de ma main abatu
Leur fist perdre, mourant, le coeur et la vertu.
Lors nous les repoussons, les hachant mille à mille,
Et fussions pesle-mesle entrez dedans la ville,
Sans Roger, qui survint aux deux parts inconnu,
Par qui de nos soudars fut l’effort retenu.
Il feit tant de beaux faicts, de prouesses si grandes,
Qu’il rompit, qu’il chassa nos vainqueresses bandes.
Je le vey dans les rangs foudroyer tout ainsi
Qu’en un blé prest à tondre un orage obscurci.
Je le prins en amour, bien qu’il nous fist outrage,
Et l’eu tousjours depuis gravé dans mon courage.
Nous retirons nos gens pour nos maisons revoir.
Mais Roger, qui eut lors de m’occire vouloir,
Vint jusqu’en Novengrade, où cogneu d’avanture
Fut prins et devalé dans une fosse obscure.
On le condamne à mort: dont estant adverti,
Du chasteau de mon père en secret je parti.
J’entre dans la prison, les fers je luy arrache;
Je le meine en ma chambre ou long temps je le cache.
Aussi tost fut le ban de Bradamante ouy,
Dont, pour avoir Roger, je fus fort resjouy,
Esperant que pour moy, comme il me feit promesse,
Il iroit au combat et vaincroit maistresse.
Nous arrivons icy, sans qu’aucun de nous sceust
Son nom, sa qualité, ny que Roger il fust.
Il entre dans la lice, il combat, il surmonte,
Retourne en mon logis, et sur son cheval monte,
S’en part secrettement, entre en un bois espais,
Voulant s’y confiner et n’en sortir jamais.
Or ayant malgré moy la bataille entreprise,
Pour maintenir mon droit, contre sa soeur Marphise,
Ne le retrouvant plus, fasché, je cours apres,
Et le trouve en ce fort confit en durs regrets,
Résolu de mourir d’une faim languissante,
Pour m’avoir surmonté sa chère Bradamante;
Me conte son malheur, son estre et son dessein,
Me pry’ de le laisser consommer par la faim.
Je demeure éperdu d’entendre telle chose,
Puis à le consoler mon esprit je dispose,
Luy redonne sa Dame, et jurant, luy promets,
Plustost qu’il en ait mal, n’y pretendre jamais.
Sire, elle est toute à luy: ne tardez d’avantage
De faire consommer un si bon mariage.
CHARLEMAGNE
Je le veux, je le veux. Qu’en dites-vous, Aymon?
AYMON
Je le veux bien aussi, je le trouve tresbon.
Roger mon cher enfant, ça que je vous embrasse!
J’ay grand peur que je sois en vostre male-grace:
Pardonnez-moy, mon fils, si j’ay si longuement
Tenu par ma rigueur vos amours en tourment.
LES AMBASSADEURS
Nous, premiers Palatins de la grand’ Bulgarie,
Venons offrir aux pieds de vostre seigneurie
Nos personnes, nos biens, nos honneurs, nostre foy,
Vous ayant d’un accord eleu pour nostre Roy.
Ne vueillez refuser nostre humble servitude:
Nous vous avons cherché en grand’ sollicitude:
Par maintes regions, pour avoir un seigneur
Qui nos peuples remplisse et de biens et d’honneur.
ROGER
J’accepte le présent qui me fait la province:
Soyez-moy bons sujets, je vous seray bon prince.
Je maintiendray le peuple en une heureuse paix,
Faisant justice droicte à bons et à mauvais.
Je me consacre à vous, et promets vous defendre
Contre tous ennemis qui voudront vous offendre.
LES AMBASSADEURS
Constantin l’empereur leve de toutes parts
Pour domter le Royaume un monde de soudars.
Le peuple est en effroy, la frontiere s’estonne.
Nous n’avons plus voisin qui ne nous abandonne.
Mais vous nous conduisant hardis nous passerons,
Jusqu’au sein de la Grece, et l’en dechasserons.
ROGER
S’il plaist à nostre Dieu, qui toute chose ordonne,
J’iray dans peu de mois recevoir la couronne,
Pour avec le conseil et l’appuy de vous tous
Empescher l’ennemy d’entreprendre sur vous.
LEON
Il n’en sera besoin, que cela ne vous presse:
Car puis qu’ils sont à vous, je leur feray promesse,
Et sous foy d’Empereur, qu’ils seront desormais
De la part de mon pere asseurez à jamais.
Vivez en doux repos, et que dans vostre teste
Ne reste aucun souci qui trouble vostre feste.
BEATRIX
Puisque Roger est roy, j’ay mon esprit contant.
Qu’on mande tost ma fille: et qu’est-ce qu’on attend?
Dites-luy qu’elle est royne, et que l’on la marie
A son amy Roger, le Roy de Bulgarie;
Qu’elle se face belle, et reprenne son teint,
Qui par ses longues pleurs estoit si fort desteint.
Scène V
HIPPALQUE, BRADAMANTE
HIPPALQUE
Vray Dieu, que j’ay de joye! ô l’heureuse journee!
Heureuse Bradamante ! ô moy bien fortunee!
Jesus, que je suis aise! et qu’aise je me voy!
Je ne sçay que je fais, tant je suis hors de moy!
Qui eust jamais pensé d’une amère tristesse
Voir sourdre tout soudain une telle liesse?
Tout estoit desastreux, chetif, infortuné.
Mon âme n’eust deux jours en mon corps sejourné
Si le mal eust eu cours, car avec ma maistresse
J’eusse triste rompu le fil de ma jeunesse.
Hé dieux qu’elle a de mal! l’amour brusle son coeur.
Le forçant desespoir, le despit, la rancoeur
La bourelle sans cesse, et la chetive dame
A la mort, à la mort continûment reclame.
De son teint, où l’albâtre opposé jaunissoit,
De sa levre, où la rose en ses plis ternissoit,
La grace est effacee: une palleur mortelle,
L’amaigrissant, déteint toute la beauté d’elle.
Or, grace à nostre Dieu, nostre bon Dieu, l’ennuy
Qui luy brassoit ce mal est esteint aujourd’huy.
Je luy vais annoncer nouvelle assez bastante
Pour morte l’arracher de la tombe relante.
Que de joye elle aura! Celuy, comme je croy,
Qui condamné reçoit la grace de son Roy
Sur le triste eschafaut prest de laisser la vie,
N’est d’aise si ravi qu’elle en sera ravie.
Mais je la voy venir: hélas! quelle pitié!
Quelle est deconfortee! ô cruelle amitié!
Elle croise les bras, et tourne au ciel la veuë.
Elle souspire helas! je m’en sens toute esmeuë.
Je m’en vay l’aborder, car ma foy je ne puis,
Je ne puis plus la veoir en de si durs ennuis.
Pourquoy de la douleur vous faites-vous la proye,
Ores que tout le monde est transporté de joye,
Que tout rit, que tout danse? Il faut quiter ces pleurs,
Et ces trenchans soupirs compagnons de douleurs.
BRADAMANTE
Las qui vous meut Hippalque? estes-vous en vous-mesme?
HIPPALQUE
Je ne veux plus vous voir le visage ainsi blesme.
Reprenez vostre teint de roses et de lis.
Ne vous torturez plus: vos malheurs sont faillis.
Il nous faut nous ébatre.
BRADAMANTE
Et qu’est-ce que vous dites?
HIPPALQUE
Qu’il nous faut despouiller ces tristesses maudites.
BRADAMANTE
Hà Dieu!
HIPPALQUE
Ne plorez plus, tout est hors de danger.
BRADAMANTE
Voire, rien n’est à craindre.
HIPPALQUE
On vous donne Roger.
BRADAMANTE
Me venez-vous moquer en destresse si grande?
HIPPALQUE
Je ne vous moque point, allons, on vous demande;
L’Empereur vous attend et vostre pere aussi
Avec vostre Roger.
BRADAMANTE
Roger?
HIPPALQUE
Il est ainsi.
BRADAMANTE
Dites-moy seurement, sans de mon mal vous rire.
HIPPALQUE
Je ne puis par ma foy plus au vray vous le dire.
BRADAMANTE
Que Roger est ici?
HIPPALQUE
Voire.
BRADAMANTE
Vous m’abusez.
HIPPALQUE
Il est avec Aymon qui veut que l’espousez.
BRADAMANTE
Mon Dieu! le sens me trouble! Est-ce point quelque songe?
HIPPALQUE
Non, ce que je vous dy n’est songe ne mensonge.
BRADAMANTE
Mais dy-moy, ma soeurete, est mon Roger venu?
HIPPALQUE
Il est dans le chasteau.
BRADAMANTE
Mais l’as-tu bien connu?
HIPPALQUE
Si j’ay connu Roger? Vous le pouvez bien croire.
BRADAMANTE
Que dit-il de Leon, d’avoir eu la victoire?
HIPPALQUE
C’est Leon qui le guide et qui parle pour luy.
BRADAMANTE
Quoy? Leon auroit-il combatu pour autruy?
HIPPALQUE
Non, ainçois c’est Roger qui vous a combatue.
BRADAMANTE
C’est Roger, c’est Roger qui m’a tantost vaincue?
HIPPALQUE
C’est Roger voirement.
BRADAMANTE
J’ay le coeur tout transi.
Mais comment le sçait-on?
HIPPALQUE
Léon le conte ainsi.
BRADAMANTE
O chose merveilleuse!
HIPPALQUE
Ell’l’est bien plus encores
Que vous ne pensez pas: Royne vous estes ores.
BRADAMANTE
Voire de mille ennuis.
HIPPALQUE
Non, d’un peuple estranger
Qui a naguere eleu pour son prince, Roger.
Encor les Palatins en ceste cour sejournent;
Vous les pourrez-bien voir devant qu’ils s’en retournent.
BRADAMANTE
Hé Dieu que dit mon père?
HIPPALQUE
Il saute de plaisir.
BRADAMANTE
Et ma mere si dure?
HIPPALQUE
Elle a tout son desir.
Ils brûlent de vous voir: allons je vous supplie.
BRADAMANTE
Hà ma soeur que tu m’as de liesse remplie!
Que j’ay d’aise en mon coeur! Je ne le puis porter;
Je me sens, je me sens hors de moy transporter.
Tout ce que j’eu jamais en amour de malaise
Ne sçauroit egaler le moindre de mon aise.
Onques je n’eusse osé seulement concevoir
Tant de biens qu’en un coup Dieu m’en fait recevoir.
Son nom en soit benist, et me donne la grace
De ne le mescognoistre en chose que je face.
Scène VI
MELISSE
Du grand moteur du ciel merveilleux sont les faits,
Que ne comprennent point nos discours imparfaits:
Lors qu’on n’y pense point, son pouvoir il découvre:
En faits desesperez miraculeux il ouvre
C’est pourquoy nous faillons, quand par faute de foy
Nous ne l’invoquons point en un trop grand esmoy
Nous pensons nostre mal estre irremediable,
Comme s’il n’estoit pas en ses faits merveillable,
Qu’il ne peust toute chose, et peinassent ses mains
A l’une plus qu’à l’autre, ainsi que nous humains.
On n’eust jamais pensé voir sans quelques miracles
Ce mariage faict, tant y avoit d’obstacles:
Toutefois tout soudain, lors qu’on l’espéroit-moins,
Ils sont prests, grace à Dieu, d’estre ensemble conjoins.
Qu’il en viendra de bien à nostre foy Chrestienne!
Que de mal au contraire en aura la Payenne!
Que de sang coulera du gosier Sarasin
Au rivage d’Afrique et au bord Palestin!
La France en est heureuse avec la Bulgarie,
Et heureuse en sera l’une et l’autre Hesperie.
Tout chacun en est aise, et je croy fermement
Que l’air, l’onde et la terre en ont contentement.
Scène VII
CHARLEMAGNE, AYMON, BEATRIX, LEON, ROGER, BRADAMANTE
CHARLEMAGNE
Grace à Dieu qui le ciel et la terre tempere,
Je voy qu’en ceste Cour toute chose prospere.
Bradamante et Roger sont conjoints à la fin,
Après avoir domté les rigueurs du destin.
Je suis aussi contant d’une telle alliance
Que de bienfaict de Dieu qu’ait receu nostre France.
Mon coeur en nage d’aise; en verité je croy
Que les peres n’en sont plus resjouis que moy.
AYMON
Sire, vostre bonté s’est tousjours fait cognoistre
A vouloir en honneurs et en biens nous accroistre.
CHARLEMAGNE
Les merites sont grands des vostres et de vous.
La France sans leurs mains se verroit à tous coups
De Sarasins couverte: elle n’a guere adresse
Après l’aide du ciel qu’à leur grand prouesse,
Et outre je prevoy qu’à l’empire Chrestien
De ce nopçage icy n’adviendra que du bien.
Escoutez mes Enfans: vos nopces ordonnees
De tout temps ont esté dans le ciel destinees.
Merlin, ce grand prophete à qui Dieu n’a celé
Ses conseils plus secrets, m’a jadis revelé
Que de vostre lignee, en Demidieux feconde,
Il naistroit des enfans qui regiroyent le monde.
Ils seront de mon sang comme du vostre issus;
Ils luiront eclatans d’heroïques vertus;
Les monstres ils vaincront, indomtables Alcides,
Et seront le support des vierges Pierides.
Or vivez bien-heureux, et vostre sainte amour
Sans chagrin ne debat croisse de jour en jour.
ROGER
Dieu face prosperer à jamais vostre Empire,
Et qu’onques ennemy n’ait pouvoir de vous nuire.
AYMON
Sire, vous plaist-il pas pour la feste combler,
Léonor, vostre fille, à Leon assembler
Sous les loix d’Hymenee? à cela son merite
Et l’auguste grandeur de sa race m’incite.
ROGER
Je vous en suppli, Sire.
BRADAMANTE
Et moy tres humblement.
BEATRIX
On ne la peut placer plus honorablement.
CHARLEMAGNE
Vrayment je le veux bien: que ma fille on appelle.
LEON
Sire, vous m’honorez et obliger plus qu’elle.
CHARLEMAGNE
Il faut d’un fort lien nos empires unir,
Pour contre les Payens nous entremaintenir.
LEON
Quel heur le Dieu du ciel insperément me donne!
Oncq, je croy, sa bonté n’en feit tant à personne.
O que je suis heureux! Je vaincray desormais
L’heur des mieux fortunez qui vesquirent jamais.
Fin
=>Retour au dossier sur la tragédie classique française