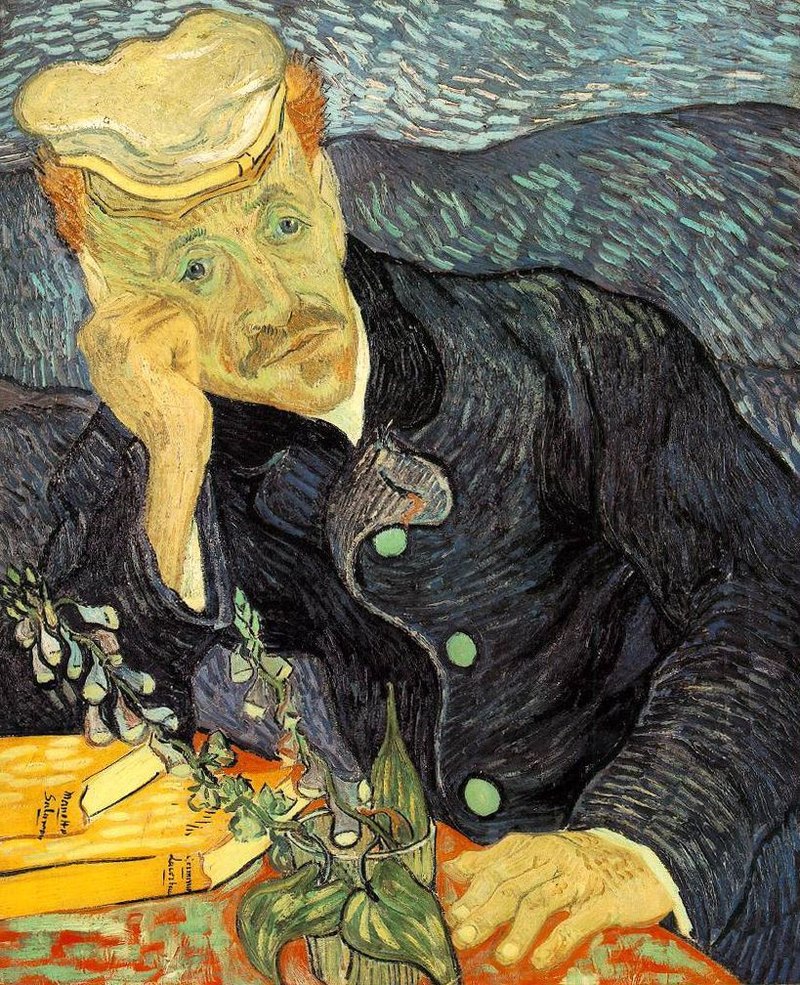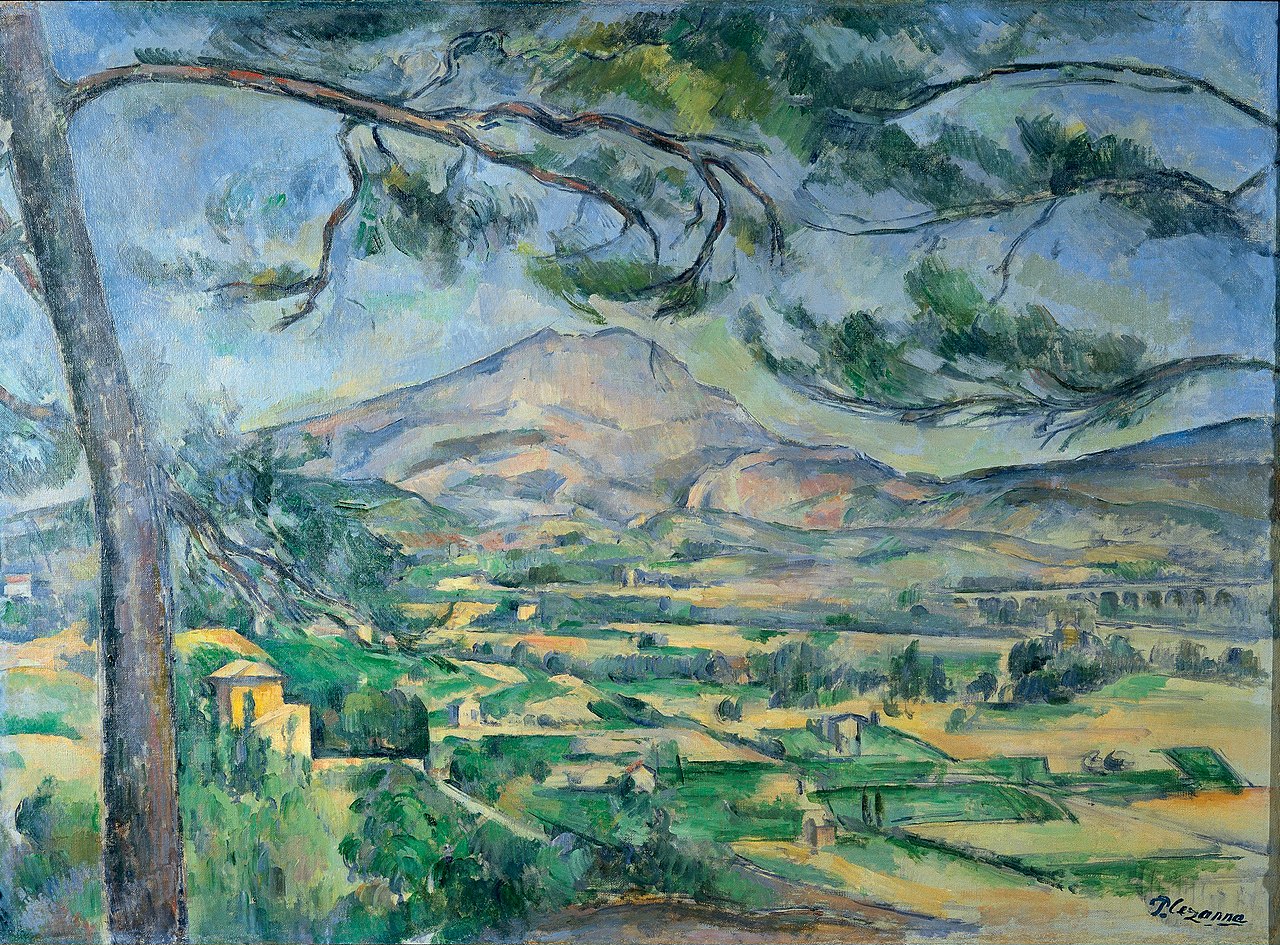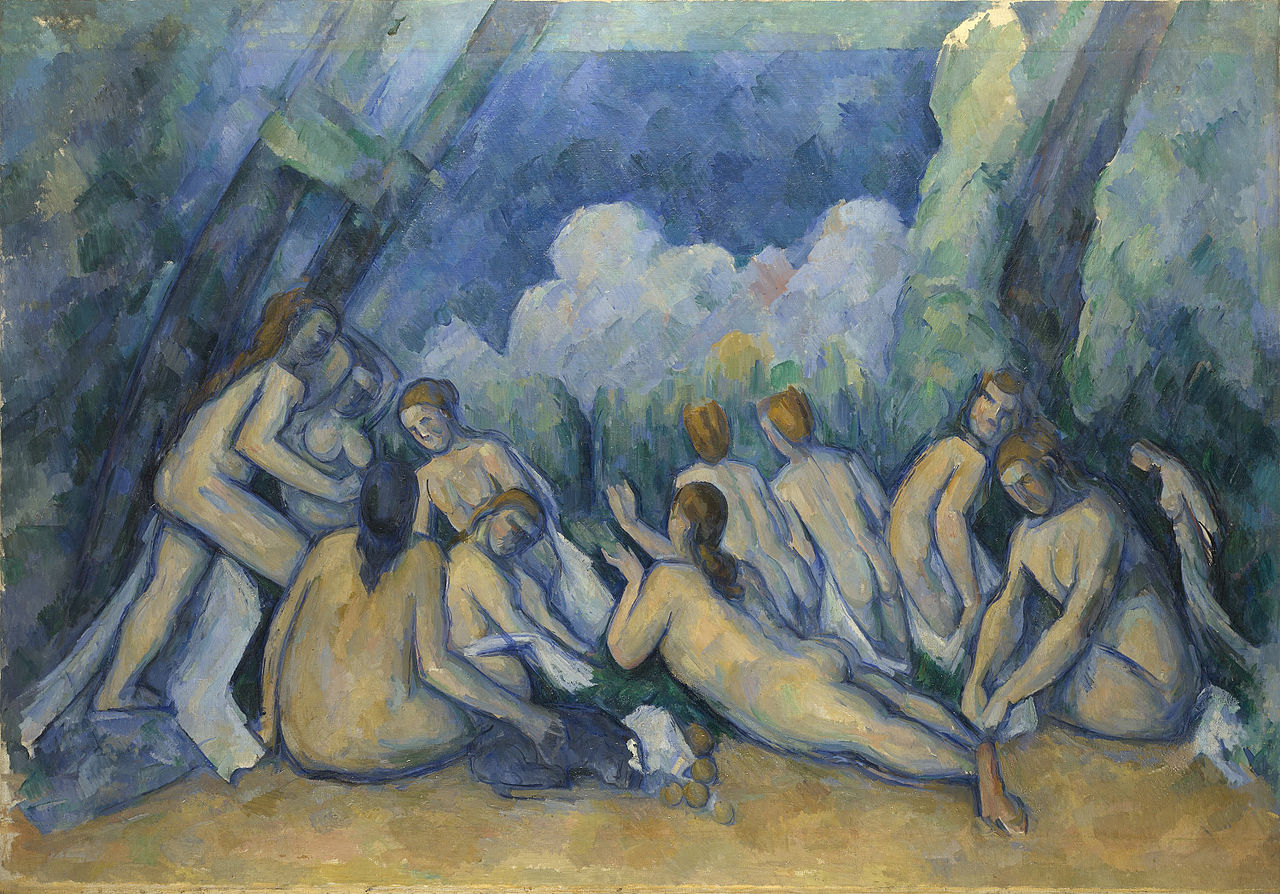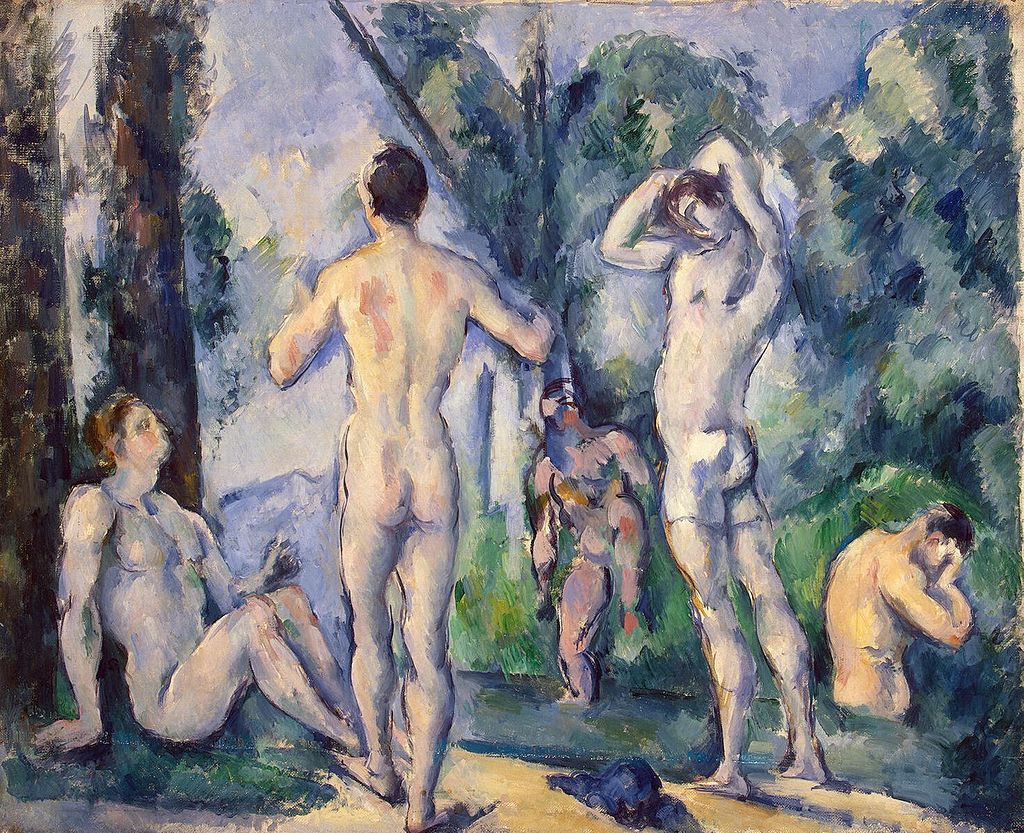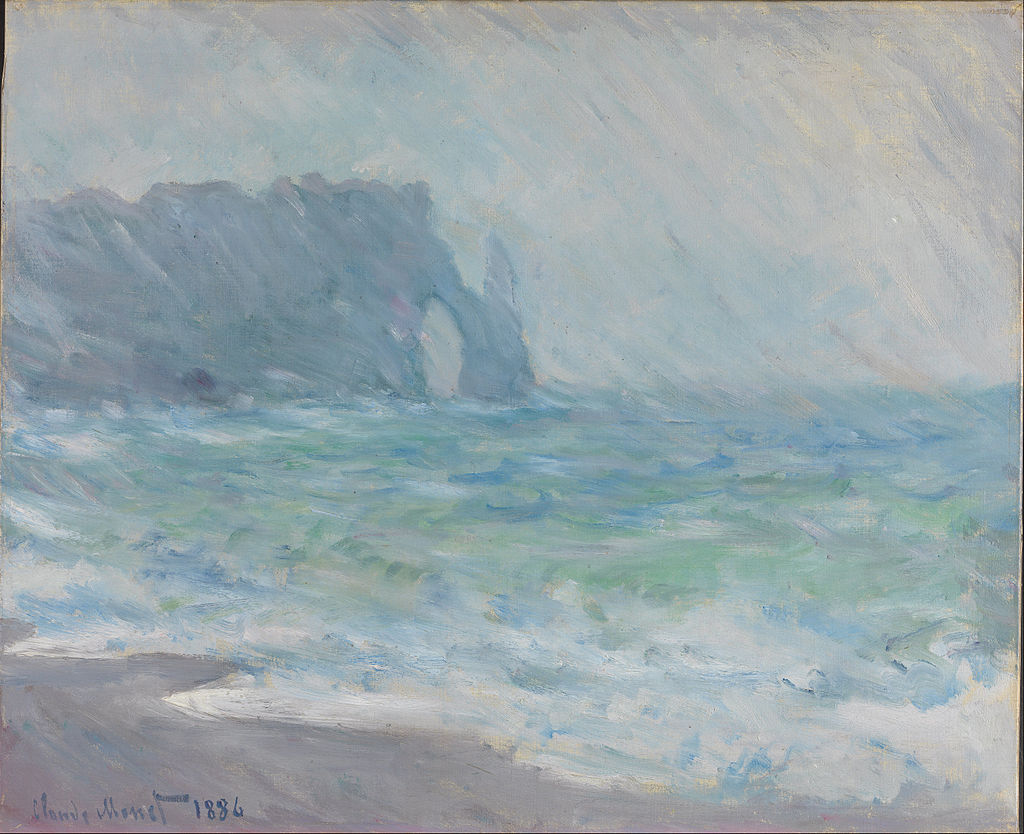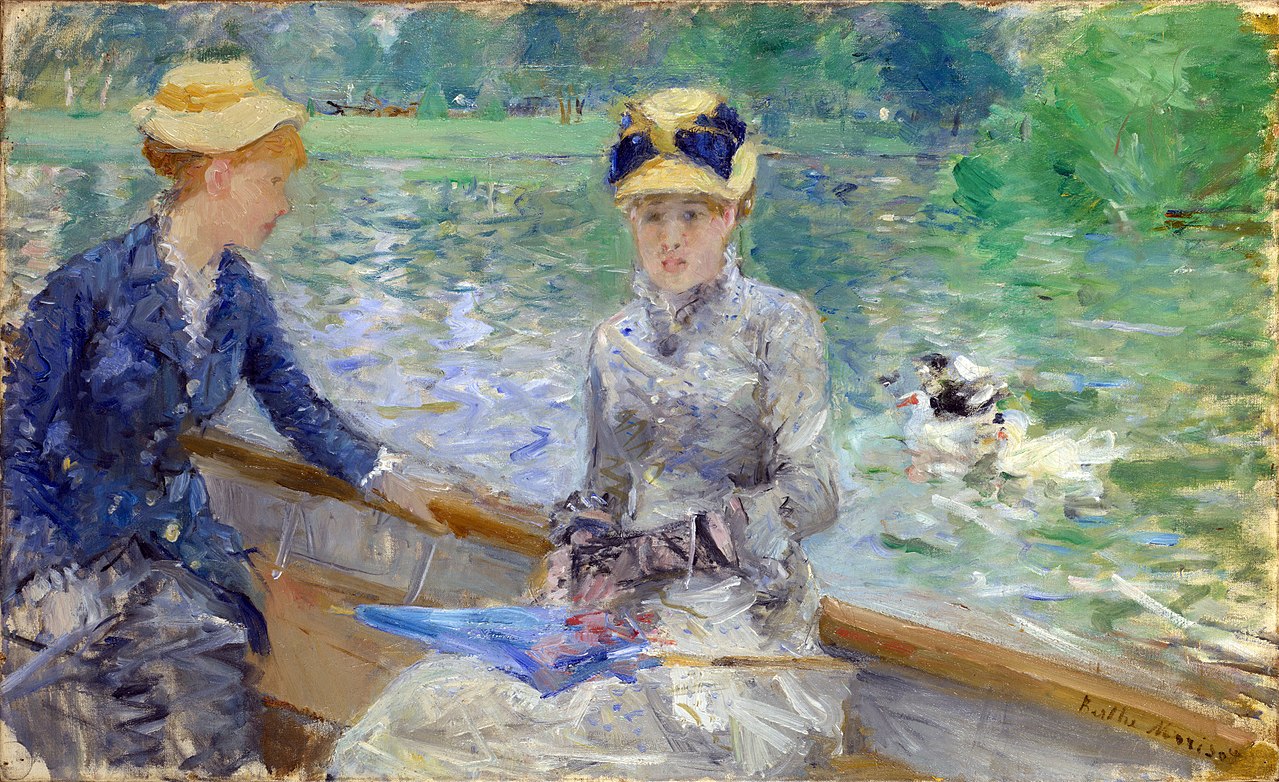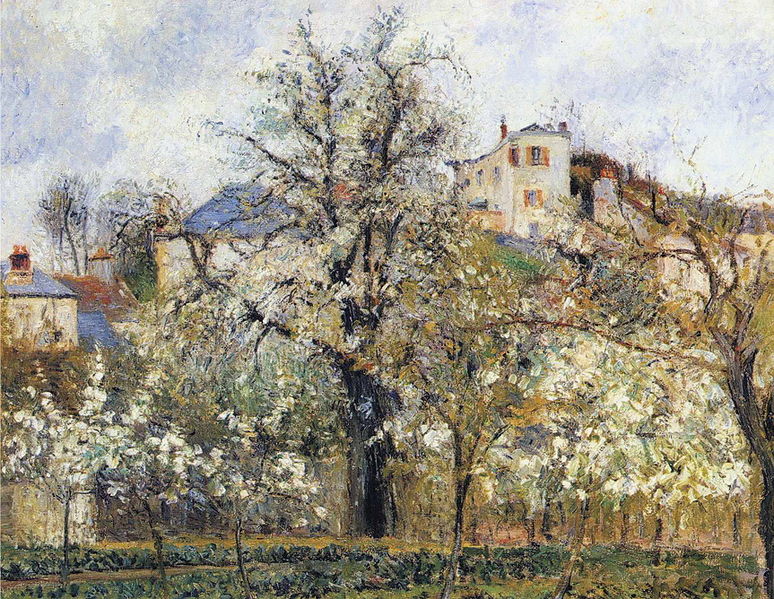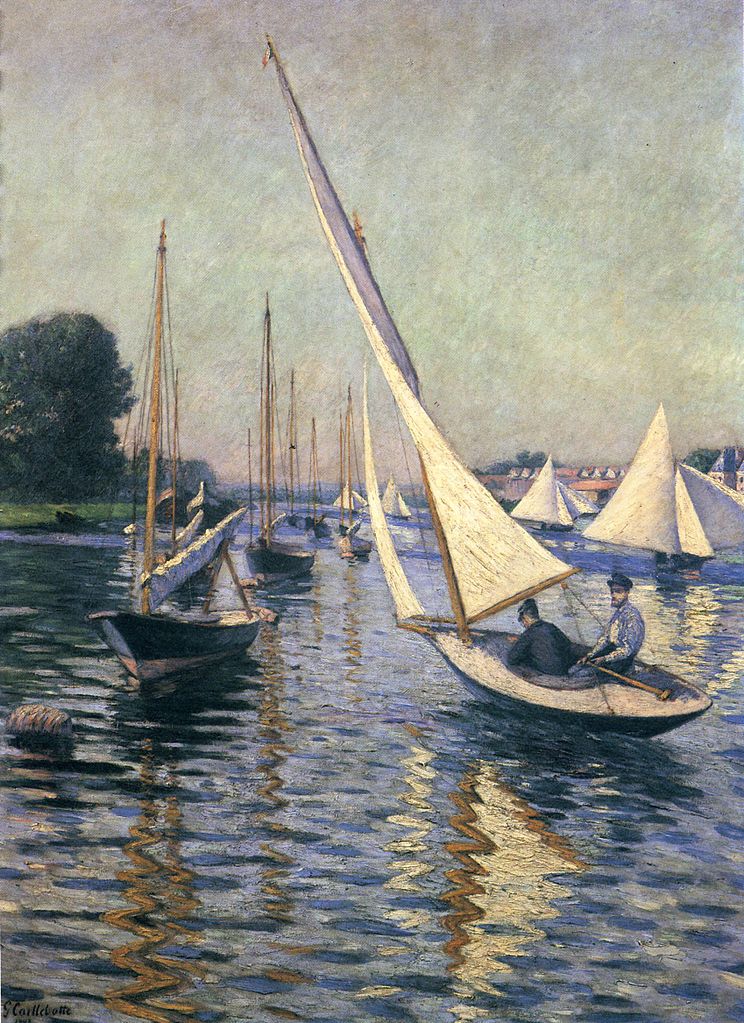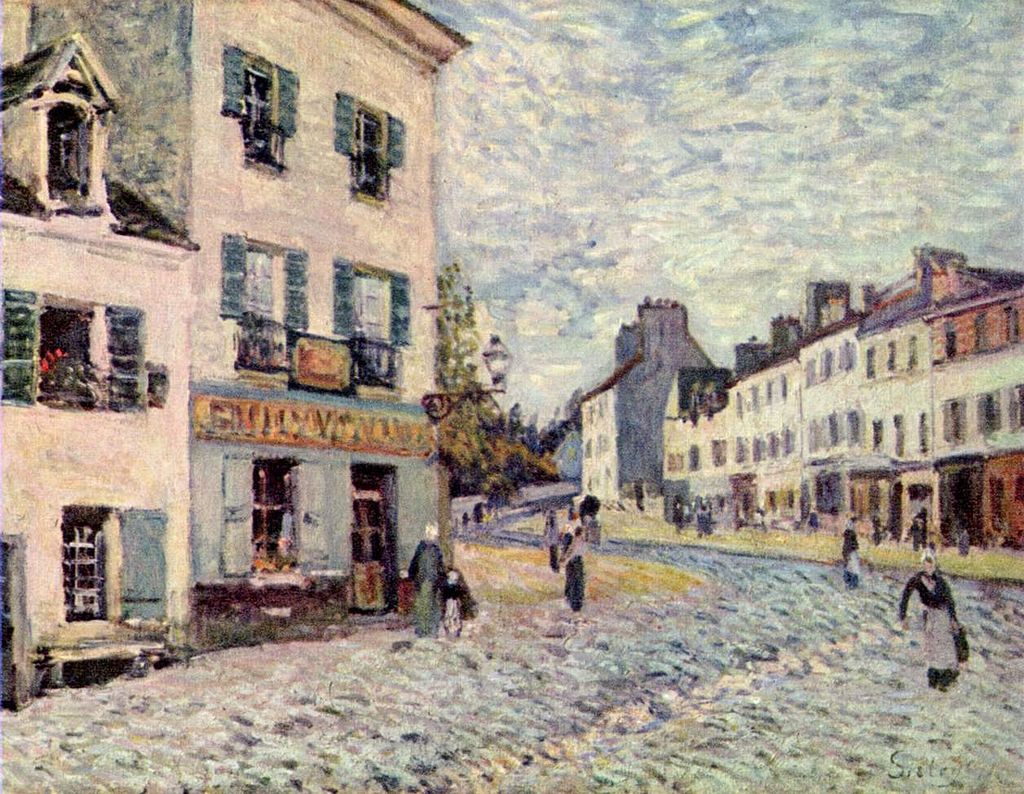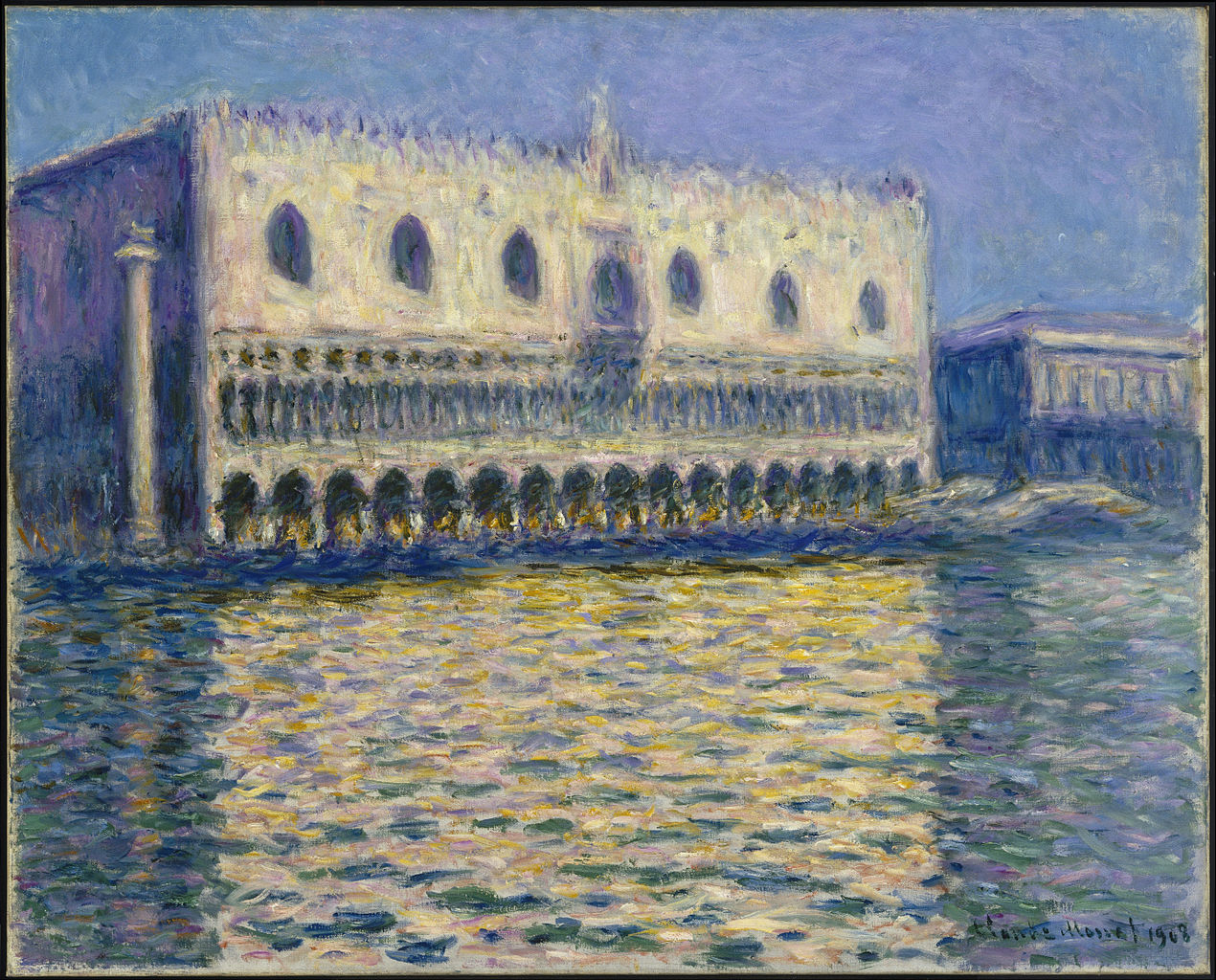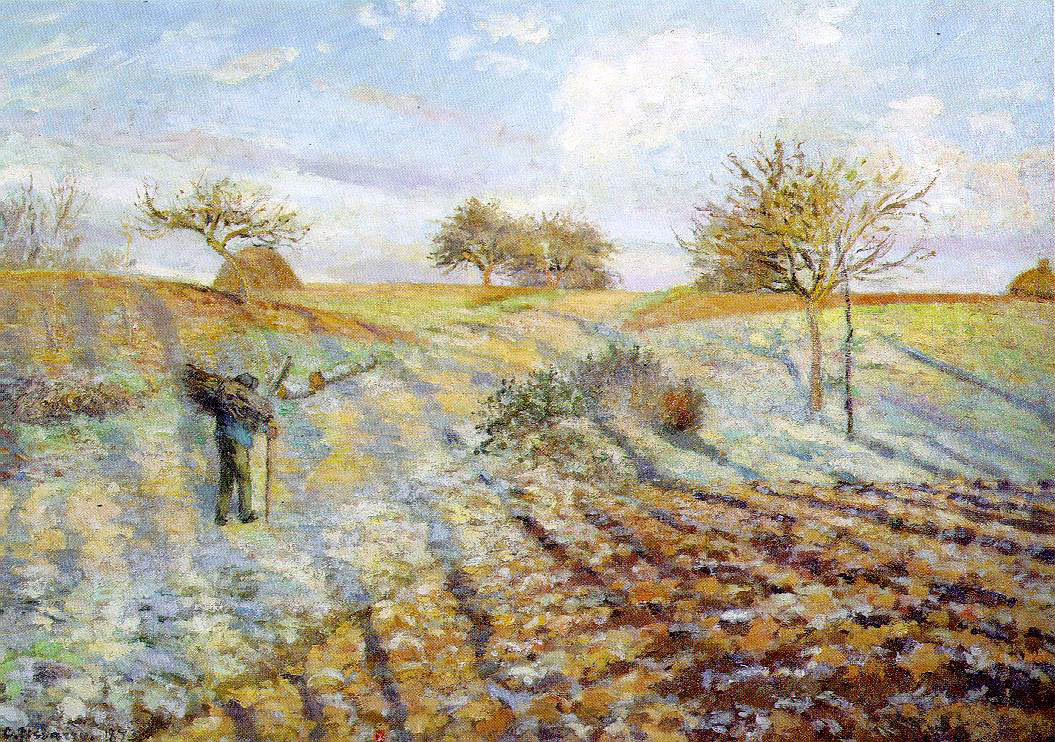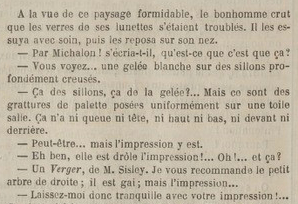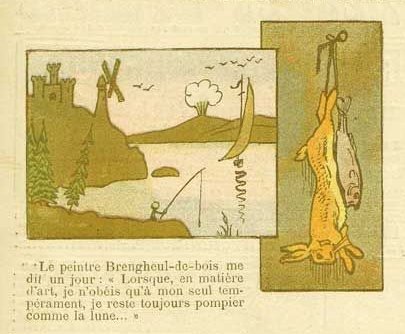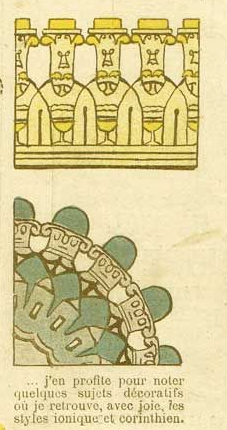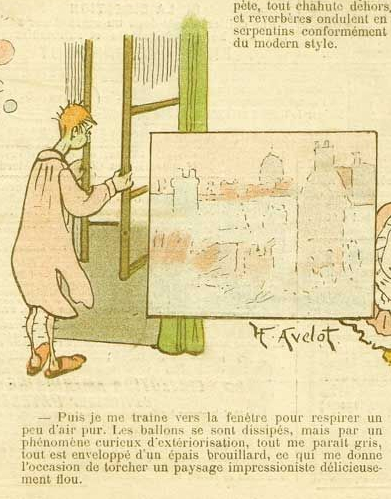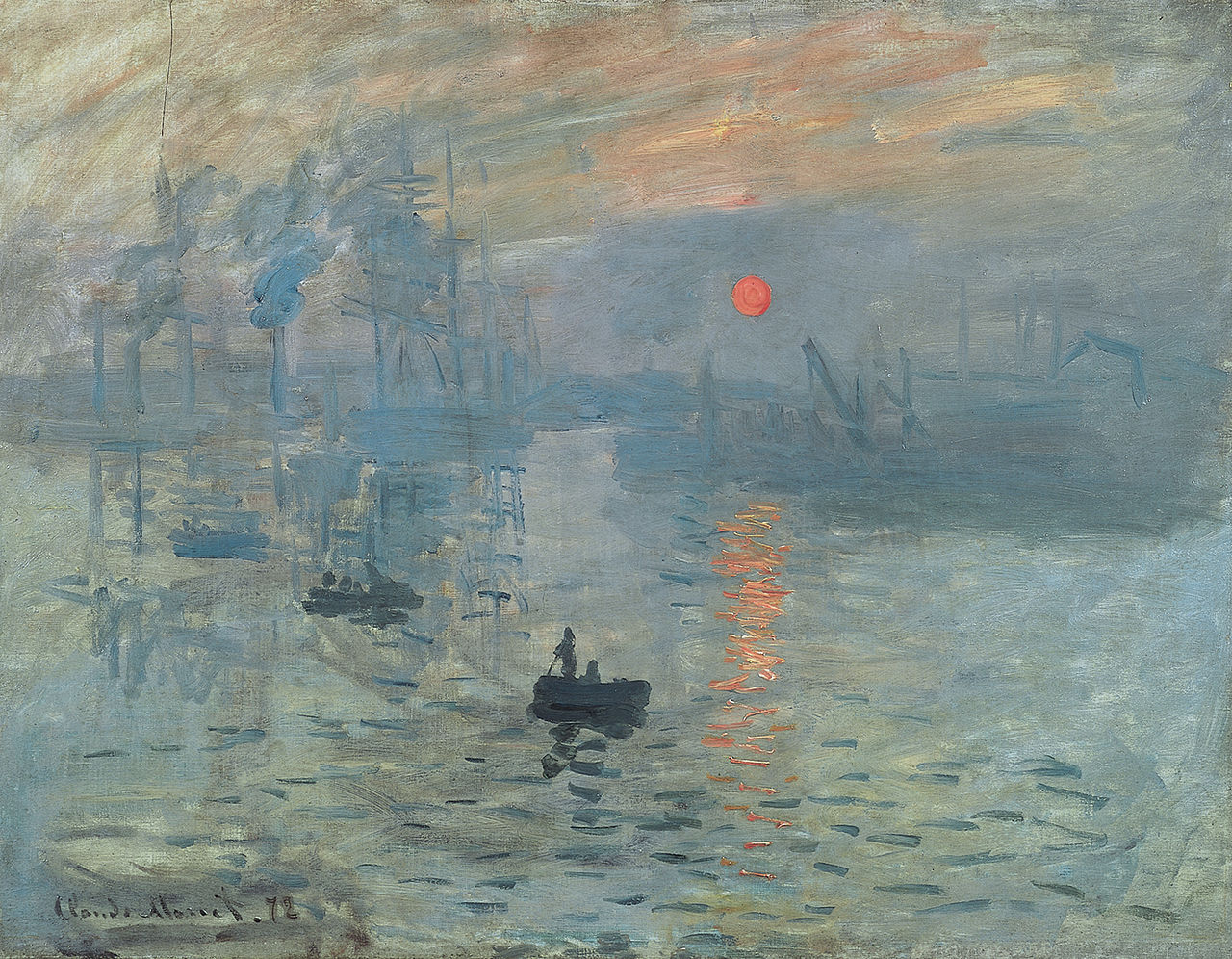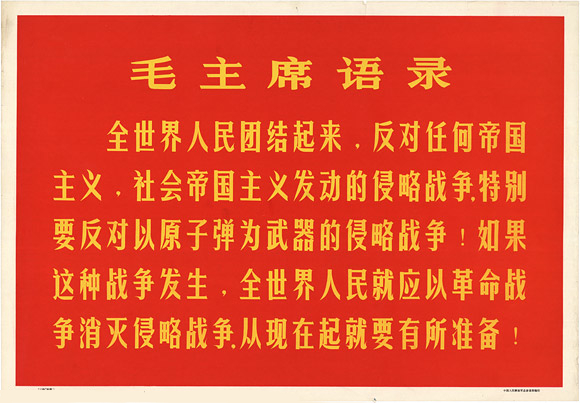Henri Claude (1909-1994) fut dans sa jeunesse un « abondanciste » et actif dans un cercle diffusant à Rouen la conception que le capitalisme allait laisser la place à une société d’abondance et qu’en attendant il menait forcément à la guerre. Il finit par considérer que cela correspondait aux thèses du communisme, mais rejoignit d’abord les rangs des trotskistes juste avant la première guerre mondiale, puis finalement le PCF en 1947.
L’article est tiré de la revue du PCF La Pensée, de septembre-octobre 1950. Il devint par la suite un économiste du PCF devenu révisionniste, dans la ligne de la thèse du capitalisme monopoliste d’État et alors que les « économistes » dont principalement Paul Boccara jouaient désormais un rôle majeur sur les orientations.
Henri Claude fut à ce titre rédacteur en chef de la revue du PCF Économie et politique. Il est notamment l’auteur de Nouvel avant-guerre? et Plan Marshall (tous deux en 1948), Où va l’impérialisme américain? (1950), Le Pouvoir et l’Argent (1972), Les Multinationales et l’Impérialisme (1978), La Troisième course aux armements (1982), Mitterrand ou l’atlantisme masqué (1986).
La notion de crise générale du capitalisme est une notion qui est encore loin
d’être claire à tous les esprits. Cela tient en partie au mot même de crise qui
prête à confusion. La plus grossière consiste à confondre « crise générale du
capitalisme » et « crise économique ». Ce sont pourtant là deux phénomènes
d’une nature entièrement différente, comme le montre le rôle joué par les crises économiques de surproduction dans l’économie capitaliste.
L’économie capitaliste est une économie anarchique et aveugle. Des milliers
de producteurs produisent sans connaître les possibilités du marché ; or c’est le marché qui commande la production. L’industriel travaille en fonction de la demande, mais sans savoir si cette demande se maintiendra ; il ne peut le savoir que lorsque la demande fait effectivement défaut ; mais comme il a produit comme si cette demande restait la même ou allait en augmentant, une partie de sa production ne trouve pas preneur ; il s’aperçoit alors qu’il a produit plus qu’il ne fallait ; il ralentit sa production ou l’arrête pour pouvoir liquider ses stocks et se régler sur la baisse de la consommation. Le ralentissement de l’activité et ses conséquences constituent ce qu’on appelle crise économique.
Comme on le voit, pour l’économie capitaliste la crise est une véritable fonction organique. Et les économistes de la bourgeoisie ont raison de dire de leur point de vue que la crise est un assainissement de l’économie momentanément engorgée. Et comme le capitalisme est incapable d’empêcher ces engorgements, les crises sont un phénomène normal et régulier résultant du fonctionnement même de l’économie capitaliste. Le capitalisme, de par sa nature même, connaîtra toujours des phases de
prospérité et de crises. Il ne peut pas vivre sans connaître ces hauts et ces bas.
Cette analyse succincte nous montre que le caractère essentiel de ce qu’on
appelle la crise générale du capitalisme ne doit pas être recherché dans l’économie.
Elle nous permet en même temps d’écarter une seconde erreur, qui consiste à voir dans la crise générale du capitalisme une crise économique plus violente que les autres et qui serait insurmontable. Mais il n’existe pas de crise permanente de surproduction, de crise économique insurmontable. Sans doute les crises économiques prennent-elles, comme nous le verrons, des caractères nouveaux dans la période de déclin du capitalisme, mais cela n’empêche pas que le mouvement de la vie économique reste fondamentalement le même et qu’une « crise » soit toujours suivie d’une « reprise » et d’une phase de « prospérité ».
La crise économique de surproduction est, et ne peut être qu’un phénomène périodique qui se reproduit régulièrement à des intervalles de sept à dix ans et qui résulte du fonctionnement, de la vie même du système capitaliste.
La crise générale du capitalisme au contraire n’est pas une crise à l’intérieur du système, mais la crise du système capitaliste lui-même ; elle affecte non seulement l’économie, mais le capitalisme pris dans son ensemble ; c’est une maladie qui s’attaque aux centres vitaux de l’organisme capitaliste et les détruit complètement ; ce n’est pas un mal passager et guérissable, mais une maladie qui ne quitte pas le malade et le conduit à la mort…
Et la mort du capitalisme, c’est la fin de la domination et de l’exploitation du prolétariat par la bourgeoisie. Le caractère essentiel de la crise générale est donc social et politique. L’examen exclusif de ses aspects économiques ne peut suffire à en rendre compte. Dire par exemple que la crise du commerce international est le phénomène le plus important de la crise générale du capitalisme dans la période qui suit la deuxième guerre mondiale est une conception « économiste » et erronée de la crise générale.
La crise générale, en réalité, c’est essentiellement la crise du pouvoir de la
bourgeoisie. Et il faut entendre le mot crise au sens non pas d’un ébranlement, mais de l’effondrement, de l’écroulement de ce pouvoir. Car depuis le début du capitalisme, la domination de la bourgeoisie a été souvent ébranlée : rappelons seulement les journées de juin 1848 et la Commune de Paris en France ; mais la crise du pouvoir de la bourgeoisie dans le monde n’a commencé réellement qu’à partir du jour où son pouvoir a été brisé, et brisé définitivement, sur une partie du globe.
Le capitalisme n’est entré ainsi dans sa crise générale qu’avec la Révolution d’octobre 1917 en Russie. Et cela non seulement parce que le pouvoir de la bourgeoisie a été jeté par terre dans un des plus grands pays capitalistes, mais parce que le prolétariat russe a construit à la place de l’ordre ancien un ordre nouveau, l’ordre socialiste qui est l’antithèse vivante de l’ordre capitaliste.
Comme l’indique avec raison Léontiev :
l’indice essentiel de la crise générale du capitalisme consiste dans la division du monde en deux systèmes, le capitalisme et le socialisme (Léontiev, L’aggravation de la crise générale du capitalisme. Paris, Éditions sociales, 1930),
et comme le précise également un éditorial du journal Pour une Paix durable :
la victoire de la grande Révolution socialiste d’octobre, qui a divisé le monde en deux camps opposés, a marqué le début de la crise générale du capitalisme ; ayant créé lès conditions de la fin inévitable et proche de ce système social, elle en hâte la fin (Pour une Paix durable, pour une Démocratie populaire, 28 avril 1950).
La rupture de l’unité du monde capitaliste, l’instauration du socialisme et
la lutte des deux systèmes constituent en effet le trait fondamental de la crise générale.
La crise générale du capitalisme nous apparaît ainsi comme un phénomène
historique, une époque particulière de l’histoire du capitalisme : c’est la période finale de l’impérialisme.
La crise générale, époque finale de l’impérialisme
L’époque de la crise générale n’est pas, dans l’histoire du capitalisme, une.
période nouvelle qui s’ajouterait aux deux époques précédentes qui sont : la
période du capitalisme de libre concurrence, qui s’est terminée dans la décade 1880-90, et la-période du capitalisme des monopoles ou période de l’impérialisme qui lui a succédé.
[Eugen Varga prétend alors déjà le contraire en URSS, puis avec le triomphe du révisionnisme Paul Boccara reprendra cette thèse en France en la développant et acquérant une stature internationale dans le camp révisionniste ; Henri Claude s’inscrira lui-même dans cette perspective.]
L’impérialisme est bien, comme l’a montré Lénine, le stade
suprême du capitalisme. La Révolution d’octobre a prouvé en effet qu’il n’y avait pas de transition entre l’impérialisme et le socialisme, que l’un menait directement à l’autre.
Mais parce que la bourgeoisie a réussi à se maintenir au
pouvoir, en dehors de l’U.R.S.S., le système impérialiste a subsisté, en gardant ses traits essentiels. Toutefois ses conditions d’existence ont radicalement changé avec l’apparition d’une nouvelle contradiction, la contradiction entre le secteur socialiste et le secteur impérialiste. Cette contradiction, d’une nature entièrement nouvelle, a fait entrer l’impérialisme dans la deuxième phase de son histoire, celle de sa crise générale.
Jusqu’alors, c’est-à-dire tant que l’impérialisme constituait un système unique, embrassant toute l’économie mondiale, il existait trois contradictions essentielles :
1° contradiction entre le prolétariat et la bourgeoisie dans les pays impérialistes ;
2° contradiction entre les États impérialistes et les pays coloniaux et dépendants ;
3° contradiction entre les États impérialistes pour un nouveau partage du
monde.
Mais il s’agissait là de contradictions inhérentes au système impérialiste
lui-même, de contradictions internes.
La quatrième contradiction au contraire n’est plus, pour reprendre l’expression de Staline, « une contradiction au sein du capitalisme ; c’est une contradiction entre le capitalisme dans son entier et le pays qui bâtit le socialisme » (Rapport au XVIe congrès du Parti Communiste de l’U.R.S.S., Deux bilans, Bureau d’Éditions, 1930, p. 14).
C’est, si l’on veut, une contradiction externe.
Cette contradiction a ceci de particulier qu’elle est insurmontable pour le capitalisme mondial et qu’elle l’entraîne irrémédiablement dans la tombe. Comment cela ?
Cela tient essentiellement à la nature de la Révolution d’octobre qu’il importe de bien préciser, car c’est elle qui donne à la crise générale du capitalisme ses traits caractéristiques. Cette Révolution a en effet une portée universelle.
Comme l’a montré Staline dans un article célèbre (Les Questions du Léninisme, Éditions sociales, 1946, t.I, pp. 186-192, toutes les citations qui suivent sont tirées de ce texte), elle n’est pas limitée au cadre national ; c’est une révolution d’ordre international, qui met en cause le pouvoir de la bourgeoisie dans le monde entier en aggravant toutes ses contradictions, et notamment en poussant au paroxysme l’antagonisme qui existe entre le prolétariat et la bourgeoisie des pays capitalistes et celui qui oppose les pays coloniaux aux États impérialistes.
« La Révolution d’octobre a inauguré une nouvelle époque, l’époque des
révolutions prolétariennes dans les pays de l’impérialisme ». En effet le fait que le prolétariat russe ait réussi à « percer le front de l’impérialisme mondial », et à « jeter bas la bourgeoisie impérialiste dans un des plus grands pays capitalistes », que « la classe des salariés, la classe des persécutés, la classe des opprimés et des exploités » se soit « élevée à la situation d’une classe dominante » est un exemple prodigieux pour les prolétaires de tous les pays.
De plus la Révolution d’octobre a montré non seulement que le prolétariat
pouvait renverser la bourgeoisie, mais aussi qu’il pouvait construire à la place de l’ordre bourgeois un ordre nouveau, socialiste.
Les succès incontestables du socialisme en U.R.S.S., dit Staline, sur le front de construction ont démontré nettement que le prolétariat peut gouverner avec succès le pays sans la bourgeoisie et contre la bourgeoisie ; qu’il peut édifier avec succès l’industrie sans la bourgeoisie et contre la bourgeoisie ; qu’il peut diriger avec succès toute l’économie nationale sans la bourgeoisie et contre la bourgeoisie ; qu’il peut édifier avec succès le socialisme malgré l’encerclement capitaliste.
Il est évident qu’un tel exemple donne confiance au prolétariat des autres
pays et l’oriente vers la voie révolutionnaire.
En transformant en propriété sociale les moyens et instruments de production appartenant aux propriétaires fonciers et aux capitalistes, en enlevant le pouvoir à la bourgeoisie, en la privant des droits politiques, en démolissant l’appareil d’État bourgeois et en transmettant le pouvoir aux Soviets, la Révolution d’octobre a ensuite montré en quoi consistait concrètement une révolution prolétarienne.
Elle a montré également au prolétariat les moyens d’y parvenir : cette révolution a été rendue possible, elle a pu triompher, puis se maintenir, dans les conditions de l’encerclement capitaliste, grâce à l’existence d’un parti révolutionnaire de type nouveau : le parti bolchevik, armé des principes du marxisme-léninisme.
Enfin elle a amené le prolétariat à faire un progrès idéologique décisif en
rompant avec le réformisme, le social-démocratisme. Or, comme le dit Staline, et comme l’expérience l’a montré :
il est impossible d’en finir avec le capitalisme sans en avoir fini avec le social-démocratisme dans le mouvement ouvrier. C’est pourquoi l’ère de l’agonie du capitalisme est en même temps celle de l’agonie du social-démocratisme dans le mouvement ouvrier.
Aussi parce qu’elle « annonce la victoire certaine du léninisme sur le social-
démocratisme dans le mouvement ouvrier mondial », la Révolution d’octobre annonce la victoire du socialisme dans tous les pays capitalistes.
Mais la Révolution d’octobre n’ébranle pas seulement le capitalisme dans les « centres de domination, dans les métropoles » ; elle frappe encore « l’arrière de l’impérialisme, sa périphérie, en sapant la domination de l’impérialisme dans les pays coloniaux et dépendants ». La Russie tzariste comprenait en effet des peuples opprimés soumis au nationalisme russe.
La Révolution d’octobre a délivré définitivement ces peuples de l’oppression nationale et coloniale et en même temps a montré la voie à la suppression définitive de cette oppression. Les peuples opprimés de la Russie tzariste ne se sont pas libérés en effet sur la base du nationalisme en essayant de prendre une revanche sur le peuple russe et en devenant à leur tour de nouveaux foyers d’oppression, mais au contraire sur la base de l’internationalisme :
Le trait caractéristique, dit Staline, de la Révolution d’octobre, c’est qu’elle a accompli en U.R.S.S. ces révolutions nationales et coloniales, non sous le drapeau de la haine nationale et des conflits entre nations, mais sous le drapeau d’une confiance réciproque et d’un rapprochement fraternel, des ouvriers et des paysans des nationalités habitant l’U.R.S.S., non pas au nom du nationalisme, mais au nom de l’internationalisme.
Précisément parce que les révolutions nationales et coloniales se sont faites, chez nous, sous la direction du prolétariat et sous le drapeau de l’internationalisme, précisément pour cette raison les peuples parias, les peuples esclaves se sont, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, élevés à la situation de peuples réellement libres et réellement égaux, gagnant par leur exemple les peuples opprimés du monde entier.
C’est dire que la Révolution d’octobre a inauguré une nouvelle époque, l’époque des révolutions coloniales dans les pays opprimés du monde, en alliance avec le prolétariat, sous la direction du prolétariat.
La conséquence, c’est qu’
en jetant la semence de la révolution aussi bien dans les centres qu’à l’arrière de l’impérialisme en affaiblissant la puissance de l’impérialisme dans les « métropoles » et en ébranlant sa domination dans les colonies, la Révolution d’octobre a, de ce fait, mis en question l’existence même du capitalisme mondial dans son ensemble.
En effet la victoire de la Révolution d’octobre, en arrachant au système impérialiste mondial un pays aussi vaste que la Russie tzariste et aussi important pour « l’équilibre » du système impérialiste, en tant que territoire d’exploitation pour le capital français, anglais, allemand, en tant que source de matières premières et bastion de la réaction politique dans le monde, a accéléré, comme nous le verrons, le processus de décomposition et de putréfaction qui est né et s’est développé dans la phase précédente de l’impérialisme, et sapé de ce fait les fondements mêmes de l’impérialisme mondial.
En même temps la Révolution d’octobre a donné au mouvement révolutionnaire mondial, pour la première fois, une base qui lui sert d’appui et de soutien et un centre autour duquel il peut se grouper « en organisant le front révolutionnaire unique des prolétaires et des peuples opprimés de tous les pays contre l’impérialisme ». Or ce front unique n’avait jamais pu se réaliser auparavant.
Comme elle élève également « la force et l’importance, le courage et la combativité des classes opprimées du monde entier », en créant pour elles « un phare éclairant leur chemin et leur révélant, des perspectives », « un forum universel ouvert » pour manifester et matérialiser leurs aspirations et leur volonté, on peut dire avec Staline :
La Révolution d’Octobre a porté au capitalisme mondial une blessure mortelle, dont il ne se remettra jamais ; l’ère de la stabilité du capitalisme est révolue, emportant avec elle la légende de l’immuabilité du monde bourgeois, l’ère est venue de l’effondrement du capitalisme.
[En effet] le capitalisme peut se stabiliser partiellement, il peut rationaliser sa production, livrer la direction du pays au fascisme, réduire momentanément la classe ouvrière, mais jamais plus il ne recouvrera ce « calme » et cette « assurance », cet « équilibre » et cette « stabilité » dont il faisait parade autrefois, car la crise du capitalisme mondial a atteint un degré de développement tel que les feux de la révolution doivent inévitablement s’ouvrir un passage, tantôt dans les centres de l’impérialisme, tantôt dans sa périphérie, réduisant à néant les rapiéçages capitalistes et hâtant de jour en jour la chute du capitalisme.
L’époque de la crise générale du capitalisme ou deuxième phase de l’impérialisme est donc bien la phase terminale de ce système. Mais l’analyse que nous venons de faire nous montre aussi que cette période appartient en réalité à deux époques différentes de l’histoire humaine. Si elle appartient encore d’un côté au capitalisme, elle appartient aussi déjà au socialisme.
La Révolution d’octobre, en abolissant le règne de l’exploitation de l’homme par l’homme, en remplaçant la démocratie bourgeoise par la démocratie prolétarienne, en construisant une économie planifiée sur la base de la socialisation des moyens de production, en réalisant l’union, au sein d’un État multinational d’un type nouveau, d’ouvriers et de paysans appartenant aux peuples les plus divers, en mettant fin à l’oppression nationale et raciale et aux haines qui en découlent, a fait entrer l’humanité dans l’ère du socialisme.
Dès lors, l’humanité n’a plus à « inventer » ou à « créer » le socialisme, elle n’a plus qu’à étendre au monde entier ce qui est réalisé sur une partie de la planète. Car entre l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques et « l’union des travailleurs de tous les pays dans une seule économie mondiale », il n’y a qu’une différence de quantité et non une différence de nature.
L’époque du socialisme a donc commencé en 1917 et la période actuelle en
est une partie intégrante, comme elle fait aussi partie de l’époque de l’impérialisme. Il faut bien mettre en relief cette double appartenance : car l’essentiel des efforts de la réaction mondiale et des agents avoués ou non, conscients ou non de l’impérialisme (fascistes, sociaux-démocrates de droite, trotskystes) consiste aujourd’hui à dénaturer le caractère de la crise générale du capitalisme en lui enlevant son appartenance au socialisme, c’est-à-dire en niant le caractère socialiste de l’U.R.S.S. et en rejetant dans l’avenir l’ère du socialisme.
Mais indiquer la double appartenance ne suffit pas pour définir l’époque de la crise générale ; il faut aussi montrer que des deux, c’est l’appartenance au socialisme qui est déterminante.
Car les économistes marxistes qui font remonter le début de la crise générale au début de l’impérialisme, comme [Eugen] Varga, ou qui voient davantage l’aspect économique que le caractère politique de la crise générale, qui grossissent d’une manière ou d’une autre l’appartenance « impérialiste » de l’époque de la crise générale et estompent de ce fait son autre appartenance, tombent sans s’en rendre compte dans le jeu de leurs adversaires.
Une définition correcte de la crise générale du capitalisme doit en effet être
faite par rapport à l’avenir et non pas par rapport au passé, par rapport au
socialisme et non par rapport au capitalisme. La période de la crise générale du capitalisme peut ainsi se définir comme la période de transition entre le socialisme dans un seul pays et le socialisme dans le monde entier, entre le succès localisé du socialisme et son triomphe universel.
II. — TRAITS PARTICULIERS DE L’IMPÉRIALISME
A L’ÉPOQUE DE LA CRISE GÉNÉRALE
Maintenant que nous avons dégagé le caractère essentiel de la période de la
crise générale, nous pouvons analyser sans erreur grave les modifications qui se produisent au sein du système impérialiste au cours de sa deuxième période.
Du point de vue économique, la période de la crise générale du capitalisme
est caractérisée par le renforcement des caractères de l’impérialisme dégagés par Lénine et par l’aggravation des conditions de fonctionnement de l’économie capitaliste, par l’accentuation de sa décomposition et de son parasitisme.
La domination des monopoles, trait essentiel de l’impérialisme, s’affirme toujours davantage dans la période de crise générale.
Depuis la première guerre mondiale la puissance des monopoles s’est en effet accrue de façon considérable : la concentration de la production, le développement sous tous les rapports (dimensions, quantité, importance) des monopoles industriels (cartels, trusts, syndicats) et des monopoles bancaires, la monopolisation de la richesse nationale par le capital financier se sont accélérés dans des proportions énormes (pour les détails, voir Varga et Mendelsohn [qui tous deux sont alors déjà révisionnistes] : Données complémentaires à « l’impérialisme » de Lénine, pp. 317 a 339).
A cette accélération de la vitesse de développement des monopoles s’ajoute un second caractère, plus spécifique encore de la crise générale, à savoir la transformation de plus en plus poussée du capitalisme monopoliste en capitalisme monopoliste d’État.
Il ne s’agit pas là d’une tendance nouvelle, puisqu’elle a déjà été décelée
par Lénine, mais elle prend des proportions inconnues jusqu’alors. Il faut souligner que si cette transformation se produit pendant les guerres mondiales, elle se survit dans les périodes dites de « paix ». L’économie allemande sous Hitler, l’économie italienne sous Mussolini sont des types d’économie propres à la crise générale du capitalisme.
Mais ce ne sont pas là des « accidents » : le capitalisme monopoliste d’État se retrouve dans tous les pays capitalistes à un degré plus ou moins grand et tend à devenir la forme universelle et spécifique dé l’impérialisme dans la période de crise générale. Les commandes de l’État (grands travaux et surtout armements) jouent un rôle de plus en plus grand dans la formation des profits du capital financier, comme le montre l’importance croissante des dépenses gouvernementales.
Corrélativement, « l’union personnelle » de l’oligarchie financière avec le gouvernement se développe de façon considérable. Après la deuxième guerre mondiale, aux Etats-Unis les postes les plus importants du gouvernement et de l’appareil d’État sont occupés par les financiers et les industriels les plus en vue et cette « occupation » prend un caractère permanent (pour les détails, voir mon livre : Où va l’impérialisme américain).
Ce phénomène montre que le capitalisme, à l’époque de la crise générale, est définitivement mûr pour le socialisme. Car, comme l’a dit Lénine :
le capitalisme monopoliste d’État est la préparation matérielle la plus complète pour le socialisme, il est le seuil du socialisme.
La domination ainsi accrue du capital monopoleur a aggravé les tendances à la décomposition et au parasitisme propres à l’impérialisme à un degré tel que des phénomènes nouveaux sont apparus.
La décomposition du capitalisme
1. L’instabilité, une instabilité grandissante, apparaît comme un des traits
les plus caractéristiques du système capitaliste à l’époque de sa crise générale.
Cette instabilité ne tient pas seulement, comme nous l’avons souligné, à la victoire de la Révolution d’octobre, mais aussi aux lois et aux contradictions propres à l’impérialisme lui-même, qui en font l’époque des « guerres et des révolutions », et aux aspects particuliers que prend l’inégalité de développement des pays impérialistes dans la période de crise générale.
Une réduction aussi sensible de la sphère d’exploitation que la perte, d’un
sixième du globe a rendu beaucoup plus violente la lutte pour l’écoulement des marchandises, pour le placement des capitaux et pour l’accaparement des matières premières. D’où l’aggravation des antagonismes entre puissances impérialistes et la nécessité de nouvelles guerres.
Mais cette instabilité est aussi une conséquence des guerres mondiales, qui
ont eu une influence décisive sur l’inégalité de développement des pays capitalistes. Privés des produits de l’industrie européenne, des pays agraires ou producteurs de matières premières installent des industries de transformation qui ferment des débouchés à la production de l’Europe ; une jeune bourgeoisie nationale, naît, qui entre en concurrence et en conflit avec les bourgeoisies européennes.
La guerre a permis ensuite à certains pays capitalistes de se développer,
pendant que d’autres régressaient à la suite des défaites militaires ou de la ruine financière. Après la première guerre mondiale, l’Allemagne a perdu toutes ses colonies et ses capitaux placés à l’étranger. Étant donné la place qu’elle occupait avant la guerre dans le monde capitaliste, cette déchéance ne pouvait manquer d’ébranler la stabilité de l’économie capitaliste.
La politique de rapine des vainqueurs a déchaîné en même temps des antagonismes violents entre pays vainqueurs et pays vaincus, source de nouvelles guerres. Parmi les « vainqueurs », certains États impérialistes ont pu, pendant que les autres se ruinaient, développer leur industrie et leur puissance financière, comme le Japon au cours de la première et les Etats-Unis au cours des deux guerres mondiales.
La guerre a provoqué ainsi des conflits parmi les vainqueurs entre les « nouveaux riches » et les « anciens », dont la puissance économique s’est affaiblie, mais qui ont quand même agrandi leur domaine colonial comme l’Angleterre et la France à la suite de la première guerre mondiale. D’où l’aggravation de l’antagonisme entre les Etats-Unis et l’Angleterre après 1918.
Les guerres mondiales ont enfin provoqué un changement brutal dans l’évolution de l’impérialisme : le cercle des « grandes puissances » impérialistes qui s’élargissait au XIXe siècle (l’Allemagne, les Etats-Unis, l’Italie et le Japon venant prendre place aux côtés de l’Angleterre, de la France, de la Russie et de l’Autriche), s’est restreint, depuis 1914, de façon considérable.
C’est là un aspect caractéristique de l’époque de la crise générale.
Après la première guerre mondiale il n’y avait plus que cinq grandes puissances (Angleterre, France, Italie, Etats-Unis, Japon) au lieu de huit (les mêmes, plus l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Russie tzariste). Après la deuxième guerre mondiale, il n’y en a plus que deux, les Etats-Unis et en partie l’Angleterre.
Avant la première guerre mondiale, les principaux pays exploiteurs étaient
l’Angleterre, la France, l’Allemagne et en partie les Etats-Unis. Après 1918 les
principaux pays créditeurs étaient les Etats-Unis et en partie l’Angleterre. Après la deuxième guerre mondiale, les Etats-Unis sont la seule grande puissance financière. Cette concentration successive de la richesse mondiale a un pôle et l’élargissement corrélatif des pays exploités entraîne une instabilité grandissante du système capitaliste.
2. La contradiction entre les forces productrices et les rapports de production, comme conséquence de la réduction de la sphère impérialiste, de la guerre mondiale et de l’appauvrissement des masses, s’est accentuée au point qu’il s’est créé un excédent continuel de capital, qui a entraîné l’inutilisation chronique d’une partie de l’appareil de production.
C’est ainsi que dans les périodes de « prospérité » maximum du temps de paix, comme en 1929 ou 1948, une partie des moyens de production aux Etats-Unis est restée inemployée. Alors que cet excédent de capital ne se produisait, avant la crise générale du capitalisme, qu’au moment des périodes de crise économique de surproduction, il est devenu depuis un phénomène permanent.
3. Il en est résulté une modification du caractère du chômage. Avant la
crise générale, les chômeurs constituaient pour le capital une armée de réserve dans laquelle il puisait lorsque les commandes affluaient. Depuis la première guerre mondiale, le chômage de masse au contraire est devenu persistant : des chômeurs en grand nombre ont cessé de remplir la fonction de réserve de l’armée industrielle, ils ne sont plus jamais appelés au service actif et sont rejetés définitivement de la production.
4. La période de crise générale a été marquée en conséquence par un ralentissement économique et un piétinement de la production. Alors que dans les seize années d’avant-guerre (1897-1913), les productions mondiales de fonte et de houille augmentaient respectivement de 140 % et de 108 %, elles n’augmentaient plus dans le même laps de temps, de 1913 à 1929, que de 23,8 % pour la première et 7,2 % pour la seconde.
De même, comme le note Léontiev, alors que la production industrielle, pendant les vingt-trois années précédant la première guerre mondiale, s’accroissait en moyenne de 5,8 % par an, dans les vingt-trois années qui ont suivi (1914-1937) elle n’a été que de 1,5 %.
Depuis la première guerre mondiale, l’industrie des principaux pays capitalistes n’a cessé de piétiner autour du niveau de 1913, ne dépassant ce niveau au bout de vingt-cinq ans que de 20 à 30 % : augmentation dérisoire;, sinon nulle, si l’on tient compte de ce que la population du monde capitaliste s’est accrue de 15 % environ et qu’une part grandissante de la production était utilisée à des buts de guerre. On peut en conclure avec Léontiev que
la production industrielle par tête d’habitants n’a pas augmenté en un quart de siècle, mais elle a même vraisemblablement diminué.
5. La première guerre mondiale a, été suivie d’une crise agraire prolongée,
qui est une caractéristique nouvelle de la crise générale. En effet pendant les hostilités, les pays d’outre-Atlantique ont augmenté la superficie des terres emblavés ; lorsque la production européenne réduite par la guerre s’est relevée, une partie de la surface mondiale emblavée s’est trouvée superflue. D’autre part les textiles artificiels ont entraîné la mévente du coton.
6. Ces divers phénomènes ont eu des répercussions sensibles sur les crises
économiques de surproduction et sur le déroulement du cycle économique.
La crise industrielle, dit Staline à propos de la crise de 1929, s’est déchaînée dans les conditions de la crise générale du capitalisme, au moment où celui-ci n’a déjà plus et ne peut plus avoir, ni dans les principaux pays, ni dans les colonies et pays vassaux, la force et la solidité qu’il avait avant la guerre et avant la Révolution d’Octobre ; où l’industrie des pays capitalistes a reçu, en héritage de la guerre impérialiste, un ralentissement chronique des entreprises et une armée de millions de chômeurs, dont elle n’est plus en mesure de s’affranchir (Deux bilans, pp. 5-6).
En conséquence la crise économique de 1929, première crise mondiale de
l’époque de la crise générale a été beaucoup plus profonde, plus aiguë, plus
prolongée et plus dévastatrice que les crises antérieures.
A l’époque du capitalisme industriel et de la libre concurrence, la crise
n’était jamais qu’un ralentissement momentané du rythme de croissance. Dans la période de l’impérialisme antérieure à la crise générale, que nous appellerons la première période de l’impérialisme, la production diminue, mais le recul dans la crise la plus forte (1907-08) atteint à peine la moitié de celui des années 1929-33.
Ensuite l’économie capitaliste a beaucoup plus de mal à sortir de la crise.
La phase de crise proprement dite (1929-1933) est bien suivie, comme dans les crises précédentes, d’une phase de dépression (1934-35), puis d’animation (1930) et de prospérité (1937), mais il s’agit, comme le notait Staline à l’époque, d’une dépression « sortant de l’ordinaire, d’une dépression d’un genre particulier », qui fut suivie non d’une véritable animation mais d’une « certaine » animation, puis d’un « certain » essor, puisque l’indice de la production industrielle en 1937 reste, aux Etats-Unis, au-dessous de celui de 1929.
Alors que, dans la première période de l’impérialisme, il suffisait d’un ou deux ans pour que la production retrouve le niveau maximum atteint antérieurement, il n’a pas fallu moins de cinq ans (1932-37) pour qu’elle y parvienne après la crise de 1929.
Enfin l’essor de 1937 ne s’est pas prolongé : il était si fragile que l’année
suivante la crise reprenait. La crise de 1938 avait ceci de particulier qu’elle
n’avait pas été précédée, comme les crises antérieures, d’une période de prospérité. Elle eut ensuite cette autre particularité d’être suivie d’une phase de prospérité également particulière, puisque ce fut celle des années de guerre 1939-45.
Le principal pays capitaliste, les Etats-Unis, ne connut en fait de nouvelle période de prospérité, après 1929, que dans la deuxième guerre mondiale.
Ainsi la guerre mondiale tend à constituer la phase de prospérité du cycle économique à l’époque de la crise générale du capitalisme.
L’industrie des pays capitalistes continue sa marche cyclique, mais le cycle
est radicalement déformé. Ce phénomène, comme le note justement Léontiev, est encore plus visible après la deuxième guerre mondiale :
La crise actuelle de surproduction, écrit-il, s’avance sur le monde capitaliste, non après une phase d’essor, mais après le boum spéculatif de courte durée qui eut lieu après la guerre sous l’effet de circonstances spécifiques en même temps qu’éphémères.
Cette déformation du cycle montre clairement l’affaiblissement général de la base économique» du capitalisme, sa précarité et sa putréfaction intérieure (L’aggravation de la crise générale du capitalisme, p. 44).
Mais si les divers éléments de la crise générale influent sur la gravité des
crises économiques, celles-ci, à leur tour, approfondissent et aggravent la crise générale dans tous ses domaines : politiques d’abord, en poussant les masses dans la voie de la révolution, économiques ensuite en ébranlant encore davantage les bases du système.
Il y a interaction constante et réciproque de la crise
générale sur la crise économique, et de la crise économique sur la crise générale.
7. On ne s’étonnera donc pas de constater dans ces conditions des bouleversements inconnus jusque-là et incessants dans la sphère de la circulation. A la stabilité et h l’unité monétaires qui règnent au cours du XIXe siècle et jusqu’à 1914 succèdent l’instabilité et le chaos des monnaies après la première guerre mondiale, au cours de la crise de 1920, puis au lendemain de la deuxième guerre mondiale, qui s’expriment dans des dévaluations répétées, dans la cessation de la convertibilité en or des billets de banque, la désorganisation du marché mondial.
Le monde capitaliste ne peut plus retrouver l’équilibre des balances de paiement d’avant la première guerre mondiale ; en provoquant l’industrialisation des pays agraires d’Amérique et d’Asie, il a brisé les circuits d’échanges qui s’étaient constitués entre les produits manufacturés européens et les matières premières d’outre-mer.
La crise des échanges internationaux est un phénomène spécifique de la
crise générale, qui se manifeste :
a) par la diminution du volume des échanges de marchandises à partir de 1929. Alors que le commerce international s’est accru régulièrement pendant tout le XIXe siècle jusqu’à 1913, cet essor a pris fin avec la crise économique de 1929, il a baissé considérablement depuis lors et malgré une certaine reprise en 1937 n’a jamais retrouvé le niveau de 1929.
Il s’agit là d’un phénomène qui met particulièrement en relief la décadence du système capitaliste ; car comme le dit Lénine, « l’extension des échanges tant nationaux qu’internationaux surtout est un des traits distinctifs du capitalisme » (Données complémentaires à « l’’Impérialisme » de Lénine, p.166).
La réduction des échanges internationaux est par là-même un des traits distinctifs du capitalisme agonisant.
b) par la dégradation des échanges qui s’exprime dans la disparition du
système d’échanges multilatéraux d’avant 1914 et dans la politique commerciale des Etats-Unis depuis 1919 et surtout depuis la deuxième guerre mondiale, et qui consiste à vendre sans acheter. Ce « commerce » unilatéral est évidemment la négation de tout commerce.
3. Cet état de choses a des répercussions sur l’exportation des capitaux,
dont le rôle ne s’est pas modifié, qui est toujours aussi nécessaire pour l’impérialisme, mais qui se heurte à tous les obstacles nouveaux soulevés par la crise générale du capitalisme et que nous venons d’énumérer : rétrécissement de la sphère capitaliste, crise du pouvoir de la bourgeoisie en Europe, révoltes coloniales, désorganisation des échanges commerciaux, dépréciations monétaires, interdiction des exportations d’or, refus de reconnaître les dettes étrangères, etc.
La conséquence en est un ralentissement de la cadence d’exportation des capitaux par rapport à l’avant-guerre, dans la période 1920-29, puis, après la crise économique, la diminution et même la cessation des investissements privés à long terme à l’étranger.
On voit alors, de 1929 à 1939, une masse de capital disponible
circuler de pays en pays à la recherche d’un placement spéculatif, s’investissant à court terme et contribuant à aggraver encore plus l’instabilité monétaire.
C’est l’État qui prend alors les risques de l’exportation du capital. Les États-
Unis, principal pays exportateur après 1918, créent dans ce but l’Export-Import Bank ; et, à la suite de la deuxième guerre mondiale, octroient des crédits énormes à tous les pays capitalistes et semi-coloniaux (Plan Marshall, etc.).
Si les investissements privés américains à long terme reprennent à partir de 1945, ils restent extrêmement faibles par rapport à l’exportation de capitaux gouvernementaux. La prédominance des crédits d’État dans l’exportation des capitaux est encore une particularité de la crise générale et un signe de sa décomposition.
Le parasitisme et la putréfaction
La période de crise générale voit une intensification extrême des phénomènes de parasitisme et de putréfaction décelés par Lénine dans l’Impérialisme.
Notons d’abord le freinage du progrès technique, la mise sous boisseau des
brevets dont la période de crise générale offre de nombreux exemples. Le signe le plus caractéristique de la décomposition du système capitaliste est le fait que la technique ne se développe pleinement que pendant la guerre (aviation, industrie chimique, T.S.F. pendant la première guerre mondiale ; énergie atomique, radar. etc…, pendant la deuxième) ou à cause de la guerre (c’est le cas particulier de la fabrication d’essence et de caoutchouc synthétiques et autres produits de synthèse par l’Allemagne hitlérienne, puis par ses concurrents impérialistes).
L’exemple le plus monstrueux de cette décomposition d’un régime est celui
de l’énergie atomique, une des plus grandes découvertes de l’histoire humaine, qui, aux Etats-Unis, n’est employée que dans des buts de destruction.
Ce parasitisme se manifeste également :
— par le retard accru des campagnes sur les villes, et de l’agriculture sur l’industrie, malgré les progrès de l’agriculture capitaliste, qui d’ailleurs se produisent surtout pendant les guerres ou à cause de la guerre ;
— par l’augmentation des bénéfices capitalistes pendant la guerre ou pendant que l’économie traverse une période de décroissance : en 1948 par exemple les bénéfices des sociétés américaines ont dépassé de deux fois ceux de 1944, alors que la production était inférieure de 20 % ;
— par la diminution non plus seulement relative mais parfois absolue du
nombre de travailleurs industriels et l’augmentation de la population employée à la distribution (commerce, services civils, services domestiques et professionnels, etc.) ;
— par l’énormité des frais die publicité qui prennent des proportions
inconnues dans la période antérieure (presse, radio, etc.).
Enfin le caractère destructeur de l’impérialisme s’affirme avec une violence
sans précédent : les destructions de stocks, de moyens de production, de main d’œuvre (chômage) pendant la crise de 1929-33 atteignent une ampleur sans exemple dans l’histoire du capitalisme : les économistes bourgeois estiment que cette crise a coûté autant que la première guerre mondiale.
Mais c’est encore la guerre qui est le principal moyen de destruction des
forces productives.
Les guerres mondiales ne sont pas un phénomène spécifique de la crise
générale ; elles sont une conséquence de la fin du partage du monde, qui est
une des caractéristiques essentielles de l’impérialisme.
Mais la prospérité des monopoles est à ce point liée à la guerre (la capacité
de production n’est utilisée à plein, le chômage n’est résorbé que pendant la
guerre ; la guerre et ses conséquences directes tendent à constituer la phase de prospérité des cycles industriels) et les contradictions de l’impérialisme sont devenues si aiguës que :
a) la période qui sépare les guerres mondiales n’est pas une période de
paix, mais remplie de « petites » guerres et, après chaque guerre mondiale, les dépenses militaires sont toujours supérieures à ce qu’elles étaient avant le déclenchement des hostilités ;
b) les guerres mondiales elles-mêmes sont de plus en plus destructrices (le
nombre des tués est passé de 10 à 50 millions et les dépenses de 200 milliards de dollars à 1000 milliards, de la première à la deuxième guerre mondiale) et de plus en plus rapprochées : comme le montre la volonté des impérialistes américains de déclencher cinq ans après la fin de la deuxième une troisième guerre mondiale.
Le régime bourgeois est donc devenu, à l’époque de la crise générale, non
seulement un obstacle au progrès de l’humanité, mais un danger pour l’existence même de l’humanité. L’exploitation de l’homme est maintenant inséparable de la destruction de l’homme. Le capitalisme, à l’époque de la crise générale, se caractérise comme le régime de la destruction de l’homme par l’homme.
Supprimer le capitalisme n’est plus seulement une action progressive ; c’est une mesure de salut public.
Mais le capitalisme précipite ainsi sa disparition. A l’époque de la crise
générale, qui voit la concentration extrême de la richesse à un pôle et de la
misère à l’autre, les rapports sociaux arrivent à une tension extrême, le joug du capital devient insupportable non seulement à la classe ouvrière, mais aussi aux classes moyennes à la ville et à la campagne. La préparation de la prochaine guerre et les frais des guerres passées écrasent toutes les couches de la population, en dehors de l’oligarchie financière, du capital cosmopolite.
L’inflation et les dévaluations ruinent toute la couche des petits rentiers. Ensuite, pendant la guerre, l’impérialisme fait subir à l’ensemble des masses des souffrances terribles. Mais il donne ainsi des alliés à la classe ouvrière, dans la lutte révolutionnaire. La conclusion de ces alliances est un trait distinctif de la crise générale du capitalisme, qui en fait l’époque des révolutions prolétariennes victorieuses, car l’alliance des ouvriers, des paysans et des classes moyennes, comme le prouve la Révolution d’octobre, signifie la mort de l’impérialisme.
Pour empêcher cette alliance et la révolution socialiste, le grand capital n’a
plus qu’un moyen : la démagogie et les méthodes du fascisme, à l’aide desquelles il utilise, en se servant d’une terminologie « révolutionnaire » et « socialiste », le mécontentement des paysans et de la petite bourgeoisie des villes pour écraser le mouvement ouvrier et régner par la terreur.
Déjà Lénine avais montré que l’impérialisme, c’était « la réaction sur toute
la ligne, quel que soit le régime politique » (L’impérialisme. Données complémentaires, p. 292). Et il avait montré le tournant politique de la bourgeoisie, lors du passage de la libre concurrence au monopole.
Le tournant de la démocratie à la réaction politique représente la superstructure politique de l’économie nouvelle du capitalisme monopoliste (l’impérialisme, c’est le capitalisme des monopoles).
A la libre concurrence correspond la réaction politique (Œuvres complètes, t.XIX, Édition russe, cité par Ségal : Principes d’économie politique, p.350).
Jusqu’à 1914 toutefois, cette réaction s’était exercée dans le cadre du parlementarisme. A l’époque de la crise générale, la bourgeoisie est obligée de renoncer à la démocratie formelle, et de recourir à la dictature terroriste ouverte.
Le fascisme est la forme politique type de la domination des monopoles à
l’époque de la crise générale : c’est, en effet exactement la superstructure politique du capitalisme monopoliste d’État.
Il n’est pas étonnant que le capitalisme américain, à la suite de la deuxième
guerre mondiale, en même temps qu’il prend de plus en plus le caractère d’un capitalisme monopoliste d’État, s’engage dans la voie de fascisation intégrale de l’appareil d’État (pour les développements, voir mon livre : Où va l’impérialisme américain).
Mais le fascisme, s’il permet à la bourgeoisie de faire reculer momentané-
ment la révolution qui s’avance, est en réalité non pas une preuve de force,
mais un symptôme de faiblesse.
Il faut, dit Staline, regarder la victoire du fascisme en Allemagne, non seulement comme un signe de faiblesse de la classe ouvrière et le résultat des trahisons perpétrées contre celle-ci par la social-démocratie qui a frayé la route au fascisme.
Il faut la considérer également comme un signe de faiblesse de la bourgeoisie, comme un signe montrant que cette dernière n’est plus en état d’exercer son pouvoir au moyen des anciennes méthodes de parlementarisme et de démocratie bourgeoise, ce qui l’oblige à recourir, dans sa politique intérieure, aux méthodes de domination par la terreur, comme un signe qu’elle n’a plus la force de trouver une issue à la situation actuelle sur la base d’une politique extérieure de paix, ce qui l’oblige à recourir à la politique de guerre.
En même temps les États impérialistes, non seulement renforcent l’exploitation des travailleurs des pays coloniaux et semi-coloniaux, mais s’en servent également comme mercenaires. Mais ce n’est pas impunément que ces peuples sont à leur tour entraînés dans la guerre ; car ils apprennent à se servir des armes modernes et les tournent contre leurs oppresseurs.
Avec la crise générale commencent ainsi les soulèvements armés qui entraînent les États impérialistes dans des guerres coloniales de longue durée, d’où ils sortent finalement vaincus, comme le montre l’exemple historique de la révolution chinoise que l’impérialisme n’a pas réussi à écraser au bout de vingt années de guerre, et qui a balayé l’impérialisme après la deuxième guerre mondiale.
III. LE DÉVELOPPEMENT DE LA CRISE GÉNÉRALE
De la. victoire du socialisme en Union soviétique
à sa victoire à l’échelle mondiale.
On ne peut avoir une idée exacte de la crise générale du capitalisme si on
ne l’étudie pas dans son développement. Cette étude est essentielle pour un
marxiste, car elle permet de faire le point de la situation et d’orienter dans la voie juste l’action révolutionnaire.
Ce qui doit nous guider dans la détermination des différentes étapes de la
période de crise générale, c’est évidemment la définition que nous avons donnée de cette crise.
En conséquence, c’est le développement du secteur socialiste,
c’est-à-dire l’accroissement de la puissance économique, politique et militaire de l’U.R.S.S., ses progrès dans la voie du communisme ; l’extension géographique du secteur socialiste ; le renforcement idéologique et numérique des partis communistes ; la régression de l’influence réformiste dans les pays capitalistes et, ce, qui résulte de tout cela, l’évolution du rapport des forces entre les deux systèmes, qui nous indiqueront les stades successifs de la crise du système capitaliste.
Vue sous cet angle, la crise générale présente deux périodes distinctes. La
première, qui va de 1917 à la deuxième guerre mondiale, est celle de la brèche unique dans la citadelle capitaliste, celle du socialisme dans un seul pays, au cours de laquelle le capitalisme s’efforce en vain de détruire le nouvel État, mais pendant laquelle le rapport des forces reste cependant favorable au capitalisme.
La deuxième, qui commence avec la deuxième guerre mondiale ou plus
exactement avec les résultats de cette guerre, est celle des brèches multiples
dans la citadelle capitaliste, du socialisme dans plusieurs pays, où l’avantage clans le rapport des forces entre les deux systèmes passe du côté du socialisme et au cours de laquelle l’impérialisme essaie en vain de redresser la situation et succombera définitivement dans ses tentatives.
A. — La première période (1917-1941)
Elle comprend trois parties :
1. 1917-1923. La Révolution d’octobre ouvre une crise révolutionnaire gigantesque : la révolution éclate en Allemagne, en Hongrie, en Autriche ; des mouvements de libération nationale se produisent clans les pays coloniaux et semi-coloniaux, notamment en Syrie, au Maroc, en Chine.
De grandes grèves se déroulent en Angleterre, en France, en Italie et aux Etats-Unis.
Le capitalisme est en même temps ébranlé par les difficultés économiques :
crise de 1920-21, désorganisation des échanges, inflation. Sa stabilité est ébranlée par la montée brusque du capitalisme américain, l’effondrement de l’Allemagne, la désorganisation de l’ancien empire austro-hongrois, etc.
Mais, grâce à l’appui de la social-démocratie dont l’influence est encore
puissante, la bourgeoisie parvient à briser les mouvements révolutionnaires sauf en U.R.S.S. L’écrasement de la Révolution allemande en 1923 marque la fin de cette période, qui se solde en définitive à l’avantage du socialisme par deux gains d’une importance décisive pour l’avenir du capitalisme : la victoire et le renforcement de la dictature du prolétariat en U.R.S.S. malgré l’assaut des puissances impérialistes, et la création de partis communistes marxistes-léninistes dans la plupart des pays capitalistes.
2. 1923-1929. C’est la période dite de stabilisation : stabilisation du capitalisme et du régime soviétique et stabilisation des rapports entre les deux systèmes.
Dans les pays capitalistes européens, la bourgeoisie reconstitue l’économie
ruinée par la guerre et consolide, relativement à la période précédente et dans une certaine mesure, sa domination politique : les surprofits tirés à nouveau de la surexploitation des peuples coloniaux lui permettent de soutenir la social-démocratie et le réformisme dans le mouvement ouvrier.
La production industrielle dépasse le niveau atteint pendant la guerre ou l’avant-guerre. Entre les États impérialistes, les liens économiques rompus par la guerre se rétablissent tant bien que mal et les impérialistes finissent par conclure des accords provisoires sur le pillage en commun de l’Allemagne (plans Dawes et Young) et des colonies.
Enfin les impérialistes renoncent, à la suite de leur échec, à l’agression et même au blocus économique de l’U.R.S.S. et nouent avec elle des rapports commerciaux.
Cette période marque-t-elle une régression ou un ralentissement de la crise générale ? En aucune façon.
D’abord, l’établissement de rapports, pacifiques entre les deux systèmes est
toujours un facteur positif pour le régime socialiste qui peut se consacrer davantage à son développement intérieur et marque un échec des cercles impérialistes les plus réactionnaires. Ensuite et surtout, la nature des deux stabilisations est complètement différente.
La stabilisation en régime capitaliste, dit Staline, se traduisant par le renforcement momentané du capital, aboutit nécessairement à l’aggravation des contradictions du capitalisme […].
Par contre, renforçant le socialisme, la stabilisation en régime soviétique doit nécessairement aboutir à l’atténuation des contradictions et à l’amélioration des rapports : a) entre le prolétariat et la paysannerie de notre pays ; b) entre le prolétariat et les peuples coloniaux des pays opprimés ; c) entre la dictature du prolétariat et les ouvriers de tous les pays.
Le fait est que le capitalisme ne peut se développer sans intensifier l’exploitation de la classe ouvrière, sans maintenir dans un état de demi-famine la grande majorité des travailleurs, sans renforcer l’oppression des pays coloniaux et vassaux, sans entraîner des conflits et des chocs entre les divers groupements impérialistes de la bourgeoisie.
Le régime soviétique et la dictature du prolétariat, au contraire, ne peuvent se développer que par l’élévation constante du niveau matériel et moral de la classe ouvrière, par l’amélioration continue de la situation des travailleurs du pays soviétique, par le rapprochement progressif et l’union de tous les ouvriers de tous les pays, par le ralliement des colonies et des pays vassaux opprimés autour du mouvement révolutionnaire du prolétariat.
Le développement du capitalisme est synonyme d’appauvrissement et de misère pour la grande majorité des travailleurs, de situation privilégiée pour une infime catégorie de travailleurs corrompus par la bourgeoisie.
Le développement de la dictature du prolétariat, au contraire, est synonyme d’un relèvement continu du bien-être de l’immense majorité des travailleurs (Rapport au XIVe congrès du Parti communiste de l’U.R.S.S.).
En effet les bases économiques de la « stabilisation » capitaliste furent la
transformation de l’appareil de production américain, connue sous le nom de rationalisation, et l’investissement de capitaux américains en Europe. La stabilisation reposait ainsi sur l’exploitation plus intense des travailleurs américains et des travailleurs européens ainsi que ceux de tous les pays soumis au capitalisme.
Aussi la lutte de classes ne s’apaise-t-elle pas, comme le montrent la
grève des mineurs en Angleterre, en 1926, la lutte armée des ouvriers de Vienne eu juillet 1927.
En même temps, dans les pays coloniaux, la révolution chinoise se développe, une insurrection se produit en Indonésie, un mouvement révolutionnaire grandit aux Indes.
L’instabilité du capitalisme s’accroît à la suite de nouvelles inégalités dans
le développement des pays capitalistes (les Etats-Unis se développent plus vite pue les pays européens, le Japon plus vite que les Etats-Unis, la France plus vite que l’Allemagne, alors que c’était le contraire avant la guerre ; l’Angleterre piétine) ; et par suite du déséquilibre causé dans les échanges par l’excédent du commerce américain et la position financièrement créditrice des Etats-Unis.
Cela entraîne une aggravation des antagonismes entre les pays, capitalistes
malgré toutes les conférences de paix, comme le montrent la concurrence
acharnée que se livrent les Etats-Unis et l’Angleterre pour les matières premières et les marchés, les conflits entre les créditeurs américains et les débiteurs européens, la rivalité entre le Japon et les Etats-Unis dans le Pacifique, etc..
La stabilisation capitaliste n’était en réalité qu’une stabilisation partielle et provisoire, sans aucune solidité et qui préparait une crise économique plus grave.
Pendant ce temps, l’U.R.S.S. réalise les conditions politiques et matérielles qui vont lui permettre d’entreprendre la construction du socialisme : grâce à la victoire sur le trotskysme de la conception léniniste, soutenue par Staline, concernant la possibilité du socialisme en U.R.S.S. et grâce à l’augmentation de la production industrielle et agricole, dont le rythme dépasse déjà celui de tous les pays capitalistes.
Parallèlement, les partis communistes qui sont nés dans
la période précédente se consolident intérieurement (élimination du trotskysme, des déviations petites-bourgeoises et sectaires).
En France notamment c’est, avec l’accession de Maurice Thorez à la direction du parti, le triomphe du courant prolétarien et léniniste et la défaite des cliques policières Celor-Barbé qui stérilisaient l’action du parti.
L’élaboration du premier plan quinquennal grâce au renforcement de
l’U.R.S.S. et la consolidation intérieure des partis communistes sont deux grands pas de plus faits sur le chemin du socialisme, et par conséquent les deux faits positifs qui marquent l’aggravation de la crise générale du capitalisme de 1923 à 1929.
3. 1929-1941. C’est une période de profonde aggravation de la crise générale,
marquée par trois faits essentiels : le succès de la construction socialiste, le
contraste criant entre les lignes de développement du socialisme et du capitalisme, et l’échec des cercles les plus réactionnaires de l’impérialisme pour réaliser un front d’agression unique du capitalisme mondial contre l’U.R.S.S.
Cette période est essentiellement celle de la victoire du socialisme, en U.R.S.S. et de sa progression dans la voie du communisme, grâce au succès des premier et deuxième plans quinquennaux et à la mise en application du troisième ; c’est celle du renforcement, à un rythme absolument inconnu jusqu’alors, de la puissance économique de l’U.R.S.S., qui, de pays arriéré et agricole, devient un pays industriel et d’avant-garde, qui met en application la Constitution stalinienne de 1936 et qui renforce son unité, sa cohésion et sa force de résistance à l’agression par l’élimination des éléments contre-révolutionnaires des cadres de l’économie et de l’armée.
Dans le même temps que l’U.R.S.S. supprime définitivement le chômage et
les crises économiques, que sa production augmente à un rythme impétueux et qui ne connaît pas de ralentissement, le système capitaliste subit la plus terrible crise de surproduction de son histoire. Commencée aux Etats-Unis, la crise industrielle atteint tous les pays capitalistes sans exception et s’enchevêtre avec la crise agraire qui, elle aussi, n’épargne aucun pays et s’étend à toutes les branches de l’agriculture.
On compte en 1932, officiellement de 30 à 40 millions de chômeurs complets. Le capitalisme étale le spectacle odieux de ses destructions gigantesques (outillages jetés au rebut, bétail abattu, récolte de blé, de coton, de café brûlée), pendant que des dizaines de millions, d’hommes sont sous-alimentés.
Les courants commerciaux, péniblement et artificiellement rétablis dans la période de stabilisation, sont désorganisés : le marché international se disloque sous l’effet des contingentements, du dumping, de « l’autarcie » ; pas une monnaie ne résiste : la livre sterling abandonne la parité or ; le dollar lui-même est dévalué pour alléger la situation des débiteurs.
Tout le système bancaire américain s’effondre et n’est sauvé que par l’intervention de l’État. Enfin, après une courte et fragile reprise en 1936-37, la crise reprend en 1938.
Le développement des pays capitalistes contraste à nouveau avec la période
antérieure : l’Allemagne, grâce au réarmement, accroît sa production industrielle, tandis que celle de la France décline ; la lutte pour les marchés prend une forme suraiguë. Les impérialismes les plus défavorisés dans le partage des colonies et des sphères d’exploitation exigent ouvertement un nouveau partage du monde.
La lutte des classes s’aggrave (manifestations de chômeurs, « marches de la
faim » aux Etats-Unis, etc.). Le capitalisme ne peut sortir de ses contradictions que par le fascisme et une nouvelle guerre mondiale.
L’instauration de la dictature nazie, forme la plus achevée du fascisme, en
Allemagne en 1933 marque le courant décisif vers la guerre, dont une série de guerres partielles (guerre du Japon contre la Mandchourie et la Chine, guerre d’Éthiopie, guerre d’Espagne) constituent le prologue.
Les cercles les plus réactionnaires de l’impérialisme auraient voulu réaliser
une entente entre les différents groupes et États capitalistes pour écraser le pays du socialisme.
Mais leurs plans, malgré la non-intervention en Espagne, Munich et la « drôle de guerre », échouèrent à cause de l’opposition des forces démocratiques et de la politique des partis communistes, qui permirent la formation de Fronts populaires contre le fascisme et la guerre (journées de février 1934 en France) et à cause des oppositions d’intérêts entre les grandes puissances qui, d’accord sur la guerre contre l’U.R.S.S., ne l’étaient plus du tout pour le partage du butin.
La conséquence, c’est que l’impérialisme réussit bien à lancer l’Allemagne contre l’U.R.S.S., mais cette guerre ne se présenta pas du tout dans les conditions qu’il espérait.
D’abord l’U.R.S.S. avait pu profiter des dissensions entre ses. adversaires
pour briser l’encerclement (pacte germano-soviétique de non-agression et non-belligérance avec le Japon) et utiliser la période de répit ainsi gagnée pour hâter sa préparation militaire.
Ensuite, lorsqu’en 1941 la guerre mondiale entra dans sa phase décisive,
l’Angleterre et les Etats-Unis se trouvèrent par la force des choses des « alliés » de l’U.R.S.S. : le front impérialiste était ainsi brisé.
Enfin et surtout, les cercles impérialistes anglo-américains ne purent empêcher que cette guerre, malgré ses causes purement impérialistes et les visées réactionnaires des Churchill et des Hoover, ne prît pour les peuples d’Europe et d’Asie et pour le peuple américain le caractère d’une guerre de libération contre le fascisme.
Ainsi la crise générale du capitalisme s’était à nouveau et considérablement
approfondie.
B. — La deuxième période (1941-…)
Cette deuxième grande période de la crise générale comprend déjà plusieurs étapes :
1. 1941-46. C’est au cours de cette étape que se produit le changement
qualitatif décisif qui marque le début de la deuxième période de la crise générale, c’est-à-dire le changement radical qui se produit en faveur du socialisme dans le rapport des forces entre les deux systèmes.
Cette brusque transformation est due à deux causes essentielles : d’une part, la défaite des pays impérialistes les plus agressifs soutenus par les réactionnaires de tous les pays capitalistes, la mise hors de combat des forces principales de la réaction fasciste internationale militante, et d’autre part, le rôle décisif de l’U.R.S.S. dans cette défaite.
Non seulement, l’État Soviétique ne s’est pas disloqué sous les coups de boutoir de l’impérialisme, mais l’Armée Rouge a écrasé, à elle seule, le gros des armées ennemies. L’U.R.S.S. n’a pas seulement remporté une victoire militaire, mais une victoire politique, morale et idéologique.
« L’importance et l’autorité internationale de l’URSS, constate Jdanov, se sont considérablement accrues par suite de la guerre. » Le système socialiste, qui n’avait plus à démontrer qu’il était viable (c’était chose faite depuis le succès des plans quinquennaux) avait encore à prouver sa supériorité dans l’épreuve décisive de la guerre.
Stalingrad et les offensives victorieuses de l’Armée Rouge ont prouvé définitivement la supériorité du régime socialiste sur le régime capitaliste, en même temps que l’indestructibilité de l’État soviétique.
Les victoires de l’Armée rouge ont eu un certain nombre de conséquences
d’une grande importance qui ont encore considérablement affaibli le système capitaliste et renforcé le système socialiste.
1. Toute une série de pays d’Europe centrale et sud-orientale se sont détachés de la sphère impérialiste. Cela signifiait, d’une part, une nouvelle réduction du champ d’exploitation capitaliste, donc un affaiblissement économique et politique du capitalisme des monopoles, et une aggravation de son instabilité et, d’autre part, la suppression du « cordon sanitaire », c’est-à-dire la disparition du réseau de bases d’agression établies aux frontières mêmes de l’U.R.S.S. et à proximité de ses centres vitaux, donc un affaiblissement stratégique de l’impérialisme.
2. Les forces démocratiques se sont considérablement accrues dans les
pays capitalistes, par suite de l’augmentation de l’influence et de la puissance des Partis communistes et de la diminution corrélative de l’influence des partis socialistes réformistes.
Les Partis communistes qui, à la fin de la première guerre mondiale, n’étaient, en dehors de l’U.R.S.S., qu’à l’état embryonnaire, qui n’existaient pas dans de nombreux pays et qui, même à la veille de la deuxième guerre mondiale, n’avaient encore souvent qu’une influence limitée, sont devenus, dans de nombreux pays, comme en Italie et en France, des partis de masses puissants.
En 1917, le Parti bolchevik russe était le seul parti marxiste
révolutionnaire existant au monde et il groupait seulement 240 000 membres.
Après la deuxième guerre mondiale, il n’était plus un seul pays qui n’eût son
Parti communiste formé selon les enseignements de Lénine et de Staline, et
l’ensemble de ces partis totalisait plus de vingt millions de membres.
À la fin des hostilités, des communistes participent au gouvernement dans plusieurs pays capitalistes d’Europe occidentale, en France, en Belgique, en Italie et même en Amérique du Sud, au Chili.
3. La crise du système colonial commencée avec la première guerre mondiale s’est considérablement accentuée. En Chine, l’Armée populaire après ses victoires sur les envahisseurs nippons occupe d’importantes parties du territoire.
Une république populaire naît en Corée du Nord. Le Viet-Nam et l’Indonésie
proclament leur indépendance. L’Inde la réclame. En Malaisie et en Birmanie, les forces populaires remportent de grands succès. En Afrique noire française, le Rassemblement démocratique africain (R.D.A.) éveille pour la première fois à la conscience politique les masses indigènes.
La vague d’émancipation qui s’élève de nouveau, comme après l’autre guerre, dans les pays coloniaux et semi-coloniaux atteint, grâce aux victoires de l’Armée rouge, une hauteur et une puissance qu’elle n’avait pas après 1918.
Les peuples des colonies ne veulent plus vivre comme par le passé. Les classes dominatrices des métropoles ne peuvent plus gouverner comme auparavant.
Les tentatives d’écrasement du mouvement de libération nationale par la force militaire se heurtent maintenant à la résistance armée croissante des peuples des colonies et conduisent à des guerres coloniales de longue durée (A. Jdanov : Rapport sur la situation internationale, conférence des Partis communistes et ouvriers, septembre 1947)
La situation générale du système impérialiste est encore aggravée par le degré d’instabilité extrême qui résulte non seulement du rétrécissement nouveau de la sphère du capitalisme, mais encore de la concentration de la puissance économique, politique et militaire aux Etats-Unis pendant cette période.
Seule puissance capitaliste à bénéficier intégralement de la guerre, ils en sortent plus puissants que tous les autres pays capitalistes réunis (our les détails, voir : Où va l’impérialisme américain) et deviennent puissance dominante du camp impérialiste.
Cette situation nouvelle et l’aggravation des contradictions du capitalisme résultant de la guerre les entraînent dans une politique de domination mondiale, dont l’obstacle essentiel est la puissance de l’U.R.S.S.
Le système impérialiste, sous la direction de l’impérialisme américain, s’engage alors dans une lutte acharnée contre le secteur socialiste pour tenter de redresser la situation en sa faveur : d’abord par le moyen de la guerre « froide » (chantage atomique, pression diplomatique et économique sur l’U.R.S.S. et les démocraties populaires d’Europe, soutien des gouvernements et formations réactionnaires contre les forces démocratiques), ensuite par le moyen de l’agression militaire.
2. 1946-49. Cette étape voit l’échec complet de la « guerre froide » qui se
termine par une véritable déroute de l’impérialisme, une nouvelle augmentation, non seulement relative mais absolue, des forces du socialisme. Le rapport des forces, déjà favorable au socialisme, se modifie à nouveau de façon considérable en sa faveur.
a) L’économie socialiste a liquidé rapidement les séquelles de la guerre ;
le quatrième plan quinquennal a été mis en application et a connu un succès complet.
b) Les Etats-Unis ont perdu le monopole de l’utilisation de l’énergie atomique.
c) Les brèches pratiquées dans la forteresse capitaliste au, cours de l’étape
précédente ont été consolidées grâce au renforcement économique et politique des États démocratiques de l’Europe de l’Est et de la Corée du Nord.
d) Deux nouvelles et énormes brèches ont été faites : création de la République populaire de Chine et de la République démocratique allemande.
La crise générale s’est encore aggravée du fait :
a) du contraste entre les lignes de développement des pays du secteur socialiste et celles du secteur capitaliste, de l’orientation de ces dernières vers la crise économique qui commence à se manifester aux Etats-Unis à la fin de 1948 et se développe au cours de l’année 1949 ;
b) de l’impuissance de la réaction européenne, poussée par l’impérialisme
américain, à écraser les partis communistes d’Europe occidentale ;
c) de l’incapacité des États impérialistes européens à briser le soulèvement
des peuples coloniaux au Vietnam, en Malaisie, en Birmanie ;
d) des difficultés grandissantes des pays capitalistes européens sous la
pression du plan Marshall ;
e) du pourrissement accéléré de l’économie américaine soutenue par
d’énormes dépenses de l’État (crédits extérieurs et armements) ;
f) de la détérioration accrue des échanges internationaux par suite du commerce unilatéral américain ;
g) de l’aggravation de toutes les contradictions internes du capitalisme, qui
se traduisent déjà par l’orientation de l’impérialisme vers le fascisme et la guerre.
3. Avec les années 1949-50 commence une troisième étape : celle de la préparation ouverte, officielle, de la guerre contre l’Union soviétique et de l’intervention directe et non plus par personnes interposées, comme dans l’étape précédente, de l’impérialisme américain contre le secteur socialiste : la signature du Pacte Atlantique, nouveau Pacte Antikomintern, et d’agression de Corée sont les événements qui marquent le début de cette étape qui, dans la pensée des impérialistes américains, doit conduire à une troisième guerre mondiale.
La crise générale touche à sa fin
Que nous enseigne le développement de la crise générale ? Tout d’abord que la crise du système, à cause de la victoire de la Révolution d’octobre, est un phénomène permanent et qu’il s’agit d’une maladie insurmontable et inguérissable.
Ensuite et surtout que le mal fait des progrès de plus en plus rapides à
mesure que les années passent. En particulier l’intensification de la crise générale à la suite de la deuxième guerre mondiale nous montre que les processus de développement du régime socialiste et d’écroulement du capitalisme vont en s’accélérant.
La prise de conscience de cette accélération est d’une importance capitale
pour la lutte du prolétariat, car seule elle permet de comprendre avec Maurice Thorez que « la paix aujourd’hui est comme suspendue à un fil », autrement dit apprend à ne pas sous-estimer le danger de guerre.
En même temps elle donne une confiance accrue à la classe ouvrière, en lui
révélant que le rapport des forces est favorable au prolétariat ; elle décuple sa volonté de lutte, en lui prouvant que le règne de la bourgeoisie touche à sa fin.
L’histoire de la crise générale du capitalisme nous fait comprendre l’opposition fondamentale de l’impérialisme et du socialisme en face de la guerre. L’Union Soviétique et les démocraties populaires, convaincues que le passage du capitalisme au socialisme résulte des lois mêmes de l’évolution sociale, ne craignent pas, mais désirent au contraire la coexistence et la confrontation pacifique des deux systèmes existant dans le monde : elles savent que cette rivalité pacifique permettra aux peuples de choisir librement, et en connaissance de cause, le régime le plus progressif.
Au contraire la peur de l’avenir et la nécessité du surarmement
pour retarder une crise économique encore plus grave que celle de 1929 poussent les impérialistes aux aventures sanglantes.
Mais si les Impérialistes n’ont pas le désir d’une coexistence pacifique des
deux systèmes, ils n’ont pas pour autant le pouvoir de déclencher, à eux seuls et sans le consentement de leurs peuples, la catastrophe d’une troisième guerre mondiale. Dès à présent, en effet, les forces de paix sont, comme le prouve l’étude de la crise générale, objectivement supérieures aux forces de guerre et peuvent imposer aux impérialistes les plus agressifs, des relations pacifiques avec le secteur socialiste.
Pour faire de cette possibilité de paix une réalité, il suffit
que la volonté des peuples vienne s’ajouter aux conditions objectives, que les centaines de millions d’hommes qui veulent la paix dans les pays encore soumis au capitalisme sachent s’unir et agir.
L’échec définitif des fauteurs de guerre ne dépend que de notre action, et
cela dicte à chacun son devoir.