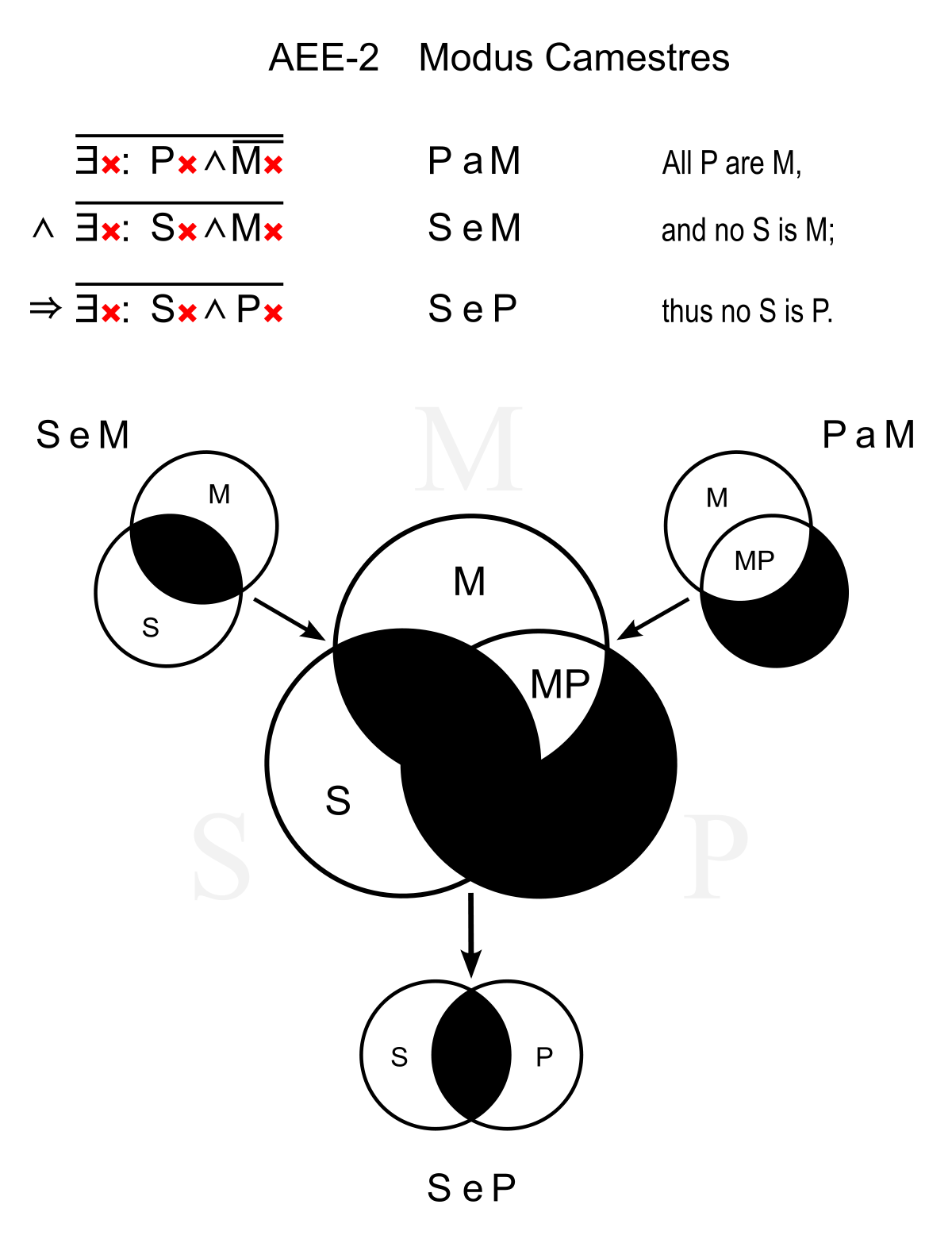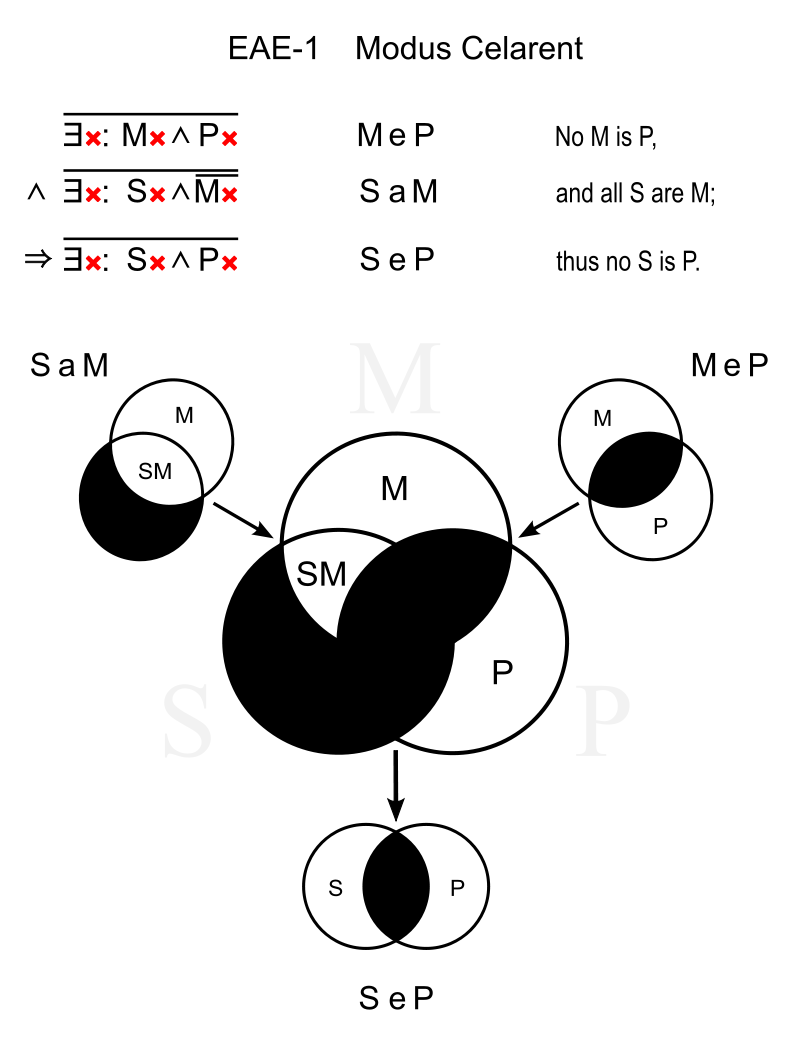Tant que Moïse, Jésus et Mahomet parlaient de Dieu, ils pouvaient faire référence à l’éternité. Le problème est tout à fait différent si l’on se place sur le plan spatial.
L’équivalent de l’éternité est l’infini. Or, si un humain peut dire que quelque chose a existé avant lui et existera après lui, le problème est tout autre avec l’espace, puisque là il est obligé non pas de parler, mais de montrer l’infini.
C’est ici très précisément ce que font les « super-héros », parce que leurs réserves d’énergie semblent inépuisables, infinis : Superman n’est jamais fatigué, l’homme-élastique conserve sa plasticité, etc.
C’est ici également qu’intervient, on l’aura deviné, la notion de miracle. Si Dieu est éternel et est au-delà du temps, alors sur le plan spatial il est infini et donc tout-puissant.

Mais dans quel domaine le miracle peut-il se réaliser ? Il n’y en a qu’un : c’est dans la nature.
La raison est très simple. En fait, si Dieu existe réellement, alors il fait apparaître des choses à partir de rien, de la même manière qu’il est censé avoir créé le monde.
Mais le monde est dans le temps, et rien de ce qui est dans le monde ne peut échapper au temps.
Tout est figé dans un temps périssable. Or, rien de ce qui relève de Dieu n’est périssable.
S’il faisait intervenir par exemple un monstre pour détruire des armées égyptiennes traquant les Hébreux, ce monstre devrait avoir des qualités divines.
Cela n’est pas possible, déjà parce que la création a déjà été réalisée au départ, et ensuite bien entendu parce que si Dieu n’existe pas, ces apparitions de « monstres » ne sont pas crédibles du tout, ne faisant pas partie d’un horizon mental et culturel cohérent pour les humains.
A cela s’ajoute naturellement que créé par Dieu, il relèverait du divin et co-existerait à côté de Dieu avec des propriétés divines, ce qui ne saurait être dans le monothéisme strict.
Dieu n’intervient alors pas dans les choses soumises au temps, mais au-delà de cela. Cela signifie agir dans le temps lui-même.
Cela signifie bloquer le temps, comme par exemple lorsque Jésus marche sur l’eau. Il devrait couler, mais sa chute est « bloquée » ; voici comment Matthieu raconte cela :
22 Aussitôt Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules.
23 Et, après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l’écart. Le soir venu, il était là, seul.
24 La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre ; elle était battue par les vagues, le vent étant contraire.
25 Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer.
26 En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés : « C’est un fantôme », disaient-ils, et, de peur, ils poussèrent des cris.27 Mais aussitôt, Jésus leur parla : « Confiance, c’est moi, n’ayez pas peur ! »
28 S’adressant à lui, Pierre lui dit : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » –
29 « Viens », dit-il. Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus.
30 Mais, en voyant le vent, il eut peur et, commençant à couler, il s’écria : « Seigneur, sauve-moi ! »
31 Aussitôt, Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? »
32 Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba.
33 Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent : « Vraiment, tu es Fils de Dieu ! »Dieu ne peut pas que bloquer le temps, il peut l’inverser – et là on rapproche évidemment le miracle de phénomènes naturels. C’est précisément la substance de la mer rouge qui s’ouvre en deux.
(Matthieu, 3:22-32)
La mer s’ouvre et se ferme, et Dieu ne fait pas apparaître quelque chose en plus : il modifie le rythme de la nature lui-même, il l’inverse.
C’est l’irruption de l’infini, mais dans le temps propre à l’espace. Voici ce qu’on lit dans le chapitre 14 de la Bible juive :
9 Les Égyptiens qui les poursuivaient les rencontrèrent, campés sur le rivage; tous les attelages de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les joignirent près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Cefôn.
10 Comme Pharaon approchait, les enfants d’Israël levèrent les yeux et voici que l’Égyptien était à leur poursuite; remplis d’effroi, les Israélites jetèrent des cris vers l’Éternel.
11 Et ils dirent à Moïse: « Est-ce faute de trouver des sépulcres en Égypte que tu nous as conduits mourir dans le désert? Quel bien nous as-tu fait, en nous tirant de l’Égypte?
12 N’est-ce pas ainsi que nous te parlions en Égypte, disant: ‘Laisse-nous servir les Égyptiens?’ De fait, mieux valait pour nous être esclaves des Égyptiens, que de périr dans le désert. »
13 Moïse répondit au peuple: « Soyez sans crainte! Attendez, et vous serez témoins de l’assistance que l’Éternel vous procurera en ce jour! Certes, si vous avez vu les Égyptiens aujourd’hui, vous ne les reverrez plus jamais.
14 L’Éternel combattra pour vous; et vous, tenez-vous tranquilles ! »
15 L’Éternel dit à Moïse: « Pourquoi m’implores-tu? Ordonne aux enfants d’Israël de se mettre en marche.
16 Et toi, lève ta verge, dirige ta main vers la mer et divise la; et les enfants d’Israël entreront au milieu de la mer à pied sec. »
(…)
21 Moïse étendit sa main sur la mer et l’Éternel fit reculer la mer, toute la nuit, par un vent d’est impétueux et il mit la mer à sec et les eaux furent divisées.
22 Les enfants d’Israël entrèrent au milieu de la mer, dans son lit desséché, les eaux se dressant en muraille à leur droite et à leur gauche.
23 Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chariots, ses cavaliers, entrèrent à leur suite au milieu de la mer.
24 Or, à la dernière veille, l’Éternel fit peser sur l’armée égyptienne une colonne de feu et une nuée et jeta la perturbation dans l’armée égyptienne
25 et il détacha les roues de ses chars, les faisant ainsi avancer pesamment. Alors l’Égyptien s’écria: « Fuyons devant Israël, car l’Éternel combat pour eux contre l’Égypte ! »
26 Le Seigneur dit à Moïse: « Étends ta main sur la mer et les eaux rebrousseront sur l’Égyptien, sur ses chars et sur ses cavaliers. »
27 Moïse étendit sa main sur la mer et la mer, aux approches du matin, reprit son niveau comme les Égyptiens s’élançaient en avant; et le Seigneur précipita les Égyptiens au sein de la mer.
28 Les eaux, en refluant, submergèrent chariots, cavalerie, toute l’armée de Pharaon qui était entrée à leur suite dans la mer; pas un d’entre eux n’échappa.
29 Pour les enfants d’Israël, ils s’étaient avancés à pied sec au milieu de la mer, ayant les eaux, comme un mur, à leur droite et à leur gauche.
30 L’Éternel, en ce jour, sauva Israël de la main de l’Égypte ; Israël vit l’Égyptien gisant sur le rivage de la mer.
31 Israël reconnut alors la haute puissance que le Seigneur avait déployée sur l’Égypte et le peuple révéra le Seigneur; et ils eurent foi en l’Éternel et en Moïse, son serviteur.(Exode, 14:9-22)
Mahomet, de son côté, n’a pas réalisé de miracles, même si la tradition musulmane, composée de « hadiths » consistant en des compte-rendus, lui attribue d’avoir fendu la lune en deux, d’avoir multiplié de l’eau et de la nourriture, etc.
On n’a pas cela dans le Coran, pour une raison très simple : c’est le Coran lui-même qui est présenté comme le miracle final.
Et naturellement, il est présenté comme ayant toujours existé de toute éternité, comme parole éternelle de Dieu, et comme se réalisant matériellement sous la forme d’un livre, dans l’espace humain.
=>Retour au dossier
Moïse, Jésus, Mahomet, les rebelles poètes