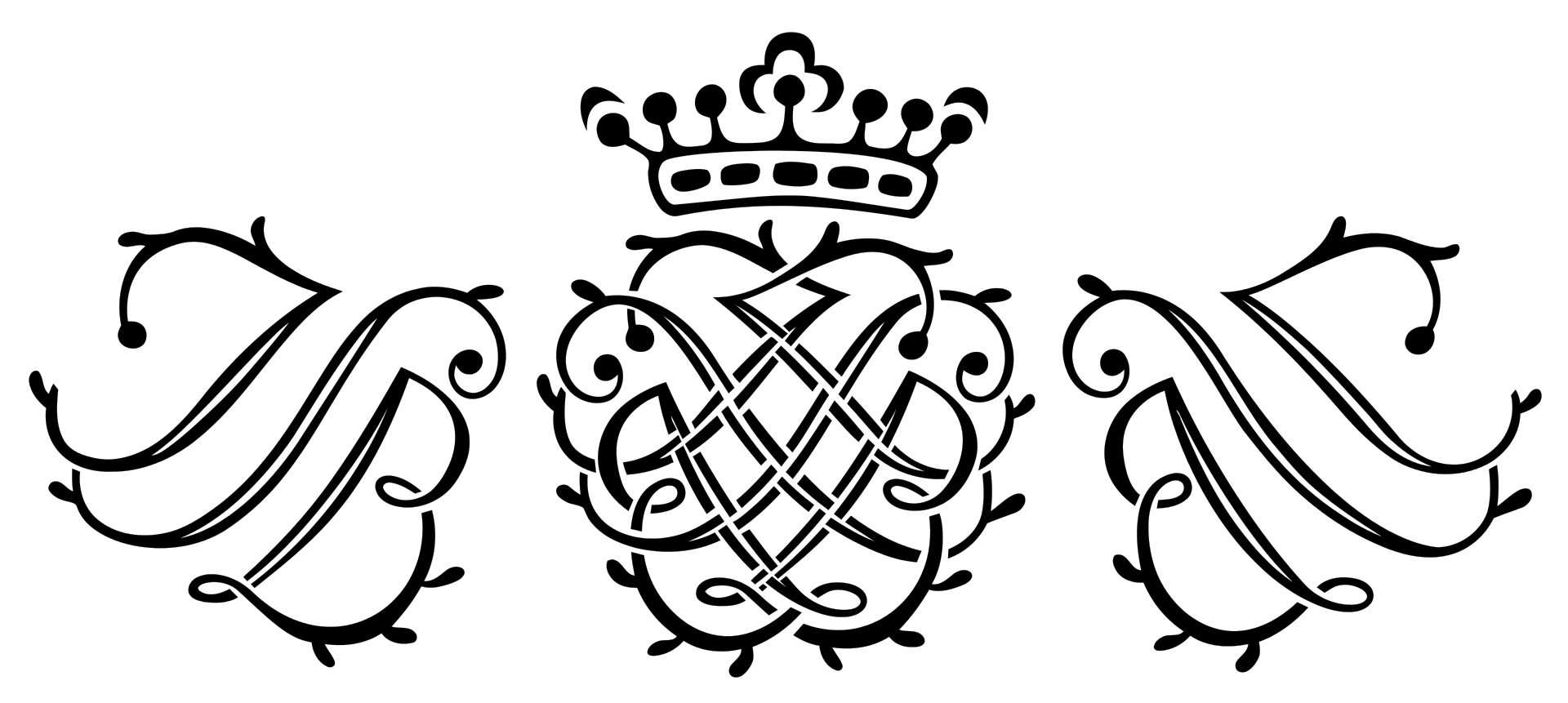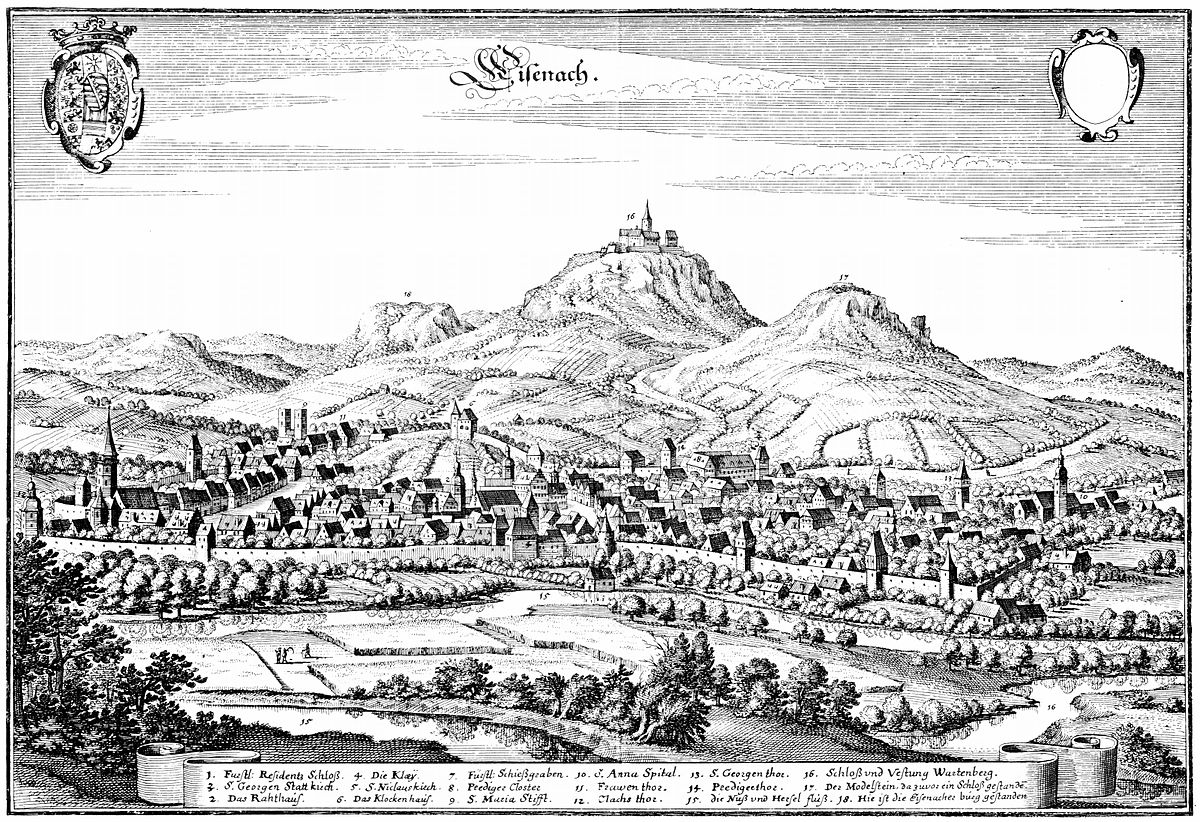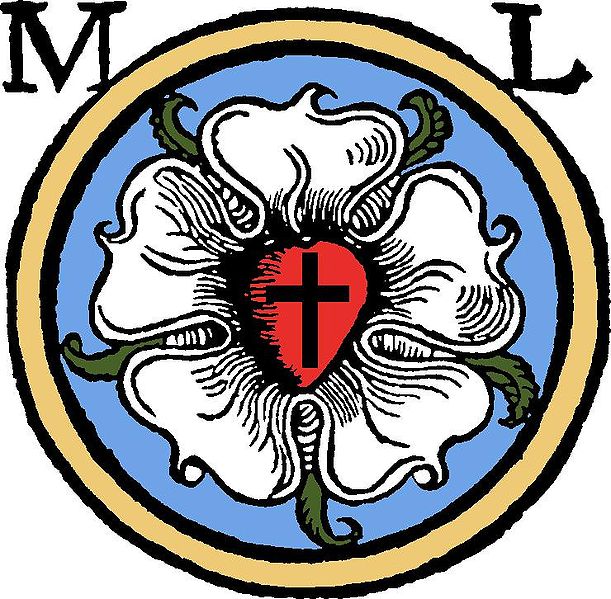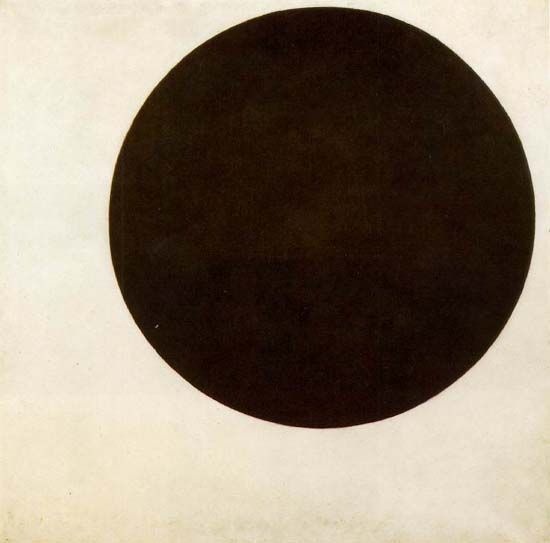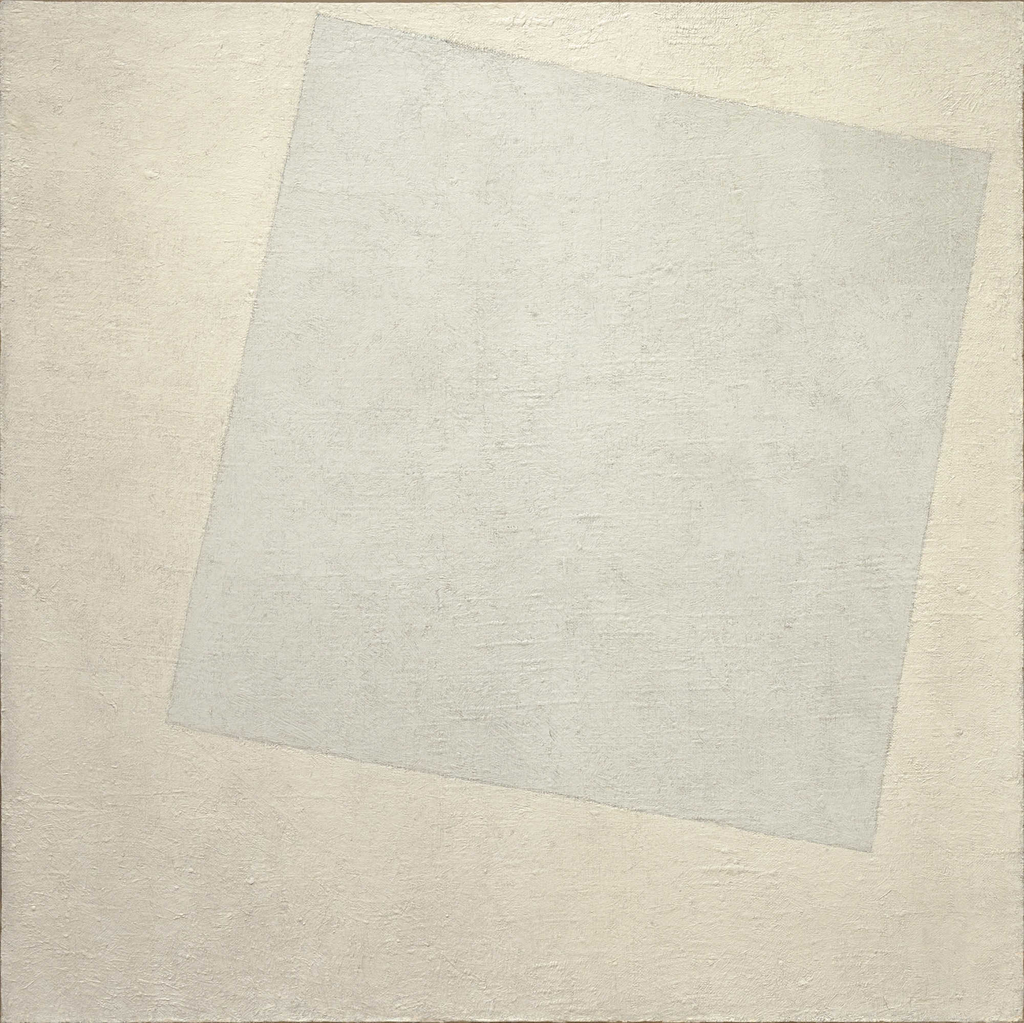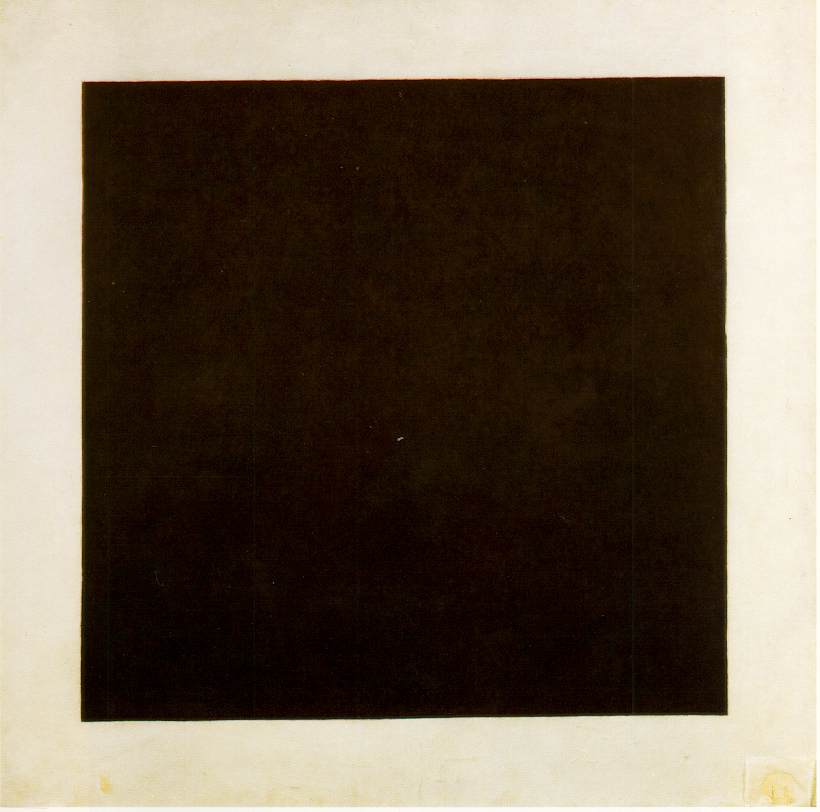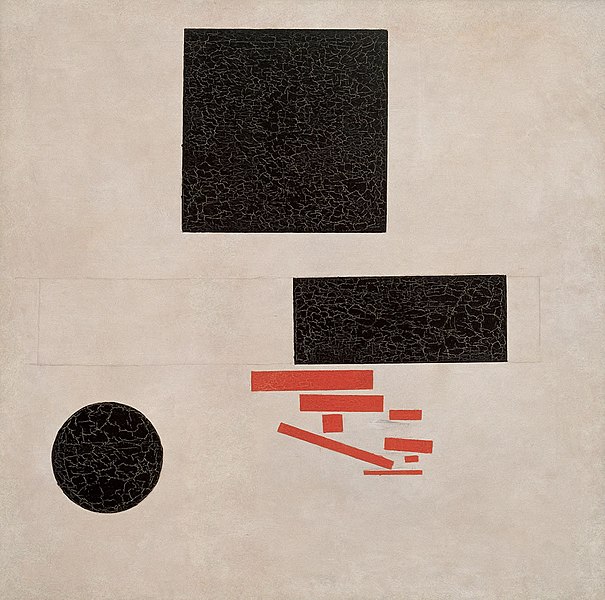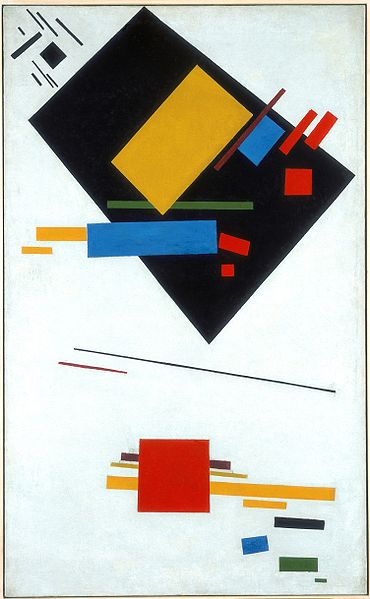C’est dans ce contexte [de nécessité de l’électrification, de l’industrialisation] que s’ouvrit le Xe congrès du Parti bolchevik, en mars 1921.
Il comptait plus de 730 000 membres et avait triomphé dans la guerre civile : l’armée rouge avait battu l’armée blanche.
Il y avait toutefois la question de l’organisation économique, et le point de vue de Lénine, s’il était hégémonique, dut faire face à une intense rébellion.
Différents courants remettaient en effet en cause le principe de la centralisation et de la direction de la société par le Parti.
Ils représentaient des courants petits-bourgeois en opposition au principe des directives mis en avant par la classe ouvrière.
Ils exprimaient le refus petit-bourgeois de ce que Lénine considérait comme central : le recensement et le contrôle, bases élémentaires pour gérer la société.

Et ces courants étaient particulièrement structurés, développant une plate-forme, une idéologie, diffusant leur propagande ; les principaux courants étaient ceux de « l’opposition ouvrière » (avec notamment Chliapnikov et Medvedev, ou encore Kollontaï qui elle pratiquera l’autocritique), les « centralistes démocrates » (avec Ossinsky, Sapronov, Drobnis, Bogousiavski, Smirnov), ainsi que les « communistes de gauche » (avec principalement Boukharine et Préobrajensky) .
Lénine mena un combat acharné contre ces courants, considérant que leurs positions étaient petites-bourgeoises et un obstacle au socialisme ; même le fait de perdre du temps avec ces courants relevait du « luxe ».
La résolution du congrès considéra ainsi même ces courants comme une nouvelle forme d’expression de la contre-révolution :
« Ces ennemis, disait la résolution, convaincus désormais que la contre-révolution tentée ouvertement sous le drapeau des gardes blancs est condamnée, font tous leurs efforts pour exploiter les divergences à l’intérieur du P.C.R. et ainsi pousser en avant la contre-révolution, d’une façon ou d’une autre, en remettant le pouvoir à des groupements politiques qui, d’apparence, sont le plus près de reconnaître le pouvoir des Soviets. »
Par conséquent, le Parti procéda à l’interdiction des fractions, au nom de la centralisation nécessaire.
Cela fut d’autant plus important que, juste avant l’ouverture du congrès, un soulèvement armé fut lancé dans la base militaire de Kronstadt, appelant à renverser le régime.
Or, ce soulèvement était différent de par la forme qu’il prit : au lieu de se revendiquer de l’armée blanche, du nationalisme bourgeois, il lança le mot d’ordre de « Pour les Soviets, mais sans les communistes ».
La base navale de Kronstadt était de plus marquée par différentes caractéristiques.
La première, c’est qu’elle avait joué un rôle très net lors de la révolution d’Octobre, et qu’ainsi elle avait un grand prestige.
Cependant, son personnel avait totalement changé depuis ; le prestige restait bien sûr cependant.
Le second fait marquant est que la base formait une forteresse protégeant l’accès à Petrograd.
Si la base tombait, avec la fonte des glaces arrivant, une intervention armée étrangère était facilitée.

A cela s’ajoute que le soulèvement suivait une tradition bien définie.
En juillet 1918, ce furent les socialistes-révolutionnaires de gauche qui tentèrent l’insurrection.
Auparavant alliés des bolcheviks, ils s’opposèrent à l’arrêt de la guerre, et organisèrent un attentat contre l’ambassade allemande, puis un coup d’État qui échoua.
Durant la guerre civile, il y eut également l’Armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne, commandée par Nestor Makhno.
Parfois alliée à l’armée rouge face à l’armée blanche, elle fut aisément écrasée en 1921, n’existant que dans le chaos qui a prédominé en Ukraine après 1917, reflétant des aspirations petites-bourgeoises opposées tant aux féodaux qu’à la classe ouvrière.
Quelle était de fait, la situation en Russie, après la révolution russe ? Elle était absolument terrible :
« La production globale de l’agriculture, en 1920, ne représentait qu’environ la moitié de celle d’avant-guerre (…).
La production de la grande industrie, en 1920, n’atteignait qu’un septième environ de la production d’avant-guerre.
La plupart des fabriques et des usines étaient arrêtées ; les mines détruites, inondées.
La métallurgie était dans un état lamentable.
La production de fonte pour toute l’année 1921 ne fut que de 116.300 tonnes, c’est-à-dire environ 3% de la production d’avant-guerre.
On n’avait pas assez de combustible. Les transports étaient désorganisés.
Les réserves de métaux et de tissus étaient presque épuisées.
Le pays manquait du strict nécessaire : pain, graisses, viande, chaussures, vêtements, allumettes, sel, pétrole, savon. »
Précis d’histoire du Parti Communiste d’Union Soviétique bolchévik
Il n’y avait donc que trois alternatives : soit le retour à l’ancien, soit le développement de la petite production capitaliste qui inévitablement fera triompher le capitalisme sur tous les plans, soit le capitalisme d’État comme sas vers le socialisme.

Lénine expliquait ainsi alors :
« Le capitalisme est un mal par rapport au socialisme.
Le capitalisme est un bien par rapport au Moyen Age, par rapport à la petite production, par rapport à la bureaucratie qu’engendre l’éparpillement des petits producteurs.
Puisque nous ne sommes pas encore en état de réaliser le passage immédiat de la petite production au socialisme, le capitalisme est, dans une certaine mesure, inévitable, c’est un produit spontané de la petite production et des échanges; aussi devons-nous l’utiliser (surtout en l’orientant dans la voie du capitalisme d’État) comme maillon intermédiaire entre la petite production et le socialisme; comme moyen, comme voie, procédé, modalité assurant l’accroissement des forces productives. »
L’impôt en nature, 1921
En fin de compte, les « gauchistes », comme ils furent appelés, représentaient la petite-bourgeoisie tentant de s’opposer au développement organisé de la société.
Ils prétendaient agir au nom de la « démocratie », pour en réalité promouvoir le libre-échange, la petite production, le petit commerce, etc.
Rejeter l’esprit petit-bourgeois de cette démarche était vital pour le Parti de la classe ouvrière.
Aussi Lénine fut-il particulièrement net tant dans sa critique que dans sa volonté de rupture.
Voici comment il formule les différences de fond :
« Premièrement, les « communistes de gauche » n’ont pas compris quel est exactement le caractère de la transition du capitalisme au socialisme qui nous donne le droit et toutes les raisons de nous appeler République socialiste des Soviets.
Deuxièmement, ils révèlent leur nature petite bourgeoise du fait, justement, qu’ils ne voient pas dans l’élément petit-bourgeois l’ennemi principal auquel se heurte chez nous le socialisme.
Troisièmement, en agitant l’épouvantail du « capitalisme d’État », ils montrent qu’ils ne comprennent pas ce qui, au point de vue économique, distingue l’État soviétique de l’État bourgeois.
Examinons ces trois points.
Parmi les gens qui se sont intéressés à l’économie de la Russie, personne, semble-t-il, n’a nié le caractère transitoire de cette économie.
Aucun communiste non plus n’a nié, semble-t-il, que l’expression de République socialiste des Soviets traduit la volonté du pouvoir des Soviets d’assurer la transition au socialisme, mais n’entend nullement signifier que le nouvel ordre économique soit socialiste.
Mais que veut dire le mot transition ?
Ne signifie-t-il pas, appliqué à l’économie, qu’il y a dans le régime en question des éléments, des fragments, des parcelles, à la fois de capitalisme et de socialisme ?
Tout le monde en conviendra.
Mais ceux qui en conviennent ne se demandent pas toujours quels sont précisément les éléments qui relèvent, de différents types économiques et sociaux qui coexistent en Russie.
Or, là est toute la question.
Énumérons ces éléments :
1.l’économie patriarcale, c’est-à-dire, en grande mesure, l’économie naturelle, paysanne;
2.la petite production marchande (cette rubrique comprend la plupart des paysans qui vendent du blé);
3.le capitalisme privé;
4.le capitalisme d’État;
5.le socialisme.
La Russie est si grande et d’une telle diversité que toutes ces formes économiques et sociales s’y enchevêtrent étroitement.
Et c’est ce qu’il y a de particulier dans notre situation.
Quels sont donc les types qui prédominent ?
Il est évident que, dans un pays de petits paysans, c’est l’élément petit-bourgeois qui domine et ne peut manquer de dominer; la majorité, l’immense majorité des agriculteurs sont de petits producteurs.
L’enveloppe du capitalisme d’État (monopole du blé, contrôle exercé sur les propriétaires d’usines et des commerçants, coopératives bourgeoises) est déchirée çà et là par les spéculateurs, le blé étant l’objet principal de la spéculation.
C’est dans ce domaine précisément que se déroule la lutte principale.
Quels sont les adversaires qui s’affrontent dans cette lutte, si nous parlons par catégories économiques, comme le « capitalisme d’État » ?
Sont-ce le quatrième et le cinquième élément de ceux que je viens d’énumérer ?
Non, bien sûr.
Ce n’est pas le capitalisme d’État qui est ici aux prises avec le socialisme, mais la petite bourgeoisie et le capitalisme privé qui luttent, au coude à coude, à la fois contre le capitalisme d’État et contre le socialisme.
La petite bourgeoisie s’oppose à toute intervention de la part de l’État, à tout inventaire, à tout contrôle, qu’il émane d’un capitalisme d’État ou d’un socialisme d’État.
C’est là un fait réel, tout à fait indéniable, dont l’incompréhension est à la base de l’erreur économique des « communistes de gauche ».
Le spéculateur, le mercanti, le saboteur du monopole, voilà notre pire ennemi « intérieur », l’ennemi des mesures économiques du pouvoir des Soviets.
Si, il y a 125 ans, les petits bourgeois français, révolutionnaires des plus ardents et des plus sincères, étaient encore excusables de vouloir vaincre la spéculation en envoyant à l’échafaud un petit nombre d’« élus » et en usant de foudres déclamatoires, aujourd’hui, les attitudes de phraseurs avec lesquelles tel ou tel socialiste révolutionnaire de gauche aborde cette question n’inspirent qu’aversion et dégoût à tous les révolutionnaires conscients.
Nous savons parfaitement que la base économique de la spéculation est constituée par la couche des petits propriétaires si largement répandus en Russie et par le capitalisme privé dont chaque petit bourgeois est un agent.
Nous savons que des millions de tentacules de cette hydre petite-bourgeoise pénètrent ça et là dans certaines couches de la classe ouvrière et que la spéculation s’introduit dans tous les pores de notre vie économique et sociale, l’emportant sur le monopole d’État.
Quiconque ne le voit pas montre par son aveuglement à quel point il est prisonnier des préjugés petits-bourgeois (…).
Quand la classe ouvrière aura appris à défendre l’ordre d’État contre l’esprit anarchique de la petite propriété, quand elle aura appris à organiser la grande production à l’échelle de l’État, sur les bases du capitalisme d’État, elle aura alors, passez-moi l’expression, tous les atouts en mains et la consolidation du socialisme sera assurée.
Le capitalisme d’État est, au point de vue économique, infiniment supérieur à notre économie actuelle. »
Sur l’infantilisme « de gauche » et les idées petites-bourgeoises