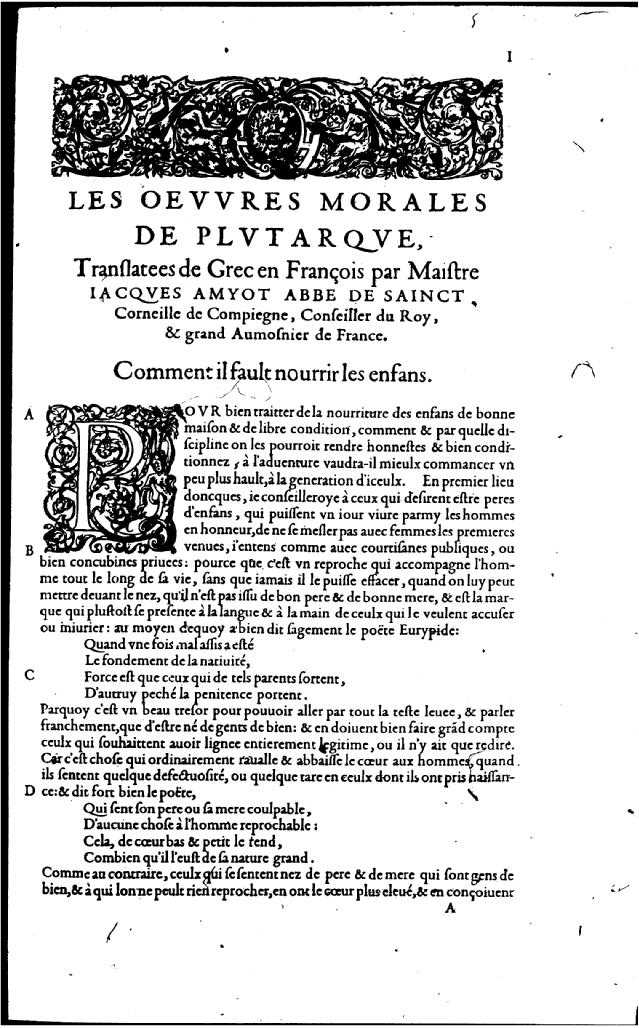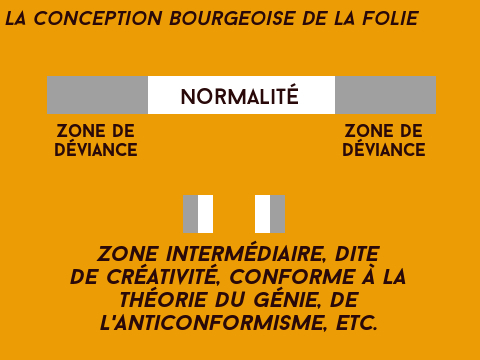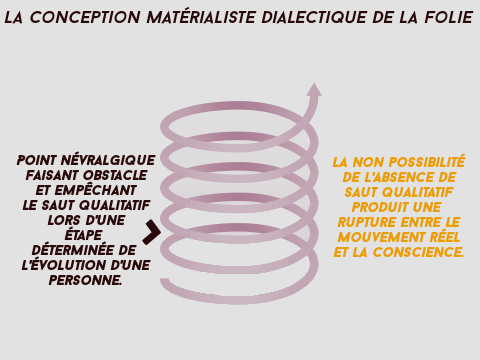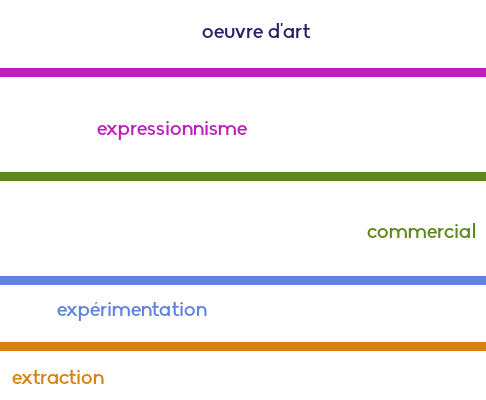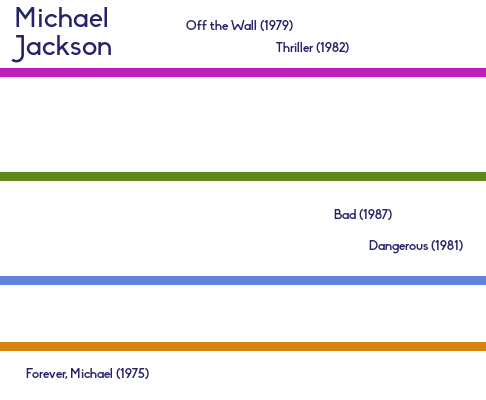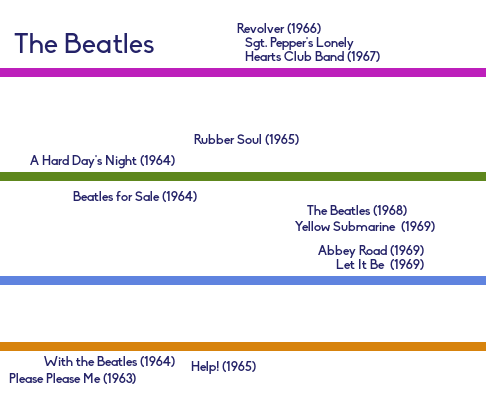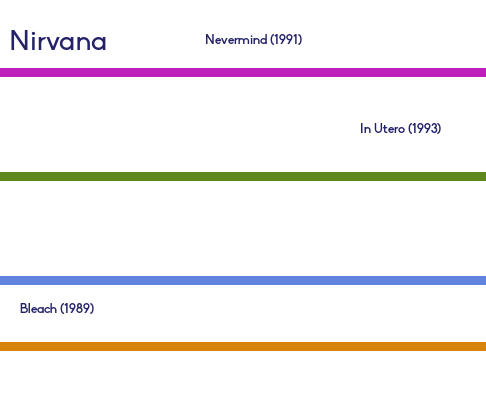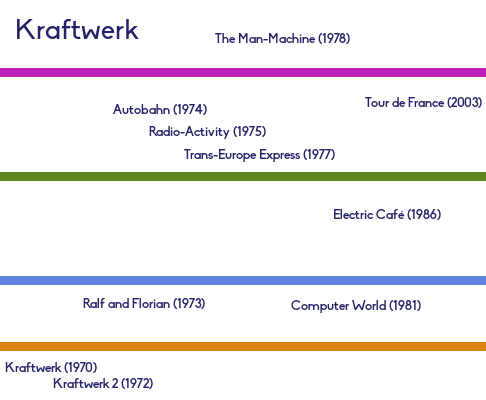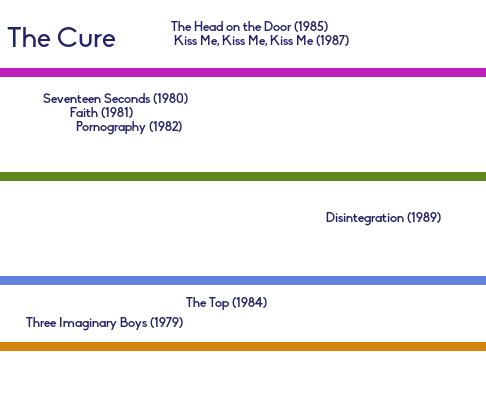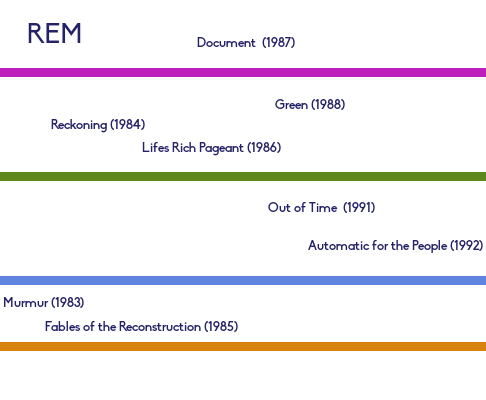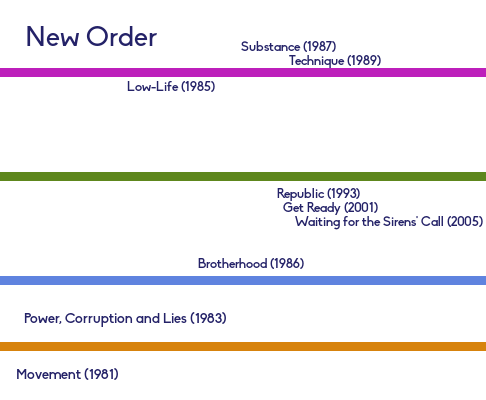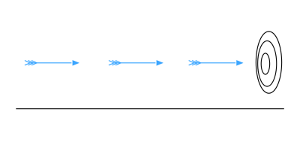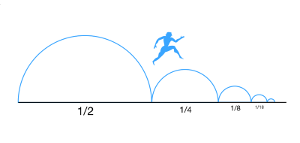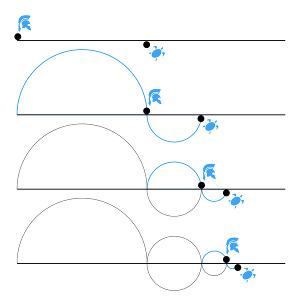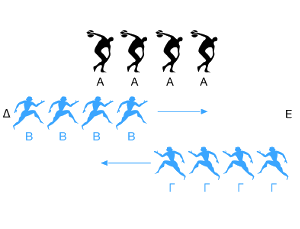S’il est inconséquent avec le calvinisme en raison de son averroïsme politique, on comprend d’autant mieux le choix de Michel de Montaigne de parler de l’Amérique. On sait à quel point Montaigne est choqué, ému quand il parle de la situation là-bas. Il constate ainsi :
« Peu importent leurs noms [de certains peuples des Indes nouvelles], car ils n’existent plus; la désolation due à cette conquête, d’un genre extraordinaire et inouï, s’est étendue jusqu’à l’abolition complète des noms et de l’ancienne topographie des lieux. »
Les Essais
C’est que le thème du nouveau monde découvert n’est pas qu’un prétexte à un discours faisant une réflexion sur la culture, la nécessité de prendre position de manière adéquate, etc. Il y a à l’arrière-plan une dénonciation indirecte de l’Espagne catholique.
Il est très étrange que personne ne l’ait remarqué jusqu’à présent : on sait pourtant qu’à cette époque, la France fait face à l’Empire espagnol qui s’est étendu jusqu’aux pays germaniques, le fameux Charles Quint étant le symbole de la puissance conquérante à laquelle la France doit faire face.
Si donc Michel de Montaigne attaque l’Espagne catholique, c’est donc forcément politique. Il semble pourtant bien que les commentateurs n’aient vu dans la dénonciation des crimes en Amérique qu’une simple dénonciation des crimes ! D’où pourrait pourtant provenir une critique, si ce n’est d’un arrière-plan social et politique le permettant ?
Il est vrai que seul le matérialisme dialectique permet de voir comment une expression idéologique provient d’une base, et aide à entrevoir comment derrière la façade il y a un contenu, dans la tradition prudente de l’averroïsme politique de cette époque.
En exprimant sa tristesse pour l’Amérique, c’est donc l’Espagne catholique que Michel de Montaigne dénonce. Voici comment il présente la situation, avec dès le départ une critique discrète de la religion :
« Notre monde vient d’en découvrir un autre. Et qui peut nous garantir que c’est le dernier de ses frères, puisque les Démons, les Sybilles et nous-mêmes avons ignoré celui-là jusqu’à maintenant?
Il n’est pas moins grand, ni moins plein, ni moins bien doté de membres ; mais il est si jeune et si enfant qu’on lui apprend encore son a, b, c. Il n’y a pas cinquante ans, il ne connaissait encore ni les lettres, ni les poids, ni les mesures, ni les vêtements, ni le blé, ni la vigne ; il était encore tout nu dans le giron de sa mère et ne vivait que grâce à elle.
Si nous jugeons bien de notre fin prochaine, comme Lucrèce le faisait pour la jeunesse de son temps, cet autre monde ne fera que venir au jour quand le nôtre en sortira. L’univers tombera en paralysie : l’un de ses membres sera perclus et l’autre en pleine vigueur. »
Les Essais
Le reproche qui est fait au départ vise la religion : le monde est plus vaste que l’on pensait et donc l’équilibre des forces posé par le Vatican est erroné, et même un piège pour la France. L’Église prétendait fournir un cadre, voici que celui-ci est ébranlé, qui plus est aux dépens des intérêts de la France ! Rien ne va plus.
Michel de Montaigne développe alors le thème politique : si la découverte avait été menée non pas par des forces féodales barbares et par l’Église évangélisant dans la violence, tout aurait pu être totalement différent… Il formule cela de la manière suivante :
« Quel dommage qu’une si noble conquête ne soit pas tombée sous l’autorité d’Alexandre ou de ces anciens Grecs et Romains, et qu’une si grande mutation et transformation de tant d’empires et de peuples ne soit pas tombée dans des mains qui eussent doucement poli et amendé ce qu’il y avait là de sauvage, en confortant et en développant les bonnes semences que la Nature y avait produites, en mêlant non seulement à la culture des terres et à l’ornement des villes les techniques de ce monde-ci, dans la mesure où cela eût été nécessaire, mais aussi en mêlant les vertus grecques et romaines aux vertus originelles de ce pays !
Comme cela eût été mieux, et quelle amélioration pour la terre entière, si les premiers exemples que nous avons donnés et nos premiers comportements là-bas avaient suscité chez ces peuples l’admiration et l’imitation de la vertu, s’ils avaient tissé entre eux et nous des relations d’alliance fraternelle ! Comme il eût été facile alors de tirer profit d’âmes si neuves et si affamées d’apprendre, ayant pour la plupart de si belles dispositions naturelles !
Au contraire, nous avons exploité leur ignorance et leur inexpérience pour les amener plus facilement à la trahison, à la luxure, à la cupidité, et à toutes sortes d’inhumanités et de cruautés, à l’exemple et sur le modèle de nos propres mœurs !
A-t-on jamais mis à ce prix l’intérêt du commerce et du profit?
Tant de villes rasées, tant de peuples exterminés, passés au fil de l’épée, et la plus riche et la plus belle partie du monde bouleversée dans l’intérêt du négoce des perles et du poivre… Beau résultat ! Jamais l’ambition, jamais les inimitiés ouvertes n’ont poussé les hommes les uns contre les autres à de si horribles hostilités et à des désastres aussi affreux. »
Les Essais
Et voici donc la charge politique ouverte, l’attaque contre l’Espagne catholique :
« Des deux plus puissants monarques de ce monde-là – Comment on traita leurs rois et peut-être même de celui-ci, étant rois de tant de rois – les derniers que les Espagnols chassèrent, l’un était le roi du Pérou.
Il fut pris au cours d’une bataille et soumis à une rançon tellement excessive qu’elle dépasse l’entendement : elle fut pourtant fidèlement payée ; il avait donné par son comportement les signes d’un cœur franc, libre et ferme, et d’un esprit clair et bien fait, et les vainqueurs en avaient déjà tiré un million trois cent vingtcinq mille cinq cents onces d’or, sans compter l’argent et un tas d’autres choses, dont la valeur n’était pas moindre – au point que leurs chevaux ne portaient plus que des fers d’or massif.
Il leur prit cependant l’envie de voir, au prix de quelque trahison que ce fût, ce que pouvait cont
enir encore le reste des trésors de ce roi, et de profiter pleinement de ce qu’il avait conservé.
On l’accusa donc avec de fausses preuves, de vouloir soulever ses provinces pour recouvrer sa liberté ; et par un beau jugement, rendu par ceux-là mêmes qui étaient les auteurs de cette machination, on le condamna à être pendu et étranglé publiquement, non sans lui avoir évité d’être brûlé vif en lui administrant le baptême pour se racheter lors de son supplice : traitement horrible et inouï, qu’il supporta cependant sans s’effondrer, avec une contenance et des paroles d’une tournure et d’une gravité vraiment royales.
Et pour endormir les peuples stupéfaits et abasourdis par un traitement aussi exceptionnel, on simula un grand deuil, et on ordonna que lui soient faites de somptueuses funérailles. »
Les Essais
Machination politique au nom de la religion : qu’à cela ne tienne, faisons de la politique et assumons cela. Voici un autre exemple de l’attaque menée par Michel de Montaigne, en apparence au nom de la religion :
« Une autre fois, ils firent brûler vifs ensemble, dans un barbarie inutile même brasier, quatre cent soixante personnes, quatre cents hommes du peuple et soixante autres pris parmi les principaux seigneurs d’une province, qui étaient simplement prisonniers de guerre.
C’est d’eux-mêmes que nous tenons ces récits ; car il ne se contentent pas de les avouer, ils s’en vantent, et les publient !
Serait-ce donc pour témoigner de leur souci de justice, ou de leur zèle envers la religion?
Certes non.
Ce sont des procédés trop contraires, trop opposés à une si sainte fin. S’ils avaient eu pour but de propager notre foi, ils auraient compris que cela ne se fait pas par la possession des territoires, mais des hommes ; et ils se seraient bien contentés des meurtres que causent les nécessités de la guerre sans y ajouter une telle boucherie comme s’il s’agissait de bêtes sauvages, et si générale, autant qu’ils ont pu y parvenir par le fer et le feu, n’en ayant volontairement conservé que le nombre nécessaire pour en faire de misérables esclaves, à travailler et servir dans leurs mines.
Au point que plusieurs de leurs chefs, d’ailleurs souvent déconsidérés et détestés, ont été punis de mort sur les lieux de leurs conquêtes, par ordre des rois de Castille, offensés à juste titre par l’horreur de leur comportement. Dieu a fort justement permis que ces grands pillages soient engloutis par la mer pendant leur transport, ou à la suite de guerres intestines pendant lesquelles ils se sont entre-tués, et la plupart de ces gens été enterrés en ces lieux sans qu’ils aient pu retirer aucun fruit de leur victoire. »
Les Essais
C’est là un coup politique : on est très loin d’une simple réflexion personnelle… En réalité, Michel de Montaigne donne l’argument politique comme quoi on devrait reprocher à l’Espagne catholique sa démarche, en jouant sur son propre terrain pour la prendre dans ses contradictions…
Tout cela est indéniablement politique.