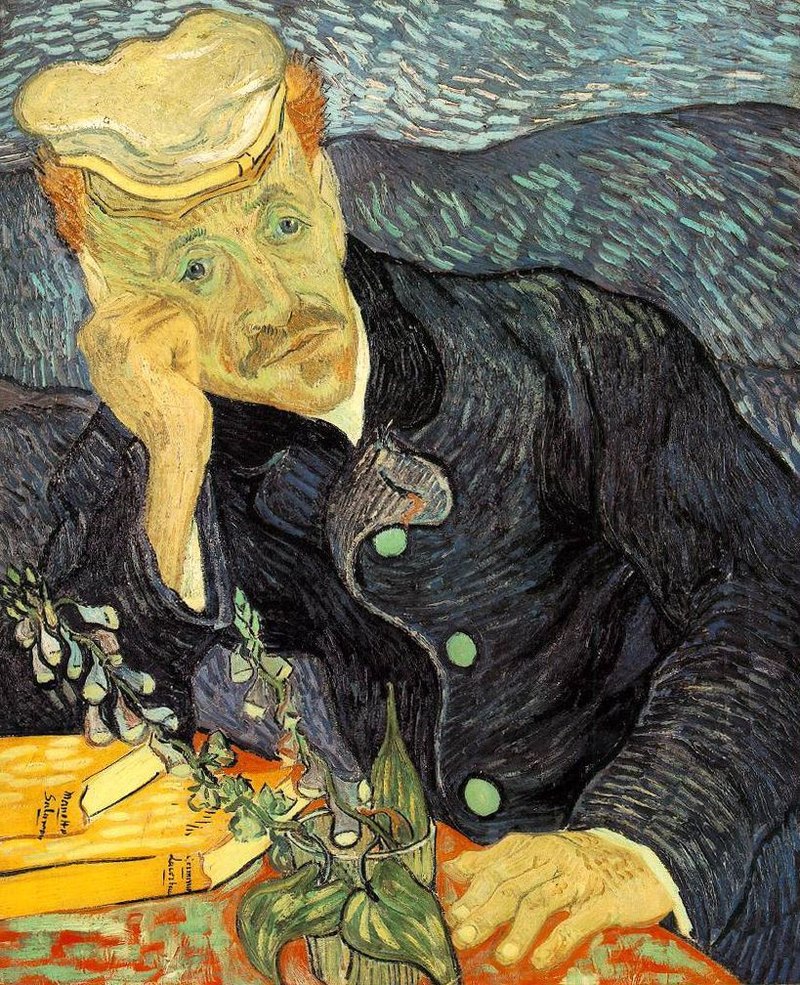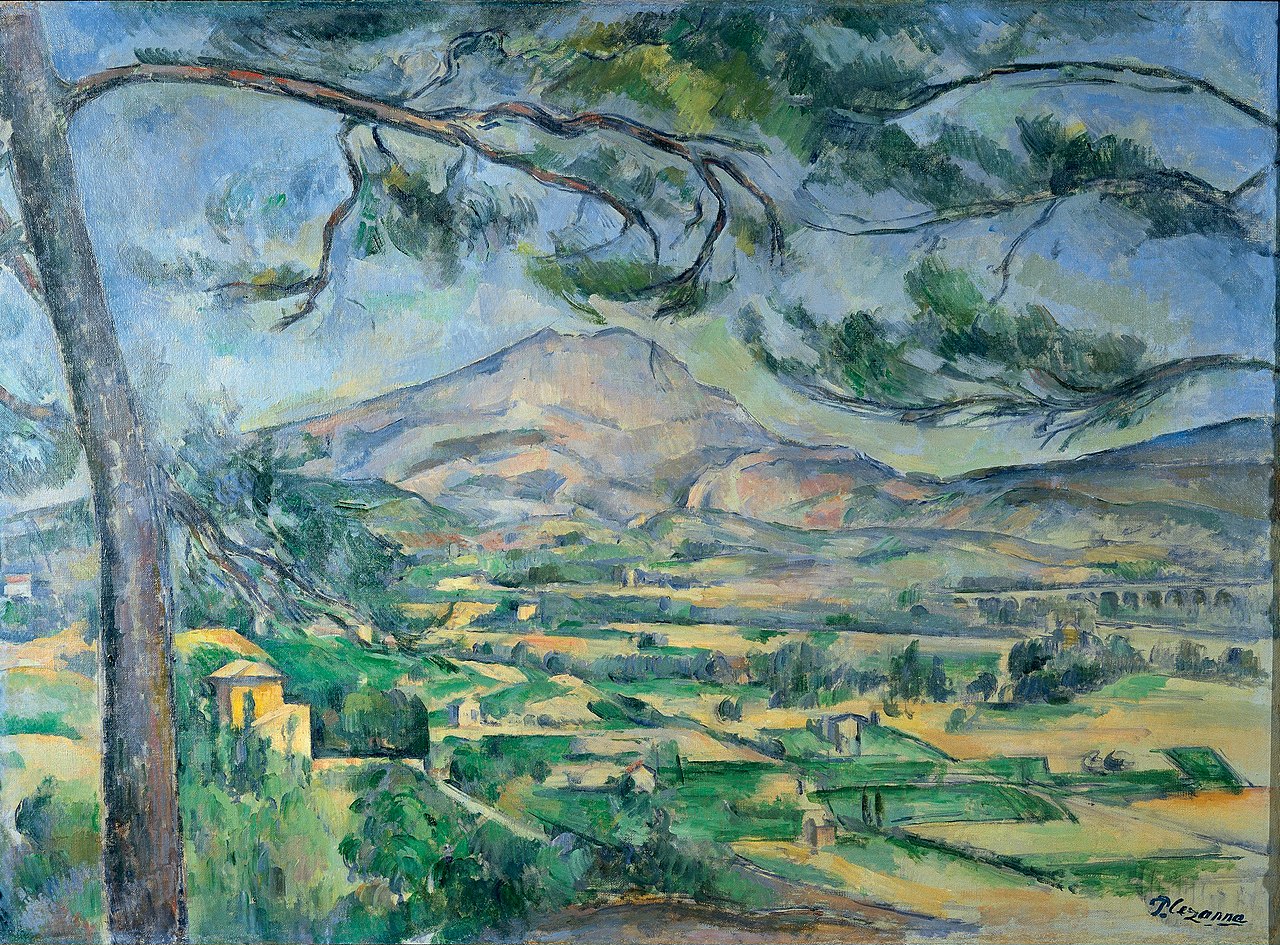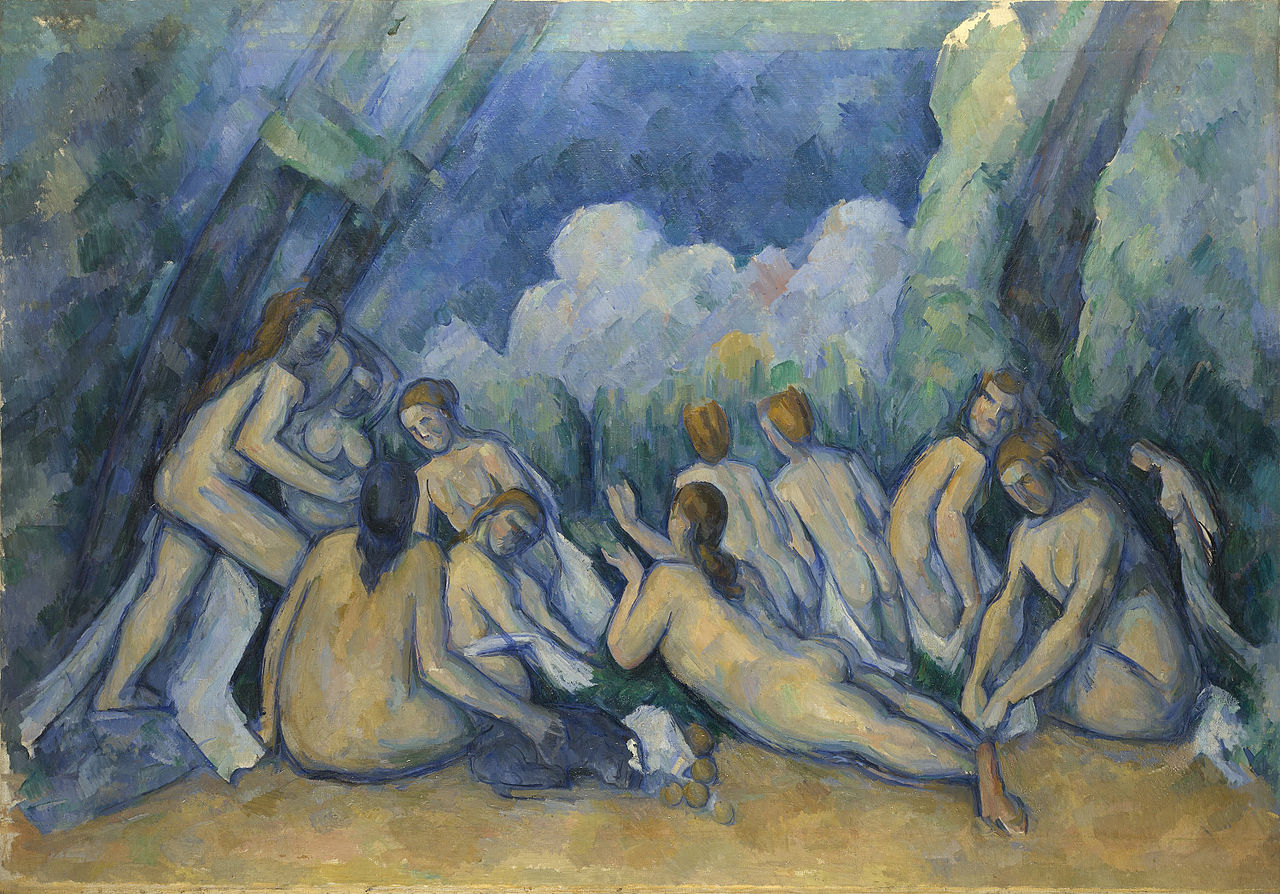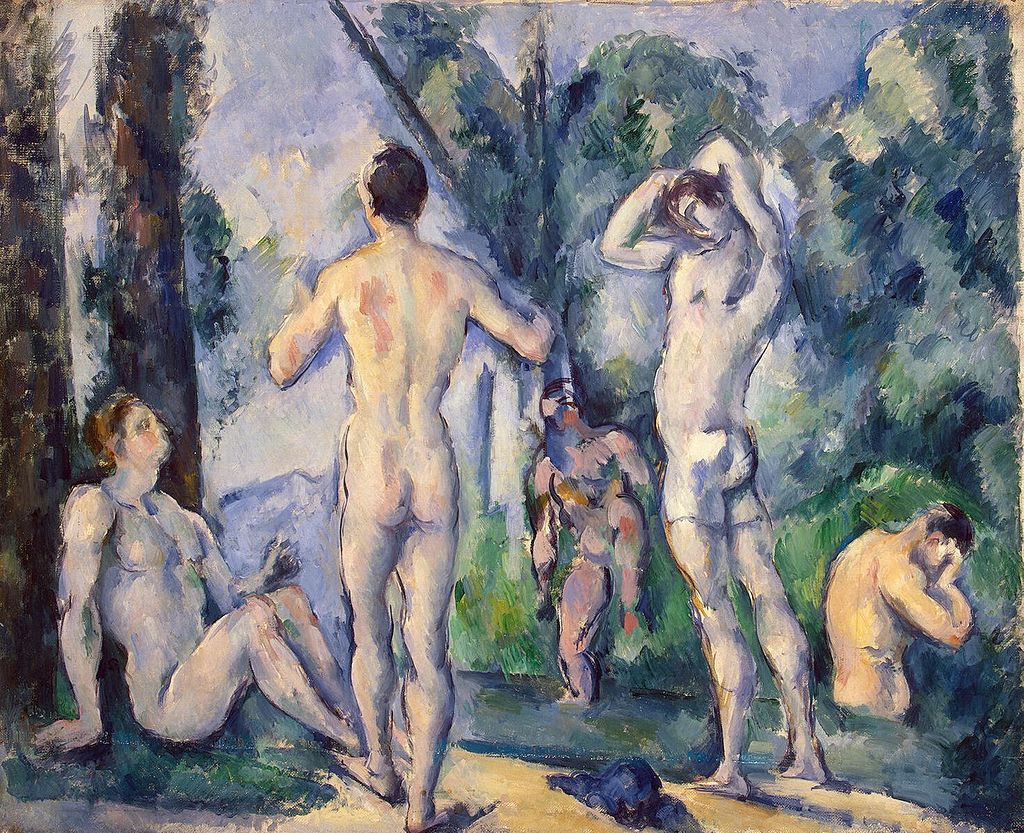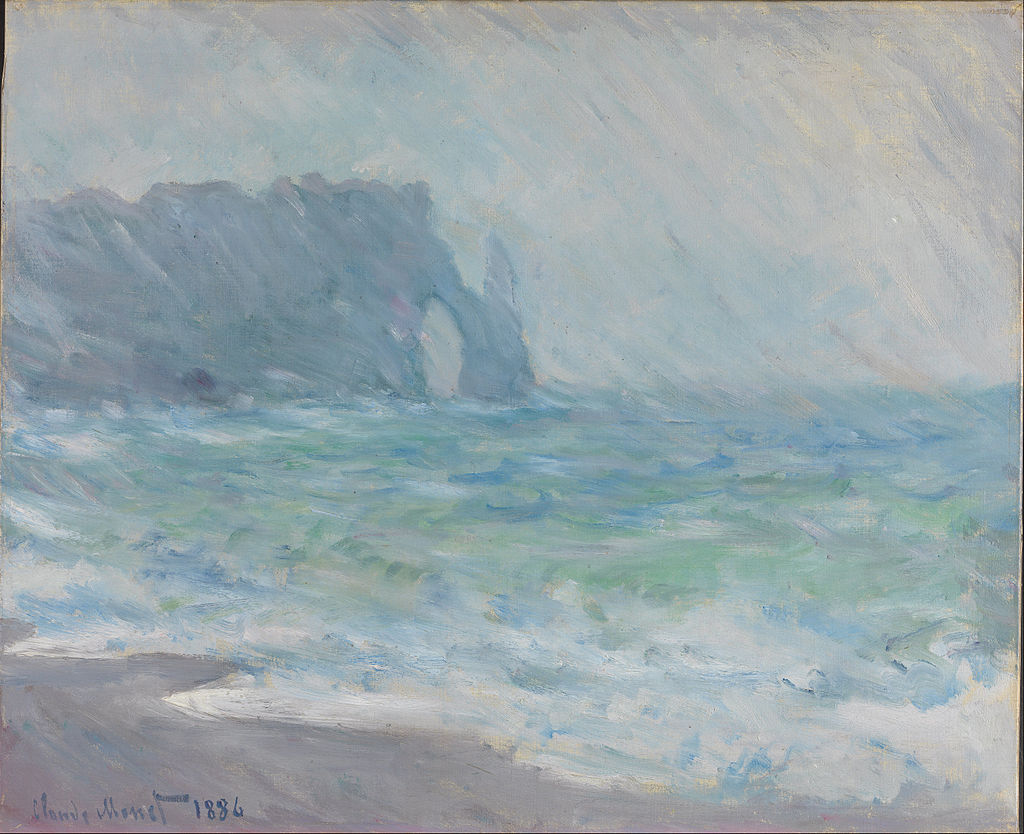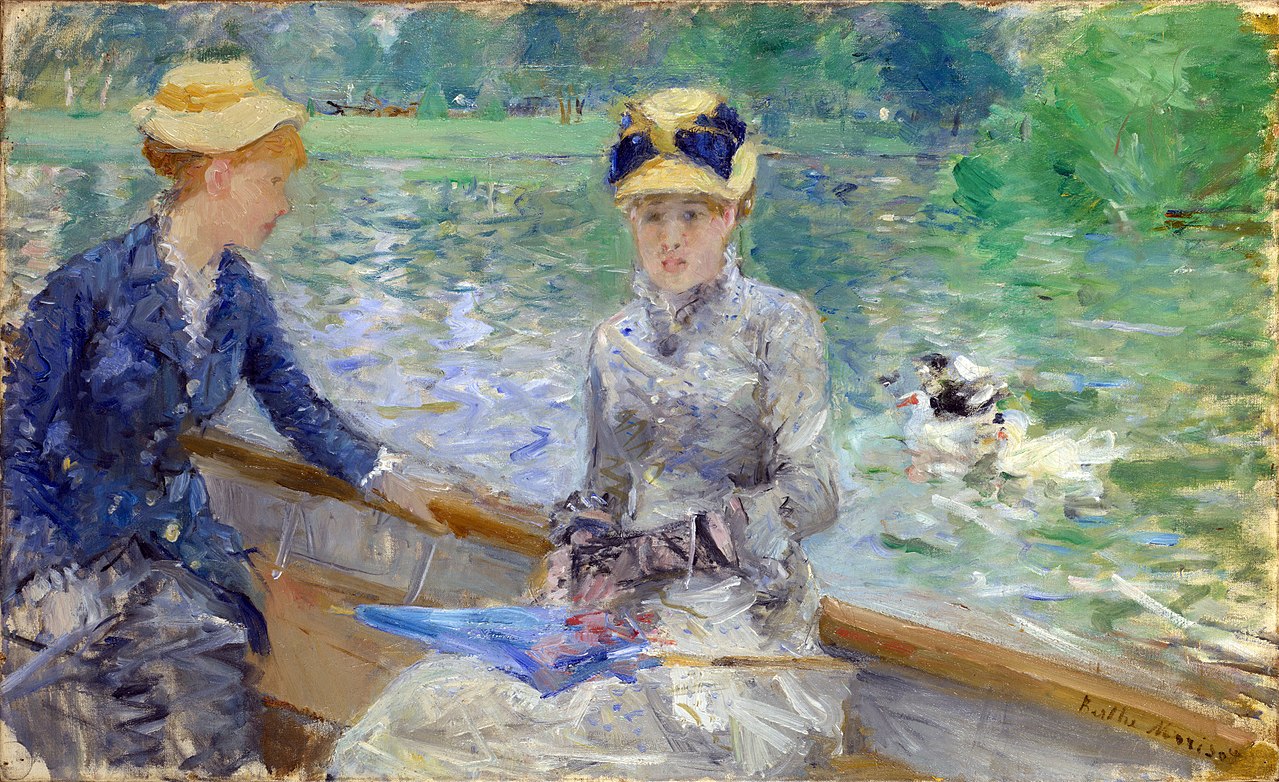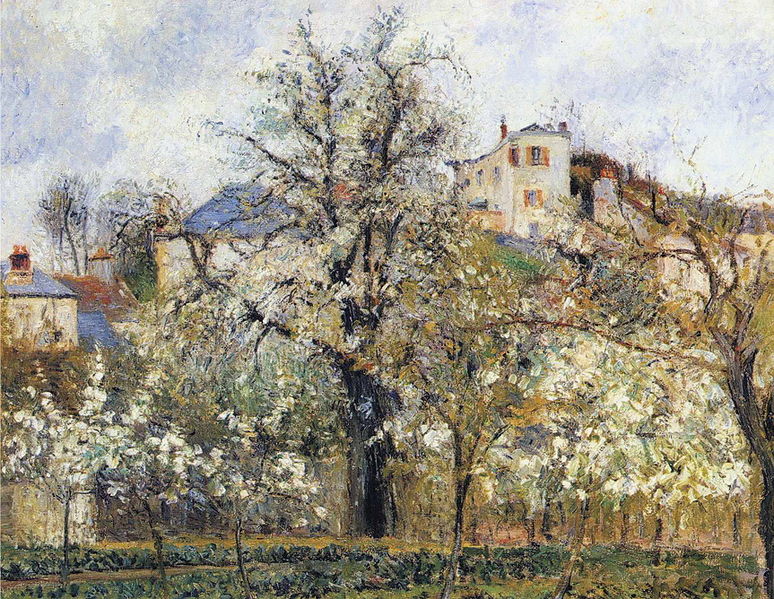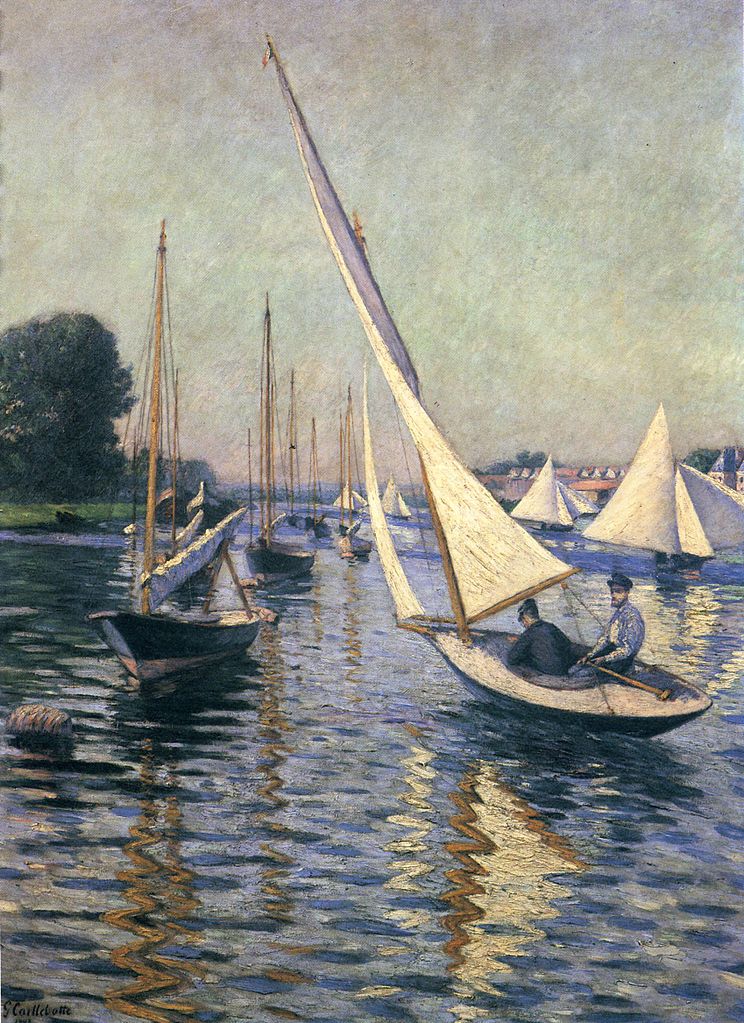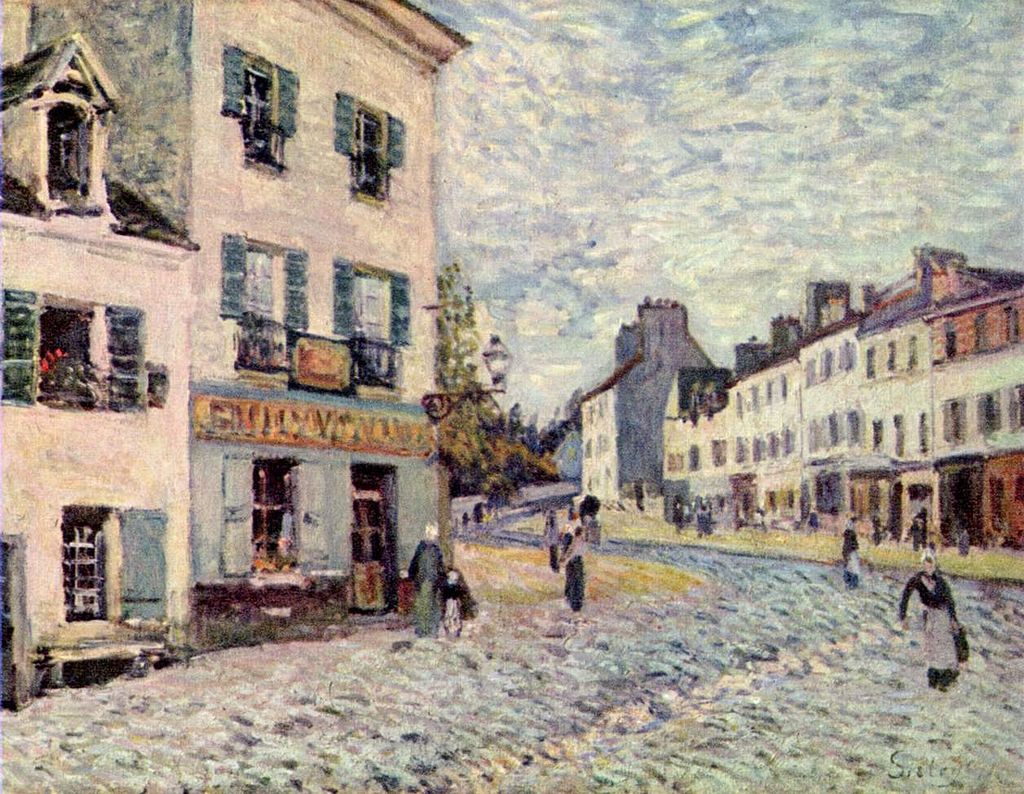Wilhelm Pieck
Rapport sur l’activité du Comité exécutif de l’IC au 7e congrès de l’Internationale communiste: Entre le 6e et le 7e congrès de l’Internationale communiste
26 juillet 1935
Camarades,
Sept années d’une lutte pénible et lourde de sacrifices des masses travailleuses contre leurs oppresseurs et exploiteurs séparent les VIe et VIIe congrès mondiaux de l’Internationale communiste. Ces sept années ont apporté un grand changement dans les rapports de forces entre les classes dans le monde entier et fourni au prolétariat une expérience révolutionnaire d’une richesse immense.
Aussitôt après le VIe congrès mondial, les événements ont confirmé la justesse de notre analyse des perspectives du mouvement révolutionnaire. Nous avions raison de dire que le développement de la révolution en Chine, l’insurrection d’Indonésie, les puissantes manifestations qui se déroulèrent en Europe et en Amérique contre l’exécution de Sacco et Vanzetti, la grève générale en Angleterre (1926), les événements de juillet 1927 à Vienne et l’accroissement marqué du mouvement gréviste dans la plupart des pays capitalistes depuis 1927 étaient les indices du nouvel essor révolutionnaire commençant. Nous prédisions l’accroissement ultérieur de cet essor.
Le congrès fixe comme tâche aux sections de l’Internationale communiste d’organiser et de diriger la lutte grandissante des travailleurs contre les classes des exploiteurs.
La nécessité de défendre les intérêts vitaux des masses travailleuses, d’accroître leur capacité de lutte contre l’exploitation et l’oppression renforcées, de rassembler les masses pour cette lutte, détermina la IXe assemblée plénière du CE de l’IC, en 1928, à fixer pour les communistes la tâche de mettre en relief d’une manière plus précise et plus vigoureuse leur ligne politique particulière, différant fondamentalement de celle des réformistes, de la mettre en relief aussi bien dans toutes les questions politiques générales (guerre, attitude à l’égard de l’Union soviétique, de la Chine, de l’Inde, de l’Égypte, etc.), que dans celles des luttes quotidiennes de la classe ouvrière (contre les tribunaux d’arbitrage, la réduction des salaires, la prolongation de la journée de travail, contre le soutien des capitalistes dans la question de la rationalisation, contre la “paix dans l’industrie”, etc.).
Cette ligne politique des communistes a trouvé son expression dans la tactique ayant pour mot d’ordre: « classe contre classe », la classe des prolétaires contre la classe de la bourgeoisie.
La tactique « classe contre classe » était dirigée contre le bloc de la coalition de la social-démocratie avec la bourgeoisie.
Elle visait à détruire ce bloc des chefs de la social-démocratie avec la bourgeoisie. Elle n’était pas dirigée contre le front unique des communistes avec les socialistes pour la lutte contre la bourgeoisie, mais l’impliquait au contraire. Elle tendait à la création d’une direction révolutionnaire des luttes économiques et politiques du prolétariat.
Dans l’application de la tactique « classe contre classe », un certain nombre de fautes sectaires ont été commises. Si juste que ce fût pour les communistes, en Angleterre, de présenter aux élections parlementaires des candidatures indépendantes contre les chefs du Labour Party et de lutter pour elles, c’était cependant une faute pour le petit Parti communiste de concentrer toute son attention sur ses propres candidats, sans guère s’occuper de faire présenter des candidats par des conférences ouvrières des syndicats locaux et des organisations locales du Labour Party.
Si juste qu’il fût, pour les communistes d’Allemagne, de se discriminer résolument d’avec la social-démocratie et de mener une lutte intransigeante contre Zörgiebel et Severing, il était par contre, de la part des communistes, erroné de commencer à s’isoler aussi des ouvriers social-démocrates et de les traiter de « petits Zörgiebel ».
Si juste qu’il fût pour les communistes d’Allemagne, de France et d’Angleterre et d’un certain nombre d’autres pays, dans les conditions des années 1928‑29, de ne pas adresser des propositions de front unique aux dirigeants de la social-démocratie, c’était par contre une faute d’interpréter les décisions de l’Internationale communiste en ce sens que nos camarades ne devaient pas non plus faire de telles propositions aux organisations locales de la social-démocratie et des syndicats réformistes.
Par suite de cette application défectueuse de notre tactique « classe contre classe » et même de sa déformation fréquente jusqu’à dire que cette tactique excluait soi-disant le front unique, nos sections n’ont pas obtenu dans cette phase de la lutte les succès qui auraient pu l’être.
C’est seulement lorsque l’essor commença dans le mouvement gréviste, lorsque la social-démocratie s’opposa à ce mouvement et mit en marche la machine d’arbitrage de l’État et se mit à étouffer les grèves, que la tactique révolutionnaire des communistes gagna les sympathies des grandes masses ouvrières. Nos sections commencèrent à se rendre compte de l’importance qu’il y a pour la lutte des ouvriers à organiser des comités de grève indépendants, élus par les ouvriers eux-mêmes.
Mais, dans ce mouvement également, les communistes ont commis nombre d’erreurs sectaires. Ils n’ont pas su implanter organiquement leur influence dans les organisations réformistes et parmi les ouvriers inorganisés.
En organisant la lutte gréviste, les communistes ont renforcé l’esprit de la lutte de classe dans le prolétariat, bien que la social-démocratie se prononçât pour la paix économique et prêchât le “mondisme” et autres théories analogues. Cependant, les communistes ont souvent commis la faute de continuer la grève alors que la majorité des grévistes avaient déjà repris le travail, de la sorte ils se sont assez souvent isolés des grandes masses ouvrières.
Au moyen du mot d’ordre de la direction indépendante des grèves par la minorité révolutionnaire, les communistes ont contribué à déclencher des grèves et à libérer le travail syndical révolutionnaire des chaînes de l’appareil syndical réformiste. Mais en réalisant ce mot d’ordre on a négligé la tâche essentielle, primordiale de la minorité révolutionnaire: assurer le ralliement de la majorité des ouvriers de l’entreprise à la déclaration de la grève et la formation d’un comité de grève indépendant, élu par les grévistes.
Bien que les communistes eussent raison de s’élever contre l’attitude aristocratique traditionnelle des réformistes à l’égard des inorganisés et de se prononcer pour l’entraînement des inorganisés dans les grèves, pour leur entrée dans les comités de grève, un certain nombre d’entre eux, en Allemagne surtout, se sont laissés aller à sous-estimer l’importance des ouvriers organisés et l’influence des syndicats réformistes, non seulement sur les ouvriers organisés, mais aussi sur les inorganisés.
L’Internationale syndicale rouge a posé d’une manière juste la tâche de briser la prétention de la bureaucratie syndicale réformiste de décider souverainement des luttes économiques, prétention dont elle n’usait que pour les empêcher. Mais la décision de la conférence de Strasbourg, tenue au début de 1929, dépassait cet objectif en proclamant que « les comités de grève et les comités d’action ont pour tâche de préparer et de diriger d’une façon indépendante la lutte gréviste, malgré et contre la volonté des syndicats réformistes ».
Cela se rapporte également à la consigne donnée qu’aux élections des comités de lutte dans les lock-outs, ainsi que des comités de grève et autres organismes de lutte, toutes les personnes liées à la social-démocratie et à la bureaucratie syndicale doivent être écartées comme briseurs de grève.
Les expériences des luttes ont également enseigné que les chefs syndicaux réformistes, sous la pression de l’état d’esprit des masses de plus en plus favorable à la grève n’ont pas toujours pu y opposer leur refus et que, par conséquent, la tactique du front unique était possible et nécessaire. Les opportunistes, dans nos rangs, soutenaient l’opinion qu’il fallait bien, dans la question de la grève, placer les bonzes syndicaux réformistes sous la pression de la masse des membres, mais que, dans le cas où les chefs syndicaux refuseraient la grève, il fallait se soumettre à leurs décisions.
Cette conception opportuniste devait, il va de soi, être combattue par nous. Mais c’était une faute, à son tour, de supposer qu’il est opportuniste d’exercer en général une pression sur la bureaucratie syndicale réformiste à l’aide de la masse des membres, sens qu’on a donné en Allemagne et plus tard dans d’autres pays, également à notre point de vue, contre le mot d’ordre brandlérien: « Imposez votre volonté aux bonzes ».
En dépit de ces fautes sectaires, l’influence des communistes sur les masses des ouvriers organisés s’est très rapidement accrue. Aussi les chefs syndicaux réformistes, en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis, ainsi que dans divers autres pays, ont-ils commencé à exclure les communistes des syndicats.
Le Parti communiste allemand adopta, pour combattre ces mesures, une tactique de combat tout à fait juste en recommandant à ses adhérents de signer les engagements proposés par les chefs syndicaux réformistes concernant la soumission à la discipline syndicale, afin de conserver ainsi la possibilité de rester dans les syndicats.
L’indignation croissante des ouvriers révolutionnaires contre les exclusions et contre la politique réformiste scissionniste poussèrent maints militants communistes à poser la revendication pseudo-radicale, mais absolument sectaire, de la cessation du versement des cotisations. Les chefs syndicaux réformistes en profitèrent naturellement aussitôt pour procéder avec plus de vigueur encore à l’exclusion de l’opposition.
Cette politique des réformistes exigeait une consolidation organique de l’opposition syndicale révolutionnaire, surtout en Allemagne et en Pologne. Et, en effet, en 1928‑1929, on obtint quelques succès. Mais, en même temps, on commit de nouveau une faute sectaire, en transformant l’OSR en de nouveaux syndicats et en s’isolant ainsi de la masse principale des syndiqués réformistes. Une autre faute, ce fut pour nos sections dans d’autres pays de reprendre cette décision du PCA d’une façon mécanique sans tenir compte de la situation concrète, toute différente de leurs pays.
Il n’en reste pas moins que ce sont les communistes qui, dans la période précédant la crise, alors que la grève économique constituait la principale forme du développement de la lutte de classe, ont été les principaux promoteurs et chefs de la lutte gréviste dans nombre de pays. Les Partis communistes, durant ce temps, se sont raffermis politiquement et leur influence idéologique sur les masses s’est considérablement élargie. Mais ils n’étaient pas encore devenus une force capable d’utiliser dans toute son ampleur pour la lutte de classe du prolétariat la nouvelle situation qui s’était constituée avec le début de la crise économique.
En automne 1929 commença aux États-Unis la crise industrielle qui se combina à la crise agraire dans les pays agricoles et à la crise dans les colonies et qui gagna avec une rapidité inusitée le monde capitaliste tout entier.
La tâche tactique, durant la crise, était d’organiser la lutte pour empêcher que le fardeau de cette crise soit rejeté sur le dos des masses souffrant de la faim et du froid. Le point stratégique essentiel de cette lutte se trouvait en Allemagne.
Mais la classe ouvrière s’engageait divisée dans cette lutte. La social-démocratie, le plus ancien et le plus grand parti ouvrier, était rongé par la rouille réformiste et, dans les conditions de la crise, elle se plaçait sur le terrain de la collaboration de classe avec la bourgeoisie. Seul, le Parti communiste, relativement jeune, ayant dans beaucoup de pays une influence encore insuffisante, se plaçait sur le terrain de la lutte de classe intransigeante.
Collaboration de classe avec la bourgeoisie ou lutte de classe? Cette question déchirait encore les rangs du prolétariat et affaiblissait ses forces.
Les communistes parvinrent dans un certain nombre de pays, en dépit de la social-démocratie, à porter à un niveau élevé le mouvement des chômeurs, les masses les plus déshéritées parmi les travailleurs.
Dans tous les pays, les communistes ont été à la tête de la lutte contre l’expulsion de leurs logements des chômeurs qui ne peuvent pas payer leur loyer, pour des secours supplémentaires des municipalités, en argent et en nature: pommes de terre, charbon, etc.
Cette lutte a été extrêmement difficile. C’est seulement en créant tout un réseau d’organisations de chômeurs et en faisant de grandes manifestations, où il y a eu bien souvent de violentes collisions avec la police, qu’on parvint à arracher à l’État bourgeois et à ses organes des concessions en faveur des chômeurs.
Grâce à cette lutte, on a réussi dans nombre de pays à soulager le sort d’une partie des chômeurs et à opposer une sérieuse résistance à l’aggravation de la législation sociale, sans parvenir cependant à empêcher de telles aggravations.
Si malgré l’acharnement de la lutte de la partie la plus avancée des chômeurs on n’est pas arrivé à intensifier encore davantage ce mouvement et à en faire la lutte des grandes masses de travailleurs, si le mouvement des chômeurs a même faibli en 1932 dans la plupart des pays, la cause réside, nous semble-t-il, dans les faits suivants:
1. Le sabotage criminel et la lutte directe des chefs de la social-démocratie contre les revendications et contre le mouvement des chômeurs ont empêché d’obtenir une amélioration sensible du sort des grandes masses de chômeurs, ce qui a provoqué parmi eux de la déception et de la passivité.
2. La social-démocratie a empêché que le mouvement des chômeurs soit appuyé par les mouvements de grève des ouvriers qui travaillent et ceux-ci sont restés passifs devant la misère, la détresse, la faim dont souffraient les chômeurs.
3. Nous n’avons réussi à entraîner dans la lutte active qu’une partie peu considérable, 10 à 20 % des chômeurs, tandis que la majorité restait passive.
4. On n’a pas expérimenté toutes les formes et toutes les méthodes de lutte qui auraient pu agiter davantage l’opinion publique et gagner davantage la sympathie de tout le peuple à la lutte des chômeurs. On ne pouvait y parvenir seulement par des manifestations politiques qui n’avaient d’ailleurs pas de but concret. Nous nous souvenons tous de la grande impression que les marches de la faim en Angleterre et aux États-Unis ont produite dans le monde entier. Mais l’impression sur toute l’opinion publique aurait été beaucoup plus grande si vraiment la totalité des chômeurs affamés était descendue dans la rue avec femmes et enfants en exigeant tout simplement du pain et des secours.
5. Les communistes n’ont pas su non plus populariser les mots d’ordre qui, par leur contenu concret, auraient pu mobiliser les chômeurs pour la lutte contre le Capital et lier également à cette lutte les masses des ouvriers qui travaillent.
Il s’agit de revendications telles que confisquer les stocks au profit des chômeurs, imposer spécialement les capitalistes, mise en régie des entreprises qui ferment ou qui licencient leur personnel et d’autres analogues. Les communistes ont bien lancé de telles revendications dans quelques pays, mais, le plus souvent, ils ne l’ont pas fait au moment opportun, leur popularisation n’a pas été faite dans d’assez larges proportions et, surtout, on n’a pas lutté sérieusement pour elles.
6. On n’a pas trouvé non plus tous les moyens possibles de faire secourir les chômeurs par l’État et les organismes publics.
Je ne veux citer qu’un exemple tiré de l’Union soviétique. Lorsqu’en 1921, la famine sévissait dans l’Union soviétique, les masses populaires ont forcé le clergé de l’Église chrétienne, le plus réactionnaire, à céder, pour secourir les affamés, l’or et l’argent qu’il avait amassés. De même, les masses populaires auraient dû exiger que les possédants, l’Église et l’État en Allemagne, aux États-Unis, en Autriche, en Pologne et dans les autres pays, ouvrissent leurs trésors aux chômeurs mourant de faim.
Il est hors de doute aussi que la position fataliste des chefs de la social-démocratie soutenant qu’il n’y a rien à faire contre la force élémentaire de la crise a influencé tout le prolétariat. Il y a eu dans la direction du mouvement des chômeurs beaucoup trop de simple agitation et pas assez d’initiative pour l’organisation d’une lutte réelle.
Les communistes, qui avaient bien su organiser des milliers et des dizaines de milliers de chômeurs, n’avaient pas encore acquis l’aptitude nécessaire pour en gagner des millions au mouvement.
Telle fut la raison pour laquelle en Allemagne une partie des chômeurs a donné dans le piège des fascistes lorsque ceux-ci ont ouvert leurs soupes populaires pour chômeurs, s’est laissée séduire par leur propagande de la « communauté du peuple », se détournant ainsi de la lutte révolutionnaire. L’activité du mouvement a aussi faibli dans d’autres pays.
Je passe maintenant au mouvement de grèves durant la crise. Si les communistes n’ont pas réussi, durant les premières années de la crise, de 1930 à 1932, à entraîner les ouvriers d’entreprise dans les grèves, si ceux-ci sont restés sourds aux appels des communistes à la grève, la cause en fut dans le sabotage de chaque mouvement de grève par les chefs syndicaux réformistes, dans la conception social-démocrate qu’on ne peut pas faire grève en temps de crise. De plus, l’exclusion en masse des communistes des syndicats avait considérablement affaibli leur influence dans les entreprises sur les ouvriers syndiqués.
Mais, finalement, les ouvriers commencèrent en 1932, dans nombre de pays, à entrer plus fréquemment et spontanément en lutte. Ce désir croissant des masses à recourir à la grève obligea les chefs syndicaux à s’y résigner et même à se mettre à leur tête.
En dépit de cette politique de la social-démocratie visant à empêcher de grandes luttes, des groupes avancés de travailleurs engagèrent sans cesse la lutte politique contre le Capital, montrant ainsi la voie juste à des millions et des millions de travailleurs.
Pourquoi les mouvements impétueux des travailleurs n’ont-ils jeté qu’une vive flamme sans résultats sérieux pour la lutte libératrice? Pourquoi n’ont-ils pas tourné en une lutte politique de masse contre l’État bourgeois?
Les causes en résident dans quatre faiblesses essentielles:
1. Ces mouvements étaient pour la plupart spontanés, sans préparation sérieuse, sans rassemblement organique de toutes les forces, sans objectif concret.
Une petite partie seulement de ces mouvements se sont déclenchés à l’appel du Parti communiste.
2. Le Parti communiste s’est bien efforcé de donner à ces mouvements des mots d’ordre concrets, de les élargir, de les porter à un niveau plus élevé de la conscience politique des masses. Mais la social-démocratie et les syndicats réformistes s’y sont opposés de toutes leurs forces. Les Partis communistes n’étaient pas encore assez forts et assez influents pour organiser les masses, qui engageaient spontanément la lutte politique, et leur donner une solide direction.
3. À ces mouvements ont pris part communistes, social-démocrates et inorganisés. Ces masses, entrées spontanément dans la lutte, n’auraient pu garder leur cohésion et être conduites plus avant dans la lutte que si l’on avait créé un front unique entre les organisations communistes et social-démocrates. Mais la social-démocratie s’opposait à un tel front unique et l’a rendu impossible.
Il eut fallu aussi constituer des organismes permanents, élus par les masses, composés de communistes, de social-démocrates et de sans-parti pour diriger la lutte, des organismes possédant une autorité assez grande pour entraîner dans la lutte des masses toujours plus grandes et en même temps assurer à tout le mouvement une direction révolutionnaire. Or, de tels organismes n’ont pas été créés.
4. L’idée de tels organismes permanents a bien surgi dans le mouvement des chômeurs. Mais les comités de chômeurs de villes et de quartiers créés ça et là par les communistes n’avaient ni une base assez large, ni assez d’autorité dans les masses pour accomplir cette grande tâche. Ils n’ont été nulle part un centre politique tant soit peu considérable, un centre d’attraction de la sympathie de tous les travailleurs, ils ne sont pas devenus la chose de toute la classe.
Les Partis communistes, dans les conditions de la crise, avaient assumé une grande et difficile tâche dans la conduite des masses; les communistes devaient compter avec les millions de travailleurs et chercher à entraîner dans le front de lutte toutes leurs couches.
Dans l’accomplissement de ces tâches, les communistes fournirent plus d’un exemple éclatant de travail exemplaire. Mais avec le développement politique précipité et compliqué, leurs mots d’ordre venaient parfois trop tard, ils n’appréciaient pas toujours d’une façon juste le rapport des forces de classe, ils persistaient parfois sur des mots d’ordre et sur des méthodes de lutte qui, encore justes peu de temps auparavant, se trouvaient déjà périmés une fois la situation changée.
Les Partis communistes se sont bien assimilé les constatations importantes du VIe congrès mondial, qu’un nouvel essor révolutionnaire est en train de grandir.
Mais, bien des fois, ils ne se sont pas suffisamment représenté que l’essor révolutionnaire n’est pas séparé de la crise révolutionnaire par une muraille de Chine. Maintes fois, ils se sont fait une idée par trop simpliste de la façon dont les masses ouvrières rompront avec leurs vieux chefs réformistes et se rallieront à la lutte révolutionnaire.
Dans un certain nombre de cas, les communistes ont surestimé la maturité politique des masses et ont pensé qu’on n’avait plus besoin d’un travail difficile et opiniâtre pour apprendre aux masses la lutte politique et les convaincre de sa nécessité. Ils ont pensé qu’il suffisait de populariser le pouvoir soviétique, d’expliquer aux masses le programme que les communistes réaliseront après la prise du pouvoir pour inciter aussitôt les ouvriers à les suivre. Ces idées erronées ont fait que certains Partis communistes sont devenus temporairement de simples organismes de propagande de notre programme au lieu de lier à la propagande du programme la tâche de lancer en temps opportun dans les masses des mots d’ordre qui les mobilisent à l’étape donnée de la lutte.
Les communistes avaient oublié dans leur travail syndical ce que le camarade Staline avait dit le 9 mai 1925 à la réunion des militants de Moscou [Staline: les Questions du léninisme] :
Si les Partis communistes veulent devenir une véritable force de masse qui soit capable de faire avancer la révolution, il faut qu’ils se lient aux syndicats et s’appuient sur eux.
Le camarade Staline avait signalé que certains communistes [Staline: les Questions du léninisme]ne comprennent pas que les simples ouvriers, membres des syndicats, que ceux-ci soient bons ou mauvais, voient en eux les forteresses qui les aident à défendre leurs salaires, leur journée de travail, etc.
C’est précisément pendant la crise où s’abattit une grande misère sur les masses travailleuses que le simple ouvrier sentit d’une façon particulièrement forte que son syndicat, si mauvais qu’il puisse être, n’en est pas moins en état de défendre ses droits et de lui assurer une aide matérielle, fût-ce minime, que ce syndicat n’en constitue pas moins une certaine force, et c’est pour cette raison qu’il ne voulait pas rompre avec lui.
Dans un certain nombre de pays, les communistes ont commis la faute de ne pas tenir compte de cet état d’esprit des masses, de ne pas travailler dans les syndicats et aussi de ne pas savoir changer à temps leur attitude envers eux, de ne pas savoir passer du front unique seulement par en bas au front unique avec les organisations. En Allemagne, au moment de l’offensive du fascisme, certains communistes ont même parlé de la nécessité de « détruire » les syndicats réformistes, contribuant ainsi à isoler les communistes des ouvriers organisés.
Aux États-Unis, les communistes ont déclaré pendant longtemps que la Fédération américaine du travail (AFL) était une organisation purement capitaliste, de briseurs de grèves, ne voyant que son leader Green et ignorant les ouvriers. C’est d’une façon bien plus tardive encore, et même en Allemagne seulement après la prise du pouvoir par Hitler, que les communistes ont donné le mot d’ordre clair: « Défense des syndicats libres », puis, plus tard: « Rétablissement des syndicats libres ». Il fallut beaucoup de temps pour que les communistes comprennent dans d’autres pays la grande importance du travail dans les syndicats.
Une faute aussi grande que celle de sous-estimer le danger fasciste fut, d’autre part, de voir le fascisme même là où il n’existait encore pas.
Cette faute venait de ce que certains publicistes communistes ont interprété d’une façon mécanique ce que signalait le VIe congrès, à savoir que la bourgeoisie cherche à se servir de plus en plus des méthodes de domination fasciste.
En Allemagne, les communistes ont pensé assez longtemps que le gouvernement Hermann Müller réalisait là fascisation, que le gouvernement Brüning était déjà un gouvernement de dictature fasciste. D’autre part, ils ont sous-estimé le mouvement hitlérien, s’imaginant qu’en un pays comme l’Allemagne, où la classe ouvrière était organisée à un degré élevé, il serait impossible aux hitlériens de prendre le pouvoir et que les masses petites-bourgeoises qui affluaient spontanément aux hitlériens leur tourneraient aussi rapidement le dos.
Ces conceptions erronées de la nature du fascisme, cette absence d’une analyse sérieuse du fascisme italien et polonais ont fait que les communistes n’ont pas été capables de lancer à temps des mots d’ordre pour défendre contre le fascisme passé à l’attaque ce qui restait encore de démocratie bourgeoise et d’exploiter les antagonismes au sein de la bourgeoisie.
En Allemagne, c’est seulement à l’élection de la présidence à la Diète prussienne en 1932 que les communistes ont déclaré qu’ils voteront pour les candidats de la social-démocratie et du Centre pour empêcher l’élection des fascistes.
Même en Pologne, où, après 1926, les communistes se sont livrés plus que dans beaucoup d’autres pays à l’étude du fascisme et ont lancé dans les masses des mots d’ordre de lutte contre la destruction des restes des libertés démocratiques bourgeoises, lorsque le bloc « centriste des gauches » a été créé, les communistes n’ont pas été capables d’exploiter les divergences entre le camp gouvernemental et le camp de l’opposition bourgeoise-démocratique.
Ces fautes provenaient de l’idée absolument fausse que tous les partis bourgeois sont fascistes, « qu’il n’y a pas deux méthodes de domination de la bourgeoisie », qu’il ne sied pas aux communistes de défendre les restes de la démocratie bourgeoise.
Tant que nous ne pouvons pas remplacer la démocratie bourgeoise par la démocratie prolétarienne, par la dictature du prolétariat, le prolétariat est intéressé à tout lambeau de la démocratie bourgeoise et doit s’en servir pour préparer les masses au renversement du Capital, à la conquête de la démocratie prolétarienne.
De telles conceptions sectaires, qui n’ont rien de commun avec les enseignements de Marx, Engels, Lénine, Staline, ni avec les décisions du VIe congrès de l’I.C., ont freiné les progrès de l’influence des Partis communistes et empêché notamment la conquête des ouvriers social-démocrates à la lutte commune.
À cette étape de notre lutte, le caractère rétrograde de notre action pour la conquête des alliés du prolétariat parmi les paysans et la petite bourgeoisie des villes se fit sentir avec une force extraordinaire. Nous avons bien triomphé de la sous-estimation de principe et du mépris corporatif des vieux Partis social-démocrates pour les masses petites-bourgeoises, selon lesquels le prolétariat ne saurait se commettre avec les masses petites-bourgeoises. Néanmoins, dans la plupart des pays, abstraction faite de la Pologne et des Balkans, les communistes, jusqu’au moment de la crise, n’ont guère été au-delà de la simple reconnaissance de principe de la nécessité du travail dans les masses petites-bourgeoises des villes et des campagnes.
Bien que l’influence et l’importance du Parti communiste dans les masses travailleuses se fussent puissamment accrues, les communistes ne furent pas assez forts pour briser l’influence des chefs du Parti social-démocrate et des syndicats sur les grandes masses ouvrières et empêcher ainsi ceux-ci de détourner au nom de la simple discipline les masses de la lutte.
C’est précisément la faiblesse de la classe ouvrière, provoquée par sa division et par la trahison de la social-démocratie envers les intérêts des ouvriers, qui a permis à la bourgeoisie allemande de profiter des flottements de la petite bourgeoisie et de la paysannerie pour attirer momentanément ces couches dans le camp du fascisme. Les communistes allemands n’ont pas assez rapidement tenu compte de l’importance extrême du joug de Versailles qui faisait peser un fardeau inouï sur les masses travailleuses, ils n’ont pas été assez habiles pour utiliser la situation ainsi créée dans l’intérêt de la lutte de classe. Ils ont permis à la bourgeoisie allemande de mettre la haine contre le joug de Versailles au service du maintien de sa domination.
***
La victoire du fascisme en Allemagne n’a nullement inauguré, comme le prédisaient les social-démocrates, une longue période de réaction. Bien au contraire, on peut constater dans le monde entier « une tendance à la maturation la plus accélérée de la crise révolutionnaire », ainsi que le soulignait la XIIIe assemblée plénière. Dans le monde entier, « l’idée de l’assaut contre le capitalisme mûrit dans la conscience des masses », comme l’a formulé le camarade Staline au XVIIe congrès du P.C. de l’U.R.S.S.
C’est dans cette situation que l’Union soviétique conquiert toujours davantage le cœur et l’esprit des travailleurs et leur montre le chemin de la lutte. C’est dans cette situation que la victoire du socialisme incite des millions de travailleurs à changer totalement d’opinions et d’idées. C’est dans cette situation que s’accomplit un revirement dans l’esprit des grandes masses travailleuses et ayant tout dans l’esprit des ouvriers membres des Partis social-démocrates et de ceux qui sont organisés dans les syndicats réformistes.
Les premières formes où s’est exprimé ce revirement, furent, premièrement, le front unique du prolétariat mondial organisé spontanément à une large échelle pour défendre les inculpés de Leipzig, où la défense courageuse du communisme par notre camarade Dimitrov eut une grande importance historique pour l’établissement du front unique; deuxièmement, le passage des ouvriers à la riposte active contre le fascisme dans leur propre pays. Le prolétariat ne recule déjà plus sans lutte devant le fascisme comme cela eut lieu en Allemagne, mais il répond à l’offensive fasciste par la grève générale en France, en février 1934, par la lutte armée en Autriche en février 1934, et en Espagne en octobre 1934.
Mais pourquoi donc la lutte armée du prolétariat en février 1934 en Autriche et en octobre 1934 en Espagne, n’a pas mené à la victoire du prolétariat contrairement à l’insurrection armée d’octobre 1917 en Russie?
En avril 1931, la monarchie fut renversée en Espagne, comme elle le fut en Russie en février 1917. La révolution bourgeoise démocratique commença en Espagne. À l’encontre des bolchéviks qui ont lutté dans les Soviets pour la continuation de la révolution, les socialistes espagnols sont entrés comme ministres dans le gouvernement d’Azaña, suivant ainsi l’exemple des menchéviks et des socialistes révolutionnaires russes qui étaient entrés alors comme ministres dans le gouvernement de Kérenski.
Que firent les ministres socialistes espagnols, que fit tout le Parti socialiste espagnol au cours des trois années de la révolution, ce même Parti socialiste qui, en octobre 1934, appela les ouvriers à la lutte armée?
Au lieu de lutter pour le désarmement de la garde civile fasciste réactionnaire, les socialistes espagnols ont voté des crédits pour son développement ultérieur et soutinrent la création de la garde d’assaut, laquelle, tout comme la garde civile, devint le détachement de choc de la contre-révolution contre la classe ouvrière et la paysannerie révolutionnaire.
Au lieu de lutter pour l’éloignement des officiers réactionnaires et pour la démocratisation de l’armée, ils laissèrent les coudées franches aux réactionnaires dans l’armée. Au lieu de désarmer les ennemis du peuple, les fascistes, et de les mettre en prison, ils poursuivirent les communistes et promulguèrent la loi pour la défense de la République, sur la base de laquelle sont jugés les participants des combats d’Octobre, socialistes et communistes.
Ils ne touchèrent pas aux terres, aux propriétés et aux droits de l’Église réactionnaire ainsi qu’à ceux des couvents et ne donnèrent pas de terre aux paysans qu’il fallait gagner à la révolution.
Ils n’introduisirent pas de contrôle ouvrier sur la production, ils n’améliorèrent pas la situation des ouvriers et ne les armèrent pas pour la défense de la révolution. Au lieu d’acculer la bourgeoisie réactionnaire à une impasse, ils lui permirent de s’organiser et de s’armer.
En Autriche, il n’y avait pas de situation révolutionnaire avant les combats armés, comme c’était le cas en Espagne, mais le prolétariat autrichien avait cet avantage que la majorité écrasante des ouvriers était organisée en un parti et dans les syndicats suivant ce parti et que le pourcentage du prolétariat dans ce pays était extraordinairement élevé.
Mais le Parti social-démocrate, que suivaient 90 % des prolétaires autrichiens, n’était pas un parti révolutionnaire ayant préparé systématiquement et d’après un plan la lutte pour la victoire du prolétariat. Ce parti avait encore aidé pendant la révolution de 1918 à 1920 la bourgeoisie à prendre le dessus et s’était contenté du fait qu’il restait à la classe ouvrière des droits démocratiques de pure forme et quelques conquêtes sociales.
Lorsque les fascistes engagèrent la lutte contre la démocratie bourgeoise, les chefs de la social-démocratie reculèrent pas à pas, abandonnant les unes après les autres les conquêtes de la révolution de 1918.
Les forces de combat de la bourgeoisie se développèrent, tandis que celles du prolétariat s’affaiblirent. La foi des masses travailleuses dans la possibilité d’une amélioration de leur situation sous la direction social-démocrate disparut.
C’est une ridicule entreprise de la part d’Otto Bauer de vouloir maintenant, après que la social-démocratie autrichienne a désorganisé les travailleurs par sa façon d’agir et n’a pas préparé la lutte, essayer de prouver qu’il a agi d’après l’exemple des bolchéviks en adaptant seulement la tactique des bolchéviks « asiatiques » aux conditions « européennes ».
L’insurrection armée doit être préparée comme la cause de toute la classe ouvrière. Pour cela il faut gagner la majorité du prolétariat; il y a plus, il est indispensable d’avoir le soutien de la lutte par la majorité des travailleurs. Les socialistes espagnols et autrichiens, par contre, ont fait de l’insurrection une affaire des seules formations de combat.
Pour qu’une insurrection triomphe, il est nécessaire de choisir le moment le plus favorable au prolétariat, les socialistes espagnols et autrichiens, par contre, ont depuis longtemps laissé échapper l’initiative de leurs mains, abandonnant aux fascistes le soin de fixer le moment du combat.
Pour le succès d’une insurrection armée, il est nécessaire que les masses connaissent clairement les objectifs de lutte poursuivis. Or, les chefs social-démocrates espagnols et autrichiens n’ont pas formulé ces objectifs de lutte. Ils n’avaient pas saisi les armes pour renverser la bourgeoisie, mais uniquement pour faire pression sur la bourgeoisie et se défendre contre son offensive.
Le prolétariat russe forma en 1917 des Soviets en tant qu’organismes capables de grouper tous les ouvriers, paysans, employés, soldats et marins.
Les bolchéviks ont lutté pour la direction des masses au sein des Soviets. Les bolchéviks ont transformé les Soviets en organismes de la préparation et de la réalisation de l’insurrection prolétarienne.
En Espagne, par contre, Largo Caballero déclara qu’on n’avait pas besoin de Soviets parce que la classe ouvrière entière était organisée dans les syndicats et dans les partis. Est-ce juste? Non, absolument pas. En Espagne, comme dans tous les autres pays capitalistes, la majorité des ouvriers n’est pas organisée.
En se prononçant contre la formation des Soviets, Largo Caballero et les socialistes espagnols voulaient transformer l’insurrection qui ne peut être que la cause de la classe ouvrière entière en la cause du Parti socialiste ou en celle d’un bloc des partis pour atténuer la force du mouvement et son caractère de masse.
En Autriche, Bauer et Deutsch ne pensaient guère à des organismes de masse de préparation et de direction de la lutte, mais ils suivaient la vraie méthode blanquiste en abandonnant la cause de la lutte armée uniquement au Schutzbund qui luttait isolément. Il aurait suffi de leur part d’appeler les masses à la lutte pour créer en quelques jours des organismes qui eussent été capables de mobiliser pour le combat les larges masses des travailleurs et d’organiser l’appui des Schutzbündler en lutte. Cela aurait changé tout le cours du développement ultérieur des combats à l’avantage du prolétariat.
Cependant, les socialistes autrichiens et espagnols trouvèrent également opportun de négliger au moment de la lutte armée l’expérience de la Révolution russe. Des milliers de prolétaires durent payer de leur vie et de tortures inouïes cet oubli voulu de l’expérience russe.
Nous reconnaissons le fait important que tant en Espagne qu’en Autriche, une partie des chefs social-démocrates, bien que ce ne fût que sous la pression des masses, se sont décidés à la lutte armée contre la bourgeoisie. Les communistes les ont appuyés de façon déterminée.
En Espagne, les communistes adhérèrent à l’ »Alliance ouvrière », bien qu’ils n’eussent aucune influence sérieuse dans celle-ci. En Espagne comme en Autriche, les communistes combattirent dans les premiers rangs, car la place des communistes est partout où on mène la lutte. Mais précisément l’expérience de ces combats armés qui se sont déroulés sous la direction social-démocrate montre que sous cette direction le prolétariat ne peut pas vaincre.
Les succès de la lutte armée dans les Asturies, où fut organisée la garde rouge, où, sous la direction des communistes, la lutte armée s’est développée en une véritable insurrection, confirment ce que la révolution russe a déjà démontré: que pour le succès de la lutte armée du prolétariat une direction communiste bolchévik est nécessaire. Mais par suite de la faiblesse et de la jeunesse des Partis communistes, tant en Espagne qu’en Autriche, cette direction n’a pas existé.
Aussi les éléments révolutionnaires du Schutzbund en ont-ils tiré les conclusions justes, en passant dans les rangs du Parti communiste, montrant ainsi qu’ils ne considéraient pas la lutte comme terminée.
La lutte en France qui prit des proportions particulièrement considérables en février 1934, reste, dans sa manifestation extérieure, à un degré de lutte plus bas qu’en Espagne et en Autriche, mais du fait que les sections de lutte du prolétariat français furent tournées au moment nécessaire contre le fascisme, elles exerçaient une influence plus grande sur le développement de la lutte prolétarienne dans tous les pays.
Quel est le fait distinctif de la lutte en France?
Lorsque les bandes fascistes pour la première fois descendirent en masse dans les rues de Paris, le prolétariat français ne se laissa pas endormir comme en Allemagne par la théorie du moindre mal et par le bavardage sur la démocratie de pure forme, mais sans distinction de parti, il déferla dès la première offensive fasciste dans les rues pour faire face au fascisme par la manifestation politique puissante du 9 février et par la grève générale politique du 12 février 1934. Ce faisant le prolétariat français a repoussé la première grande offensive des fascistes en France.
Par cette action le prolétariat contraignit le Parti socialiste français à accepter d’établir le front unique avec le Parti communiste, bien qu’avec de grandes hésitations. Cela fut la base des actions antifascistes communes de l’ensemble du mouvement ouvrier organisé qui exercent une influence énorme sur la majorité inorganisée de la classe ouvrière et des masses petites-bourgeoises dans les villes et les campagnes.
Notre Parti communiste français, puissamment accru et faisant preuve de grande initiative, ne s’est pas contenté d’établir le front unique avec les socialistes, mais il a établi un programme de revendications qui attaquent la bourgeoisie en pleine chair.
Le Parti communiste français par sa façon d’agir a posé les fondements d’un large front populaire en vue de la lutte contre le fascisme et la guerre, qui attire des couches de plus en plus larges de paysans, de la petite bourgeoisie urbaine et des intellectuels, amène au mouvement les adhérents du Parti radical-socialiste et assure, de plus en plus, au prolétariat révolutionnaire l’hégémonie et la direction de la lutte de tous les travailleurs.
La lutte du prolétariat français a une grande importance internationale.
Les succès du prolétariat français qui, en février 1934, a refoulé le premier assaut de masse des fascistes, ,grâce au front unique des communistes et des socialistes, qui, le 14 juillet 1935, a déclenché sa formidable marche de lutte contre le fascisme, ont montré aux travailleurs de tous les pays, que seule la lutte commune des travailleurs sur la base d’une tactique révolutionnaire peut repousser l’offensive du Capital et du fascisme et mettre fin aux manœuvres des instigateurs de la guerre.
La lutte du prolétariat français a montré à tous les travailleurs comment doit agir le prolétariat dans les pays capitalistes pour repousser les attaques du fascisme et pour marcher à la conquête de la dictature du prolétariat, au socialisme.
L’accord de front unique entre les socialistes et les communistes en France, auquel les socialistes n’ont consenti que sous la pression des masses, contre la volonté expresse de l’Exécutif de la IIe Internationale, a montré le chemin aux social-démocrates de gauche dans tous les pays.
Des accords de front unique se sont réalisés entre les communistes et les socialistes en Autriche, en Espagne, en Italie, et des actions de masse de la classe ouvrière sur la base du front unique ont eu lieu en Angleterre, aux États-Unis, en Pologne, en Tchécoslovaquie et dans beaucoup d’autres pays où les dirigeants des Partis socialistes de même que l’Exécutif de la IIe Internationale continuent à décliner tout accord avec les communistes.
Le mouvement de front unique des travailleurs se fraie la voie dans tous les pays capitalistes, quoi que fassent les chefs de la social-démocratie pour s’opposer dans la pratique à l’entente avec les communistes, quelle que soit chez les chefs la peur de l’influence révolutionnaire du front unique ·avec les communistes sur les masses qui les suivent.
Le mouvement pour le front unique signifie beaucoup plus que l’addition arithmétique des forces des deux partis ouvriers. La majorité de la classe ouvrière dans les pays capitalistes est inorganisée et dans beaucoup de pays elle suit encore les partis bourgeois.
Le front unique du mouvement ouvrier signifie une telle augmentation de ses forces qu’il devient une force d’attraction puissante pour les masses prolétariennes jusqu’à présent sans conscience de classe, qu’il les détache des partis bourgeois et les entraîne dans la lutte de classe.
***
Le développement des événements historiques dépend aujourd’hui plus que jamais du degré de conscience et d’organisation de la classe ouvrière, d’une tactique habile et intelligente des communistes, de la puissance et des effectifs de l’Internationale communiste.
Le camarade Staline a dit dans son rapport au XVIIe congrès du P.C. de l’U.R.S.S. en janvier-février 1934 [ Staline: les Questions du léninisme Staline: Deux mondes] :
Certains camarades pensent qu’aussitôt que commence une crise révolutionnaire. force est à la bourgeoisie d’entrer dans une situation sans issue, que sa fin est donc déjà déterminée à l’avance, que la victoire de la révolution s’en trouve déjà assurée et qu’ils n’ont qu’à attendre simplement le renversement de la bourgeoisie et à écrire des résolutions de victoire. C’est une grave erreur; la victoire de la révolution ne vient jamais d’elle-même, il faut la préparer et remporter de haute lutte. Or, seul un fort parti prolétarien révolutionnaire peut la préparer et la gagner. Il y a des moments où la situation est révolutionnaire, où le pouvoir de la bourgeoisie est ébranlé jusqu’aux fondements, mais où la victoire de la révolution, néanmoins, n’arrive pas, parce qu’il n’y a pas de parti révolutionnaire du prolétariat possédant assez de force et d’autorité pour conduire les masses et pour prendre le pouvoir entre ses mains. Il serait absurde de croire que de pareils “cas” ne peuvent pas se produire.
Nous devons avouer que de pareils “cas” se répètent, que de pareils “cas” peuvent encore se répéter, si nous ne tenons pas compte de l’avertissement du camarade Staline et si nous ne faisons pas tout ce qui est possible et nécessaire pour renforcer les Partis communistes et veiller à ce qu’ils acquièrent la possibilité de conquérir la majorité du prolétariat.
La période entre les VIe et VIIe congrès mondiaux de l’Internationale communiste a été, comme je l’ai déjà dit auparavant, une période de revirement dans les masses ouvrières en faveur de la lutte révolutionnaire, une période d’accroissement rapide de l’influence des Partis communistes sur les masses et en même temps une période de consolidation organique et politique des Partis communistes.
Cette consolidation politique et organique des Partis communistes s’est réalisée dans la lutte contre les éléments de droite qui poussaient le Parti à capituler devant la social-démocratie. Aussitôt après le VIe congrès mondial, ce fut le soulèvement des droitiers contre la ligne du congrès: Brandler en Allemagne, un peu plus tard Lovestone aux États-Unis, Jilek en Tchécoslovaquie, Kilbom en Suède, Sellier et plus tard Doriot en France.
Cependant, ni en Allemagne, ni aux États-Unis, ni en Tchécoslovaquie, ni en France, les opportunistes de droite n’ont réussi à entraîner à leur suite une partie tant soit peu importante des membres du Parti. Ce n’est qu’en Suède que le groupe de Kilbom réussit à scinder le Parti communiste de Suède, par suite d’un travail d’explication défectueux et des fautes des partisans de la ligne de l’IC, et à détacher de l’IC une partie des ouvriers révolutionnaires.
Dans la lutte contre les droitiers, de même que dans la lutte simultanée contre les conceptions sectaires “de gauche” menant le Parti à l’isolement des larges masses, les Partis communistes se sont suffisamment trempés pour se défendre de l’influence opportuniste.
Par suite de la consolidation au sein du Parti, grâce à l’expérience recueillie dans la nouvelle étape de lutte et d’éducation sérieuse des cadres, les Partis communistes sont parvenus à un nouveau degré, à un degré supérieur. On en trouve le témoignage dans les combats héroïques de l’Armée rouge chinoise à la tête de laquelle sont des paysans, des ouvriers agricoles, des étudiants, qui, au cours de ces sept années, ont été éduqués par le Parti et se sont développés en organisateurs et guides marquants des masses et en hommes d’État prolétariens.
On en trouve le témoignage dans le travail du Parti communiste d’Allemagne, dans le travail de ses cadres de base, qui malgré la désorganisation fréquente de la direction centrale par la Gestapo (police secrète d’État) et une atroce terreur moyenâgeuse, savent s’orienter d’une façon indépendante dans les questions politiques compliquées, publient des milliers de journaux illégaux et organisent la lutte des ouvriers contre les nationaux-socialistes. On en trouve le témoignage dans la tactique habile du PC de France qui a amené l’établissement du front unique et l’union des larges masses du peuple pour la lutte contre l’offensive des fascistes.
On en trouve le témoignage dans les combats d’Octobre en Espagne, où cinq ans auparavant, il n’y avait encore qu’un insignifiant groupe de propagande communiste, dirigé par des éléments semi-trotskistes qui, plus tard, brisèrent avec l’IC, mais où au cours des dernières années, fut fondé un fort Parti communiste qui a dirigé les combats armés dans une importante partie des Asturies.
Les sept années écoulées ont montré au monde que partout où les masses travailleuses commencent la lutte contre le joug impérialiste, contre le rançonnement des travailleurs par la haute finance, les banques et les trusts, pour la défense de la liberté des peuples et pour la culture humaine, les communistes ont lutté dans les tout premiers rangs.
Au cours des sept années écoulées, le monde a pu se persuader de la fermeté et de l’abnégation, du dévouement illimité des cadres de l’Internationale communiste à la cause de la lutte pour la libération de tous les exploités et opprimés.
Souvenez-vous de l’attitude de Dimitrov au procès de Leipzig, rappelez-vous les procès contre Rakosi en Hongrie, Antikaïnen en Finlande, Fiete Schulze en Allemagne, souvenez-vous de la mort héroïque des camarades Tsou-tsu-bo (Strakhov), de Lütgens, Kofardjiev, souvenez-vous enfin des nombreux héros et victimes de la grande lutte de libération dans tous les pays du monde.
Face à l’abandon impétueux du réformisme par les masses, à la menace de la révolution prolétarienne, la bourgeoisie procède à la suppression des derniers vestiges des libertés démocratiques bourgeoises et des organisations du prolétariat, y compris celles des Partis social-démocrates et des syndicats.
Par suite de cette offensive de la bourgeoisie contre les organisations ouvrières, sur les 67 sections de l’Internationale communiste, dans les pays capitalistes, 22 sections seulement, dont onze en Europe, peuvent aujourd’hui travailler légalement ou semi-légalement, 45 sections, dont 15 en Europe, sont contraintes de travailler dans la plus stricte illégalité et dans les conditions de la terreur la plus cruelle. Dans le nombre, il y a quelques pays comme l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche, la Lettonie où les fascistes ont détruit toutes les organisations du prolétariat, y compris aussi celles des Partis social-démocrates et des syndicats et poussent de force les ouvriers dans les organisations fascistes.
Je passe maintenant à l’état d’organisation de nos sections. Dans tous les pays nos sections ont grandi politiquement et numériquement. Mais les progrès d’organisation ne répondent pas à l’accroissement de notre influence et il peut en résulter que les Partis communistes soient incapables de se montrer pleinement à la hauteur de la tâche formidable que .leur impose la situation politique dans la question de la direction des masses.
Les progrès d’organisation des sections de l’Internationale communiste dans les pays où le mouvement est légal se heurtent aujourd’hui, avant tout, à un certain nombre de défauts dans le recrutement de nouveaux membres, dans le travail de leur éducation, ainsi que dans le développement des organisations du Parti. C’est ce qui ressort tout particulièrement dans les fluctuations, c’est-à-dire que les nouveaux membres nouvellement gagnés au parti ou bien n’entrent pas réellement dans ses rangs, ou le quittent à nouveau au bout de quelques mois.
Beaucoup parmi les ouvriers nouvellement affiliés au Parti sont politiquement encore peu éduqués, ne sont pas encore suffisamment actifs et disciplinés. Il faut donc que l’organisation du Parti s’occupe beaucoup d’eux pour en faire des communistes voulant lutter et des militants du Parti. Or, c’est précisément de cela que souvent les anciens membres se préoccupent fort peu. Le développement organique des sections de l’Internationale communiste dans les pays où le mouvement est illégal se trouve fortement entravé par les mesures de répression policière et par la peur de la pénétration de provocateurs dans l’organisation. Mais dans les sections illégales, les nouveaux adhérents, en règle générale, sont mieux éduqués, mieux disciplinés et plus actifs. Cependant là, également, de grands défauts se manifestent.
Très souvent les cellules ne sont pas des organisations politiques examinant les diverses questions politiques, ce qui ne s’explique nullement par les besoins éventuels de la conspiration. Les cellules ne sont souvent que des organisations qui encaissent les cotisations ou répartissent les fonctions du travail du Parti.
Dans beaucoup d’organisations, aussi bien dans les sections légales qu’illégales, règne une peur sectaire de l’afflux d’anciens ouvriers social-démocrates. Ce sectarisme, dans maintes organisations d’Allemagne, a atteint un tel point qu’on a établi pour les anciens social-démocrates des conditions spéciales d’admission ou qu’on les a groupés dans des cellules spéciales, en formulant même souvent, à leur égard, des exigences politiques trop élevées. Une telle façon de traiter les anciens social-démocrates témoigne d’une incompréhension totale du revirement qui se produit parmi les masses social-démocrates.
Ce revirement ressort de l’exemple de notre Parti autrichien qui, aujourd’hui, se compose, pour plus des 2/3, de camarades qui, il y a une année encore, étaient dans le Parti social-démocrate et sont aujourd’hui des membres fidèles, dévoués et actifs du Parti communiste d’Autriche. Et il en est ainsi non seulement des simples membres du rang de la social-démocratie, mais également des anciens militants social-démocrates.
Je voudrais ici indiquer deux secteurs particulièrement importants du travail d’organisation de nos Partis qui sont précisément les plus négligés, c’est le travail parmi les femmes et parmi les jeunes. Les prémices dans tous les pays sont des plus favorables, précisément à. l’heure actuelle, pour les gagner à la lutte révolutionnaire.
Le- travail des communistes dans les syndicats et dans les autres organisations groupant des masses ouvrières est la condition première, décisive pour le succès du travail de masse des communistes et pour la conquête des masses par les Partis communistes. Sans assurer leur influence sur les masses des membres de ces organisations, il ne saurait être question pour les Partis communistes de conquérir la majorité de la classe ouvrière.
Dans les pays où toutes les organisations ouvrières sont détruites par les fascistes, les communistes ne pourront toucher les grandes masses ouvrières s’ils n’utilisent toutes les possibilités légales ou semi-légales, s’ils ne travaillent dans les syndicats fascistes en Italie et en Autriche, ainsi que dans les rangs du soi-disant « Front du travail » en Allemagne, si dans ces organisations ils ne luttent pour conquérir l’influence sur les masses, pour leur direction.
Notre mot d’ordre, dans la lutte pour la conquête de la majorité du prolétariat pour le Parti communiste est: élargir le front, pénétrer plus profondément dans toutes les organisations de masse.
La tâche de notre travail au sein du Parti est: renforcer le Parti et élever le niveau politique de ses organisations.
D’une manière générale, je ne veux souligner tout particulièrement qu’un seul point. Un nombre de plus en plus grand de Partis communistes qui, au moment du VIe congrès mondial, n’étaient encore que de simples groupes de propagande, commencent aujourd’hui à se transformer en partis de masse et à devenir des facteurs politiques importants dans leur pays. Dans tous les Partis communistes des grands pays, il s’est déjà formé des organismes dirigeants fidèles à nos principes et capables de résoudre de façon indépendante, en se basant sur les décisions de nos congrès et assemblées plénières, les questions politiques et tactiques les plus complexes de leur pays.
Ce fait modifie les fonctions du Comité exécutif de l’Internationale communiste et permet au CE de l’IC de porter le centre de gravité de son activité sur l’élaboration de l’orientation politique et tactique fondamentale du mouvement ouvrier international, étant bien entendu que pour la solution de toutes les questions il faut partir des conditions concrètes et des particularités de chaque pays donné, se faire une règle d’éviter l’immixtion dans les questions d’organisation intérieure des différents Partis et venir en aide à tous les Partis pour la consolidation d’organismes dirigeants véritablement bolchéviks, dans la question de l’agitation, de la propagande et de l’utilisation internationale de l’expérience du mouvement communiste mondial.
Il faut que nous donnions à notre travail une impulsion beaucoup plus forte et il ne doit pas y avoir aujourd’hui, ni dans la politique intérieure et extérieure des pays, ni dans les rapports réciproques entre le Parti et les groupes, de questions sur lesquelles les communistes ne portent pas leur attention, au sujet desquelles ils ne prennent pas position, afin d’influencer tout le cours du développement historique.
***
Quelles sont les perspectives du développement mondial, quelles sont les perspectives de la révolution mondiale?
Le système capitaliste est ébranlé jusque dans ses fondements par le développement de la crise générale du capitalisme, par la crise économique mondiale, par le révolutionnement croissant des travailleurs et par les symptômes de la crise politique qui se manifestent dans nombre de pays.
Les forces de la bourgeoisie se sont affaiblies, les forces du prolétariat se sont consolidées. Le rapport des forces à l’échelle mondiale a changé en faveur du socialisme, au détriment du capitalisme.
L’Union soviétique est devenue le facteur le plus puissant et le plus important dans la lutte mondiale pour le socialisme. Si, au moment du VIe congrès mondial de l’IC elle était encore un État relativement faible qui ne possédait pas de grande industrie digne d’être mentionnée, aujourd’hui l’Union soviétique est devenue une grande puissance socialiste, regorgeant de forces au point de vue économique et politique, qui s’appuie sur une industrie lourde parachevée et sur la meilleure technique moderne.
Aujourd’hui l’Union soviétique, par l’ensemble de sa politique, a une influence de plus en plus forte sur les destinées du capitalisme mondial et sur le développement de la lutte pour la libération du prolétariat mondial et des peuples des pays coloniaux et dépendants. C’est dans cette influence de plus en plus croissante de la victoire du socialisme dans l’Union soviétique sur le développement mondial et sur la conscience des masses travailleuses des pays capitalistes que se manifeste l’importance mondiale de la victoire du socialisme dans un seul pays, car c’est une victoire qui ne peut rester isolée, mais qui mène à la victoire du socialisme dans le monde entier.
C’est dans la victoire du socialisme en U.R.S.S. et les perspectives illimitées du développement ultérieur de l’U.R.S.S., dans la voie du socialisme, que nous puisons l’assurance que notre influence sur les masses travailleuses du monde entier s’accroîtra avec une rapidité énorme, que la victoire du socialisme orientera vers le communisme la classe ouvrière de tous les pays et entraînera la victoire du socialisme dans le monde entier.
Mais le système capitaliste n’abandonnera pas sans lutte l’arène de l’histoire mondiale.
Le système capitaliste est affaibli, mais le capitalisme a réussi à remonter du point le plus bas de la crise économique. Cependant, trois ans après que fut dépassé ce point le plus bas de la crise, malgré l’influence notoire des préparatifs de guerre sur l’accroissement de la production, la production dans la majorité des pays n’a néanmoins pas atteint à nouveau le niveau de la période d’avant la crise.
Cette situation économique, qui est caractérisée par une dépression de nature particulière, qui condamne dans tous les pays capitalistes des dizaines de millions de chômeurs à la famine et à l’extinction et des centaines de millions d’ouvriers, de paysans, d’intellectuels, de petits bourgeois et d’esclaves coloniaux à l’indigence, a encore approfondi l’abîme entre le petit groupe de monopolistes du capital financier et les masses fondamentales du peuple vouées à la misère et au désespoir.
La foi dans le capitalisme, dans l’aptitude des chefs et des dirigeants de l’économie capitaliste et de l’État à trouver une issue à la crise et à arriver à une nouvelle prospérité est sapée parmi les larges masses du peuple. L’autorité des impérialistes est affaiblie dans les colonies, tous les fondements économiques, sociaux et politiques de la société bourgeoise sont ébranlés, de sorte que les classe dominantes elles-mêmes sont obligées de recourir à une démagogie anticapitaliste.
Telle est la situation qui, mettant sous les yeux des masses travailleuses de la façon la plus tangible le contraste entre le capitalisme et le socialisme, aggravera rapidement la lutte des opprimés contre leurs oppresseurs, fera rapidement grandir l’indignation des masses contre le régime capitaliste, portera à maturité la crise révolutionnaire et fera mûrir dans la conscience des masses prolétariennes de plus en plus larges l’idée de l’assaut du capitalisme.
Mais il peut arriver que dans quelques pays, l’économie capitaliste surmontant les conditions défavorables à son développement, connaisse encore un essor passager, que la bourgeoisie de ces pays trouve un allégement. Cependant, un tel essor de l’économie capitaliste dans les conditions de l’aggravation générale de la crise du capitalisme ne saurait amener la stabilisation et le reflux de la vague révolutionnaire. Au contraire, cela ne fera que renforcer la lutte entre les différents groupes de la bourgeoisie qui s’empresseront de profiter de la conjoncture améliorée, cela accentuera la lutte sur l’arène internationale, car les marchés sont protégés par de hautes barrières douanières, car en fin de compte l’essor d’un pays quelconque se fera aux dépens d’autres pays qui seront refoulés à l’arrière-plan.
Notre tâche est d’organiser ces masses travailleuses qui se lèvent contre le capitalisme en une armée révolutionnaire cohérente du prolétariat et de la conduire à l’assaut du capitalisme.
Notre congrès mondial doit raffermir la volonté de tous les prolétaires de mettre fin à la division dans la classe ouvrière, d’établir un large front unique capable de mobiliser les plus grandes masses du peuple pour la lutte contre l’offensive du Capital, contre le fascisme et la guerre.
Notre congrès mondial doit montrer au prolétariat la voie vers un parti révolutionnaire unique se plaçant sur le terrain inébranlable du marxisme-léninisme.
Nous, communistes, nous montrons aux masses la seule issue de la crise, l’issue des ouvriers et des paysans de l’Union soviétique, l’issue du pouvoir soviétique.
Notre tâche n’est pas seulement de montrer cette issue aux masses, mais de nous y engager avec elles, à leur tête.
Nous partons en lutte pour la liberté, pour la paix, pour le pain, pour le pouvoir soviétique, pour le socialisme.
Notre principal mot d’ordre est la lutte pour le pouvoir soviétique. Notre drapeau est le drapeau de Marx, d’Engels, de Lénine, de Staline!
Notre chef est Staline!
Sous ce drapeau pénétrons plus profondément dans les masses, resserrons nos liens avec les masses, élargissons le front unique avec le prolétariat!
Communistes! Soudez la classe révolutionnaire en une seule armée politique de millions d’organisés!
>Retour au dossier sur le septième congrès de l’Internationale Communiste