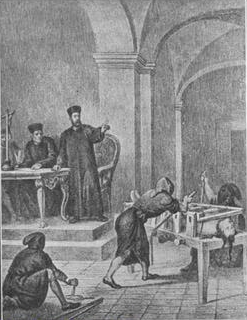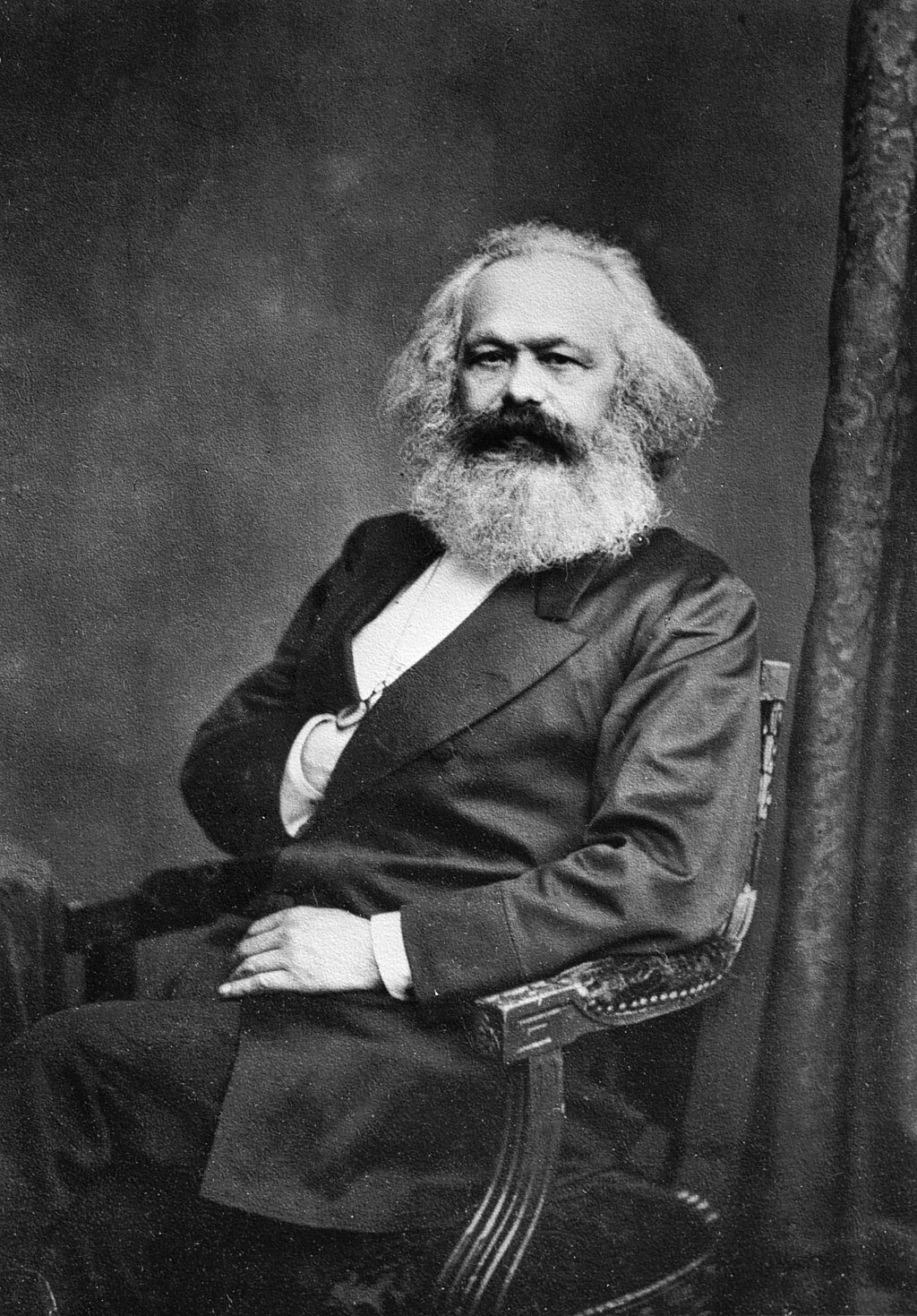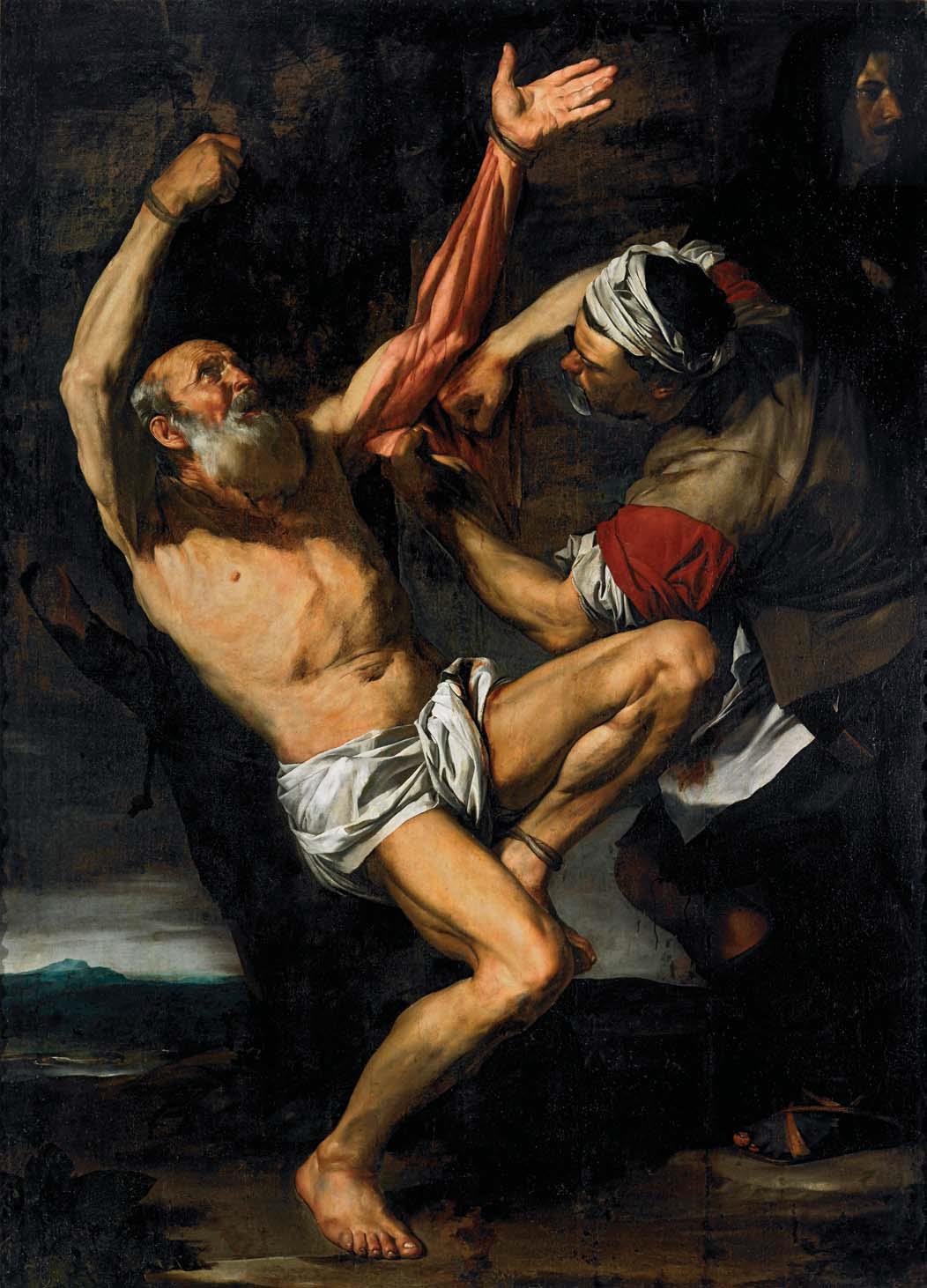À la suite du coup de force d’extrême-droite de février 1934, les ouvriers socialistes et communistes ont pris l’initiative de se confronter aux agitateurs fascistes ; dans la foulée s’initie un processus d’unité entre le Parti socialiste-SFIO et le Parti Communiste Français.
Pareillement, la CGT et la CGT-Unitaire se rapprochent, jusqu’à la fusion en mars 1936, alors que l’unité socialiste-communiste s’étend aux radicaux, pour former le Front populaire.
La tension est alors extrême dans une France touchée par la crise générale du capitalisme ; cette dernière a mis du temps à s’installer, mais sa pression est devenue très forte sur les masses sur le plan de l’économie.

Du côté de la bourgeoisie française, il y a l’inquiétude politique, dans la mesure où l’Allemagne nazie cherche clairement à gagner en dimension militaire. Une fraction est pour s’en rapprocher, par refus des « rouges », mais les valeurs traditionnelles de la République tendent plutôt à intégrer ceux-ci.
C’est en ce sens qu’il faut comprendre les revendications du Front populaire. On parle ici de :
– la dissolution des ligues fascistes, qui mènent des troubles et s’arment massivement ;
– l’élévation du pouvoir d’achat populaire ;
– la mise en place d’un fonds national pour les chômeurs ;
– l’aménagement des dettes des petits commerçants ;
– la réduction des heures de travail hebdomadaires sans baisse de salaire ;
– l’instauration d’une retraite minimale ;
– la programmation de grands travaux ;
– la nationalisation de l’industrie de l’armement ;
– des impôts plus importants pour les grandes fortunes ;
– l’arrêt du commerce privé des armes ;
– le contrôle des capitaux quant à une éventuelle sortie du pays,
– le soutien à la Société des nations pour la sécurité collective.
Dès son élection, le gouvernement du Front populaire, par la voix de Léon Blum, présenta ainsi les mesures devant être réalisées dans le plus bref délai :
« L’amnistie,
La semaine de quarante heures,
Les contrats collectifs,
Les congés payés,
Un plan de grands travaux, c’est-à-dire d’outillage économique, d’équipement sanitaire, scientifique, sportif et touristique,
La nationalisation de la fabrication des armes de guerre,
L’office du blé qui servira d’exemple pour la revalorisation des autres denrées agricoles, comme le vin, la viande et le lait,
La prolongation de la scolarité,
Une réforme du statut de la Banque de France, garantissant, dans sa gestion, la prépondérance des intérêts nationaux,
Une première révision des décrets-lois en faveur des catégories les plus sévèrement atteintes des agents des services publics et des services concédés, ainsi que des anciens combattants. »
Le Parti Communiste Français est celui qui a porté le Front populaire, doublement : de par la mobilisation de sa base contre les fascistes, en premier lieu, ensuite avec l’alignement sur une ligne d’unité la plus large possible.
Le prestige du Parti Communiste Français est alors immense dans l’Internationale Communiste, et tous les espoirs sont permis pour lui. Il peut enfin abandonner sa ligne sectaire, avec une hémorragie permanente de cadres et de militants, et se lancer dans la politique.
Cependant, Maurice Thorez ne le veut pas. Celui qui a porté le combat contre les ultra-gauchistes a déformé le Parti Communiste Français. Il se précipite dans une quête de légitimité sans bornes.
Sur Radio-Paris, il s’exprime ainsi, et il faut noter que c’est la première fois qu’un responsable du Parti Communiste Français a le droit de prendre la parole sur une antenne nationale.
« Nous travaillons à l’union de la nation française contre les deux cents familles et leurs mercenaires. Nous travaillons à une véritable réconciliation du peuple de France.
Nous te tendons la main, catholique, ouvrier, artisan, commerçant, nous qui sommes des laïques, parce que tu es notre frère, ancien combattant devenu Croix de feu, parce que tu es un fils de notre peuple, parce que tu souffres comme nous du désordre et de la corruption, parce que tu veux, comme nous, éviter que la paix ne glisse à la ruine et à la catastrophe.
Nous sommes le grand Parti communiste, aux militants dévoués et pauvres, dont les noms n’ont jamais été mêlés à aucun scandale et que la corruption ne peut atteindre. Nous sommes les partisans du plus noble idéal que puissent se proposer les hommes.
Nous communistes, qui avons réconcilié le drapeau tricolore de nos pères et le drapeau rouge de nos espérances, nous vous appelons tous. Oui, nous voulons et nous ferons une France dont les fils, unis et libérés du joug du capital, pourront dire : nous ne convoitons pas un pouce de territoire étranger, mais nous ne laisserons pas toucher à un pouce de notre territoire.
Il n’est pas vrai que notre histoire appartienne au passé. Nous combattons pour l’avenir. Nous croyons que la République française des Conseils ouvriers et paysans assurera à jamais à notre peuple le travail, le bien-être, le bonheur, la liberté et la paix. »
« Les deux cents familles » est un concept composé par les radicaux, pas par les communistes. C’est Édouard Daladier qui formule le concept lors du congrès du Parti radical-socialiste d’octobre 1934.
« Ce sont deux cents familles qui, par l’intermédiaire des conseils d’administration, par l’autorité grandissante de la banque qui émettait les actions et apportait le crédit, sont devenues les maîtresses indiscutables, non seulement de l’économie française mais de la politique française elle-même.
Ce sont des forces qu’un État démocratique ne devrait pas tolérer, que Richelieu n’eût pas tolérées dans le royaume de France.
L’empire des deux cents familles pèse sur le système fiscal, sur les transports, sur le crédit. Les deux cents familles placent leurs mandataires dans les cabinets politiques.
Elles agissent sur l’opinion publique car elles contrôlent la presse. »
=> Retour au dossier sur le Front populaire