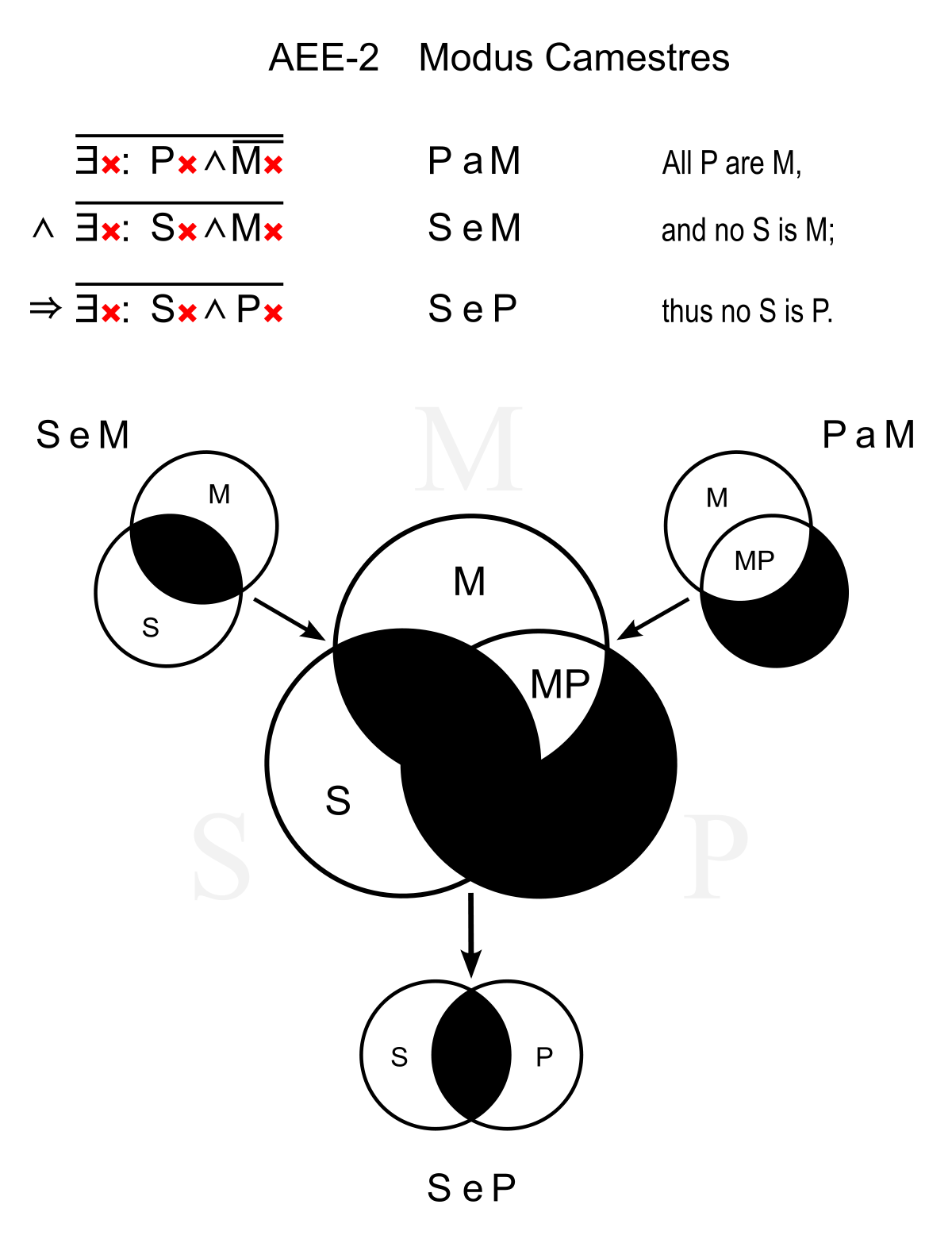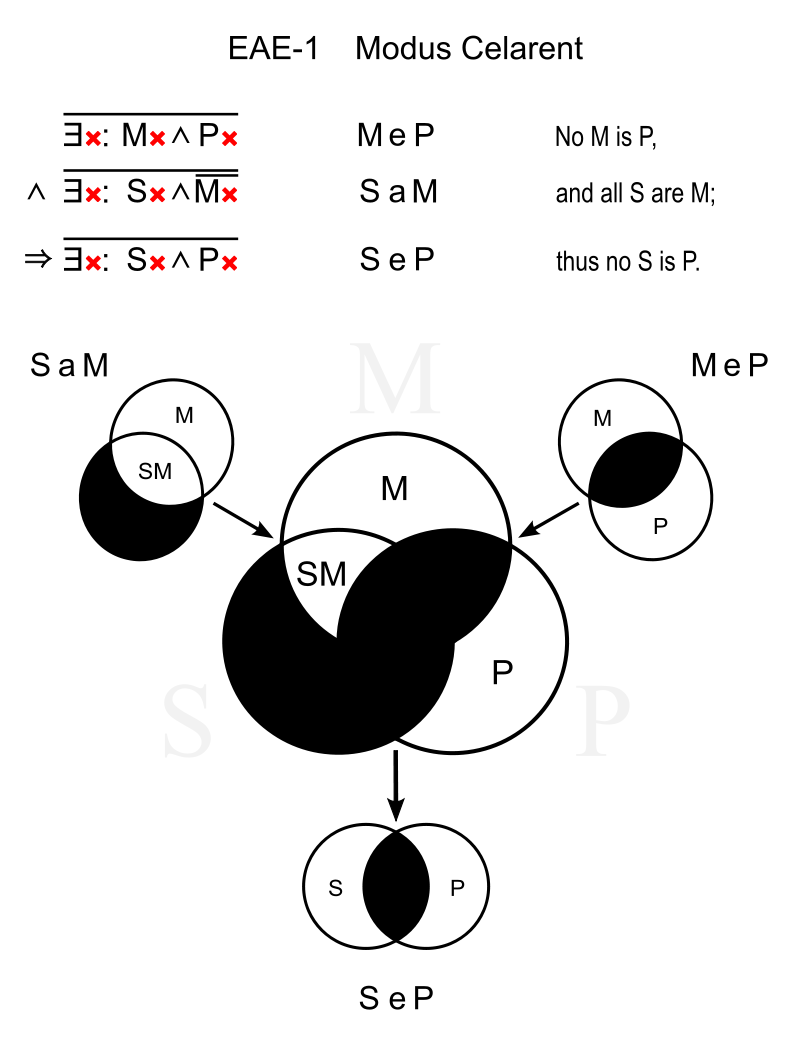Les seconds analytiques se concluent par un manifeste matérialiste.
L’induction est clairement présenté comme se fondant sur une accumulation de données sensibles, saisie par intuition et généralisé à un niveau supérieur comme principes premiers.
On a ici la thèse matérialiste dialectique de la pensée comme reflet présentée de manière développée.
L’œuvre est clairement un assemblage de différents cours différents et on peut considérer cette partie placée à la fin comme un garde-fou pour préserver l’esprit général de la philosophie d’Aristote.
Ce qu’on lit sera d’ailleurs résumé à la fin du Moyen Âge sous la formule « l’Homme ne pense pas », que l’Église catholique romaine interdira.
« Il est donc clair que nous ne pouvons pas posséder une connaissance innée des principes [premiers], et que les principes [premiers] ne peuvent non plus se former en nous alors que nous n’en avons aucune connaissance, ni aucun habitus.
C’est pourquoi nous devons nécessairement posséder quelque puissance de les acquérir, sans pourtant que cette puissance soit supérieure en exactitude à la connaissance même des principes. —
Or c’est là manifestement un genre de connaissance qui se retrouve dans tous les animaux, car ils possèdent une puissance innée de discrimination que l’on appelle perception sensible.
Mais bien que la perception sensible soit innée dans tous les animaux, chez certains il se produit une persistance de l’impression sensible qui ne se produit pas chez les autres.
Ainsi les animaux chez qui cette persistance n’a pas lieu, ou bien n’ont absolument aucune connaissance au-delà de l’acte même de percevoir, ou bien ne connaissent que par le sens les objets dont l’impression ne dure pas ; au contraire, les animaux chez qui se produit cette persistance retiennent encore, après la sensation, l’impression sensible dans l’âme.
Et quand une telle persistance s’est répétée un grand nombre de fois, une autre distinction dès lors se présente entre ceux chez qui, à partir de la persistance de telles impressions, se forme une notion, et ceux chez qui la notion ne se forme pas.
C’est ainsi que de la sensation vient ce que nous appelons le souvenir, et du souvenir plusieurs fois répété d’une même chose vient l’expérience, car une multiplicité numérique de souvenirs constitue une seule expérience.
Et c’est de l’expérience à son tour (c’est-à-dire de l’universel en repos tout entier dans l’âme comme une unité en dehors de la multiplicité et qui réside une et identique dans tous les sujets particuliers) que vient le principe de l’art et de la science, de l’art en ce qui regarde le devenir, et de la science en ce qui regarde l’être.
Nous concluons que ces habitus ne sont pas innés en nous dans une forme définie, et qu’ils ne proviennent pas non plus d’autres habitus plus connus, mais bien de la perception sensible.
C’est ainsi que, dans une bataille, au milieu d’une déroute, un soldat s’arrêtant, un autre s’arrête, puis un autre encore, jusqu’à ce que l’armée soit revenue à son ordre primitif : de même l’âme est constituée de façon à pouvoir éprouver quelque chose de semblable.
Nous avons déjà traité ce point, mais comme nous ne l’avons pas fait d’une façon suffisamment claire, n’hésitons pas à nous répéter.
Quand l’une des choses spécifiquement indifférenciées s’arrête dans l’âme, on se trouve en présence d’une première notion universelle ; car bien que l’acte de perception ait pour objet l’individu, la sensation n’en porte pas moins sur l’universel : c’est l’homme, par exemple, et non l’homme Callias.
Puis, parmi ces premières notions universelles, un nouvel arrêt se produit dans l’âme, jusqu’à ce que s’y arrêtent enfin les notions impartageables et véritablement universelles : ainsi, telle espèce d’animal est une étape vers le genre animal, et cette dernière notion est elle-même une étape vers une notion plus haute.
Il est donc évident que c’est nécessairement l’induction qui nous fait connaître les principes, car c’est de cette façon que la sensation elle-même produit en nous l’universel.
Quant aux habitus de l’entendement par lesquels nous saisissons la vérité, puisque les uns sont toujours vrais et que les autres sont susceptibles d’erreur, comme l’opinion, par exemple, et le raisonnement, la science et l’intuition étant au contraire toujours vraies ; que, d’autre part, à l’exception de l’intuition, aucun genre de connaissance n’est plus exact que la science, tandis que les principes sont plus connaissables que les démonstrations, et que toute science s’accompagne de raisonnement : il en résulte que des principes il n’y aura pas science.
Et puisque, à l’exception de l’intuition, aucun genre de connaissance ne peut être plus vrai que la science, c’est une intuition qui appréhendera les principes.
Cela résulte non seulement des considérations qui précèdent, mais encore du fait que le principe de la démonstration n’est pas lui-même une démonstration, ni par suite une science de science.
Si donc nous ne possédons en dehors de la science aucun autre genre de connaissance vraie, il reste que c’est l’intuition qui sera principe de la science.
Et l’intuition est principe du principe lui-même, et la science tout entière se comporte à l’égard de l’ensemble des choses comme l’intuition à l’égard du principe. »