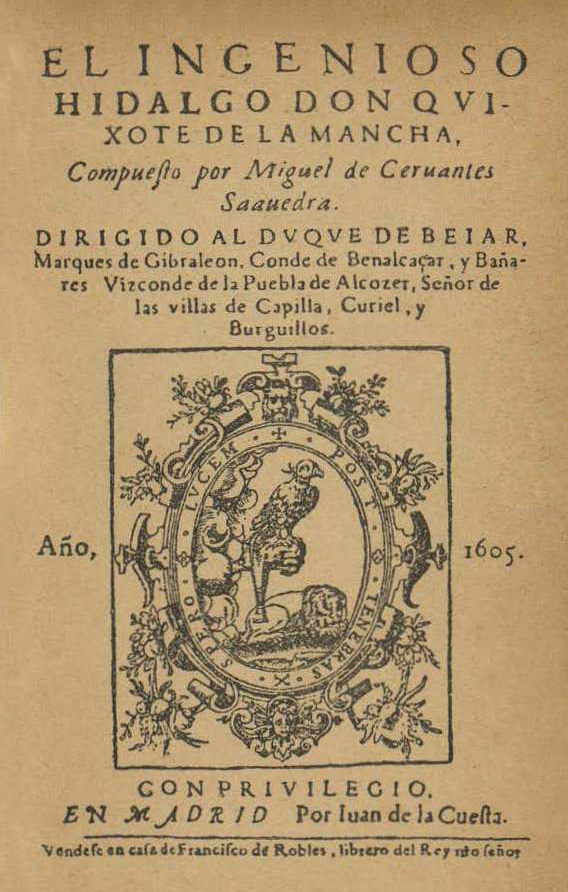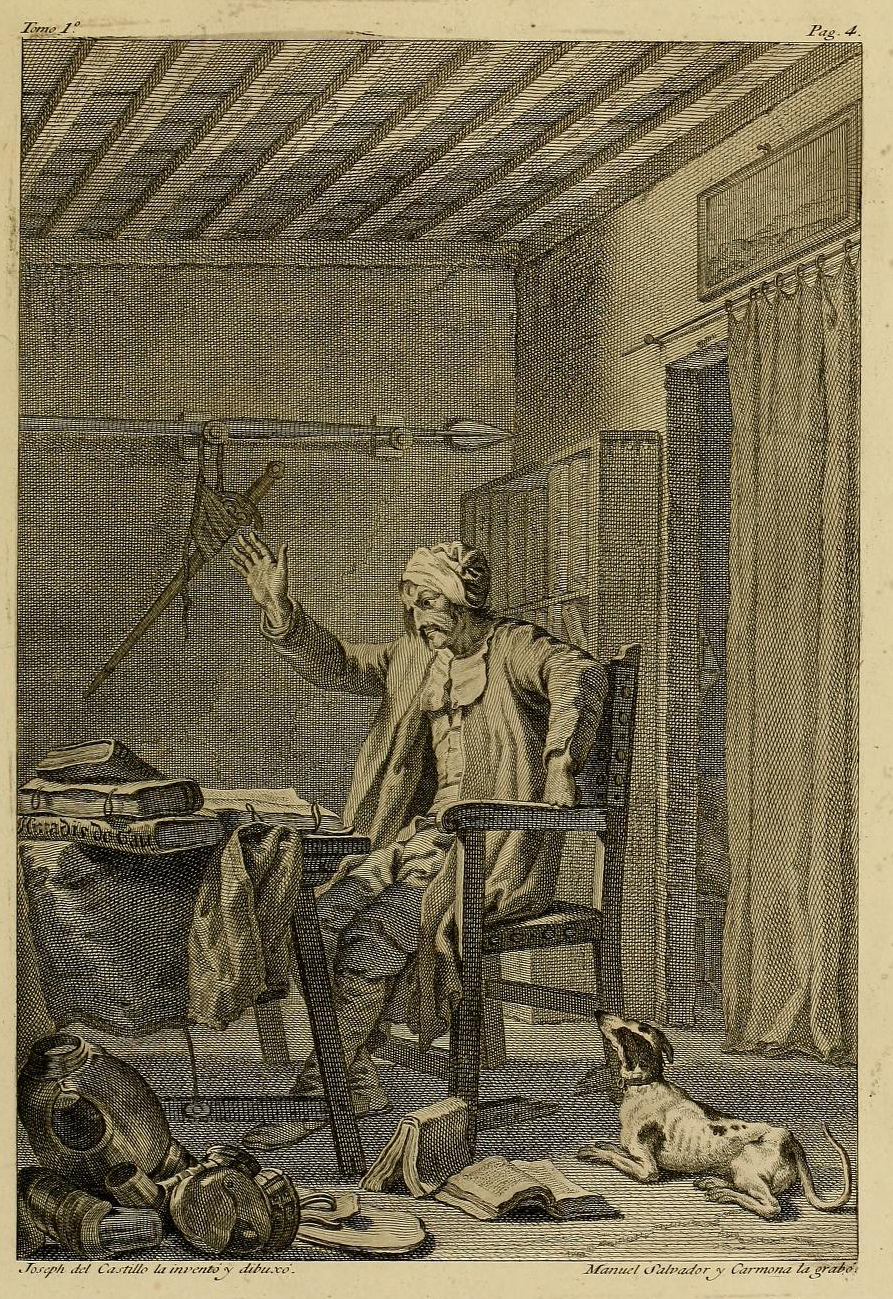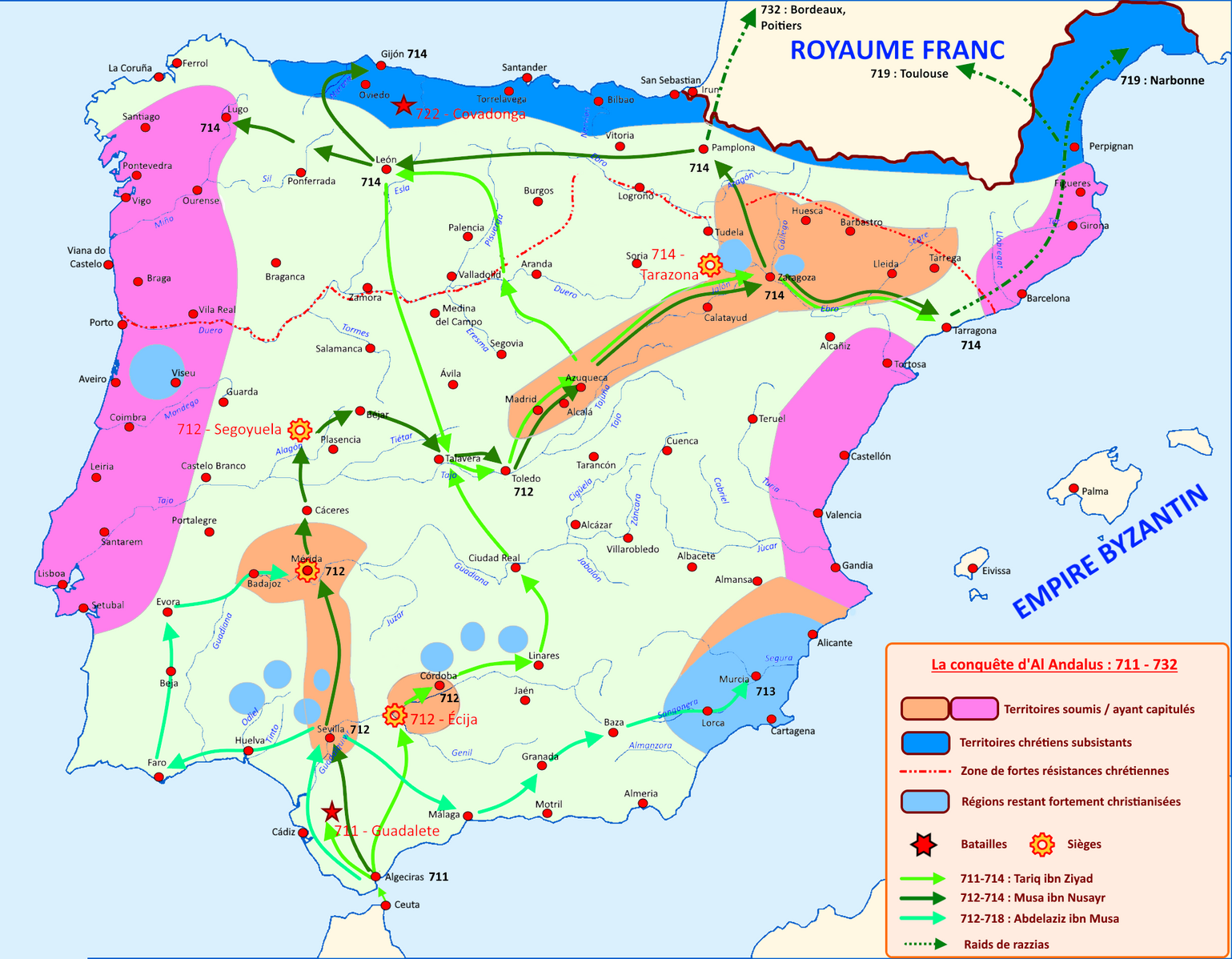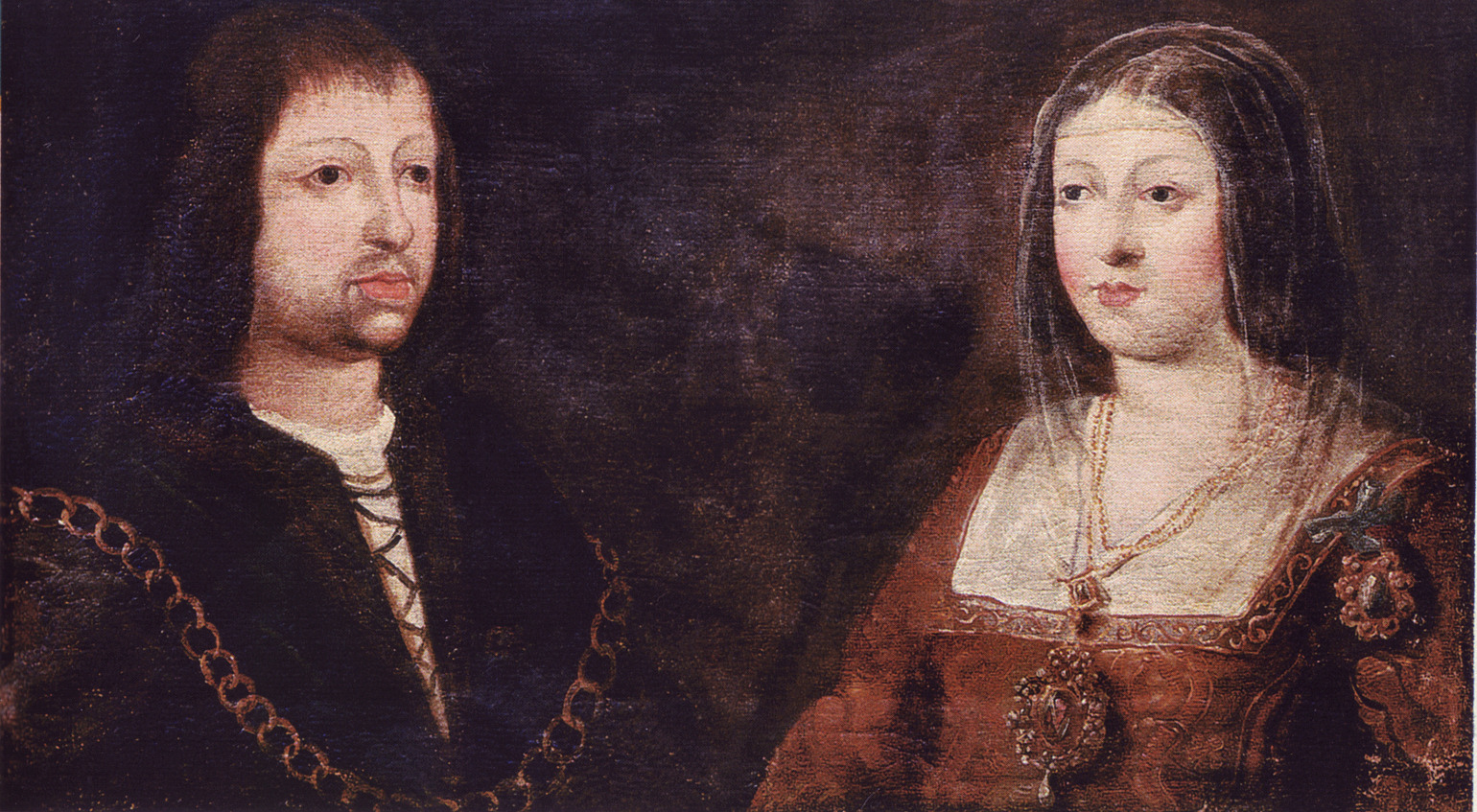L’hégémonie de la bourgeoisie française sur la société est une réalité particulièrement profonde de notre pays. Cela tient fondamentalement au fait que la bourgeoisie française a imprimé une profonde marque par la charge de la Révolution française et de son prolongement.
On peut résumer cette hégémonie à trois formes principales sur lesquelles s’appuie la domination de la bourgeoisie en tant que classe, et que tout révolutionnaire en France doit connaître, étudier et combattre:
– l’importance sociale et culturelle de la petite-bourgeoisie entrepreneuriale,
– le caractère militaire et bureaucratique des institutions et de l’administration,
– enfin, l’état d’esprit politiquement tourné vers l’opinion et « l’art de vivre ».
La petite bourgeoisie entrepreneuriale est un appui essentiel à la bourgeoisie de notre pays. La Révolution française et le processus d’industrialisation qui a suivi ont permis de généraliser l’urbanisation et l’accès à la petite propriété.
Dans les campagnes, la redistribution des terres, et dans les villes la multiplication des activités de « services » accompagnant l’industrialisation de l’appareil productif, ont progressivement, au cours du 19e siècle, étendu la surface de la petite bourgeoisie. Portée par cet élan, la petite bourgeoisie a littéralement empoisonné la vie politique française en perturbant à tout propos le processus de la lutte des classes.
C’est ce qu’a bien montré Karl Marx dans La lutte des classes en France (publié en 1850), en parlant des soulèvements de 1848 :
« Le combat de Juin avait été dirigé par la fraction républicaine de la bourgeoisie, avec la victoire lui revint nécessairement le pouvoir de l’État.
L’état de siège mettait sans résistance Paris à ses pieds, et dans les provinces régnait un état de siège moral, l’arrogance de la victoire pleine de brutalité menaçante chez les bourgeois et l’amour fanatique de la propriété déchaîné chez les paysans. Donc aucun danger d’en bas ! (…)
En juin 1848, la République bourgeoise qui se constituait avait gravé son acte de naissance sur les tables de l’histoire par une bataille indicible contre le prolétariat, en juin 1849, la République bourgeoise constituée le fit par une comédie inénarrable, jouée avec la petite bourgeoisie. Juin 1849 fut la Némésis de juin 1848.
En juin 1849, ce ne furent pas les ouvriers qui furent vaincus, mais les petits bourgeois placés entre eux et la révolution qui furent défaits.
Juin 1849, n’était pas la tragédie sanglante entre le travail salarié et le capital, mais le spectacle abondant en scènes d’emprisonnement, le spectacle lamentable entre le débiteur et le créancier.
Le parti de l’ordre avait vaincu, il était tout-puissant, il lui fallait maintenant montrer ce qu’il était. »
L’établissement de la troisième République à partir de 1870 est la forme institutionnelle de cette neutralisation politique à laquelle la petite bourgeoisie aspire dans son alliance avec la bourgeoisie, aussi bien que le « bonapartisme », que Karl Marx désigne dans cet extrait comme « le parti de l’ordre ». C’est la force idéologique de la bourgeoisie lorsqu’elle s’impose de fait avec l’appui des masses.
Tout le paradoxe de la vie politique française, vue depuis la bourgeoisie, tient dans cette confrontation entre bourgeoisie et petite bourgeoisie. Leurs intérêts sont présentés comme communs alors qu’ils sont divergents, tout en étant divergents lorsqu’ils parviennent à être communs.
Concrètement, la bourgeoisie subjugue sans cesse les masses par la promesse petite-bourgeoise de l’ordre et de la petite propriété contre les revendications révolutionnaires, mais en même temps elle s’oppose à l’agitation ultra démocratique ou aux demandes de réformes en tout sens, pour ne pas dire hystériques, de cette couche sociale, incapable de se constituer en parti de par son inconsistance sociale fondamentale.
La petite bourgeoisie, qui incarne si on peut dire la réalisation (temporaire historiquement) des promesses sociales de la bourgeoisie, vit en permanence entre des aspirations idéalement élevées, ou bassement matérielles et pragmatiques. Et cela sous la double menace de la Révolution sociale et de la liquidation par la bourgeoisie, qui est prête à tout moment à détourner sur elle la révolte populaire au nom de l’aspiration à l’ordre.
Il faut alors noter le point suivant. En phase d’expansion, la petite bourgeoisie se reconnaît volontiers dans une sorte de centrisme, tel que l’expriment en partie par exemple des gens comme Emmanuel Macron, François Hollande ou Raphaël Glucksmann.
Un tel cadre empoisonne constamment et de manière structurelle, pour des raisons historiques, la vie sociale française dans son ensemble. Une figure nationale petite-bourgeoise du Français typique est ainsi le petit entrepreneur besogneux et magouilleur « juste ce qu’il faut », à qui « on ne la fait pas », qui méprise la grande bourgeoisie et ses cadres et se sent plus proche du peuple, c’est-à-dire de « ceux qui travaillent », en dénonçant au passage les « profiteurs » des avantages sociaux et les tire-au-flanc.
C’est typiquement le public de Cnews ou Sud Radio, volontiers « gilets jaunes », pro-paysans, anti-fiscal, ou tout ce que l’on voudra dès lors que c’est pour « foutre la paix aux gens et laisser bosser ceux qui bossent ». Sa caricature est le beauf, et une partie du prolétariat malheureusement subit l’influence néfaste de ce modèle, poussant l’effectif des masses disponibles à se réduire à une plèbe et à se vendre à toutes les promesses populistes.
Cette base est un terreau particulièrement fertile à l’irrationalisme, religieux et/ou complotiste en général et bien entendu antisémite en particulier. Cependant, comme la petite bourgeoisie est en roue libre, et serait de toute manière incapable de constituer un Parti, il existe une fraction en son sein qui a des ambitions contestataires. Elle entend rassembler cette plèbe, placer le lumpen-prolétariat des métropoles derrière elle, avec des slogans et revendications ultra-démocratiques. C’était déjà le cas dans le Paris de l’époque de Karl Marx en 1848, avec par exemple les partisans républicains-sociaux de Ledru-Rollin et de George Sand. Pierre-Joseph Proudhon est la grande figure historique de ce type de contestation.
Cette frange de la petite bourgeoisie s’exprime aujourd’hui volontiers à travers des mouvements comme celui de la France Insoumise, ou dans le cadre des nombreux petits partis trotskistes, dont l’agitation alimente de toute manière le terreau populiste, complotiste, poussant les masses vers l’extrême-droite, tout en prétendant (et encore même pas toujours) la combattre.
On perdrait de toute façon de l’énergie et un temps inutilement dépensé à essayer de faire le panorama de ce que toute l’agitation de la petite bourgeoisie produit, ou frelate pour mieux dire, sur le plan social et politique. On aura compris l’essentiel si on part du postulat posé par Karl Marx à ce propos, et qui concerne directement notre pays.
La lecture et l’étude de la thèse de Zeev Sternhell, notamment dans Ni droite ni gauche : l’idéologie fasciste en France (1983), permet de saisir l’essentiel de ce qu’il faut comprendre concernant l’inévitable dérive fasciste de la petite bourgeoisie lorsqu’elle est en roue libre entre le prolétariat et la bourgeoisie.
La position à tenir face à la petite bourgeoisie pour les révolutionnaires est donc de ne surtout et jamais se mettre à la remorque d’une organisation petite bourgeoise, mais tout au contraire d’en polariser les éléments démocratiques dans un Front commun, en les mettant fermement sous surveillance idéologique, notamment en écrasant par tous les moyens adaptés et nécessaires les tendances à l’irrationnel, complotistes et antisémites tout particulièrement.
Les éléments les plus centristes de la petite bourgeoisie sont généralement les plus enclins à se rallier à la bannière du matérialisme dialectique en ce qu’il affirme la centralité de la Culture et le refus net et catégorique de la barbarie. En revanche, les éléments ultra-démocratiques, notamment trotskistes ou leurs doubles symétriques libertaires-souverainistes sont à considérer a priori comme de potentiels traîtres à la Cause révolutionnaire, de par leur incapacité idéologique à assumer sérieusement une pensée rationnelle.
Il faut ici garder fermement la ligne rouge de la lutte des classes : affirmer le prolétariat face à la bourgeoisie. La trajectoire de la petite bourgeoisie, peu importe ses formes du moment, est de subir l’écartèlement et de choisir son camp. Et même pour les fractions de la petite bourgeoisie qui viendront gonfler le torrent de la Révolution, il faut garder à l’esprit qu’elles resteront nécessairement la base de la formation de lignes noires au sein de l’élan révolutionnaire, risquant à tout moment de le détourner ou de le trahir.
En second lieu, l’hégémonie de la bourgeoisie nous lègue aussi un appareil d’État, des institutions et des administrations, profondément marquées par la dimension militaire, historiquement héritées de la monarchie absolue, modernisées par la Révolution française à travers ce que l’on peut appeler le « bonapartisme », dont le pétainisme et le gaullisme de 1958 sont des avatars. On touche là au cœur de ce qui fait la domination bourgeoise qu’il s’agit de renverser. En substance, il s’agit d’une lutte d’un nouvel État contre l’ancien.
Les cadres et l’ensemble du personnel de l’ancien État constituent au premier rang l’armée de la bourgeoisie. Mais de par la fonction historique de l’État, ils sont aussi au service du peuple, notamment dans les parties les plus élémentaires de l’appareil.
La figure typique de ces cadres est celui de l’ingénieur ou du manager ayant fait ses études en classes préparatoires et dans une Grande École plutôt qu’à l’Université, et travaillant indifféremment dans le « public » ou le « privé ».
L’état d’esprit dominant dans ces couches de la bourgeoisie française et de ses cadres est volontiers militaire, aimant la planification, les statistiques, le pilotage et le renseignement. Historiquement, la figure de Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, est centrale dans le dispositif idéologique.
C’est sur cette base que la bourgeoisie s’est montrée historiquement en mesure de mobiliser et d’embrigader les masses sous sa bannière, de Bonaparte au gaullisme et au néo-gaullisme.
Toute tendance contestataire cherchant à s’emparer de l’appareil d’État bourgeois ne peut manquer de se faire avaler par ce dernier. Le modèle du genre est le Républicanisme social mis en forme par Jaurès, puis bouillie et re-bouillie par une partie de la Gauche française, jusqu’à François Mitterrand en 1981, et bien plus tard Jean-Luc Mélenchon notamment.
Ici, la tâche pour les Révolutionnaires est de conquérir une partie des cadres de cet appareil bourgeois, mais non par la séduction neutralisée du fétichisme de l’État ou de la République, mais par la conversion, au sens strict du terme, à l’esprit prolétarien et au matérialisme dialectique, du plus grand nombre possible d’entre eux afin de les retourner pour qu’ils servent les masses et le Peuple avant tout.
Cela passe donc par l’affirmation d’une nette et ferme ligne rouge idéologique visant à démolir totalement toute tendance ou toute faiblesse face au néo-gaullisme.
Enfin, la bourgeoisie française est parvenue à produire un type d’être humain au sens culturel et historique du terme, qu’elle pense être universel : le citoyen.
On ne peut négliger l’immense appareil culturel, le dispositif que la bourgeoisie a édifié dans notre pays, et qui fait encore dans une certaine mesure la force de la bourgeoisie française.
Certes, ses intellectuels et ses artistes organiques sont aujourd’hui dans une complète décadence, pour ne rien dire des institutions éducatives et culturelles dont le niveau s’effondre littéralement, mais là aussi, l’heure est à la conquête, il faut gagner les forces éducatives, intellectuelles et artistiques de notre pays et leur faire se tourner vers le drapeau de la Révolution, vers l’esprit prolétarien et son idéologie matérialiste dialectique.
Pour cela, il faut affirmer les forces éducatives, intellectuelles et artistiques des masses, les élancer de l’avant en arborant l’horizon de la Démocratie Populaire et de la Nouvelle Culture qu’elles portent, pour que cet élan inonde notre pays et anéantisse l’ancien monde bourgeois qui se meurt.
L’état d’esprit dominant dans notre pays est encore loin de ce compte, culturellement. Le Français de l’époque de la bourgeoisie décadente est un être à l’esprit enclin à l’analyse et à la critique, qui ne manque jamais une occasion de débattre ou de se faire entendre, mais qui n’a pas de dimension démocratique sérieuse. Le Français est plus volontiers journaliste qu’acteur politique.
L’horizon est avant tout personnel, ce qui ne veut pas dire que le partage n’existe pas, mais essentiellement sur le mode du banquet, de l’art de vivre.
La discipline collective est regardée comme une sorte d’horreur oppressive, de terreur devant être rejetée au nom de la liberté et de la bonne humeur, même râleuse, du grand banquet collectif, propre et géométrique en façade, délicieusement licencieux en discrétion.
C’est ce qui explique la remise en cause incomplète du catholicisme en France, ainsi que symétriquement, la séduction, tout aussi incomplète, en sens opposé pour l’austérité rigoriste et le collectivisme protestant ou islamique.
C’est aussi ce qui explique la facilité déconcertante avec laquelle la France se fait satelliser par les États-Unis d’Amérique. Les Américains sont une sorte d’alternative à la fois plus réussie et complètement ratée de la culture bourgeoise française.
Par exemple, en termes de style, d’art de vivre, les Américains sont moins complets, mais plus pragmatiques ; en matière d’éducation, ils sont moins théoriques mais plus pratiques ; en matière de goût pour le débat critique, ils sont plus sarcastiques qu’ironiques, etc.
Mais la Crise accélère la tendance historique de la bourgeoisie française à se placer en orbite de la puissance de frappe américaine, tendance qui s’est affirmée dans la construction européenne comme syndicat de la bourgeoisie occidentale, dépassée par les effets de la Mondialisation et de la Crise qui en découle.
Comme le sol se dérobe sous les pieds de la bourgeoisie française à mesure que sa base historique, la nation française, se délite inévitablement dans la Crise, la fuite en avant tous azimuts à la fois vers la vassalisation américaine et vers l’expansion impérialiste, multipliant les contradictions et les impasses, impose l’américanisation de tout ce qui fait la domination bourgeoise en France, aussi bien dans la culture que dans les institutions.
Par exemple, les partis parlementaires du régime bourgeois se polarisent toujours plus nettement en deux blocs : un progressiste, imitant la « grande tente » du Parti Démocrate, et un populiste-conservateur, imitant le Parti Républicain, les uns tout aussi pro-américains et pro-Union européenne que les autres sur le fond.
Pour les Français, la découverte et la conversion au matérialisme dialectique est avec un tel arrière-plan nécessairement et littéralement un choc renversant. Il sera vécu comme une évidence dans le prolétariat et entraînera les masses dont il est le reflet de la pensée et des aspirations à la fois les plus profondes et les plus élevées. Mais entre cette évidence naturelle et la situation que nous avons sous les yeux, il y a la réalité de la France bourgeoise décadente qui a imprimé profondément les esprits dans notre pays.
Nous portons le remède, mais les guérisseurs que sont les dialecticiens doivent savoir trancher dans le vif. L’heure est venue d’arborer la dialectique, la Culture… De diriger les consciences vers le nouveau monde auquel aspirent les masses en France et dans le monde. Notre pays est une des bases les plus importantes de la bourgeoisie de notre époque, les contradictions y sont immenses, la conscience du besoin de transformer et de se transformer aussi.
Soulevons les cœurs et aiguisons les esprits pour écrire les premiers la page du nouveau chapitre de l’Histoire de l’Humanité, celui où les Peuples fraterniseront dans la Paix, celui qui nous réconciliera avec la Nature, celui où l’Humanité célébrera la Vie sans que personne ne soit laisser de côté et tournera les yeux vers les étoiles pour se fondre dans le Cosmos. Il faut marcher au Communisme !
=> retour à la revue Connexions