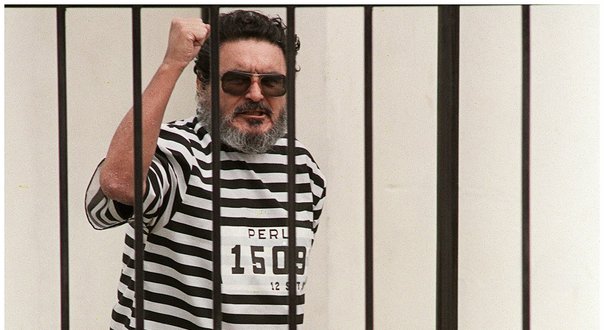Dieu produit la piété qui produit la religion – mais pourquoi Jean Calvin ne pense-t-il pas, tels les philosophes, que les êtres humains peuvent utiliser l’entendement – la piété – sans la religion ?
C’est parce qu’il a constaté que les esprits faisaient un fétichisme de leur capacité à raisonner. Le calvinisme n’est pas une idéologie de l’individualisme bourgeois, mais de l’individualité bourgeoise au sein de la société bourgeoise. C’est radicalement différent.
Jean Calvin souligne cela par exemple de la manière suivante :
« Et ici se découvre une ingratitude trop vilaine, d’autant que les hommes ayant en eux comme une boutique excellente de tant de beaux ouvrages de Dieu, et une autre richement pleine et garnie d’une quantité inestimable de tous biens, au lieu de se mettre en avant à louer Dieu s’enflent de tant plus grand orgueil et présomption. »
Les gens qui nient Dieu sont donc ici des gens trop fiers, qui savent qu’il y a une réalité autour d’eux, mais refusent de le reconnaître. Le concept de Dieu est ici utilisé par Jean Calvin afin de dénoncer le solipsisme des individus ne s’orientant plus que par eux-mêmes.
Jean Calvin explique cette présomption en les termes suivants :
« Cette connaissance est ou étouffée ou corrompue, partie par la sottise des hommes, partie par leur malice. »
On comprend alors tout de suite pourquoi Jean Calvin critiquait les épicuriens, qu’il associe justement aux partisans d’Aristote. Jean Calvin propose une théorie de la connaissance qui, si elle s’oppose à celle de l’Église catholique, doit absolument pour pouvoir exister se distinguer de l’averroïsme.
Jean Calvin reproche en fait à l’averroïsme de proposer un Aristote affirmant que la pensée relève de « l’intellect » universel, mais sans attribuer de contenu précis à cet intellect.
Or, une société organisée selon les exigences de la bourgeoisie ne peut pas se contenter de faire comme Aristote et de contempler l’univers tel qu’il a été fait par le « moteur premier ». C’est pour cela que Jean Calvin associe partisans d’Aristote et épicuriens : ils ne proposent pas de voie pratique, or la pratique est le critère utilitaire fondamental de la bourgeoisie naissante.
L’esprit doit amener au travail, pas à la contemplation de l’ordre cosmique, aussi Jean Calvin reproche-t-il aux épicuriens la chose suivante :
« Mais je laisse pour cette heure ces pourceaux en leurs étables : je m’adresse à ces esprits volages, lesquels volontiers tireraient par façon oblique ce dicton d’Aristote, tant pour abolir l’immortalité des âmes, que pour ravir à Dieu son droit.
Car sous ombre que les vertus de l’âme sont instrumentales pour s’appliquer d’un accord avec les parties extérieures, ces rustres l’attachent au corps comme si elle ne pouvait sans lui : et en magnifiant nature tant qu’il leur est possible ils tâchent d’amourtir [faire dépérir, supprimer] le nom de Dieu.
Or il s’en faut beaucoup que les vertus de l’âme soient encloses en ce qui est pour servir au corps. Je vous prie quelle correspondance y a-il des sens corporels avec cette appréhension si haute et si noble, de savoir mesurer le ciel, mettre les étoiles en conte et en nombre, déterminer de la grandeur de chacune, connaître quelle distance il y a de l’une à l’autre, combien chacune est hâtive ou tardive à faire son cours, de combien de degrés elles déclinent çà ou là ?
Je confesse que l’astrologie est utile à cette vie caduque, et que quelque fruit et usage de cette étude de l’âme en revient au corps : seulement je veux montrer que l’âme a ses vertus à part, qui ne sont point liées à telle mesure qu’on les puisse appeler organiques ou instrumentales au regard du corps, comme on acouple deux bœufs ou deux chevaux à traîner une charrue. »
Jean Calvin affirme ici que l’âme ne meurt pas avec le corps, et que si les sens sont utiles pour des connaissances scientifiques en ce bas monde, ils ne sont que « mécaniques » en quelque sorte, et que ce n’est pas le cas de l’âme qui elle fait faire, en quelque sorte, un saut qualitatif à l’entendement.
Jean Calvin rejette ainsi le matérialisme pour qui l’entendement est un assemblage des sens (et pour le matérialisme dialectique une synthèse de la réalité issue de l’activité pratique).
Il a besoin de justifier l’âme car il veut une activité sociale pratique, pas simplement une contemplation – et ici l’exemple des étoiles va avec cela : l’astronomie est une constatation passive de l’ordre cosmique, et une activité par ailleurs logique dans la perspective d’Aristote (au point de dériver même en astrologie).
Jean Calvin veut l’activité consciente – il a besoin d’un entendement non pas simplement contemplant l’ordre cosmique, mais en phase avec des exigences concrètes, dynamiques – il a donc besoin non pas d’un moteur premier passif et lointain comme chez Aristote et l’averroïsme, mais d’un Dieu qui s’adresse aux êtres humains.