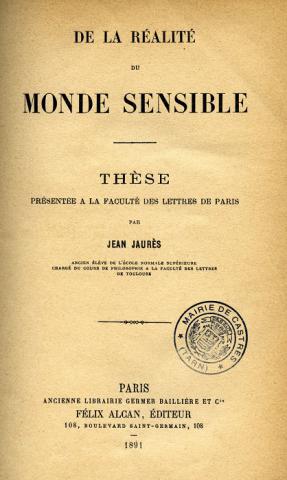Paris, 17 novembre 1901
Mon cher Péguy,
Vous m’avez demandé de réunir pour les Cahiers de la Quinzaine les études socialistes que j’ai publiées ces derniers mois dans La Petite République ; vous vous proposez d’adresser un exemplaire de ce volume à chacun de vos abonnés.
Je me réjouis d’entrer ainsi en communication directe avec des esprits libres, habitués à la critique indépendante et probe. Bien que ces articles n’eussent point été destinés, d’abord, à paraître en volume, je n’ai point scrupule à les reproduire sous cette forme : car je n’ai jamais considéré l’article de journal comme une œuvre hâtive et superficielle ; et j’y mets, par respect pour le prolétariat qui lit les journaux socialistes, toute ma conscience d’écrivain.
Je n’ai pas besoin d’avertir qu’ils ne prétendent pas épuiser les sujets qu’ils traitent. Ils ne sont, évidemment, qu’un fragment, ou plutôt une préparation d’une œuvre plus vaste, plus dogmatique et plus documentée, où je voudrais définir exactement ce qu’est, au début du vingtième siècle, le socialisme, sa conception, sa méthode et son programme.
Mais, déjà, les études ici rassemblées touchent, avec une suffisante précision et une suffisante étendue, à des problèmes de la plus haute importance et qui pressent notre parti. Il est très divisé à l’heure présente, et vous m’accuseriez, sans doute, d’avoir la folie « de l’unité mystique », si je disais que ces divisions sont superficielles.
Je ne les crois pas irréductibles, mais elles tiennent à de graves dissentiments, ou au moins à de graves malentendus sur les méthodes. C’est la croissance même de notre parti, c’est la puissance grandissante de notre idée — pardonnez-moi cette rechute d’optimisme —, qui ont créé le dissentiment, en nous posant à tous la question de méthode.
Comment se réalisera le socialisme ? Voilà un problème que nous ne pouvons pas éluder : et c’est l’éluder que d’y faire des réponses incertaines et vagues. Ou encore, c’est se tromper soi-même, que de répéter, en 1901, les réponses que firent, il y a un demi-siècle, nos aînés et nos maîtres.
Il y a un fait incontestable, et qui domine tout. C’est que le prolétariat grandit en nombre, en cohésion et en conscience. Les ouvriers, les salariés, plus nombreux, plus groupés, ont maintenant un idéal. Ils ne veulent pas seulement obvier aux pires défauts de la société présente : ils veulent réaliser un ordre social fondé sur un autre principe.
À la propriété individuelle et capitaliste, qui assure la domination d’une partie des hommes sur les autres hommes, ils veulent substituer le communisme de la production, un système d’universelle coopération sociale qui, de tout homme, fasse, de droit, un associé. Ils ont ainsi dégagé leur pensée de la pensée bourgeoise : ils ont aussi dégagé leur action de l’action bourgeoise.
Au service de leur idéal communiste, ils mettent une organisation à eux, une organisation de classe, la puissance croissante des syndicats ouvriers, des coopératives ouvrières, et la part croissante de pouvoir politique qu’ils conquièrent sur l’état ou dans l’état. Sur cette idée générale et première, tous les socialistes sont d’accord. Ils peuvent assigner des causes différentes à cette croissance du prolétariat ; ou du moins ils peuvent donner aux mêmes causes des valeurs différentes.
Ils peuvent faire la part plus ou moins grande à la force de l’organisation économique ou de l’action politique. Mais tous ils constatent que par la nécessité même de l’évolution capitaliste qui développe la grande industrie, et par l’action correspondante des prolétaires, ceux-ci sont la force indéfiniment grandissante qui est appelée à transformer le système même de la propriété.
Les socialistes discutent aussi sur l’étendue et sur la forme de l’action de classe que doit exercer le prolétariat. Les uns veulent qu’il se mêle le moins possible aux conflits de la société qu’il doit détruire, et qu’il réserve toutes ses énergies pour l’action décisive et libératrice.
Les autres croient qu’il doit, dès maintenant, exercer sa grande fonction humaine. Kautsky rappelait, récemment, au congrès socialiste de Vienne, le mot fameux de Lassalle : « Le prolétariat est le roc sur lequel sera bâtie l’église de l’avenir. » et il ajoutait : « Le prolétariat n’est point seulement cela : il est aussi le roc contre lequel se brisent, dès aujourd’hui, les forces de réaction. »
Et moi je dirai qu’il n’est pas précisément un roc, une puissance compacte et immobile. Il est une grande force cohérente, mais active, qui se mêle, sans s’y perdre, à tous les mouvements vastes et s’accroît de l’universelle vie.
Mais tous, quelles que soient la hauteur et l’étendue de l’action de classe assignée par nous au prolétariat, nous le concevons comme une force autonome, qui peut coopérer avec d’autres forces, mais qui, jamais, ne se fond ou s’absorbe en elles, et qui garde toujours, pour son œuvre distincte et supérieure, son ressort distinct. C’est le mérite décisif de Marx, le seul peut-être qui résiste pleinement à l’épreuve de la critique et aux atteintes profondes du temps, d’avoir rapproché et confondu l’idée socialiste et le mouvement ouvrier.
Dans le premier tiers du dix-neuvième siècle, la force ouvrière s’exerçait, se déployait, luttait contre la puissance écrasante du capital : mais elle n’avait pas conscience du terme où elle tendait ; elle ne savait pas que, dans la forme communiste de la propriété, était l’achèvement de son effort, l’accomplissement de sa tendance. Et, d’autre part, le socialisme ne savait point que, dans le mouvement de la classe ouvrière, était sa réalisation vivante, sa force concrète et historique.
La gloire de Marx est d’avoir été le plus net, le plus puissant de ceux qui mirent fin à ce qu’il y avait d’empirisme dans le mouvement ouvrier, à ce qu’il y avait d’utopisme dans la pensée socialiste. Par une application souveraine de la méthode hégélienne, il unifia l’idée et le fait, la pensée et l’histoire.
Il mit l’idée dans le mouvement et le mouvement dans l’idée, la pensée socialiste dans la vie prolétarienne, la vie prolétarienne dans la pensée socialiste. Désormais, le socialisme et le prolétariat sont inséparables : le socialisme ne réalisera toute son idée que par la victoire du prolétariat ; et le prolétariat ne réalisera tout son être que par la victoire du socialisme.
À la question toujours plus impérieuse : comment se réalisera le socialisme ? il convient donc d’abord de répondre : par la croissance même du prolétariat qui se confond avec lui. C’est la réponse première, essentielle : et quiconque ne l’accepte point dans son vrai sens et dans tout son sens, se met nécessairement lui-même hors de la pensée et de la vie socialistes. Cette réponse, si générale qu’elle soit, n’est pas vaine, car elle implique l’obligation pour chacun de nous d’ajouter sans cesse à la puissance de pensée, d’organisation, d’action et de vie du prolétariat.
Elle est de plus, en un sens, la seule certaine. Il nous est impossible de savoir avec certitude par quel moyen précis, sous quel mode déterminé, et à quel moment, l’évolution politique et sociale s’achèvera en communisme. Mais ce qui est sûr, c’est que tout ce qui accroît la puissance intellectuelle, économique et politique de la classe prolétarienne accélère cette évolution, anime, élargit et approfondit le mouvement.
Mais cette réponse première, quelque forte et substantielle qu’elle soit, ne suffit point. Précisément parce que le prolétariat a déjà grandi, parce qu’il commence à mettre la main sur le mécanisme politique et économique, la question se précise : quel sera le mécanisme de la victoire ?
À mesure que la puissance prolétarienne se réalise, elle s’incorpore à des formes précises, au suffrage universel, au syndicat, à la coopérative, aux formes diverses des pouvoirs publics et de l’État démocratique. Et nous ne pouvons pas considérer la force prolétarienne indépendamment des formes où elle s’est déjà partiellement organisée, et des mécanismes qu’elle s’est partiellement appropriés.
Il n’y a donc pas utopie aujourd’hui à chercher avec précision quelle sera la méthode de réalisation socialiste, et quel sera le mode d’accomplissement.
Ce n’est pas retourner à l’utopie et se séparer de la vie du prolétariat, c’est au contraire rester en elle, progresser et se déterminer avec elle. Elle n’est plus « l’esprit flottant sur les eaux » : elle s’est déjà incorporée à des institutions : institutions économiques et institutions politiques ; ces institutions, suffrage universel, démocratie, syndicat, coopérative, ont un degré déterminé de développement, une force et une direction acquises : et il faut savoir si le communisme prolétarien pourra se réaliser par elles, s’accomplir par elles, ou si au contraire il ne s’accomplira que par une suprême rupture.
À vrai dire, toujours les socialistes ont cherché à prévoir et à déterminer sous quelle forme, par quels procédés historiques, le prolétariat triompherait.
Et si nous souffrons aujourd’hui, s’il y a dans notre parti incertitude et malaise, c’est parce qu’il associe en des mélanges confus les méthodes en partie surannées que nos maîtres nous ont léguées, et les nécessités mal formulées encore des temps nouveaux. Marx et Blanqui croyaient tous deux à une prise de possession révolutionnaire du pouvoir par le prolétariat. Mais la pensée de Marx était beaucoup plus complexe. Sa méthode de révolution avait des aspects multiples. C’est donc chez Marx surtout que je veux la discuter.
Or, toute entière et en quelque sens qu’on la prenne, elle est surannée. Elle procède ou d’hypothèses historiques épuisées, ou d’hypothèses économiques inexactes.
D’abord, les souvenirs de la révolution française et des révolutions successives qui en furent, en France et en Europe, le prolongement, dominaient l’esprit de Marx.
Le trait commun de tous les mouvements révolutionnaires, de 1789 à 1796, de 1830 à 1848, c’est qu’ils furent des mouvements révolutionnaires bourgeois auxquels la classe ouvrière se mêla pour les dépasser.
Dans toute cette longue période, la classe ouvrière n’était pas assez forte pour tenter une révolution à son profit : elle n’était pas assez forte non plus pour prendre peu à peu, et selon la légalité nouvelle, la direction de la révolution.
Mais elle pouvait faire et elle faisait deux choses. D’abord elle se mêlait à tous les mouvements révolutionnaires bourgeois pour y exercer et y accroître sa force ; elle profitait des périls que courait l’ordre nouveau menacé par toutes les forces de contre-révolution pour devenir une puissance nécessaire.
Et en second lieu, quand sa force s’était ainsi accrue, quand l’espérance et l’ambition s’étaient éveillées au cœur des prolétaires, quand les diverses fractions révolutionnaires de la bourgeoisie s’étaient usées ou discréditées par leurs luttes réciproques, la classe ouvrière tentait, par une sorte de coup de surprise, de s’emparer de la révolution et de la faire sienne.
C’est ainsi que sous la Révolution française en 1793, le prolétariat parisien pesa, par la commune, sur la Convention et exerça parfois une sorte de dictature. C’est ainsi qu’un peu plus tard Babeuf et ses amis tentaient de saisir, par un coup de main et au profit de la classe ouvrière, le pouvoir révolutionnaire.
Ainsi encore, après 1830, le prolétariat français, après avoir joué dans la Révolution de Juillet le grand rôle noté par Armand Carrel, essaya d’entraîner la bourgeoisie victorieuse, et bientôt de la dépasser. C’est ce rythme de révolution qui s’impose d’abord à la pensée de Marx. Certes en novembre 1847, au moment où avec Engels il écrit le Manifeste communiste, il sait bien que le prolétariat a grandi : c’est le prolétariat qu’il considère comme la vraie force révolutionnaire ; et c’est contre la bourgeoisie que se fera la révolution.
Il écrit : « Le progrès de l’industrie dont la bourgeoisie, sans préméditation et sans résistance, est devenue l’agent, au lieu de maintenir l’isolement des ouvriers par la concurrence, a amené leur union révolutionnaire par l’association. Ainsi le développement même de la grande industrie détruit dans ses fondements le régime de production et d’appropriation des produits où s’appuyait la bourgeoisie. Avant tout la bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs. La ruine de la bourgeoisie et la victoire du prolétariat sont également inévitables ».
Et encore : « Le but immédiat pour les communistes est le même que pour tous les autres partis prolétariens : la constitution du prolétariat en classe, le renversement de la domination bourgeoise, la conquête du pouvoir politique par le prolétariat ». Voici qui est très précis encore : « Nous avons suivi la guerre civile plus ou moins latente dans la société actuelle jusqu’au point où elle éclate en une révolution ouverte, et où, par l’effondrement évident de la bourgeoisie, le prolétariat fondera sa domination ».
Ainsi, c’est par une révolution violente contre la classe bourgeoise que le prolétariat s’emparera du pouvoir et réalisera le communisme. Mais, en même temps, il paraît à Marx que c’est la bourgeoisie elle-même qui, ayant à compléter son propre mouvement révolutionnaire, donnera le signal de l’ébranlement.
Contre l’absolutisme ou ce qui en reste, contre le féodalisme ou ce qui en reste, la bourgeoisie se lèvera, et quand elle aura déchaîné les événements, quand elle aura ouvert la crise, le prolétariat, plus puissant aujourd’hui que ne l’étaient sous la révolution anglaise en 1648 les niveleurs de Lilburne et en 1793 les prolétaires de Chaumette, s’emparera révolutionnairement de la révolution bourgeoise. Il commencera par lutter aux côtés de la bourgeoisie, et aussitôt qu’elle sera victorieuse, il l’expropriera de sa victoire. « En Allemagne, écrivent en 1847 Marx et Engels, le parti communiste luttera aux côtés de la bourgeoisie dans toutes les occasions où la bourgeoisie reprendra son rôle révolutionnaire ; avec elle il combattra la monarchie absolue, la propriété foncière féodale, la petite bourgeoisie.
Mais pas un instant il n’oubliera d’éveiller parmi les ouvriers la conscience la plus claire possible de l’opposition qui existe entre la bourgeoisie et le prolétariat et qui en fait des ennemis. Il faut que les conditions sociales et politiques qui accompagneront le triomphe de la bourgeoisie se retournent contre la bourgeoisie elle-même comme autant d’armes dont aussitôt les ouvriers allemands sauront faire usage. Il faut qu’après la chute des classes réactionnaires en Allemagne, la lutte contre la bourgeoisie s’engage sans tarder.
C’est l’Allemagne surtout qui attirera l’attention des communistes. L’Allemagne est à la veille d’une révolution bourgeoise. Cette révolution, elle l’accomplira en présence d’un développement général de la civilisation européenne et d’un développement du prolétariat que ni l’Angleterre au dix-septième siècle ni la France au dix-huitième n’ont connu. La révolution bourgeoise sera donc, et de toute nécessité, le prélude immédiat d’une révolution prolétarienne ».
Ainsi, c’est sur une Révolution bourgeoise victorieuse que se greffera la Révolution prolétarienne.
L’esprit de Marx, en sa haute ironie un peu sarcastique, se complaisait à ces jeux de la pensée. Que l’histoire mystifiât la bourgeoisie en lui arrachant des mains sa victoire toute chaude, c’était pour lui une âpre joie. Mais c’était un plan de révolution prolétarienne trop compliqué et contradictoire. D’abord, si le prolétariat n’a pas la force de donner lui-même le signal de la Révolution, s’il est obligé de compter sur les surprises heureuses de la Révolution bourgeoise, comment peut-on être assuré qu’il aura contre la bourgeoisie victorieuse la force qu’il n’avait pas avant le mouvement bourgeois ?
Ou bien, dans sa tentative de révolution contre le vieux monde absolutiste et féodal, la bourgeoisie sera vaincue : et sous sa défaite le prolétariat sera accablé bien avant d’avoir combattu pour lui-même. Ou bien elle l’emportera ; elle brisera l’arbitraire des rois, la puissance des nobles et des prêtres, absorbera la propriété féodale, abolira les entraves corporatives : et elle s’élancera d’un mouvement si vif, si enthousiaste dans la carrière ouverte par elle, que le prolétariat sera impuissant à créer soudain un mouvement nouveau et contraire.
Et il aura beau procéder par surprise et violence, tenter d’organiser « sa dictature », et de « conquérir la démocratie » par la force, sa puissance réelle ne pourra pas être élevée artificiellement au-dessus du niveau où elle était avant la Révolution bourgeoise. Miquel ne manquait pas de clairvoyance lorsqu’il écrivait à Marx dans sa fameuse lettre de 1850, et en prévision d’une reprise de Révolution : « Le parti ouvrier pourra l’emporter sur la haute bourgeoisie et les restes de la haute féodalité, mais il sera fusillé dans les flancs par les démocrates.
Nous pouvons peut-être donner pour quelque temps à la Révolution une direction antibourgeoise, nous pouvons détruire les conditions essentielles de la production bourgeoise : mais il nous est impossible d’abattre la petite bourgeoisie. Obtenir autant que possible, voilà ma devise.
Nous devons empêcher aussi longtemps que possible après la première victoire toute organisation des petits bourgeois, et notamment nous opposer en phalange serrée à toute assemblée constituante. Le terrorisme particulier, l’anarchie locale, doivent remplacer pour nous ce qui nous manque en gros ».
Mais on ne remplace pas ainsi « ce qui manque en gros ». Il est certain que lorsqu’une classe n’est pas encore prête historiquement, lorsqu’elle est obligée d’attendre le signal et le moyen de sa propre action de ceux-là mêmes qu’elle prétend remplacer, lorsque sa Révolution empruntant sa force du mouvement ennemi n’est encore qu’une Révolution parasitaire, elle ne peut se promettre quelque succès que si elle tient la Révolution ouverte et « en permanence », si elle prolonge l’agitation de tous les éléments sociaux. Mais à ce jeu elle ne fait guère que gagner du temps ou accroître les chances d’une réaction qui emporte à la fois et prolétariat et bourgeoisie.
C’est la tactique à laquelle la classe ouvrière est condamnée, quand elle est encore dans une période d’insuffisante préparation. Et si un des caractères du socialisme utopique est de n’avoir pas compté sur la force propre de la classe ouvrière, le Manifeste communiste de Marx et de Engels fait encore partie de la période d’utopie. Robert Owen, Fourier, comptaient sur le bon vouloir des classes supérieures. Marx et Engels attendent, pour le prolétariat, la faveur d’une Révolution bourgeoise.
Ce que propose le Manifeste, ce n’est pas la méthode de révolution d’une classe sûre d’elle-même et dont l’heure est enfin venue : c’est l’expédient de Révolution d’une classe impatiente et faible, qui veut brusquer par artifice la marche des choses.
Aussi bien, au bout de cet effort paradoxal, après cette sorte de détournement prolétarien de la Révolution bourgeoise, ce n’est pas une pleine victoire du prolétariat et du communisme que Marx entrevoit : c’est un régime singulièrement mêlé de propriété capitaliste et de communisme, de violence à la propriété et d’organisation du crédit.
Chose singulière ! Après avoir constaté que c’est l’évolution de l’industrie et la croissance du prolétariat industriel qui créent une force révolutionnaire, le Manifeste ne prévoit d’abord, dans le programme immédiat de la révolution communiste victorieuse, que l’expropriation de la rente foncière. Il rétrograde au delà de Babeuf, dont la gloire est d’avoir fait entrer la production industrielle aussi bien que la production agricole dans le plan communiste. Il recule presque jusqu’à Saint-Just, qui semble avoir prévu la possibilité pour la nation d’absorber les fermages.
« Nous avons vu plus haut, dit Marx, que la première démarche de la révolution ouvrière serait de constituer le prolétariat en classe régnante, de conquérir le régime démocratique.
« Le prolétariat usera de sa suprématie politique pour arracher peu à peu à la bourgeoisie tous les capitaux, pour centraliser entre les mains de l’état, c’est-à-dire du prolétariat constitué en classe dirigeante, les instruments de production et pour accroître au plus vite la masse disponible des forces productives.
« Il va de soi que cela impliquera dans la période du début des infractions despotiques au droit de propriété et aux conditions bourgeoises de la production. Des mesures devront être prises qui sans doute paraîtront insuffisantes et auxquelles on ne pourra pas s’en tenir, mais qui, une fois le mouvement commencé, mèneront à des mesures nouvelles et seront indispensables à titre de moyens pour révolutionner tout le régime de production. Ces mesures, évidemment, seront différentes en des pays différents. Cependant les mesures suivantes seront assez généralement applicables, du moins dans les pays les plus avancés :
« 1° Expropriation de la propriété foncière ; affectation de la rente foncière aux dépenses de l’État.
« 2° Impôt fortement progressif.
« 3° Abolition de l’héritage.
« 4° Confiscation des biens de tous les émigrés et rebelles.
« 5° Centralisation du crédit aux mains de l’État par le moyen d’une banque nationale constituée avec les capitaux de l’État et avec un monopole exclusif.
« 6° Centralisation des industries de transport aux mains de l’État.
« 7° Multiplication des manufactures nationales, des instruments nationaux de production, défrichement et amélioration des terres cultivables d’après un plan d’ensemble.
« 8° Travail obligatoire pour tous : organisation d’armées industrielles, notamment en vue de l’agriculture.
« 9° Réunion de l’agriculture et du travail industriel : préparation de toutes les mesures capables de faire disparaître progressivement la différence entre la ville et la campagne.
« 10° Éducation publique et gratuite de tous les enfants. Abolition des formes actuellement en usage du travail des enfants dans les fabriques. Réunion de l’éducation et de la production matérielle, etc. »
Étrange programme, où sont rapprochés le communisme agraire du dix-huitième siècle et quelques éléments de ce que nous appelons aujourd’hui le programme de Saint-Mandé : Marx et Engels, dans l’ordre industriel, se contentent d’abord de la nationalisation des chemins de fer : il n’y a même pas la nationalisation des mines acceptée aujourd’hui par les radicaux-socialistes. Mais ce qui me frappe, ce n’est pas le chaos du programme, la coexistence du communisme agricole et du capitalisme industriel.
Ce n’est pas la contradiction entre l’article qui abolit l’héritage et qui retire ainsi par là aux générations nouvelles le capital industriel, et l’ensemble des articles qui laissent subsister la propriété individuelle. L’histoire démontre que des formes diverses et même contradictoires ont souvent coexisté : longtemps la production corporative et la production capitaliste ont fonctionné côte à côte : tout le dix-septième et tout le dix-huitième siècles sont faits du mélange des deux, et longtemps aussi le travail libre agricole et le servage avaient coexisté.
Et je suis convaincu que dans l’évolution révolutionnaire qui nous conduira au communisme, la propriété collectiviste et la propriété individuelle, le communisme et le capitalisme seront longtemps juxtaposés.
C’est la loi même des grandes transformations. Marx et Engels avaient parfaitement le droit, sans se désavouer eux-mêmes, de dire en 1872 qu’ils faisaient assez bon marché de leur programme de 1847. « Ce passage aujourd’hui devrait être modifié en plusieurs de ses termes. Les progrès immenses accomplis par la grande industrie dans les vingt-cinq dernières années, les progrès parallèles accomplis par la classe ouvrière organisée en parti… font paraître vieillis plus d’un passage de ce programme. » Tout au plus peut-on s’étonner qu’ils n’aient pas fait, dès 1847, une part plus large au communisme industriel.
Mais ce qui étonne, c’est qu’ils aient pu croire le prolétariat capable de confisquer à son profit les révolutions bourgeoises et de conquérir, par un coup d’autorité, la démocratie, alors qu’ils le supposaient incapable, au lendemain de sa victoire et même dans les pays les plus avancés, d’instituer largement le communisme industriel.
Ce qui frappe surtout, dans le Manifeste, ce n’est pas le chaos du programme, qui pourrait se débrouiller, mais le chaos des méthodes. C’est par un coup de force que le prolétariat s’est installé d’abord au pouvoir : c’est par un coup de force qu’il l’a arraché aux révolutionnaires bourgeois. Il « conquiert la démocratie », c’est-à-dire qu’en fait il la suspend, puisqu’il substitue à la volonté de la majorité des citoyens librement consultés la volonté dictatoriale d’une classe.
C’est encore par la force, par la puissance dictatoriale, qu’il commet ces premières « infractions despotiques » à la propriété que le Manifeste prévoit. Mais ensuite, pour tout le développement de la révolution, pour l’élaboration et l’organisation de l’ordre nouveau, est-ce encore la dictature du prolétariat qui subsiste, ou est-il rentré sous la loi de la démocratie, du suffrage universel et des transactions ? Il est impossible de supposer que Marx et Engels aient songé à suspendre longtemps, au profit de la dictature prolétarienne, la démocratie. Comment le pourraient-ils, la révolution prolétarienne elle-même ayant surgi d’un mouvement vaste vers la démocratie ?
Comment le pourraient-ils encore, puisqu’ils laissent subsister la puissance économique de la bourgeoisie, la forme capitaliste de l’industrie ?
Laisser au patronat, au moins dans une période provisoire dont ils n’essaient même pas d’indiquer le terme, la direction des ateliers, des manufactures et des usines, et tenir ce même patronat hors du droit politique, hors de la cité, c’est une impossibilité. Il est contradictoire de faire des bourgeois des citoyens passifs et de leur laisser encore dans une large mesure la maîtrise de la production. Il est contradictoire d’organiser le crédit d’État et de ne pas soumettre au contrôle de toute la nation le fonctionnement de ce crédit. Une classe, née de la démocratie, qui, au lieu de se ranger à la loi de la démocratie, prolongerait sa dictature au delà des premiers jours de la révolution, ne serait bientôt plus qu’une bande campée sur le territoire et abusant des ressources du pays.
Donc ou Marx et Engels acheminent le prolétariat à un chaos de barbarie et d’impuissance, ou ils prévoient qu’après les premiers actes politiques et économiques qui auront donné à la classe ouvrière un grand essor et marqué d’un sceau socialiste la démocratie, il se confondra de nouveau dans la vie nationale et dans la légalité du suffrage universel. Mais qu’est-ce à dire ? Et si la démocratie n’est point préparée au mouvement communiste, ne va-t-elle point contrarier, au lieu de les étendre, les effets des premières mesures dictatoriales du prolétariat ?
Et si au contraire la démocratie y est préparée, si le prolétariat peut, par la seule force légale, obtenir d’elle qu’elle développe dans le sens communiste les premières institutions révolutionnaires, c’est en réalité la conquête légale de la démocratie qui devient la méthode souveraine de Révolution.
Tout le reste, je le répète, n’est que l’expédient, peut-être nécessaire un moment, d’une classe encore débile et mal préparée. Mais ceux des socialistes d’aujourd’hui qui parlent encore de « dictature impersonnelle du prolétariat » ou qui prévoient la prise de possession brusque du pouvoir et la violence faite à la démocratie, ceux-là rétrogradent au temps où le prolétariat était faible encore, et où il était réduit à des moyens factices de victoire.
En fait, la tactique du Manifeste, qui consiste pour le prolétariat à dériver vers lui des mouvements qu’il n’eût pu susciter lui-même, cette tactique de la force croissante et hardie mais subordonnée encore, la classe ouvrière l’a employée d’instinct dans toutes les crises de la société démocratique et bourgeoise. Marx en avait reçu l’idée de la révolution française et de Babeuf. Après 1830, les mouvements ouvriers de Paris et de Lyon prolongèrent en une confuse affirmation prolétarienne la révolution de la bourgeoisie. En 1848, les prolétaires de Paris, de Vienne, de Berlin tentèrent, en d’audacieuses journées, de dériver vers le socialisme le mouvement de la Révolution.
La fameuse parole de Blanqui : « On ne crée pas un mouvement, on le dérive » est l’expression même de cette politique. C’est la formule active du Manifeste communiste de Marx, c’est le mot d’ordre d’une classe qui se sent mineure encore mais appelée à de hautes destinées. En 1870, le 31 octobre succédant au 4 septembre est une reprise de la méthode marxiste et blanquiste. Dans la commune même, l’action croissante du prolétariat socialiste se substituant à la démocratie petite-bourgeoise est encore une application de la tactique du Manifeste : greffer la révolution prolétarienne sur la révolution démocratique et bourgeoise.
Lassalle avait eu une ambition plus hardie. Lui, il ne voulait pas laisser la révolution, même bourgeoise, prendre d’abord une forme bourgeoise. Il voulait la capter, pour ainsi dire, à sa source même, et la dériver d’emblée vers le prolétariat. Ainsi, lorsque, en 1863, éclata le conflit entre la représentation prussienne et le ministère prussien, lorsque la bourgeoisie progressiste et libérale d’Allemagne s’agita pour défendre le droit constitutionnel menacé par Bismarck, on put se demander si le conflit n’aboutirait point à une révolution.
En celle-ci, ce n’est donc pas la question sociale, la question de la propriété qui aurait été posée. Elle n’eût pas été d’origine communiste et prolétarienne, mais au contraire d’origine bourgeoise et parlementaire. Elle eût été comme la reprise de la Révolution bourgeoise allemande que Marx annonçait en novembre 1847, et qui avorta en 1848 et 1849.
Mais cette Révolution allemande, si bourgeoise qu’elle fût en ses origines, Lassalle ne voulait pas qu’elle fût bourgeoise, même un moment, dans sa manifestation et dans sa marche. C’était, selon lui, le prolétariat allemand organisé qui devait susciter du conflit bourgeois la Révolution et prendre tout de suite en main la force nouvelle des événements. Il proclamait que la bourgeoisie était sans audace, qu’elle essaierait tout au plus de revenir à la fédération allemande de 1848, et qu’il fallait au contraire instituer l’entière unité de l’Allemagne démocratique.
« Des buts misérablement médiocres, s’écriait-il, ne peuvent susciter qu’une conduite misérablement médiocre ; seule une grande idée, seul l’enthousiasme pour des buts puissants créent le dévouement, l’esprit de sacrifice, la vaillance ! » Et de quel droit la bourgeoisie allemande, qui avait laissé périr la liberté en 1848, se donnerait-elle aujourd’hui comme la gardienne de la liberté ? Aussi bien, et Lassalle en prenait acte triomphalement, les chefs de la bourgeoisie libérale déclaraient d’avance se refuser à toute révolution.
C’est donc le prolétariat qui passerait d’emblée au premier plan si la crise devenait révolutionnaire. « Je trouve très maladroit M De Benningsen, disait Lassalle, de nous rappeler que lui et son parti ne veulent point de révolution ! Puisqu’il nous le rappelle sans relâche, nous voulons lui faire cette joie de ne point l’oublier. Levons nos mains et engageons-nous, si sous une forme ou sous une autre se produit le grand ébranlement, à rappeler aux nationaux-libéraux que jusqu’au dernier moment ils ont déclaré ne vouloir pas de révolution. »
C’est donc au prolétariat que serait, pour ainsi dire, adjugée dès la première heure la Révolution. Lassalle, conscient de la croissance de la classe ouvrière, et impatient aussi de cueillir tous les fruits de la vie, n’accepte point, comme Marx en 1847, une période première de révolution bourgeoise.
Quoique née d’un conflit entre la bourgeoisie libérale et l’absolutisme royal, la Révolution passera dès le premier jour aux mains ouvrières. C’est encore l’application de la méthode marxiste, mais dans une sorte de cas limite où est réduite à zéro la durée de la période bourgeoise. De ce pouvoir révolutionnaire soudain conquis, Lassalle se proposait, il est vrai, de faire un usage très modéré. Il se serait borné à fonder le suffrage universel, à supprimer les impôts indirects, à affranchir la presse du joug du capital et à subventionner largement sur les ressources de l’État des associations ouvrières de production : pas d’expropriation ; pas d’application étendue d’un plan communiste.
Ainsi, depuis cent vingt ans, la méthode de révolution ouvrière dont Babeuf a donné l’application première, dont Marx et Blanqui ont donné la formule, et qui consiste à profiter des révolutions bourgeoises pour y glisser le communisme prolétarien, a été essayée ou proposée bien des fois, et sous bien des formes. Elle a donné certes de grands résultats. C’est par elle qu’en de grandes journées historiques la classe ouvrière a pris conscience de sa force et de son destin.
C’est par elle qu’indirectement encore et obliquement, le prolétariat s’est essayé au pouvoir. C’est par elle que la question de la propriété et du communisme a été constamment à l’ordre du jour de l’Europe selon le conseil du Manifeste. « Dans tous ces mouvements, la question que les communistes mettront au premier plan, la question pour eux essentielle, est celle de la propriété, dût même le débat sur cette question n’être pas encore engagé très à fond. » C’est par cette méthode enfin que le prolétariat a agi, bien avant d’avoir la force décisive. Mais c’était une chimère d’espérer que le communisme prolétarien pourrait être greffé sur la révolution bourgeoise.
C’était une chimère de croire que les agitations révolutionnaires de la bourgeoisie donneraient au prolétariat l’occasion d’un coup de force heureux. En fait, cette tactique n’a jamais abouti. Tantôt la bourgeoisie révolutionnaire a sombré, entraînant avec elle le prolétariat. Tantôt la bourgeoisie révolutionnaire victorieuse a eu la force de contenir, de refouler le mouvement prolétarien. Et d’ailleurs, même si par surprise un mouvement prolétarien s’était soudain imposé à des agitations d’un autre ordre et d’une autre origine, à quoi eût-il abouti ? Il se serait rapidement affaibli en un mouvement purement démocratique par une série de compromis. De la Commune victorieuse, c’est tout au plus une république radicale qui serait sortie.
Aujourd’hui, le mode déterminé sous lequel Marx, Engels et Blanqui concevaient la Révolution prolétarienne est éliminé par l’histoire. D’abord, le prolétariat plus fort ne compte plus sur la faveur d’une révolution bourgeoise. C’est par sa force propre et au nom de son idée propre qu’il veut agir sur la démocratie. Il ne guette pas une révolution bourgeoise pour jeter la bourgeoisie à bas de sa révolution comme on renverse un cavalier pour s’emparer de sa monture. Il a son organisation à lui, sa puissance à lui. Il a, par les syndicats et les coopératives, une puissance économique grandissante. Il a par le suffrage universel et la démocratie une force légale indéfiniment extensible.
Il n’est pas réduit à être le parasite aventureux et violent des révolutions bourgeoises. Il prépare méthodiquement, ou mieux, il commence méthodiquement sa propre Révolution par la conquête graduelle et légale de la puissance de la production et de la puissance de l’État. Aussi bien il attendrait en vain, pour un coup de force et de dictature de classe, l’occasion d’une révolution bourgeoise.
La période révolutionnaire de la bourgeoisie est close. Il se peut que pour la sauvegarde de ses intérêts économiques et sous l’action de la classe ouvrière la bourgeoisie d’Italie, d’Allemagne, de Belgique, soit conduite à étendre les droits constitutionnels du peuple, à revendiquer la plénitude du suffrage universel, la vérité du régime parlementaire, la responsabilité des ministres devant le parlement.
Il se peut que l’action combinée de la démocratie bourgeoise et du prolétariat fasse reculer partout la prérogative royale ou l’autocratie impériale jusqu’au point où la monarchie n’a plus qu’une existence nominale. Il est certain que la lutte pour l’entière démocratie n’est pas close en Europe : mais, dans cette lutte, la bourgeoisie ne jouera guère qu’un rôle d’appoint, comme il est visible en ce moment en Belgique.
Et d’ailleurs, il y a déjà, dans toutes les constitutions de l’Europe centrale et occidentale, assez d’éléments de démocratie pour que le passage à l’entière démocratie s’accomplisse sans crise révolutionnaire. Ainsi le prolétariat ne peut plus, comme l’avaient pensé Marx et Blanqui, abriter sa Révolution derrière les révolutions bourgeoises : il ne peut plus saisir et tourner à son profit les agitations révolutionnaires de la bourgeoisie, qui sont épuisées. Maintenant c’est à découvert, sur le large terrain de la légalité démocratique et du suffrage universel, que le prolétariat socialiste prépare, étend, organise sa Révolution.
C’est à cette action révolutionnaire méthodique, directe et légale que Engels, dans la dernière partie de sa vie, conviait le prolétariat européen en des paroles fameuses qui rejetaient, en fait, le Manifeste communiste dans le passé. Désormais, l’action révolutionnaire de la bourgeoisie étant close, tout moyen de violence employé par le prolétariat ne ferait que coaliser contre lui toutes les forces non prolétariennes. Et c’est pourquoi j’ai toujours interprété la grève générale non comme un moyen de violence, mais comme un des plus vastes mécanismes de pression légale que, pour des objets définis et grands, pouvait manier le prolétariat éduqué et organisé.
Mais si l’hypothèse historique dont procède la conception révolutionnaire du Manifeste communiste est en effet épuisée, si le prolétariat ne peut plus compter sur les mouvements révolutionnaires de la bourgeoisie pour déployer sa propre force de révolution, s’il ne peut plus faire surgir sa dictature de classe d’une période de démocratie chaotique et violente, peut-il du moins attendre son avènement soudain d’un brusque effondrement économique de la bourgeoisie, d’un cataclysme du système capitaliste acculé enfin à l’impossibilité de vivre et déposant son bilan ? C’était encore là une perspective de Révolution prolétarienne ouverte par Marx.
Il comptait à la fois, pour susciter la dictature de classe du prolétariat, sur l’avènement politique révolutionnaire de la bourgeoisie et sur sa chute économique. De lui-même, un jour, sous l’action toujours plus intense et plus fréquente des crises déchaînées par lui, et par l’épuisement de misère auquel il aurait réduit les exploités, le capitalisme devait succomber. Il n’est pas possible de contester sérieusement que ce fût là, dans le Manifeste, la pensée de Marx et de Engels. « Toutes les sociétés jusqu’à ce jour ont reposé, nous l’avons vu, sur l’antagonisme de classes oppressives et de classes opprimées.
Mais pour pouvoir opprimer une classe, au moins faut-il lui assurer des conditions d’existence qui lui permettent de traîner sa vie d’esclavage. Le serf, malgré son servage, s’était élevé au rang de membre de la commune, le petit bourgeois était devenu bourgeois malgré le joug de l’absolutisme féodal. L’ouvrier moderne, au contraire, au lieu de s’élever par le progrès de l’industrie, descend de plus en plus au-dessous de la condition de sa propre classe.
Le travailleur devient un pauvre, et le paupérisme grandit encore plus vite que la population et la richesse. Il devient ainsi manifeste que la bourgeoisie est incapable de demeurer désormais la classe dirigeante de la société et d’imposer à la société, comme une loi impérative, les conditions de son existence de classe. Elle est devenue incapable de régner, car elle ne sait plus assurer à ses esclaves la subsistance qui leur permette de supporter l’esclavage. Elle en est réduite à les laisser tomber à une condition où il lui faut les nourrir au lieu d’être nourrie par eux. La société ne peut plus vivre sous le règne de cette bourgeoisie ; c’est-à-dire que l’existence de cette bourgeoisie n’est plus compatible avec la vie sociale. »
Et c’est à ce moment que, l’exploitation bourgeoise et capitaliste ayant atteint pour ainsi dire la limite de tolérance vitale des classes exploitées, il se produit une commotion inévitable, un soulèvement irrésistible, et la guerre civile latente entre les classes se dénoue enfin par « l’effondrement violent de la bourgeoisie ».
Voilà bien la pensée de Marx et de Engels, à cette date. Je sais que l’on cherche maintenant à jeter un voile sur la brutalité de ces textes. Je sais que de subtils interprètes marxistes disent que Marx et Engels n’ont entendu parler que d’une paupérisation « relative ». Ainsi, quand les théologiens veulent mettre d’accord les textes de la Bible avec la réalité scientifiquement constatée, ils disent que dans la genèse, le mot jour désigne une période géologique de plusieurs millions d’années. Je n’y contredis point. Ce sont des élégances et des charités d’exégèse qui permettent de passer sans douleur du dogme longtemps professé à la vérité mieux connue.
Et puisque des esprits « révolutionnaires » ont besoin de ces ménagements, qui songerait à les contrarier ? Pourtant si Marx n’avait voulu parler que d’une paupérisation relative, comment aurait-il conclu que le capitalisme ferait tomber ses esclaves au-dessous même du minimum vital et les contraindrait ainsi, par une suite de réflexes irrésistibles, à faire s’effondrer violemment la bourgeoisie ?
On a dit aussi que Marx et Engels avaient voulu seulement définir la tendance abstraite du capitalisme, ce que deviendrait la société bourgeoise par sa propre loi si l’organisation ouvrière ne contrariait point, par un effort inverse, cette tendance d’oppression et de dépression.
Et certes comment Marx, qui faisait du prolétariat l’essence même et la forme vivante du socialisme, aurait-il méconnu cette action prolétarienne ? Mais il semble que dans la pensée de Marx, cette action, tout en assurant en effet au prolétariat quelques avantages économiques partiels, se résume surtout à accroître sa conscience de classe, à développer en lui le sentiment de ses maux et celui de sa force. « Mais le développement de l’industrie ne fait pas qu’augmenter en nombre le prolétariat. Il agglomère le prolétariat en masses plus denses, et sa force en est grandie avec le sentiment qu’il en a.
Les différences dans les intérêts et dans le genre de vie se nivellent entre les catégories diverses du prolétariat lui-même, à mesure que l’outillage mécanique détruit les différences dans le genre de travail et réduit presque partout le salaire à un niveau d’une égale modicité. Mais ce salaire des ouvriers subit des oscillations de jour en jour plus fréquentes, du fait de la concurrence croissante que les bourgeois se font entre eux, et qui entraîne des crises commerciales.
La condition entière de l’ouvrier est de plus en plus mise en question à mesure que s’accélèrent le développement et l’amélioration incessante du machinisme. De plus en plus alors les collisions entre l’ouvrier individuel et le bourgeois individuel prennent le caractère de collisions entre deux classes. Le début, c’est que les ouvriers commencent à former des coalitions contre les bourgeois. L’objet de leur union est la défense de leur salaire. Ils vont jusqu’à fonder des associations durables dans le but d’accumuler des munitions pour des soulèvements éventuels. Par endroits, la lutte éclate en émeutes.
Parfois les ouvriers remportent une victoire, mais passagère. Le bénéfice véritable de ces luttes n’est pas celui qui donne le succès immédiat. Il consiste dans l’union qui se propage de plus en plus entre les ouvriers. Cette union est facilitée par les moyens de communication multipliés que la grande industrie crée et qui permettent aux ouvriers de localités différentes d’entrer en relations mutuelles. Or dès que cette union est faite, la multiplicité des luttes locales du même ordre se transforme en une lutte nationale unique, à direction centralisée, en une lutte de classe. Mais toute lutte de classe est une lutte politique. L’union que les bourgeois du moyen-âge quand ils ne disposaient que de chemins vicinaux, mirent des siècles à réaliser, les prolétaires modernes, grâce aux chemins de fer, la réalisent en peu d’années.
Cette organisation toutefois, qui crée une classe prolétarienne et, par suite, un parti politique prolétarien, à tout instant se brise à nouveau par la concurrence des ouvriers entre eux. Mais toujours aussi elle se redresse plus forte, plus ferme, plus puissante. En tirant parti des dissentiments internes de la bourgeoisie, elle parvient à faire reconnaître de force, et par la loi, quelques-uns des intérêts des travailleurs. Ainsi pour la loi sur la journée de dix heures en Angleterre. »
Si j’ai reproduit ce génial tableau du mouvement ouvrier moderne, ce n’est pas pour en discuter chaque trait : il y aurait en plusieurs points, et notamment sur le nivellement des salaires, bien des réserves à faire. Mais j’ai voulu que le lecteur pût se poser utilement la question que je me pose ici moi-même : dans quelle mesure Marx a-t-il admis que l’organisation économique et politique des prolétaires faisait échec à la tendance de paupérisation qui est, selon lui, la loi même du capitalisme ?
Je crois qu’on peut répondre : dans une mesure très faible. Sans doute, les ouvriers ainsi groupés en classe et en parti remportent, surtout grâce aux divisions de la classe possédante, quelques avantages partiels : mais il semble bien que leur union dans le combat est le seul bénéfice substantiel qu’ils retirent du combat même.
Donc la force de cohésion et de protestation des ouvriers s’accroît en vue d’un soulèvement général ; leurs chances s’accroissent de mener à bien le mouvement révolutionnaire et de précipiter l’effondrement de la bourgeoisie. Mais en fait, et dans le fond même de leur vie actuelle, ils subissent, en n’y opposant que de trop faibles contrepoids, la loi de paupérisation prolétarienne. C’est même sans doute cette contradiction entre la paupérisation croissante subie par le prolétariat et la force croissante de revendication et d’action qui s’organise en lui qui apparaît à Marx comme le ressort des grands soulèvements prochains, comme la force immédiate de révolution.
Les améliorations concrètes obtenues par l’effort ouvrier ne compensent qu’imparfaitement la dépréciation concrète que subit la vie ouvrière par la loi de la production bourgeoise. Dans le conflit des tendances qui se disputent le prolétariat, la tendance déprimante a la primauté dans le présent ; c’est elle surtout qui agit sur la condition réelle de la classe ouvrière.
Et puisqu’on parle de tendances, c’est dans ce sens qu’inclinait visiblement toute la pensée de Marx et de Engels. Je dirai presque que Marx avait besoin d’un prolétariat infiniment appauvri et dénué, dans sa conception dialectique de l’histoire moderne. Le prolétariat, pour être dans la dialectique hégélienne de Marx le moment humain, pour être vraiment l’idée même de l’humanité, devait à ce point être dépouillé de tout droit social, que l’humanité seule, infinie en détresse et en droit, subsistât en lui.
Et comment pourrait-on se flatter de comprendre Marx sans descendre aux origines dialectiques, aux sources profondes de sa pensée ? Sa Critique de la philosophie hégélienne du droit, parue en 1844 dans les Annales germano-françaises, est à cet égard un document décisif. « Où est donc, dit-il, la possibilité positive de l’émancipation allemande ?
Réponse : dans la formation d’une classe avec des chaînes radicales, d’une classe de la société bourgeoise, qui ne soit pas une classe de la société bourgeoise, d’un état, qui soit la dissolution de tout état, d’une sphère qui ait un caractère universel par la souffrance universelle et qui ne revendique aucun droit particulier, parce que ce n’est point une injustice particulière, mais l’injustice totale qui est accomplie sur lui, qui ne puisse faire appel à aucun titre historique, mais seulement au titre d’humanité, qui soit non pas en opposition particulière avec telle ou telle conséquence, mais en opposition générale avec tous les principes de l’État allemand, d’une sphère enfin qui ne puisse s’émanciper elle-même, sans s’émanciper de toutes les autres sphères de la société, et sans émanciper par là toutes les autres sphères de la société, qui, en un mot, soit la perte totale de l’homme, et qui ne puisse par conséquent se retrouver elle-même que par l’entière restitution de l’homme. »
J’entends bien que c’est de l’Allemagne que parle ici Marx, et des conditions particulières de son affranchissement. Je sais qu’il reconnaît aux classes sociales de la France un plus haut idéalisme historique, qu’elles ont, selon lui, l’habitude de se considérer comme les gardiennes de l’intérêt universel et qu’il suffira en France, pour que s’accomplisse l’entière émancipation, que cette action idéaliste passe de la bourgeoisie, en qui la mission humaine est limitée et contrariée par des soucis de propriété, au prolétariat français, en qui la mission humaine peut développer sans obstacle son universalité.
Oui, c’est de l’Allemagne et du prolétariat allemand qu’il s’agit. Mais qui ne voit que, malgré les différences ethniques et historiques, il est pour Marx une figure du prolétariat et même, par son absolu dénuement, la figure suprême ?
C’est donc sous une transposition hégélienne du christianisme que Marx se représente le mouvement moderne d’émancipation. De même que le Dieu chrétien s’est abaissé au plus bas de l’humanité souffrante pour relever l’humanité toute entière, de même que le sauveur, pour sauver en effet tous les hommes, a dû se réduire à ce degré de dénuement tout voisin de l’animalité, au-dessous duquel ne se pouvait rencontrer aucun homme, de même que cet abaissement infini de Dieu était la condition du relèvement infini de l’homme, de même dans la dialectique de Marx, le prolétariat, le Sauveur moderne, a dû être dépouillé de toute garantie, dévêtu de tout droit, abaissé au plus profond du néant historique et social, pour relever en se relevant toute l’humanité.
Et comme le dieu-homme, pour rester dans sa mission, a dû rester pauvre, souffrant et humilié jusqu’au jour triomphal de la résurrection, jusqu’à cette victoire particulière sur la mort qui a affranchi de la mort toute l’humanité, ainsi le prolétariat reste d’autant mieux dans sa mission dialectique, que, jusqu’au soulèvement final, jusqu’à la résurrection révolutionnaire de l’humanité, il porte, comme une croix toujours plus pesante, la loi essentielle d’oppression et de dépression du capitalisme.
De là évidemment, chez Marx, une tendance originelle à accueillir difficilement l’idée d’un relèvement partiel du prolétariat. De là une sorte de joie, où il entre quelque mysticité dialectique, à constater les forces d’écrasement qui pèsent sur les prolétaires.
Marx se trompait. Ce n’est pas du dénuement absolu que pouvait venir la libération absolue. Quelque pauvre que fût le prolétaire allemand, il n’était pas la pauvreté suprême. D’abord dans l’ouvrier moderne il y a d’emblée toute la part d’humanité conquise par l’abolition des sauvageries et des barbaries premières, par l’abolition de l’esclavage et du servage. Puis, quelque médiocres que fussent en effet à ce moment les titres historiques propres des prolétaires allemands, ils n’en étaient point tout à fait démunis. Leur histoire, depuis la Révolution française, n’était pas tout à fait vide.
Et surtout, par leur sympathie pour l’action émancipatrice des prolétaires français, des ouvriers du 14 juillet, des 5 et 6 octobre, du 10 août, des sections parisiennes, ils avaient une part dans les titres historiques du prolétariat français, devenus des titres universels, comme la Déclaration des Droits de l’homme avait été un symbole universel, comme la chute de la Bastille avait été une délivrance universelle. Au moment même où Marx écrivait pour le prolétariat allemand ces paroles de mystique abaissement et de mystique résurrection, les prolétaires allemands, comme d’ailleurs Marx lui-même, tournaient leur cœur et leurs yeux vers la France, vers la grande patrie des titres historiques du prolétariat.
Mais quoi d’étrange que Marx, avec cette conception dialectique première, ait accordé la primauté, dans l’évolution capitaliste, à la tendance de dépression ? Quoi d’étonnant que dans le Capital encore il ait écrit que « l’oppression, l’esclavage, l’exploitation, la misère, s’accroissaient », mais aussi « la résistance de la classe ouvrière, sans cesse grossissante et de plus en plus disciplinée, unie et organisée par le mécanisme même de la production capitaliste », mettant encore ici en balance une force de dépression qui agit immédiatement et une force de résistance et d’organisation qui semble surtout préparer l’avenir ?
Engels, lui, s’est fait de l’inflexibilité du système capitaliste, de son impuissance à s’adapter à la moindre réforme, une idée si rigide et si stricte qu’il commet dans l’interprétation des mouvements sociaux les plus graves et les plus décisives erreurs.
Il est difficile d’imaginer des méprises plus lourdes que celles qu’il commet à chaque pas dans son livre célèbre sur la situation des classes laborieuses en Angleterre. Il a vu partout des incompatibilités, des impossibilités, des contradictions insolubles et qui ne pouvaient se résoudre que par la Révolution. Il annonce en 1845, comme imminente et absolument inévitable en Angleterre, une Révolution ouvrière et communiste, qui sera la plus sanglante qu’ait vue l’histoire.
Les pauvres égorgeront les riches et brûleront les châteaux. Il n’y a pas de doute possible à cet égard. « Nulle part il n’est aussi facile de prophétiser qu’en Angleterre, parce qu’ici tous les développements sociaux sont d’une netteté et d’une acuité extrêmes. La révolution doit venir, et il est déjà trop tard pour introduire une solution pacifique. »
Étrange vue sur ce pays d’Angleterre, si habile toujours aux évolutions et aux compromis ! Il pousse si loin son intransigeance sociale qu’il en arrive à tenir sur les grandes questions précises qui sont posées à ce moment le langage des conservateurs les plus têtus. Comme à eux, tout progrès politique et social lui paraît impossible dans le système présent. Les chartistes acculent l’Angleterre ou à l’abîme ou à l’entière révolution communiste.
Ils demandent le suffrage universel : mais il est inconciliable avec la monarchie ; ils demandent la journée de dix heures : mais elle est inconciliable dans le système capitaliste avec les exigences de la production ; et son effet, vraiment excellent, sera d’obliger l’Angleterre à entrer sous peine de ruine dans des voies toutes nouvelles.
« Les arguments d’économie nationale des fabricants, écrit Engels, que le bill des dix heures accroîtra les frais de production, que par là l’industrie anglaise sera rendue incapable de lutter contre la concurrence étrangère, que le salaire du travail tombera nécessairement, sont à moitié vrais : mais ils ne prouvent qu’une chose, c’est que la grandeur industrielle de l’Angleterre ne peut être maintenue que par le traitement barbare infligé aux ouvriers, par la destruction de la santé, par la décadence sociale, physique et intellectuelle de générations entières.
Naturellement si la journée de dix heures devenait une mesure légale définitive, l’Angleterre serait ruinée par là ; mais parce que cette loi entraînerait nécessairement après elle d’autres mesures, qui obligeraient l’Angleterre à entrer dans une voie tout autre que celle qui a été suivie jusqu’ici, cette loi sera un progrès. »
Quel esprit de défiance à l’égard des réformes partielles ! Quelles limites étroites assignées aux facultés de transformation du régime industriel ! Et quand en 1892, cinquante ans après, Engels réédite ce livre, il ne songe pas un moment à se demander par quel vice de pensée, par quelle erreur systématique il a été induit à des idées aussi fausses sur le mouvement politique et social de l’Angleterre.
Il aime mieux se complaire dans une œuvre que l’histoire a presque toute démentie. Il est donc tout naturel de supposer que Engels, avec cette façon première de comprendre les choses, a incliné toujours, comme Marx, à donner aux forces de dépression qui abaissent en régime capitaliste la classe ouvrière, la primauté sur les forces de relèvement.
Mais, quelle que soit l’interprétation donnée sur ce point à la pensée incertaine et obscure de Marx et de Engels, il importe peu. L’essentiel, c’est que nul des socialistes, aujourd’hui, n’accepte la théorie de la paupérisation absolue du prolétariat.
Les uns ouvertement, les autres avec des précautions infinies, quelques-uns avec une malicieuse bonhomie viennoise, tous déclarent qu’il est faux que dans l’ensemble la condition économique matérielle des prolétaires aille en empirant. Des tendances de dépression et des tendances de relèvement, ce ne sont pas au total, et dans la réalité immédiate de la vie, les tendances dépressives qui l’emportent.
Dès lors il n’est plus permis de répéter après Marx et Engels que le système capitaliste périra parce qu’il n’assure même pas à ceux qu’il exploite le minimum nécessaire à la vie. Dès lors encore, il devient puéril d’attendre qu’un cataclysme économique menaçant le prolétariat dans sa vie même provoque, sous la révolte de l’instinct vital, « l’effondrement violent de la bourgeoisie ». Ainsi, les deux hypothèses, l’une historique, l’autre économique, d’où devait sortir, dans la pensée du Manifeste communiste, la soudaine Révolution prolétarienne, la Révolution de dictature ouvrière, sont également ruinées.
Ni il n’y aura dans l’ordre politique une révolution bourgeoise que le prolétariat révolutionnaire puisse soudain chevaucher ; ni il n’y aura dans l’ordre économique un cataclysme, une catastrophe qui, sur les ruines du capitalisme effondré, suscite en un jour la domination de classe du prolétariat communiste et un système nouveau de production. Ces hypothèses n’ont pas été vaines.
Si le prolétariat n’a pu se saisir d’aucune des révolutions bourgeoises, il s’est poussé cependant depuis cent vingt années à travers les agitations de la bourgeoisie révolutionnaire, et il continuera encore, sous les formes nouvelles que développe la démocratie, à tirer parti des inévitables conflits intérieurs de la bourgeoisie.
S’il n’y a pas eu réaction totale et révolutionnaire de l’instinct vital du prolétariat sous un cataclysme total du capitalisme, il y a eu d’innombrables crises qui, en attestant le désordre intime de la production capitaliste, ont naturellement excité les prolétaires à préparer un ordre nouveau.
Mais où l’erreur commence, c’est lorsqu’on attend en effet la chute soudaine du capitalisme et l’avènement soudain du prolétariat ou d’un grand ébranlement politique de la société bourgeoise, ou d’un grand ébranlement économique de la production bourgeoise.
Ce n’est pas par le contre-coup imprévu des agitations politiques que le prolétariat arrivera au pouvoir, mais par l’organisation méthodique et légale de ses propres forces sous la loi de la démocratie et du suffrage universel.
Ce n’est pas par l’effondrement de la bourgeoisie capitaliste, c’est par la croissance du prolétariat que l’ordre communiste s’installera graduellement dans notre société.
À quiconque accepte ces vérités désormais nécessaires, des méthodes précises et sûres de transformation sociale et de progressive organisation ne tardent pas à apparaître. Ceux qui ne les acceptent pas nettement, ceux qui ne prennent pas vraiment au sérieux les résultats décisifs du mouvement prolétarien depuis un siècle, ceux qui rétrogradent jusqu’au Manifeste communiste si visiblement dépassé par les événements, ou qui mêlent aux pensées directes et vraies que la réalité présente leur suggère des restes de pensées anciennes d’où la vérité a fui, ceux-là se condamnent eux-mêmes à vivre dans le chaos.
Mais je ne pourrais justifier dans le détail cette affirmation générale que par l’analyse minutieuse de toutes les tendances présentes du socialisme français et du socialisme international. Je ne pourrais aussi légitimer pleinement la méthode que j’ai indiquée que par des applications précises et par l’exposé d’un programme « d’évolution révolutionnaire » .
Ce sera l’objet d’une œuvre plus systématique et plus liée que les études fragmentaires qu’à votre demande, mon cher Péguy, je soumets dès maintenant aux lecteurs de bonne foi, curieux, en ces questions difficiles, même d’un modeste commencement de clarté.
Je ne veux, dans cette introduction, ajouter qu’un mot, qui a un rapport direct à l’objet du volume. Quelques-uns de nos contradicteurs disent volontiers que cette méthode d’évolution soumise à la loi de la démocratie risque d’affaiblir et d’obscurcir l’idéal socialiste. C’est exactement le contraire.
Ce sont les appels déclamatoires à la violence, c’est l’attente quasi-mystique d’une catastrophe libératrice qui dispensent les hommes de préciser leur pensée, de déterminer leur idéal.
Mais ceux qui se proposent de conduire la démocratie, par de larges et sûres voies, vers l’entier communisme, ceux qui ne peuvent compter sur l’enthousiasme d’une heure et sur les illusions d’un peuple excité, ceux-là sont obligés de dire avec la plus décisive netteté vers quelle forme de société ils veulent acheminer les hommes et les choses, et par quelle suite d’institutions et de lois ils espèrent aboutir à l’ordre communiste.
Plus le parti socialiste se confondra dans la nation par l’acceptation définitive de la démocratie et de la légalité, plus il sera tenu de marquer sa conception propre : et à travers l’atmosphère moins agitée le but final se dessinera mieux.
Sous peine de se perdre dans le plus vulgaire empirisme et de se dissoudre dans un opportunisme sans règle et sans objet, il devra ordonner toutes ses pensées, toute son action en vue de l’idéal communiste. Ou plutôt cet idéal devra être toujours présent et toujours discernable en chacun de ses actes, en chacune de ses paroles.
Je ne sais si Bernstein n’a pas été conduit, par la nécessité de la polémique, à éclairer surtout le côté critique de son œuvre. Ce serait en tout cas une grande erreur et une grande faute de paraître dissoudre dans les brumes de l’avenir le but final du socialisme. Le communisme doit être l’idée directrice et visible de tout le mouvement. Le socialisme « critique » doit être, plus que tout autre, agissant et constructif. Et une des formes premières de l’action c’est de dissiper les équivoques dont les partis extrêmes de la démocratie bourgeoise leurrent encore les esprits…
Démêler les sophismes et dénoncer les contradictions du radicalisme bourgeois est peut-être le premier devoir de ceux qui veulent conquérir légalement, à toute l’idée socialiste et communiste, la démocratie. C’est tout naturellement que j’ai été conduit, après avoir esquissé à grands traits la méthode d’évolution révolutionnaire, à demander au parti radical ce qu’il entend par sa fameuse formule de la « propriété individuelle ». Ce n’est là, bien entendu, qu’une très faible partie de l’examen critique auquel les équivoques et les contradictions radicales devront être soumises par notre parti.
M Maxime Leroy, dans La Revue blanche, m’a fait quelques objections : il me dit que l’usufruit, l’usage, l’habitation, l’hypothèque, la copropriété des gros murs et escaliers, etc., sont des droits anciens qui n’impliquent en aucune manière un droit social nouveau.
Mais il y a un malentendu. Je n’ai jamais dit que ce fussent là des formes nouvelles, encore moins des ébauches de copropriété sociale. J’ai au contraire toujours rappelé que c’était au profit d’autres individus qu’était limité le droit de l’individu.
Mais il reste vrai que la propriété, même individuelle, est extrêmement complexe, qu’elle est formée de droits très divers, tantôt réunis dans la main d’un seul individu, tantôt dispersés dans les mains de plusieurs ; qu’elle est bien loin d’être un bloc indécomposable et une quantité simple, qu’il y a dès lors quelque enfantillage à se donner, in abstracto, comme le défenseur de la propriété individuelle, et qu’on est mal fondé en outre à nous reprocher l’extrême complication du concept de la propriété communiste, qui enveloppera le droit de la nation, le droit des groupes intermédiaires et le droit des individus. C’est là, en ce point, tout ce que j’ai voulu démontrer.
M Leroy dit : « Ce qu’il faut constater, c’est que toutes les législations ont apporté des restrictions au droit de propriété individuelle comme à tous les droits individuels… L’individualisme juridique absolu ne peut être qu’une entité métaphysique. »
Sans doute : mais ce que je note, c’est d’abord que la Révolution française elle-même, malgré sa préoccupation individualiste, a porté à la propriété individuelle, dans l’ordre de l’héritage, une atteinte sans précédent. M Leroy me dit que « le principe de l’égalité des partages était un principe coutumier déjà appliqué en Germanie et dans la Grèce d’avant Solon ». Il y aurait sans doute beaucoup à dire sur cet objet : mais quelle distance entre ces coutumes anciennes et la législation vigoureuse de la Convention !
Et surtout, comment M Leroy n’a-t-il pas vu que ce qui fait l’intérêt de la législation révolutionnaire c’est son apparente antinomie ? C’est au nom du droit des individus et pour le sauvegarder, que la révolution est obligée de constituer un domaine familial commun et intangible.
L’individualisme concret se traduit ici par un communisme familial : de même, lorsque la société aura souci de tous les individus, lorsqu’elle verra et protégera en eux contre toutes les usurpations, non pas les héritiers désignés de tel ou tel patrimoine familial, mais les héritiers du patrimoine humain, c’est le communisme social qui sera la forme suprême et la suprême garantie de ce haut individualisme universel.
Que ce soit la logique individualiste qui ait abouti au collectivisme familial, voilà qui est nouveau dans le monde et je m’étonne que M Leroy me rappelle aux forêts de la Germanie.
En second lieu, ce que j’ai noté c’est que dans cette société individualiste la propriété individuelle subit un refoulement incessant et une incessante dénaturation. M Leroy en convient pour toute une catégorie de lois :
« Aussi, dit-il, c’est moins dans le Code civil de 1804, qui n’est que le proche passé remanié, qu’il faut chercher le droit nouveau, que dans les lois sociales postérieures qui, ainsi que le remarque M. Jaurès, constituent, elles, de véritables dépossessions dans un sens collectiviste : droit de grève, inspection du travail, etc. »
Cela est très important et suffirait à montrer la frivolité et l’inconsistance doctrinale des radicaux, qui se proclament contre nous les sauveurs de la propriété individuelle et qui ne paraissent pas se douter que les lois sociales auxquelles ils consentent sous l’action de la classe ouvrière en sont une perpétuelle restriction.
Mais s’il serait puéril de chercher dans le Code Napoléon les traits du droit nouveau, il y a intérêt à montrer que, même dans le Code civil, même en dehors de la législation sociale que la classe ouvrière a peu à peu imposée, la propriété individuelle a des facultés presque illimitées de décomposition, qu’elle se prête à toutes sortes de démembrements et que les rapports mêmes des propriétés individuelles se marquent par de réciproques expropriations partielles.
Aussi bien M Leroy fait vraiment trop bon marché du sens révolutionnaire et communiste latent du droit d’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le droit supérieur que la société s’arroge sur les propriétés privées n’est que la reprise, dans un sens démocratique, du droit de propriété éminent du roi sur tous les biens du royaume. »
Peut-être, quoique la Révolution assignât d’autres origines à ce droit. Mais ce qui est important, précisément, c’est la reprise de ce droit dans un sens démocratique. Car cette reprise démocratique pourra être continuée et agrandie dans le sens socialiste. Et comment peut-il paraître indifférent à M Leroy que la société bourgeoise, entraînée par la puissance des intérêts capitalistes, ait peu à peu donné à ce droit d’expropriation, sous les yeux du prolétariat qui médite et qui attend, une extension croissante ?
Pendant que les radicaux disent : « Propriété individuelle », le capitalisme lui-même fortifie et assouplit l’outil juridique d’expropriation dont le prolétariat fera usage à l’égard de tout le système bourgeois. Voilà ce que j’avais le droit de marquer : et il me semble que, si on prend toute ma démonstration dans son vrai sens, elle résiste pleinement aux objections de M Leroy, que je remercie d’ailleurs de la forme courtoise et presque amicale qu’il leur a donnée.
Je m’arrête, mon cher Péguy, en me félicitant une fois de plus, quelles que soient nos divergences en bien des questions ou à raison de ces divergences mêmes, d’être en communication directe de pensée avec les libres esprits que votre initiative et votre critique toujours en éveil ont groupés autour des Cahiers de la Quinzaine.